21/11/2016
Mémoires d'outre-tombe, de Chateaubriand, Livres I à XII
Monument de la littérature
Mémoires d’outre-tombe
Livres I à XII
En écrivant les Mémoires d’outre-tombe Chateaubriand a érigé une statue à sa propre gloire dans le but de passer à la postérité. Il prend le lecteur par la main et celui-ci n’a qu’à se laisser guider. L’ensemble est vivant, les chapitres sont courts et le style de l’auteur est fluide. Dans les livres I à XII, Chateaubriand évoque son enfance à Combourg, les débuts de la Révolution et son voyage en Amérique.
Selon la volonté de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe furent publiés après sa mort, d’où leur titre. L’auteur narre les principaux épisodes de sa vie, il retrace également les grands événements de l’Histoire auxquels il a été mêlé et évoque les grands personnages qu’il a croisés sur sa route, donnant à son œuvre un aspect de fresque épique.
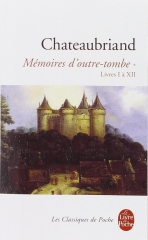 Chateaubriand a vécu la Révolution française, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet ; il a rencontré Washington en Amérique ; il a été en pèlerinage à Jérusalem ; il a assisté à la fin de la féodalité et aux débuts de la Révolution industrielle. Les Mémoires d’outre-tombe constituent un témoignage de première importance pour comprendre une époque qui a été marquée par de grandes transformations. Peu importe que son imagination débordante conduise Chateaubriand à se rappeler des faits qui ne sont peut-être jamais produits ; ce qui compte, c’est que par la force de son écriture et de ses évocations, il amène le lecteur à s’identifier à lui et à se plonger dans les périodes qu’il a traversées.
Chateaubriand a vécu la Révolution française, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet ; il a rencontré Washington en Amérique ; il a été en pèlerinage à Jérusalem ; il a assisté à la fin de la féodalité et aux débuts de la Révolution industrielle. Les Mémoires d’outre-tombe constituent un témoignage de première importance pour comprendre une époque qui a été marquée par de grandes transformations. Peu importe que son imagination débordante conduise Chateaubriand à se rappeler des faits qui ne sont peut-être jamais produits ; ce qui compte, c’est que par la force de son écriture et de ses évocations, il amène le lecteur à s’identifier à lui et à se plonger dans les périodes qu’il a traversées.
Les Mémoires d’outre-tombe sont une œuvre (constituée de trente-quatre livres) qui, par sa longueur, peut donner le vertige à qui voudrait se lancer dedans. Mais, en réalité, l’ensemble est aéré, car les chapitres sont courts. Et surtout, le style de l’auteur est fluide et vivant, ce qui rend la lecture aisée. On peut presque dire que Chateaubriand prend le lecteur par la main, et que celui-ci n’a qu’à se laisser guider, quitte à s’arrêter sur certaines phrases pour bien s’en imprégner.
Les Mémoires d’outre-tombe sont un monument de la littérature et sont aussi un monument que Chateaubriand a édifié à sa propre gloire dans le but de passer à la postérité, alors qu’il craignait d’être oublié des générations à venir.
***
Les livres I à XII, consacrés par Chateaubriand à ses années de jeunesse, ont été regroupés en un volume de la collection Le Livre de poche, l’ensemble des mémoires faisant quatre tomes.
La solitude de Combourg
François-René de Chateaubriand naquit en 1768 à Saint-Malo. Le petit René avait un frère et quatre sœurs, dont il était le cadet. Il était très proche de sa sœur Lucile ; tous deux vivaient auprès de leurs parents en Bretagne. M. de Chateaubriand, seigneur de l’Ancien Régime, s’était retiré dans son château de Combourg, au nord de Rennes (voyez l’illustration de couverture ci-dessus). Il y menait une vie triste et solitaire, ne recevant quasiment aucun visiteur. Selon René, son père était un homme redouté qui inspirait la crainte :
M. de Chateaubriand était grand et sec; il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits et pers ou glauques, comme ceux des lions ou des anciens barbares. Je n’ai jamais vu un pareil regard : quand la colère y montait, la prunelle étincelante semblait se détacher et venir vous frapper comme une balle.
Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. Son état habituel était une tristesse profonde que l’âge augmenta et un silence dont il ne sortait que par des emportements. Avare dans l’espoir de rendre à sa famille son premier éclat, hautain aux états de Bretagne, dur avec ses vassaux à Combourg, taciturne, despotique et menaçant dans son intérieur, ce qu’on sentait en le voyant était la crainte.
« Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été »
Chateaubriand introduit le lecteur dans le quotidien de Combourg. Son père était le premier levé le matin :
Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été : il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre, à l’entrée de l’escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à cinq heures ; il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu’à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre, à huit heures du matin. Je n’avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner ; j’étais censé étudier jusqu’à midi : la plupart du temps, je ne faisais rien.
Les soirées à Combourg se déroulaient dans une atmosphère lourde. Ni Lucille, ni René, ni leur mère, saisis de terreur, n’osaient avoir de conversation en présence de M. de Chateaubriand. Quand dix heures sonnaient à l’horloge du château, M. de Chateaubriand tirait sa montre, la montait, embrassait ses enfants et se retirait pour se coucher. Les portes se refermaient sur lui, et alors :
Le talisman était brisé ; ma sœur, ma mère et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles : si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher.
François-René de Chateaubriand est né dans une famille noble, mais, ainsi qu’il le souligne, cela fut le fruit du hasard. Il n’en tire aucune vanité et juge sans complaisance son milieu social :
Je suis né gentilhomme. Selon moi, j’ai profité du hasard de mon berceau, j’ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l’aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L’aristocratie a trois âges successifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités : sortie du premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier.
Chateaubriand est présenté au Roi à Versailles
« Obscur cadet de Bretagne », le jeune Chateaubriand, âgé de dix-huit ans, fait ses débuts à la cour à Versailles. Un matin de février 1787, dans le salon de l’Œil-de-Bœuf, au milieu des courtisans, il est là à attendre le lever du Roi. Sous le règne de Louis XVI, la cérémonie du lever semble réduite à une fonction symbolique :
La chambre à coucher du Roi s’ouvrit : je vis le Roi, selon l’usage, achever sa toilette, c’est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service.
Le lendemain, le « débutant » Chateaubriand est invité à chasser avec le Roi dans la forêt de Saint-Germain. Au cours de la chasse, après qu’un chevreuil eut été abattu, Louis XVI dit à Chateaubriand : « Il n’a pas tenu longtemps ! » Et, dans ses mémoires, Chateaubriand a ce commentaire : « C’est le seul mot que j’aie jamais obtenu de Louis XVI. »
Chateaubriand critique les dépenses de la monarchie,
les dettes des princes et les acquisitions de châteaux
Avec le recul des années, malgré son attachement aux Bourbons et à la monarchie, Chateaubriand critique sévèrement les excès de dépenses dans le budget de la maison du Roi et dénonce « les dettes des princes, les acquisitions de châteaux et les déprédations de la cour », le terme de déprédation devant s’entendre ici au sens de « détournement d’argent ». Par ailleurs, Chateaubriand a conscience des contradictions de la société française :
A cette époque, tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d’une révolution prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tournaient en moquerie la gravité de leurs pères. […] Le prêtre, en chair, évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du législateur des chrétiens ; les ministres tombaient les uns sur les autres ; le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d’être Américain à la ville, Anglais à la cour, Prussien à l’armée ; d’être tout, excepté Français. Ce que l’on faisait, ce que l’on disait était une suite d’inconséquences. On prétendait garder des abbés commendataires, et l’on ne voulait point de religion ; nul ne pouvait être officier s’il n’était gentilhomme, et l’on déblatérait contre la noblesse ; on introduisait l’égalité dans les salons et les coups de bâton dans les camps.
Chateaubriand spectateur des débuts de la Révolution
Le 14 juillet 1789, à Paris, Chateaubriand était le « spectateur » de la prise de la Bastille, qu’il qualifie d’« assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur ». Il décrit les « orgies » qui suivirent et ironise sur la multiplication des clefs qui se produisit : « Les clefs de la Bastille se multiplièrent ; on en envoya à tous les niais d’importance dans les quatre parties du monde. » Cependant, avec le recul, Chateaubriand mesure la portée de l’événement :
Tout événement, si misérable ou si odieux qu’il soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et qu’il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté : ce qu’il fallait voir dans la prise de la Bastille (et qu’on ne vit pas alors), c’était, non l’acte violent de l’émancipation d’un peuple, mais l’émancipation même, résultat de cet acte.
« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable,
de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste »
Quelques jours après le 14 juillet 1789, Chateaubriand était aux fenêtres de son hôtel avec ses sœurs, quand :
Nous entendons crier : « Fermez les portes ! Fermez les portes ! » Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue ; du milieu de ce groupe s’élevaient deux étendards que nous ne voyions pas bien de loin. Lorsqu’ils s’avancèrent, nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées, que les devanciers de Marat portaient au bout d’une pique : c’était les têtes de MM. Foulon et Bertier. […] Ces têtes, et d’autres que je rencontrai bientôt après, changèrent mes dispositions politiques ; j’eus horreur des festins de cannibales […].
Chateaubriand eut d’abord de la sympathie pour les idées nouvelles, mais il fut dégoûté par le déchainement de violence de la Révolution :
La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique, et je reculai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste.
Paradoxalement, malgré la violence des événements, la vie culturelle est intense et les Parisiens sortent beaucoup. Chateaubriand s’en explique :
Les effets de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. […] Dans tous les coins de Paris, il y avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des spectacles ; les renommées futures erraient dans la foule sans être connues, comme les âmes au bord du Léthé avant d’avoir joui de la lumière. J’ai vu le maréchal Gouvion Saint-Cyr remplir un rôle, sur le théâtre du Marais, dans la Mère coupable de Beaumarchais. […] Aux théâtres, les acteurs publiaient les nouvelles ; le parterre entonnait des couplets patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient la foule : un abbé paraissait sur scène ; le peuple lui criait : « Calotin ! calotin ! » et l’abbé répondait : « Messieurs, vive la nation ! »
Dans le Nouveau-Monde
Chateaubriand rencontre Washington
Dégoûté par la violence révolutionnaire, l’idée de quitter la France pour quelque pays lointain germait dans l’esprit de Chateaubriand. En 1791, il s’embarqua pour l’Amérique. Arrivé là-bas, il remarqua que d’autres Français l’avaient précédé, la jeune République offrant l’asile à des émigrés qui n’avaient pas les mêmes idées que lui. « Une terre de liberté, note Chateaubriand, offrait un asile à ceux qui fuyaient la liberté : rien ne prouve mieux le haut prix des institutions généreuses que cet exil volontaire du pouvoir absolu dans une pure démocratie. »
A Philadelphie, muni d’une lettre de recommandation, Chateaubriand se présente au palais du président des Etats-Unis : « une petite maison, ressemblant aux maisons voisines ». Il est introduit auprès du général Washington, un homme « d’une grande taille, d’un air calme et froid plutôt que noble. » Le président lui parla « par monosyllabes anglais et français », et l’invita à dîner le soir suivant. Or, ce soir-là, à table, les cinq ou six convives présents parlèrent des événements en France, et il se passa ceci :
La conversation roula sur la Révolution française. Le général nous montra une clef de la Bastille [envoyée par La Fayette]. Ces clefs, je l’ai déjà remarqué, étaient des jouets assez niais qu’on distribuait alors. […] Si Washington avait vu dans les ruisseaux de Paris les vainqueurs de la Bastille, il aurait moins respecté sa relique.
Chateaubriand déplore la quasi-absence
de la langue française en Amérique
Dans un passage des Mémoires rédigé en 1822, Chateaubriand est assez critique sur l’Amérique du Nord, notamment quant au sort réservé aux tribus indiennes, « car, note-il, les puissances civilisées, républicaines et monarchiques, se partagent sans façon en Amérique des terres qui ne leur appartiennent pas. »
Aux Etats-Unis, il fut « fort scandalisé de trouver partout le luxe des équipages, la frivolité des conversations, l’inégalité des fortunes, l’immoralité des maisons de banque et de jeu, le bruit des salles de bal et de spectacle. »
Cependant, dans la version des Mémoires revue en 1846, Chateaubriand reste fasciné par le prodigieux essor que connaissent les Etats-Unis et notamment leurs villes. Ainsi il souligne qu'en 1791, « New-York était loin d’être ce qu’elle est aujourd’hui, loin de ce qu’elle sera dans quelques années : car les Etats-Unis croissent plus vite que ce manuscrit. »
Chateaubriand déplore la quasi-absence de la France dans le Nouveau Monde, suite à la perte du Canada sous Louis XV et la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte ; et il laisse entrevoir le déclin du rayonnement de la langue française :
Nous sommes exclus du nouvel univers, où le genre humain recommence : les langues anglaise, portugaise, espagnole, servent en Afrique, en Asie, dans l’Océanie, dans les îles de la mer du Sud, sur les continents des deux Amériques, à l’interprétation de la pensée de plusieurs millions d’hommes ; et nous, déshérités des conquêtes de notre courage et de notre génie, à peine entendons-nous parler dans quelques bourgades de la Louisiane et du Canada, sous une domination étrangère, la langue de Colbert et de Louis XIV : elle n’y reste que comme un témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique.
Apprenant l’arrestation du Roi à Varennes, Chateaubriand décida de rentrer en France. Il débarqua en Bretagne, embrassa sa mère à Saint-Malo, et se maria ; ou plutôt, comme il le dit lui-même, on le maria. Puis il rejoignit l’armée des princes, se battit aux côtés des émigrés et passa en Angleterre. C’est en exil qu’il apprit l’arrestation de sa mère et de ses sœurs et l’exécution de son frère aîné.
Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand, 1848, Livres I à XII, collection Le Livre de poche.
08:39 Publié dans Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre, Mémoires, autobiographie, témoignage | Tags : mémoires d'outre-tombe, chateaubriand | Lien permanent | Commentaires (2)
25/01/2016
J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de Christine Arnothy
Le siège de Budapest vécu par une fillette
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir
Ce livre, qualifié d’autobiographie, est le récit au jour le jour du siège de Budapest, en 1945. L’auteur, Christine Arnothy, raconte le calvaire qu’elle vécut, alors qu’elle n’avait que quinze ans. Elle fait partager au lecteur ses émotions et sa peur de la mort, dans une ville en proie aux bombardements.
En 1954 paraissait J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Le succès du livre fut immédiat. Son auteur, Christine Arnothy, était une jeune réfugiée hongroise installée en France. Quelques années plus tôt, elle avait fui son pays natal, en compagnie de ses parents ; ils étaient partis sans bagage, elle-même emportant pour seul bien les feuillets de son journal, cousus dans son manteau. C’est ce journal qui est la source de J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Christine Arnothy y raconte au jour le jour comment elle vécut le siège de Budapest et le calvaire enduré par ses habitants au début de l’année 1945.
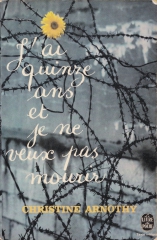 La fillette et ses parents habitaient alors un immeuble en bordure du Danube. Au début des combats, ils trouvèrent refuge dans la cave : « Les trois premiers jours passèrent assez vite. A chaque craquement de l’escalier, nous pensions : voilà les Russes, les combats ont pris fin près d’ici, nous pourrons remonter dans nos chambres et renouer le fil de notre existence […]. Au cinquième jour de notre exil dans les souterrains, il fut évident que les Allemands avaient décidé de défendre la ville. C’est alors que nous perdîmes toute notion du temps. Les journées mortelles, angoissantes, se succédèrent avec une lenteur accablante. » Les Allemands, qui n’ont plus rien à perdre, sont décidés à vendre chèrement leur peau et les bombardements deviennent presqu’incessants.
La fillette et ses parents habitaient alors un immeuble en bordure du Danube. Au début des combats, ils trouvèrent refuge dans la cave : « Les trois premiers jours passèrent assez vite. A chaque craquement de l’escalier, nous pensions : voilà les Russes, les combats ont pris fin près d’ici, nous pourrons remonter dans nos chambres et renouer le fil de notre existence […]. Au cinquième jour de notre exil dans les souterrains, il fut évident que les Allemands avaient décidé de défendre la ville. C’est alors que nous perdîmes toute notion du temps. Les journées mortelles, angoissantes, se succédèrent avec une lenteur accablante. » Les Allemands, qui n’ont plus rien à perdre, sont décidés à vendre chèrement leur peau et les bombardements deviennent presqu’incessants.
Les locataires de l’immeuble, qui s’ignoraient jusqu’ici, en sont réduits à vivre dans la même cave : « Ils dormaient, mangeaient, se lavaient et se chamaillaient dans la promiscuité la plus totale. » Et ensemble ils sont condamnés à affronter la peur de la mort, que chacun ressent individuellement à chaque bombardement. Quand un prêtre leur rend visite dans la cave, Christine se confesse à lui : « Je ne veux pas mourir, mon père, lui dis-je presqu’en pleurant. Je n’ai que quinze ans et j’ai affreusement peur de la mort. Je veux vivre encore. »
Suite à un vol de vivres, des soldats allemands menacent de fusiller tous les locataires de l’immeuble. Christine a alors très peur, mais le voisin de ses parents, un magistrat en retraite, a encore plus peur qu’elle : « Le procureur général criait qu’il voulait encore vivre. Je me disais qu’il avait déjà vécu quatre-vingt ans, tandis que, moi, je n’en avais que quinze, et j’avais plus de raison que lui de pleurer… » Et c’est le procureur général qui manifestera le plus vif soulagement à la perspective d’échapper à la mort.
Dans cette ville en ruines, les cœurs durs ont plus de chances
de survivre que les cœurs tendres
Le récit de Christine Arnothy montre bien à quel point la guerre bouleverse les relations sociales. Le chaos finit par s’installer dans la ville, et, dès que les Allemands sont partis, des habitants s’adonnent au pillage. Même le procureur général participe au sac du tribunal. Christine Arnothy le constate : « Toutes les notions morales sont bouleversées dans cette ville en ruine. Le vice compte pour la vertu et les cœurs durs ont plus de chances de survivre que les cœurs tendres. »
La peur ne disparaît pas avec l’arrivée des Russes, car ils ne sont pas les libérateurs que l’on croyait qu’ils seraient. Une femme de soixante-treize ans dit avoir été violée par cinq soldats russes, l’un après l’autre.
Christine et ses parents réussissent à s’échapper de Budapest occupé par les Russes, et gagnent la maison qu’ils possèdent en périphérie. Ils y retrouvent tante Julia à qui ils ont prêté leur maison. Quand elle les voit arriver, tante Julia n’est pas folle de joie. Au contraire, elle est ébahie et leur déclare : « Comment, vous n’êtes pas tous morts, vous autres ? » Elle semble très déçue qu’ils soient encore en vie. Comme le note Christine Arnothy, elle les avait probablement pleurés un moment, puis elle avait admis qu’ils étaient morts, et s’était consolée à la perspective de garder la maison pour elle et ses enfants. A Budapest et dans ses environs, règne le chacun pour soi. L’essentiel étant de survivre soi-même, cela devient un luxe de se soucier de son prochain.
Malgré tout, dans ce récit, il y a de rares moments d’humanité ; il n’y a alors plus d’Allemands, plus de Russes, plus de Hongrois, mais seulement des frères humains. Ces moments sont brefs et n’empêchent pas le tragique de se produire.
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir est un récit court et facile à lire, qui montre le vrai visage de la guerre. Un lecteur adolescent s’identifiera sans mal à la narratrice.
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de Christine Arnothy, 1954, collection Le Livre de Poche.
30/11/2015
Et dans l'éternité je ne m'ennuierai pas, de Paul Veyne
Un ancien professeur au Collège de France se raconte
Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas
Paul Veyne, grand spécialiste de la Rome antique, livre ses souvenirs en toute liberté. Il parle de sa vocation d’érudit, de son passage à l’Ecole normale supérieure et de son élection au Collège de France. Il évoque Aron, qui lui apporta son soutien avant de se brouiller avec lui. Enfin Paul Veyne, qui manifesta contre de Gaulle en 1958, lui rend aujourd’hui hommage.
En ouverture de son livre de souvenirs, Paul Veyne, professeur honoraire d’histoire romaine au Collège de France, fait une déclaration de patrimoine et de revenus. Il dit toucher une pension de 4500 euros par mois, à laquelle s’ajoutent des droits d’auteur variables selon les années. Cette transparence sur ses finances est signe que Paul Veyne ne veut pas cacher grand-chose de sa vie. Et il est vrai qu’il donne beaucoup d’éléments sur son parcours professionnel, sa vie privée et ses croyances.
 Né en 1930 dans le Midi de la France, Paul Veyne est le fils d’un négociant en vin. Sa famille était aisée et, pendant la guerre, son père fut favorable à la Collaboration, même si, par prudence, il évita de faire de la politique. Enfant, Paul Veyne découvrit sa vocation, celle de l’érudition. Pour lui, apprendre est un jeu ; il se passionne déjà pour Homère et ambitionne de devenir un être cultivé.
Né en 1930 dans le Midi de la France, Paul Veyne est le fils d’un négociant en vin. Sa famille était aisée et, pendant la guerre, son père fut favorable à la Collaboration, même si, par prudence, il évita de faire de la politique. Enfant, Paul Veyne découvrit sa vocation, celle de l’érudition. Pour lui, apprendre est un jeu ; il se passionne déjà pour Homère et ambitionne de devenir un être cultivé.
A dix-huit ans, le baccalauréat en poche, il monta à Paris et s’inscrivit en hypokhâgne au lycée Henri IV, pour préparer le concours de l’Ecole normale supérieure. Quelques temps auparavant, il ne connaissait pas l’existence de cette école, mais le notaire de ses parents leur avait dit qu’il fallait passer par Normale pour devenir professeur.
Après un échec, Paul Veyne fut reçu à l’ENS, à sa seconde tentative. Il fit son entrée à l’Ecole, qu’il qualifie de « monastère laïc de la rue d’Ulm » sans expliquer les raisons de cette appellation. Pendant ses études, il succomba à la tentation communiste et s’inscrivit au Parti, bien qu’il n’eût pas la foi :
Mais pourquoi adhérer au Parti, fût-ce sous l’effet de l’alcool, alors que je ne croyais pas à ces « lendemains qui chantent » dont parlait Aragon et que la politique ne m’intéressait pas ? […] Oui, mais avoir sa carte du Parti ! Participer à la croisade de mon époque ! Pouvoir répondre : « Oui, je l’ai. » […] Désormais, j’aurais le droit d’être heureux avec bonne conscience […]. »
Dans le débat opposant Sartre à Aron, il dit n’avoir pu prendre Sartre au sérieux. Cependant l’égoïsme social d’Aron lui glaçait le sang. Selon Paul Veyne, Aron se désintéressait complètement du sort du prolétariat.
En 1958, quand de Gaulle revint au pouvoir à la faveur des événements d’Algérie, le militant de gauche qu’est Paul Veyne participa naturellement à la manifestation du 28 mai, organisée au nom de la défense de la République. Avec le recul des années, Paul Veyne a radicalement changé d’avis sur de Gaulle. Aujourd’hui, il le vénère :
Oui, je vénère de Gaulle, je l’ai dit, pour avoir été le plus grand réformateur de gauche de notre siècle […] : décolonisation, vote des femmes, Sécurité sociale, et j’en passe. »
Au Collège de France, Paul Veyne fut traité de provocateur
pour avoir choisi un sujet d’étude qui sentait le souffre
En 1961, Paul Veyne fut nommé maître de conférences de latin à la faculté d’Aix-en-Provence. A trente-et-un ans, il est titularisé ; sa sécurité matérielle est assurée à vie.
Il se lança dans la préparation de sa thèse, consacrée à la Rome antique. Il décida de la faire précéder d’une préface, qu’il commença de rédiger et dans laquelle il glissa ses souvenirs personnels. La préface ne cessa de s’allonger et finit par former une œuvre à part, presqu’un livre, si bien que Paul Veyne décida d’en envoyer le manuscrit au Seuil. Cette jeune maison d’édition accepta le texte et le publia sous le titre Comment on écrit l’histoire. Le livre fut remarqué par Raymond Aron, qui en fit une critique élogieuse. Fort de son soutien, Paul Veyne monta régulièrement à Paris suivre son séminaire. En 1975, quand un poste se libéra au Collège de France, Aron obtint la création d’une chaire d’histoire de Rome qu’il destina à Paul Veyne. Avec un parrain aussi influent et après des visites protocolaires, Paul Veyne fut élu professeur au Collège de France. Lors de sa leçon inaugurale, il commit un impair en omettant de rendre hommage à Aron. Aron eut la rancune tenace, selon Veyne :
La conséquence fut plus amère : à la suite de ma leçon inaugurale, Aron s’écarta de moi, m’écarta de lui, lança contre moi ses élèves lorsque je revins parler à son séminaire. Il n’avait pas tort, je m’étais conduit plus que grossièrement avec lui.
Au Collège de France, Paul Veyne choisit un sujet qui, en 1975, sentait encore le souffre : l’amour et les pratiques homosexuelles dans la Rome antique. Cela fit réagir :
Dans un certain milieu, cela fit pousser des oh ! et des ah ! sur ma personne, voire sur mes mœurs ; au mieux, on me traitait de provocateur et ce qualificatif m’est longtemps resté.
Le livre peut paraître quelque peu désordonné, Paul Veyne passant sans cesse d’une idée à l’autre, pour revenir ensuite en arrière ; mais, après tout, il affirme lui-même n’avoir aucune ambition littéraire. En tout cas, il parle librement de sa vie et de ses passions, notamment pour l’escalade. Il évoque aussi les drames qui ont marqué sa vie de famille. Il parle, avec franchise, de sa peur de la mort et de son absence de foi religieuse. Il ajoute néanmoins :
J’aimerais qu’il existe « autre chose » qui nous dépasse. […] Je ne suis pas croyant, mais je voudrais bien croire en revanche à une sorte de l’immortalité de l’âme (ne me demandez pas de préciser) : à peine serai-je mort que « je » découvrirai que ce n’est pas le trou noir, le néant. Si bien que, dans l’éternité, « je » ne m’ennuierai pas.
Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas, de Paul Veyne, 2014, éditions Albin Michel.


