06/02/2020
Clarissa
Le monde vu à travers la vie d’une femme
Clarissa
Clarissa, fille d’un officier de l’armée austro-hongroise, prend conscience qu’elle vit dans un univers étriqué. Dès lors elle veut échapper à son milieu social pour vivre sa vie, quand, en 1914, éclate la guerre. Dans ce roman qui a la forme d’une chronique, Zweig montre sa capacité à mêler des destins individuels à la tragédie collective. Avec une économie de moyens, il atteint une grande profondeur psychologique dans les personnages.
Clarissa fait partie des œuvres que Stefan Zweig a laissé inachevées à sa mort. Mais inachevé ne veut pas dire inabouti. Cette histoire a un début et une fin, même s’il apparaît que Stefan Zweig avait l’intention de prolonger son roman de plusieurs chapitres supplémentaires. On retrouve tout au long du texte le style concis et précis de l’auteur, et l’on a peine à se dire qu’il aurait, selon son habitude, remanié encore et encore son texte pour en effacer toute lourdeur et toute surcharge.
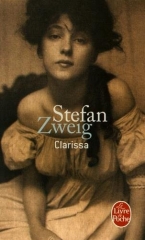 Présentée sous forme de chronique, Clarissa raconte, année après année, la vie d’une jeune femme née dans l’empire austro-hongrois. Le lecteur entre dans l’intimité de cette jeune femme qui se trouve confrontée à la tragédie collective de la guerre. Ce roman, c’est, a écrit Zweig, « le monde vu à travers la vie d’une femme ».
Présentée sous forme de chronique, Clarissa raconte, année après année, la vie d’une jeune femme née dans l’empire austro-hongrois. Le lecteur entre dans l’intimité de cette jeune femme qui se trouve confrontée à la tragédie collective de la guerre. Ce roman, c’est, a écrit Zweig, « le monde vu à travers la vie d’une femme ».
Clarissa Schulmeister est née en 1894. Sa mère est morte en la mettant au monde, et son père est militaire de carrière. Il est lieutenant-colonel affecté à l’état-major à Vienne, au moment où commence le récit. C’est un officier de bureau, sorte d’esprit étriqué, qui accumule des données chiffrées sur toutes les armées d’Europe, ce qui lui a valu le surnom de « maître statisticien ». Sa déformation professionnelle, due à l’abus de tableaux et de chiffres, est telle, qu’il exige de Clarissa qu’elle fasse un rapport quotidien de ses activités ; sur des feuilles préparées à cet usage elle devait noter ce qu’elle avait appris à chaque heure de cours, quels livres elle avait lus, quels morceaux de musique elle avait étudiés au piano... Cette besogne, qu’on appelle de nos jours le reporting, obligeait Clarissa à se noyer dans les détails et ne lui fut pas du tout bénéfique, selon Stefan Zweig : « En réalité, le caractère machinal de ces rapports et de ces annotations eut pour effet d’ôter à Clarissa toute vue d’ensemble sur ces années, car les impressions, au lieu de s’accumuler et de prendre du relief, tombaient en poussière et se désintégraient sous l’effet de ces rapports prématurés […] »
Le professeur Silberstein se dit sceptique
sur l’efficacité de la psychanalyse
Encouragée par son père à faire des études avant de se marier, Clarissa rencontre le professeur Silberstein, dont elle est l’étudiante puis l’assistante. Neurologue réputé et spécialiste des névroses, Silberstein est lui-même un névrosé. Semblable à de nombreux autres personnages créés par Zweig, il est facilement la proie d’idées fixes et ne le cache pas à Clarissa ; ainsi il lui déclare : « Quand quelque chose s’empare de moi, plus rien ne peut m’arrêter, je ne pense plus qu’à cela. » Il se dit sceptique sur l’efficacité de la psychanalyse : « Freud veut faire découvrir aux hommes la cause de leur déséquilibre psychique, et moi, je veux la leur faire oublier. Je crois qu’il vaut mieux leur en inculquer une autre qui soit inoffensive. Je ne crois pas que la vérité puisse les aider. […] Je ne crois pas à la guérison. » Pour échapper à ses névroses, il vit dans un tourbillon et multiplie les mondanités pour qu’on parle de lui et qu’on ne l’oublie pas.
Silberstein envie le calme et la sérénité de Clarissa. Mais, au lieu de la féliciter de l’équilibre de son caractère, il prend un air grave pour lui dire : « Vous avez vraiment une attitude passive. Vous n’exigez jamais rien. Il y a quelque chose qui fait de vous une personne merveilleuse. Je serais presque tenté de dire : " On sent à peine votre présence." » Et il lui annonce qu’elle sera un jour ou l’autre rattrapée par une illusion spécifique : « Vous n’y échapperez pas, vous n’échapperez pas à vous-même. »
Seuls les gens simples savent profiter des petits bonheurs de la vie
et sont vraiment heureux
Clarissa est chargée par le professeur Silberstein de le représenter à un congrès de pédagogie à Lucerne. Le congrès est organisé par des professeurs progressistes français regroupés au sein de L’Education nouvelle ; il est question de méthodes pédagogiques, de démarche scientifique, de Montessori, de Pestalozzi. Pour la première fois de sa vie, Clarissa côtoie des personnes d’un autre milieu social que le sien : les participants sont des instituteurs venus de toute l’Europe, ce sont des gens simples, des gens de condition modeste, qui n’avaient jamais voyagé avant de venir en Suisse. A l’occasion d’une croisière fluviale organisée en clôture du congrès, Clarissa les voit heureux d’être ensemble : ils s’enthousiasment devant des fleurs et mangent des tartines pour le déjeuner. « Je vis dans un univers étriqué. » se dit-elle en les voyant. Elle prend alors conscience que seuls ceux qui se contentent de peu, connaissent ces petits bonheurs. « Pour la première fois, écrit Zweig, elle s’ouvrait au monde. »
Sa rencontre avec Léonard est pour beaucoup à son ouverture au monde. Professeur au lycée de Dijon, il est l’organisateur du congrès ; ils sympathisent tous les deux et, à l’occasion de leurs conversations, il lui fait partager ses idées, qui sont assez largement le reflet de celles de Zweig. Son auteur préféré, c’est Montaigne, car, parmi tous les écrivains, déclare Léonard, « personne n’était plus humain, personne mieux que lui ne comprenait l’Homme, celui de tous les jours. » Il la met en garde contre le nationalisme : « C’est lui, le mal qui place une seule patrie au-dessus de toutes les autres. » Anticolonialiste, il lutte contre le chauvinisme et l’esprit de conquête et donne sa définition de la France : « Le sol, la terre, la langue, l’art, voilà ce qu’est la France et non le Cambodge, la Guyane et Madagascar. » Pour lui, ce sont les anonymes, tels les participants au congrès, qui comptent : « Ce ne sont pas les morts illustres qui font la valeur d’un pays. Ce sont les gens qui y vivent. »
En vacances, Clarissa et Léonard vivent hors du temps
et n’achètent pas de journaux,
car cela reviendrait à s’imposer une contrainte
En vacances dans les montagnes avec Léonard, elle connaît, le temps d’un été, des moments d’intense bonheur. Ils vivent libres, détachés de tout et hors du temps. Ils n’achètent pas les journaux, car, disent-ils, « cela reviendrait à nous imposer une contrainte. » Cette liberté qu’il souhaite vivre pleinement concerne en premier lieu le cerveau qui doit être détaché de toute entrave, ce qui conduit Léonard à dire : « Ne pas penser une heure durant ! Ce n’est pas une heure perdue. »
Clarissa sort métamorphosée de son expérience avec Léonard. Elle repense à son père qui, dévoré par le devoir, aura passé son existence à s’effacer pour servir ; maintenant elle entend rompre avec les principes que lui a inculqués son père : « A présent, vivre était son plus ardent désir. »
Mais la mobilisation générale, le départ de Léonard et la guerre vont bouleverser tous ses plans. Clarissa va alors connaître un autre événement qui va la transformer en tant que femme.
Heureusement pour le lecteur, Stefan Zweig a eu le temps de conduire Clarissa jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui donne au récit une fin, même provisoire. C’est l’occasion pour l’auteur d’exposer à nouveaux ses idées sur la nation et sur la guerre, cette fois par l’intermédiaire du professeur Silberstein. La fin de l’empire et de l’empereur ne signifie rien pour lui. « Nous vivons, c’est tout ce qui importe. », déclare-t-il.
Dans ce roman, Zweig montre sa capacité à mêler des destins individuels à la tragédie collective. Il propose une galerie de personnages aux caractères variés, et, avec une économie de moyens, il atteint une grande profondeur psychologique.
Clarissa, c’est l’histoire d’une jeune femme, qui, malgré son éducation et malgré la guerre, cherche à s’affranchir de son milieu social pour vivre en être libre.
Clarissa, de Stefan Zweig, 1942, collection Le Livre de poche.
09:04 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : clarissa, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)
20/11/2017
Balzac, le roman de sa vie
L’homme qui voulut concurrencer Dieu
Balzac
Le roman de sa vie
Stefan Zweig consacra à Balzac une biographie dans laquelle il montra l’étendue et la puissance de son œuvre. Il raconta sa vie, qui fut un véritable roman, et toutes ses mésaventures, qui nourrirent nombre de ses livres. La Comédie humaine était une œuvre titanesque dont l’accomplissement finit par épuiser ses forces, si bien que Balzac est mort d’avoir voulu concurrencer Dieu.
Stefan Zweig avait fait de Balzac l’un de ses principaux maîtres. Non sans déférence, il l’appelait le « Grand Balzac ». Il était fasciné par sa personnalité hors du commun, sa puissance créatrice, sa force, sa volonté, qui lui paraissaient surhumaines. Il voyait en lui un concurrent de Dieu qui avait créé « à côté du monde réel un autre cosmos », celui de la Comédie humaine.
 Le Balzac de Zweig est un homme qui entend soumettre le réel à sa volonté. C’est ainsi que, pour commencer, il modifia son patronyme. Né Honoré Balzac, sans particule, il décida, à trente ans, de se l’attribuer et de devenir Honoré de Balzac aux yeux de ses contemporains et pour la postérité. Très en avance sur son temps à cet égard, il transforma son nom en une marque destinée à rencontrer le succès littéraire et commercial.
Le Balzac de Zweig est un homme qui entend soumettre le réel à sa volonté. C’est ainsi que, pour commencer, il modifia son patronyme. Né Honoré Balzac, sans particule, il décida, à trente ans, de se l’attribuer et de devenir Honoré de Balzac aux yeux de ses contemporains et pour la postérité. Très en avance sur son temps à cet égard, il transforma son nom en une marque destinée à rencontrer le succès littéraire et commercial.
Ce sont les femmes qui contribuèrent à forger le destin de Balzac. La première d’entre elles fut Mme de Berny, une aristocrate ayant quinze ans d’âge de plus que lui et dont il fit la connaissance dans ses années d’apprentissage. Dans un écrit, Balzac reconnut la dette qu’il lui devait : « elle a été une mère, une amie, une famille, un ami, un conseil. Elle a fait l’écrivain, elle a consolé le jeune homme […]… sans elle, je serais mort. » C’est Mme de Berny qui lui inspira La Femme de trente ans, l’un de ses premiers succès ; à travers l’Europe, des milliers de lectrices qui étaient malheureuses dans leur mariage se reconnurent dans le personnage principal et eurent l’impression qu’il se trouvait enfin un écrivain pour comprendre leur désarroi.
De toutes les femmes de Balzac, Zulma Carraud fut, selon Zweig la plus pure. Bourgeoise de province, elle était cultivée et surtout très lucide, notamment quand elle poussa Balzac à nettoyer son style de ses lourdeurs. Plein de reconnaissance à son égard, il la remercia de l’aider à « arracher les mauvaises herbes de son champ ». Avant tout le monde, elle avait compris la puissance de l’œuvre de Balzac et lui déclara avec beaucoup de pertinence : « Vous êtes le premier prosateur de l’époque et, pour moi, le premier écrivain. Vous seul vous êtes semblable et tout paraît fade après vous. »
Si elle admirait l’écrivain,
Mme de Hanska n’avait que mépris pour l’homme
Il y eut beaucoup d’autres conquêtes dans la vie de Balzac, lequel, selon les mots de Zweig, « change de femme plus souvent que de chemise. » Néanmoins Balzac eut l’intention de se marier ; il voulait, disait-il, « une femme et la fortune » pour assurer sa sécurité matérielle. Or, un jour de 1831, Balzac, qui était habitué à recevoir des lettres d’admiratrices, en reçut une provenant d’Ukraine, mystérieusement signée « l’Etrangère ». Son auteur se révèle être Mme de Hanska, épouse d’un aristocrate russe ; il entama avec elle une correspondance régulière, et ils se rencontrèrent, pour la première fois, à Genève en présence de M. de Hanski, lequel voyait en Balzac un ami de la famille, sans percevoir qu’il entretenait une liaison avec sa femme. Les deux amants s’engagèrent et attendirent patiemment la mort du mari, beaucoup plus âgé que sa femme.
Mais ensuite, au lieu d’épouser aussitôt Balzac, Mme de Hanska, devenue libre, le fit lanterner ; car, si elle admirait l’écrivain, elle n’avait que mépris pour l’homme Balzac, individu d’un rang social largement inférieur au sien. Zweig se montre sévère pour Mme de Hanska, en qui il voit une femme gâtée par la fortune et ne pensant qu’à son propre plaisir. Elle traita Balzac comme s’il était un serf lui appartenant ; et lui-même accepta son statut d’inférieur : il se présentait, dans ses lettres, comme étant « son fidèle et obéissant moujik ». Elle consentit à l’épouser, mais seulement après avoir acquis la certitude que leur union serait brève, Balzac étant gravement malade.
Zweig perce le grand secret de Balzac
Balzac vécut mille aventures et mésaventures au cours de son existence. Il se lança dans de nombreuses entreprises commerciales (imprimerie, édition, spéculation foncière, exploitation de mines d’or…), et à chaque fois il échoua, non qu’il eût tort sur le fond, mais parce qu’il était d’un caractère trop impatient : après avoir semé, il ne parvenait pas à attendre le temps de la récolte. Sur le long terme, toutes ses intuitions se révélèrent justes. Mais ce furent d’autres que lui qui en tirèrent profit. Lui-même passa sa vie criblé de dettes et harcelé par ses créanciers. Pour leur échapper, il inventa mille stratagèmes, possédant par exemple plusieurs demeures à Paris, dans lesquelles un visiteur ne pouvait pénétrer sans avoir donné le mot de passe au domestique.
Le lecteur doit se féliciter des multiples échecs qu’essuya Balzac, car ils servirent de matériaux à nombre de ses romans, dont César Birotteau ou Illusions perdues. Zweig note : « Pour avoir travaillé avec les ouvriers, lutté contre les usuriers, marchandé sans répit avec les fournisseurs, il a acquis une connaissance infiniment plus précise des rapports et des conflits sociaux que ses grands contemporains : Victor Hugo, Lamartine et Alfred de Musset. » Plus loin, Zweig perce le grand secret de Balzac : « tout est sujet » ; « La réalité est une mine inépuisable quand on s’entend à la fouiller. Il n’est besoin que d’observer comme il faut et chaque homme devient un acteur de La Comédie humaine. Il n’y a pas de haut ni de bas : on peut tout choisir et – c’est là pour Balzac le point capital – on doit tout choisir. Qui veut peindre le monde ne peut laisser de côté aucun de ses aspects, tous les échelons de l’échelle sociale doivent être représentés, le peintre tout comme l’avocat et le médecin, le vigneron, la concierge, le général et le fantassin, la comtesse, la petite prostituée des rues, le porteur d’eau, le notaire et le banquier. »
« Plus Balzac devient amer sous les coups de l’expérience,
plus il devient vrai »
La Comédie humaine, telle que la concevait Balzac, était une œuvre titanesque, dont l’accomplissement finit par épuiser ses forces : « C’est le seul homme peut-être dont on peut dire sans exagération qu’il s’est tué au travail. » Sa monomanie conduisit Balzac à un rythme quotidien hors du commun : il se couchait tous les soirs à six heures, se levait à minuit et écrivait de minuit à huit heures quand Paris dormait. Le jour levé, il ne ralentissait pas son rythme de travail et relisait les épreuves apportées de l’imprimerie. Ses corrections étaient si nombreuses qu’il indisposait les typographes, lesquels refusaient de « faire plus d’une heure de Balzac par jour ».
Zweig n’hésite pas à critiquer certaines imperfections dans nombre de romans de Balzac. Ainsi il déplore que Louis Lambert fut écrit trop vite, mais il reste admiratif devant Le Père Goriot et César Birotteau, écrits dans les années 1830 ; et il fait observer que ses dernières œuvres sont les plus percutantes : « Plus Balzac devient amer sous les coups de l’expérience, plus il devient vrai. » Pour Zweig, Une ténébreuse affaire et La Rabouilleuse, écrits dans les années 1840, sont des « œuvres grandioses ». Balzac eut le temps de finir Le Cousin Pons et La Cousine Bette, qui sont, aux yeux de Zweig, ses « deux plus grands romans ».
Vers 1847, son cerveau soumis à trop de tensions refusa d’obéir à sa volonté créatrice. Balzac, qui perdait peu à peu la vue, cessa définitivement d’écrire et mourut, riche et marié. Sur sa tombe, Victor Hugo prononça une oraison funèbre que Zweig reproduit et dans laquelle le poète qualifia Balzac d’ «homme de génie », ce que nombre de contemporains ne mesuraient pas.
Notre époque a trop tendance à réduire Balzac à l’état d’écrivain un peu ennuyeux, réservé aux programmes scolaires. Le livre de Zweig permet de découvrir l’étendue et la richesse de son œuvre. Qui doute encore du génie de Balzac n’a qu’à lire La Messe de l’athée, qui fait une trentaine de pages et qui n’exige pas plus d’une heure de lecture ; Zweig qualifie cette nouvelle de « chef-d’œuvre en miniature ».
Balzac, le roman de sa vie, de Stefan Zweig, 1942, collection Le Livre de poche.
08:37 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre | Tags : balzac le roman de sa vie, balzac, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)
20/01/2014
La Peur, de Stefan Zweig
Histoire de la femme adultère
La Peur
Cette nouvelle, qui se lit presque d’une traite, est une œuvre de jeunesse de Stefan Zweig. A Vienne, l’épouse d’un grand avocat trompe son mari avec un pianiste. Un jour, elle est surprise par l’amie du musicien qui va se transformer en maître-chanteuse. La peur envahit la femme adultère.
La Peur est l’une des nombreuses nouvelles de Stefan Zweig. Elle est facile à lire et se dévore presque d’une traite. Comme d’habitude, l’auteur fait preuve d’une économie de moyens : il n’y a ni lourdeur ni longueur, la construction du récit étant très rigoureuse. Tout est concentré, ce qui donne à l’histoire toute son efficacité. La Peur a été écrite en 1913, c’est une œuvre de jeunesse de Zweig que l’on peut qualifier de balzacienne. L’auteur nous décrit avec minutie les ravages de la peur qui envahit une épouse infidèle, issue de la bonne société.
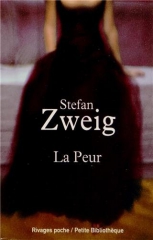 A Vienne, dans les années 1900, madame Irene Wagner, épouse d’un grand avocat, vit une aventure avec un pianiste de renom. Au sortir d’un rendez-vous avec son amant, elle est surprise par l’amie du musicien, une femme de basse extraction, qui l’accuse de lui avoir volé son homme. Aussitôt, madame Wagner ressent une montée d’adrénaline qui a pour effet d’imprimer le visage de cette femme-là dans son cerveau : « l’horreur de ce souvenir […] restait fiché dans son cerveau comme un hameçon ». Elle va être victime d’un chantage, sous la menace que sa liaison soit révélée à son mari. Elle sait bien qu’il ne faut jamais céder à un maître-chanteur, mais sous le coup de l’émotion elle perd ses moyens. La peur s’empare de tout son être, avec toute une série de symptômes qui l’accompagnent : nervosité, spasmes, émotions exacerbées, sommeil perturbé, mauvais rêves, crises d’hystérie…
A Vienne, dans les années 1900, madame Irene Wagner, épouse d’un grand avocat, vit une aventure avec un pianiste de renom. Au sortir d’un rendez-vous avec son amant, elle est surprise par l’amie du musicien, une femme de basse extraction, qui l’accuse de lui avoir volé son homme. Aussitôt, madame Wagner ressent une montée d’adrénaline qui a pour effet d’imprimer le visage de cette femme-là dans son cerveau : « l’horreur de ce souvenir […] restait fiché dans son cerveau comme un hameçon ». Elle va être victime d’un chantage, sous la menace que sa liaison soit révélée à son mari. Elle sait bien qu’il ne faut jamais céder à un maître-chanteur, mais sous le coup de l’émotion elle perd ses moyens. La peur s’empare de tout son être, avec toute une série de symptômes qui l’accompagnent : nervosité, spasmes, émotions exacerbées, sommeil perturbé, mauvais rêves, crises d’hystérie…
Irene ne connait pas son mari
Madame Wagner ne sait quelle attitude adopter face à son mari. Elle aimerait lui avouer la vérité, lui dire qu’elle l’a trompé et qu’aujourd’hui une odieuse femme la fait chanter, mais elle n’ose pas franchir le pas. Son mari lui paraît plein de bonté et de sagesse. Elle se souvient qu’un soir il était rentré à la maison en déclarant « Aujourd’hui, on a condamné un innocent ». Et Zweig de poursuivre, comme si les idées de l’avocat reflétaient les siennes : « Un voleur venait d’être condamné pour un larcin commis trois ans auparavant, et à tort selon lui, car après trois années ce crime n’était plus le sien. On condamnait quelqu’un qui était devenu autre et on le punissait doublement car il avait passé trois ans dans la prison de sa propre peur, dans l’inquiétude permanente d’être découvert. » Le mari de madame Wagner est un homme d’une grande humanité dans sa vie professionnelle, mais montrera-t-il la même compassion face à une affaire d’adultère dans laquelle sa femme est coupable ? C’est alors que madame Wagner prend conscience qu’après huit ans de mariage et d’intimité partagée, elle ne connait pas vraiment son mari et se sent incapable de prévoir sa réaction.
Envahie par la peur, craignant de croiser sa maître-chanteuse dans la rue si elle met le nez dehors, madame Wagner décide de se cloître dans son appartement. Mais, faisant ainsi, privée de toute relation sociale, elle perd sa raison de vivre, car dans son milieu on n’existe que par rapport aux autres : « Irene appartenait à cette élégante bourgeoisie viennoise dont l’emploi du temps semble régi par un accord tacite qui fait que tous les membres de cette alliance invisible se retrouvent toujours aux mêmes heures à s’intéresser aux mêmes choses, au point que s’observer mutuellement et se rencontrer étaient peu à peu devenu le sens de leur existence. » Livrée à elle-même, rongée par la peur et confrontée au vide de son existence, madame Wagner se dirige vers la solution du suicide.
Les lecteurs de Zweig sont habitués à ce que ses histoires terminent mal, tant le pessimisme est présent dans son œuvre ; en sera-t-il de même cette fois ?
La Peur, de Stefan Zweig (1913), collections Rivages Poche / Petite Bibliothèque.
09:15 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la peur, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)


