05/05/2014
Madame Malraux, d'Aude Terray
Les statues qu’on abat
Madame Malraux
Madame Malraux fut d’abord l’épouse de Malraux. Devenue veuve après la guerre, elle se remaria avec et André Malraux, frère aîné de son défunt mari. Le livre d’Aude Terray nous fait vivre dans l’intimité du grand homme, il nous raconte les drames qui ont marqué la famille, et ne nous cache pas qu’André fut quelques fois bien décevant.
Madame Malraux, née Madeleine Lioux, est décédée en janvier 2014. Deux ans avant sa mort, elle a raconté sa vie à l’historienne Aude Terray, déjà auteur d’une très intéressante biographie de Claude Pompidou. Madeleine Lioux est née en 1914 dans une famille de la bourgeoisie toulousaine. Son père est un riche industriel passionné de musique. La petite Madeleine est une pianiste prodige. En 1928, elle monte à Paris et entre au conservatoire. En 1942, elle tombe amoureuse d’un jeune homme de trente ans, Roland Malraux. Roland a été le secrétaire de Gide, pour qui il faisait des traductions d’articles de journaux allemands et anglais. Il est le demi-frère d’André Malraux. Ils ont le même père, mais Roland est un fils adultérin.
 Peu à peu, Madeleine s’aperçoit que rien n’est simple chez les Malraux. André, le grand homme, se montre même bien décevant. Il est marié à Clara, mais il a une maîtresse, Josette Clotis, qui le pousse à divorcer. Le divorce ne vient pas. Josette Clotis s’impatiente. Elle attend un enfant, qu’elle choisit de mettre au monde afin de mettre André face à ses responsabilités. Gauthier naît en 1940. André ne le reconnaît pas. Pour que l’enfant ait un père, Roland fait une fausse déclaration à l’état-civil ; Gauthier devient officiellement son fils. En 1943, Josette Clotis est à nouveau enceinte. Roland précipite son mariage avec Madeleine pour reconnaître l’enfant à venir. Vincent naît en 1943. Mais cette fois la mère refuse de renouveler le stratagème, afin qu’André comprenne la situation une fois pour toute. André ne veut rien entendre. Vincent sera ce qu’on appelait alors un bâtard, et portera le nom de Clotis. Quant à Madeleine, devenue madame Roland Malraux, elle aura de son mari un fils prénommé Alain.
Peu à peu, Madeleine s’aperçoit que rien n’est simple chez les Malraux. André, le grand homme, se montre même bien décevant. Il est marié à Clara, mais il a une maîtresse, Josette Clotis, qui le pousse à divorcer. Le divorce ne vient pas. Josette Clotis s’impatiente. Elle attend un enfant, qu’elle choisit de mettre au monde afin de mettre André face à ses responsabilités. Gauthier naît en 1940. André ne le reconnaît pas. Pour que l’enfant ait un père, Roland fait une fausse déclaration à l’état-civil ; Gauthier devient officiellement son fils. En 1943, Josette Clotis est à nouveau enceinte. Roland précipite son mariage avec Madeleine pour reconnaître l’enfant à venir. Vincent naît en 1943. Mais cette fois la mère refuse de renouveler le stratagème, afin qu’André comprenne la situation une fois pour toute. André ne veut rien entendre. Vincent sera ce qu’on appelait alors un bâtard, et portera le nom de Clotis. Quant à Madeleine, devenue madame Roland Malraux, elle aura de son mari un fils prénommé Alain.
Roland Malraux s’engage dans la Résistance. Claude, le troisième frère Malraux, fait de même, tandis qu’André, lui, ne bouge pas. Le héros de la guerre d’Espagne se réfugie dans un attentisme prudent. En mars 1944, Roland et Claude Malraux sont arrêtés par les Allemands. Suite à ce double coup dur, André entre en résistance. Bien que son engagement soit tardif, il s’impose rapidement comme un chef. Il y va au culot et joue de son prestige. Pour asseoir sa légitimité, il évoque des actes héroïques qu’il a commis dès 1940. Les faits décrits sont authentiques, à la réserve près qu’André s’attribue la paternité d’opérations dont ses deux frères cadets sont les véritables auteurs. Néanmoins, sous le nom de colonel Berger, André Malraux devient le chef incontesté de la brigade Alsace-Lorraine et combat courageusement jusqu’à la victoire de 1945.
Après la guerre, quand il devient évident que Roland Malraux ne reviendra plus, André propose à Madeleine de vivre sous son toit. André, même s’il reste officiellement marié à Clara, est esseulé depuis la mort accidentelle de Josette Clotis. Madeleine vient vivre à Boulogne dans l’hôtel particulier du grand homme. André mène maintenant la vie d’un riche rentier. Il a des domestiques, un chauffeur et une limousine. D’où lui vient sa soudaine fortune ? Nul ne le sait. Aude Terray propose une piste pour expliquer l’origine de cet argent.
Malraux est difficile à vivre
Au bout de quelques temps, Madeleine, veuve de Roland Malraux, épouse l’écrivain et devient madame André Malraux. Son nouveau mari se montre très exigeant. Il veut que son épouse soit digne de lui. Elle doit mettre en valeur son génie, elle doit briller mais sans lui faire de l’ombre. Madeleine accepte bien des sacrifices et doit s’effacer devant lui. Le lecteur comprend qu’elle a réussi à tenir parce qu’elle avait conscience de vivre à côté d’un génie.
Dans la vie quotidienne, Malraux est difficile à vivre. Il abuse du whisky, des somnifères et des amphétamines. Sa silhouette épaissit. Ses relations sont difficiles avec ses fils. Un jour de 1956, il convoque Gauthier, Vincent et Alain dans son bureau, et, selon Madeleine, leur déclare froidement : « Vous avez un âge où il ne faudra plus nous embrasser. Vous pouvez disposer. »
Madeleine partage le combat de son mari pour de Gaulle. Malraux a rencontré le général en 1945 et a été subjugué. En 1958, il rêve d’un grand ministère et doit se contenter des Affaires culturelles. C’est lui qui est à l’origine du transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin. Il y prononce son plus grand discours, resté dans la mémoire nationale : « Entre ici, Jean Moulin !... ». Mais Madeleine, qui vit dans le souvenir de Roland et de Claude, est très mal à l’aise ce jour-là. Elle trouve tout cela bien grandiloquent et hors-de-propos.
Trois auparavant est survenu un drame. En 1961, Vincent, âgé de dix-huit ans, est au volant de sa voiture de sport, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, il a pour passager son frère Gauthier, âgé de vingt ans. La voiture sort de la route et percute un arbre. Les deux garçons sont tués. Apprenant la nouvelle, Malraux ne manifeste aucune émotion. Il réagit en soldat, habitué à voir ses camarades tomber au combat. En réalité, il tait sa douleur qu’il ne sait exprimer. Peu à peu, il va devenir une épave.
Le livre d’Aude Terray nous raconte une histoire tragique et pathétique. Même s’il s’agit de la version des faits vus par Madeleine Malraux, l’ensemble paraît sincère. Il ne s’agit pas d’une hagiographie, comme ne l’était pas non plus la biographie de Claude Pompidou. Aude Terray a su garder une distance critique avec son sujet. Il est dommage que le livre n’ait pas été davantage relu, certaines phrases étant peu claires. Cependant le livre est fascinant. Le lecteur est emporté dans un tourbillon, il est mêlé à la grande histoire tout en partageant le quotidien de la famille Malraux.
Madame Malraux, d’Aude Terray (2013), éditions Perrin.
08:05 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : madame malraux, aude terray, madeleine malraux, malraux | Lien permanent | Commentaires (0)
24/02/2014
Clemenceau, de Michel Winock
Le destin extraordinaire d’un révolutionnaire patriote
Clemenceau
Le récit de Michel Winock est vivant et facile à lire. Jeune homme, Clemenceau fut emprisonné par le Second Empire ; à l’âge mûr, il fut un député d’extrême gauche tombeur de ministères ; vieillard il devint le père La Victoire. Non seulement Winock nous raconte la vie de Clemenceau, mais en plus il nous replonge dans l’histoire de la IIIème République et nous montre qu’il y avait jadis une gauche républicaine et patriote.
Georges Clemenceau est vendéen, mais un Vendéen « bleu », d’une famille républicaine. Son père est médecin, mais, vivant de ses rentes, n’a quasiment jamais exercé. Georges plaisantait là-dessus, disant « Heureusement qu’il n’a jamais eu un seul malade – il le tuait net ! » Le fils marche sur les traces du père en faisant des études de médecine. Il soutient sa thèse de doctorat en 1865 ; il dira plus tard de sa thèse « Oh ! ça n’a aucun intérêt. C’est une compilation. » Mais déjà la politique le passionne. Il s’oppose au Second Empire et à la domination de l’Eglise catholique. Etudiant, avec des camarades il prend l’engagement écrit de ne jamais recevoir de sacrement : « Pas de prêtre à la naissance ! Pas de prêtre au mariage ! Pas de prêtre à la mort ! » Fils de son siècle et du positivisme, Clemenceau restera toujours fidèle à l’athéisme de sa jeunesse.
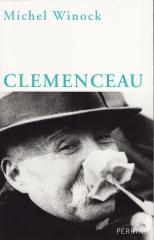 Le Second Empire l’emprisonne à Mazas et, à se libération, Clemenceau s’exile aux Etats-Unis. Il y reste de 1865 à 1869. De fait, Clemenceau sera l’un des rares hommes politiques de sa génération à parler couramment l’anglais et à avoir vu de l’intérieur le fonctionnement de la grande démocratie américaine. C’est de là probablement que vient son attachement au capitalisme ou tout au moins son opposition au collectivisme naissant.
Le Second Empire l’emprisonne à Mazas et, à se libération, Clemenceau s’exile aux Etats-Unis. Il y reste de 1865 à 1869. De fait, Clemenceau sera l’un des rares hommes politiques de sa génération à parler couramment l’anglais et à avoir vu de l’intérieur le fonctionnement de la grande démocratie américaine. C’est de là probablement que vient son attachement au capitalisme ou tout au moins son opposition au collectivisme naissant.
En 1870, il est élu maire de Montmartre. Tout en comprenant le peuple de Paris, partisan de la poursuite de la guerre contre les Prussiens, il s’oppose à la Commune et à ses excès. Il ne fuit pas le danger et prend des risques. Il va à la rencontre de la populace pour tenter de sauver deux généraux versaillais qu’elle a capturés. Clemenceau arrive trop tard et manque lui-même de se faire tuer par la foule en délire. Il ne perd pas son sang-froid et s’explique avec les meneurs. Il sauve sa peau de justesse. Grande leçon donnée par Clemenceau : l’homme politique ne doit pas fuir le danger, mais l’affronter.
Gambetta, Hugo et Clemenceau, contre la paix avec l’Allemagne
En 1871, Clemenceau est élu député. Avec Gambetta et d’autres, il s’oppose à l’armistice et à la cession de l’Alsace et de la Lorraine à l’Allemagne. On l’a oublié aujourd’hui, mais à l’époque le patriotisme est une valeur de gauche. Ainsi un illustre député républicain, Victor Hugo, se prononce pour la poursuite de la guerre, parce que la France ne peut décemment accepter la perte de l’Alsace-Lorraine. Mais la majorité monarchiste de l’assemblée vote la paix au prix des cessions territoriales.
Battu aux élections suivantes, Clemenceau fait son retour à la chambre en 1876. Il est député radical, c'est-à-dire qu’il est partisan de réformes radicales destinées à établir rapidement les fondements de la République ; autrement dit, il siège à l’extrême gauche. Il s’oppose à Gambetta et à Jules Ferry, chefs de file des « opportunistes », qui privilégient une politique de petits pas afin de ne pas effrayer la bourgeoisie et de la rallier au nouveau régime. Clemenceau, lui, trouve que les choses ne vont pas assez vite et, tout en restant opposé au collectivisme, il déplore l’absence de grande réforme sociale.
Dans les années 1880, Clemenceau se dresse contre la politique coloniale de Ferry. Le président du Conseil des ministres lance la France dans la conquête d’un empire, considérant qu’il en va de la grandeur du pays. Clemenceau s’y oppose au nom des droits de l’homme… et parce que la politique coloniale va détourner la France de ce qui doit être son objectif principal : le reconquête des provinces perdues. Le mérite de Michel Winock est de nous replonger dans le débat de l’époque, sans anachronisme. Si aujourd’hui nous avons tendance à donner raison à Clemenceau, Ferry faisait valoir, lui aussi, de solides arguments que Winock nous expose
Clemenceau provoque la chute de Ferry et gagne sa réputation de tombeur de ministères. Il a le verbe haut et, contrairement à l’usage qui veut qu’un orateur reste imperturbable, il n’hésite pas, lui, à répondre du tac-au-tac aux parlementaires qui interrompent ses prises de parole. Il se bat aussi en duel quand il le faut, car un homme politique doit risquer sa vie pour laver son honneur. Ces duels au pistolet finissent en général bien, par une légère blessure au pire, mais un drame reste possible.
Clemenceau éclaboussé par « Panama »
Clemenceau, tombeur de ministère, est aussi un manipulateur. Quand le général Boulanger, ardent patriote, commence à faire parler de lui, Clemenceau le soutient par derrière. Boulanger présente l’avantage, rare à l’époque, d’être un général républicain. Nommé ministre de la Guerre, il n’hésite pas à épurer les cadres de l’armée et à en rayer les princes des maisons de France. Sans être boulangiste lui-même, Clemenceau utilise Boulanger contre ses adversaires. Mais dès qu’il comprend que le général mène une aventure personnelle au parfum d’antiparlementarisme, Clemenceau s’en détache et le combat.
Clemenceau se tire sans heurt de l’aventure Boulanger et poursuit sa carrière politique. C’est le scandale de Panama qui le mettra à terre. La classe politique est éclaboussée. De nombreux élus, appelés les chéquards, ont été arrosés par un escroc, Cornélius Herz. Clemenceau n’a pas touché un centime. Mais il croyait pouvoir tirer les ficelles de cette affaire. Or il apparaît qu’il a compté Herz parmi ses proches et que l’escroc a aidé son journal La Justice. Clemenceau semble coupable d’avoir été bien imprudent. Malgré sa harangue célèbre aux électeurs du Var (« Où sont les millions ? »), il est battu aux élections de 93. C’en est fini de Clemenceau.
Il se retire de la vie politique et se consacre exclusivement au journalisme. C’est par l’affaire Dreyfus qu’il revient dans le jeu. Comme Jean Jaurès, dans un premier temps il croit Dreyfus coupable et, bien qu’opposé à la peine capitale, il s’étonne de la clémence du conseil de guerre qui a renoncé à condamner à mort un homme reconnu coupable du crime de haute trahison. Mais dès que Clemenceau prend connaissance du caractère irrégulier du procès, il se prononce tout de suite pour la révision. Il précise qu’il ne sait pas si Dreyfus est coupable ou innocent, et réclame simplement l’application stricte du droit. Une fois convaincu de l’innocence du capitaine, Clemenceau se bat pour qu’elle soit établie. C’est lui, en tant que directeur de L’Aurore, qui publie le lettre ouverte d’Emile Zola au président de la République, et c’est lui qui place en une le titre « J’accuse ! »
Clemenceau fait son retour dans l’arène politique en 1902, en tant que sénateur. Lorsqu’Aristide Briand présente aux parlementaires la proposition de loi portant sur la séparation des Eglises et de l’Etat, Clemenceau, qui réclamait depuis longtemps la séparation, trouve le texte trop favorable aux catholiques, mais finit par le voter. Attention cependant, l’athée Clemenceau, qui combat le pouvoir de l’Eglise catholique, n’est pas forcément là où on l’attend. S’il est un ardent partisan de la laïcité, de l’expulsion des congrégations, il se prononce aussi pour la liberté d’enseignement. Sa prise de position en faveur de la séparation le rend impopulaire à droite, tandis que son soutien à la coexistence de l’école catholique et de l’école publique mécontente la gauche.
A 65 ans, Clemenceau devient ministre pour la première fois
La forte personnalité de Clemenceau, son caractère imprévisible le maintenait à l’extérieur des gouvernements. C’est seulement en 1906, à l’âge de 65 ans, qu’il devient ministre pour la première fois. Il prend l’Intérieur et devient, comme il aime à le dire, le premier des flics de France. A ce titre, il modernise l’institution et fonde les brigades mobiles, rebaptisées plus tard par la télévision « les brigades du Tigre ». Lui, l’anticlérical, suspend les inventaires dans les églises, qui provoquaient des manifestations de colère de catholiques, déclarant : « Nous trouvons que la question de savoir si l’on comptera ou ne comptera pas les chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. » Bientôt il cumule le portefeuille de l’Intérieur avec la présidence du Conseil des ministres. Et lui, Clemenceau, le radical, le social, le républicain d’extrême gauche, se heurte aux grandes manifestations ouvrières et paysannes de 1906-1907. Or, s’il est un homme de dialogue, Clemenceau est avant tout un homme d’ordre qui entend défendre, par la force s’il le faut, le droit des non-grévistes de travailler alors que leurs camarades grévistes les empêchent de rejoindre leur poste de travail.
Le ministère Clemenceau tombe en 1909, sans qu’il ait fait voter une seule loi sociale. La loi sur le repos hebdomadaire avait été votée juste avant, et la création de l’impôt sur le revenu est rejetée par le Sénat. Clemenceau, redevenu sénateur, ne peut empêcher l’élection à la présidence de la République de son vieil ennemi, Raymond Poincaré. Il s’inquiète de la menace allemande et déplore le manque de préparation de la France. Il se déclare pour le service militaire de trois ans. En cela, il s’oppose à Jean Jaurès, il le juge naïf de croire que l’internationalisme va désarmer les nationalismes.
De 1914 à 1917, Clemenceau se livre à une guerre de mots, dénonçant dans son journal et au Sénat la faillite des gouvernements successifs dans leurs tentatives de gagner la guerre. Il faut attendre que la situation soit sans issue pour qu’en 1917 Poincaré se décide à faire appel à Clemenceau dans l’espoir de restaurer la situation. Même certains de ses ennemis de droite, comme Léon Daudet, estiment que lui seul, par sa volonté, est en mesure de sauver ce qui peut l’être. Clemenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre, mobilise les énergies, il se rend sur le front, marche dans la boue des tranchées, et n’hésite pas à prendre des risques en s’avançant à la portée des unités allemandes. Clemenceau est un patriote héritier des révolutionnaires de 1793, partisan de la nation en armes.
Le 11 novembre 1918, Clemenceau pleure
En février 1918, l’Allemagne conclut la paix de Brest-Litovsk avec la Russie et peut ainsi masser toutes ses troupes sur le front occidental. Les Alliés ont de quoi être inquiets : si le front est percé, l’Allemagne emportera la victoire définitive. Clemenceau, comme Poincaré, est effaré du pessimisme du général Pétain, qui n’est plus, selon eux, l’homme de la situation. Il lui préfère Foch pour prendre le commandement suprême des forces alliées. Bien que Winock ne soit pas très explicite, on comprend que Clemenceau admire en Foch son optimisme à toute épreuve et son inclination pour une stratégie offensive. Lorsque, le 11 novembre 1918, Clemenceau apprend la signature de l’armistice, il verse des larmes et découvre l’immense popularité dont il jouit, y compris dans les milieux catholiques. Lui, l’élu d’extrême gauche, le tombeur de ministères, est devenu « le Père la Victoire ». Plus tard, il recevra un hommage inattendu, et peut-être exagéré, de la part Kronprinz ; le prince héritier de la couronne allemande écrira dans ses mémoires : « La cause principale de la défaite allemande ? Clemenceau. Oui, Clemenceau fut le principal artisan de notre défaite […] Si nous avions eu un Clemenceau, nous n’aurions pas perdu la guerre. »
Pour récompenser les Poilus de leur sacrifice et en dépit de la situation économique et financière, Clemenceau fait voter une vieille revendication ouvrière : la journée de huit heures. Puis il consacre ses efforts à la diplomatie. Winock parle de la paix difficile de Versailles et montre que certains ont reproché à Clemenceau d’être trop dur avec l’Allemagne, tandis que d’autres lui ont reproché d’être trop conciliant. Ce sera d’ailleurs l’origine de sa brouille définitive avec Foch, qui critiquera son manque de fermeté supposé pour que la France garde le contrôle de la rive gauche du Rhin. Pourtant Clemenceau reste lucide sur le retour de la menace allemande. Dans son dernier livre, il met en garde les Français contre le retour de « l’empire germanique ». Cet écrit posthume sera publié en 1930, un an après sa mort.
Winock accompagne sa biographie d’une introduction et d’une conclusion dans laquelle il affiche son ambition : fournir des repères aux Français du XXIème siècle et leur montrer qu’avant la gauche actuelle il existait une autre gauche républicaine et patriote. En cela, Winock est convaincant. Cependant l’ouvrage aurait gagné à une relecture plus attentive : quelques phrases sont mal tournées. Le chapitre intitulé « Clemenceau écrivain » est un peu long. Il manque aussi quelques faits marquants, comme la célèbre réponse de Clemenceau à une interpellation au Parlement, en 1918 (« Politique intérieure ? Je fais la guerre ! Politique extérieure ? Je fais la guerre ! Je fais toujours la guerre ! »). Néanmoins les qualités du livre l’emportent largement sur ces défauts mineurs. Le récit de Winock est très vivant. Au-delà d’une leçon politique, l’auteur nous offre en Clemenceau un modèle de combativité : jamais il ne renonce.
Clemenceau, de Michel Winock (2007), éditions Perrin et collection Tempus.
09:05 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : clemenceau, michel winock | Lien permanent | Commentaires (1)


