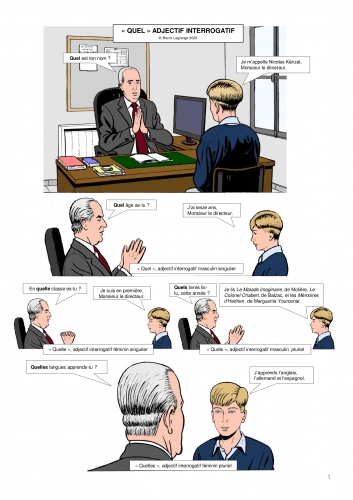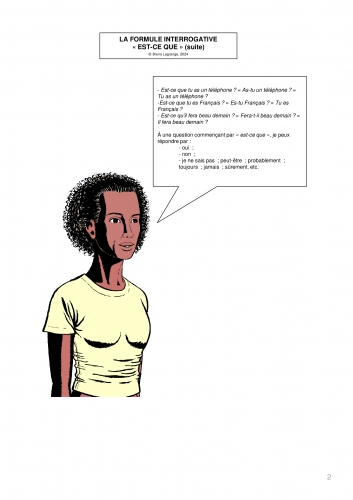01/10/2025
"Quel" adjectif interrogatif
10:25 | Tags : quel, adjectif interrogatif, grammaire, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)
21/08/2025
Comment adverbe interrogatif
09:33 | Tags : comment, adverbe interrogatif, grammaire, grammar, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)
18/07/2025
La formule interrogative "est-ce que"
08:13 | Tags : est-ce que, questions, interrogations, grammaire, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)