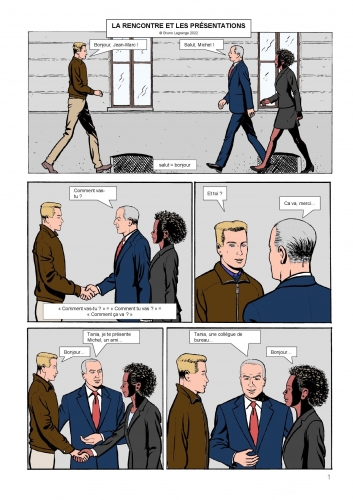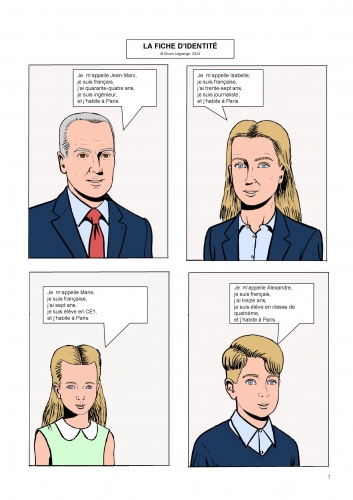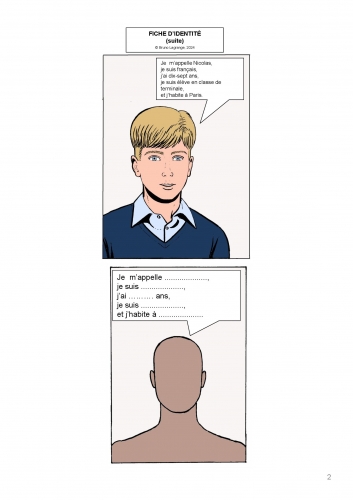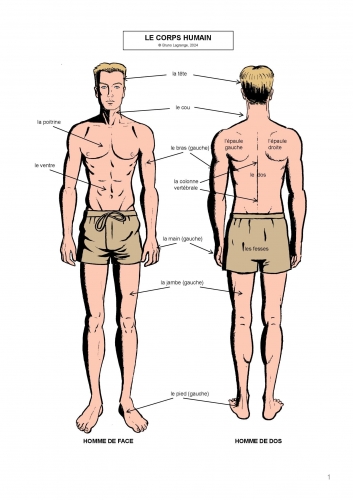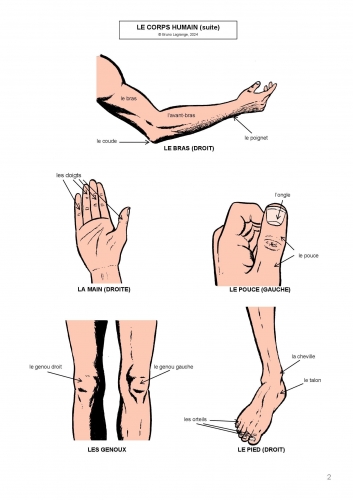21/01/2025
La rencontre et la présentation
08:45 | Tags : rencontre, présentation, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)
07/01/2025
La fiche d'identité
07:51 | Tags : fiche d'identité, vocabulaire, vocabulary, français, french, comic strip, bande dessinée | Lien permanent | Commentaires (0)
13/12/2024
Le corps humain (couleurs)
08:40 | Tags : corps humain, anatomie, vocabulaire, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (1)