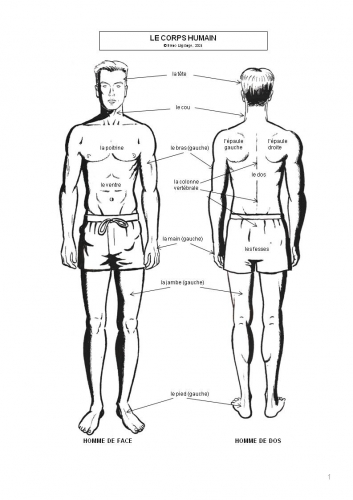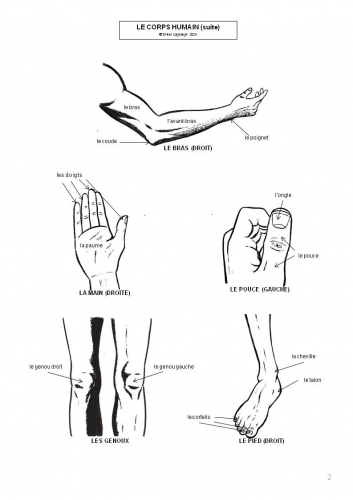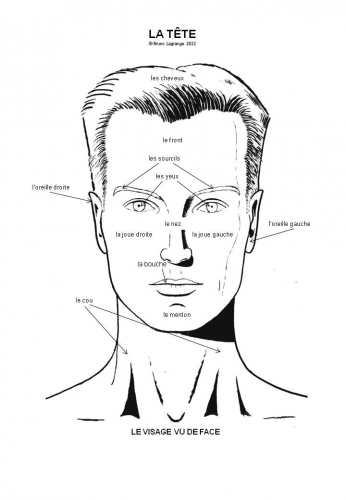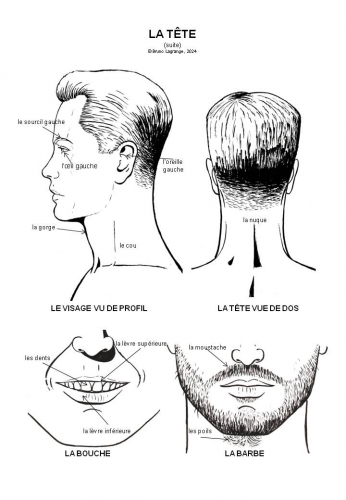26/08/2024
Le français par la bande dessinée : couverture et page de garde (couleurs)
09:43 | Lien permanent | Commentaires (0)
15/07/2024
Le corps humain
11:15 | Lien permanent | Commentaires (0)
24/06/2024
La tête (visage et nuque)
10:11 | Lien permanent | Commentaires (0)