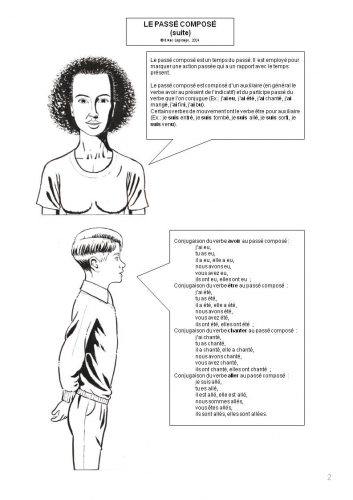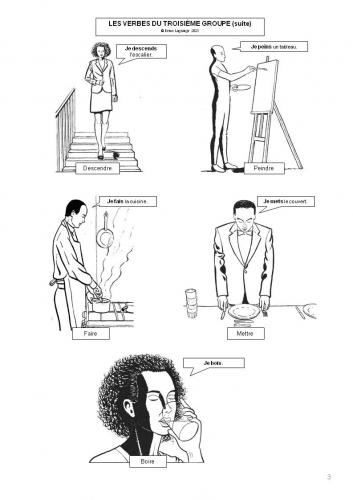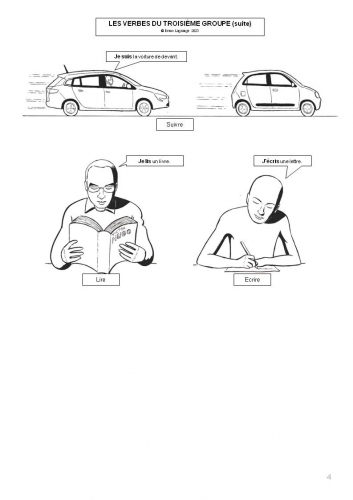10/06/2024
La négation (ne pas)
10:45 | Tags : ation, ne pas, french, comic strip, français, bande dessinée | Lien permanent | Commentaires (0)
27/05/2024
Le passé composé (et le futur proche)
11:10 | Tags : passé composé, futur proche, verbes, conjugaison, verbs, french, comic strip, français, bande dessinée | Lien permanent | Commentaires (1)
13/05/2024
Les verbes du troisième groupe
09:27 | Tags : troisième groupe, verbes, français, bande dessinée, french, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)