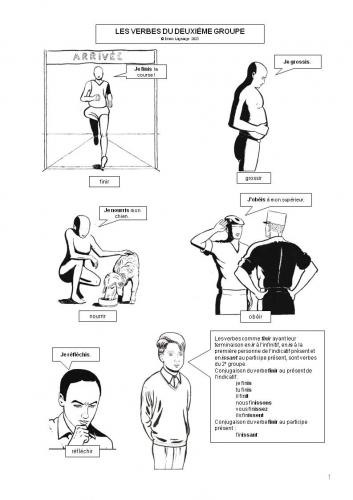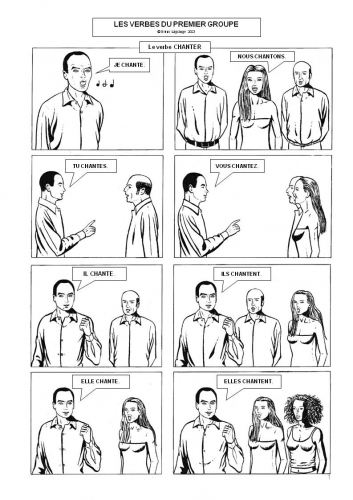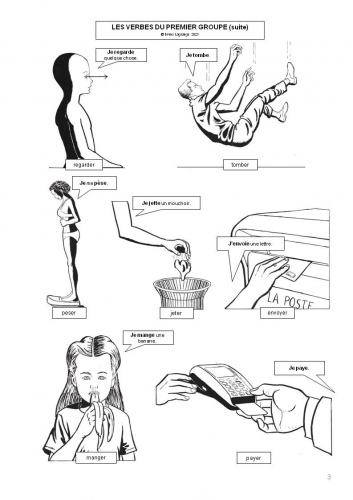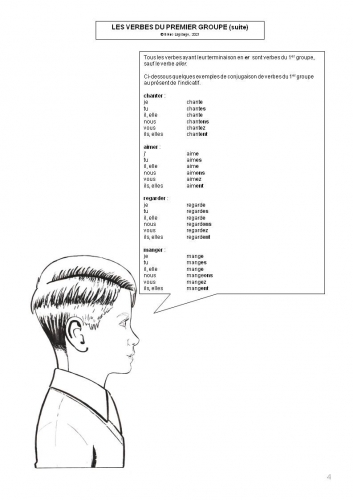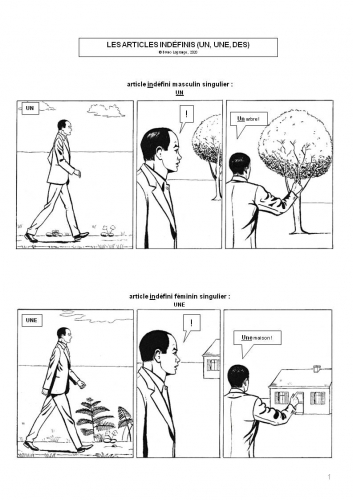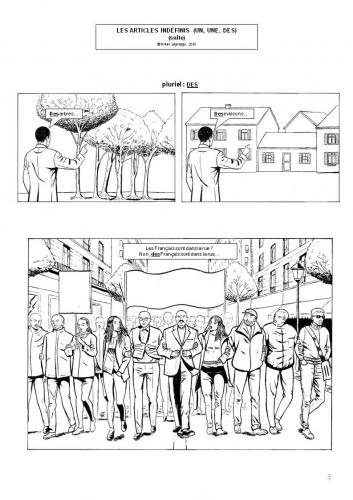29/04/2024
Les verbes du deuxième groupe
10:39 | Tags : deuxième groupe, verbes, français, bande dessinée, french, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)
08/04/2024
Les verbes du premier groupe
08:28 | Tags : premier groupe, verbes, français, bande dessinée, comic strip, french | Lien permanent | Commentaires (0)
25/03/2024
Les articles indéfinis (un, une, des)
11:39 | Tags : articles indéfinis, grammaire, français, bande dessinée, french, comic strip, grammar | Lien permanent | Commentaires (0)