05/12/2016
VGE, une vie, de Georges Valance
Biographie comblant une lacune
VGE
Une vie
C’est l’une des rares biographies du plus jeune président de la Ve République. Georges Valance fait le portrait d’un chef d’Etat réformateur. Giscard voulut adapter la loi aux mœurs et fit passer des mesures qui étaient le fruit de sa réflexion personnelle. Bien qu’expert en matière monétaire, il peina à comprendre la nature et l’ampleur de la crise économique, mais il fit preuve de rigueur dans la gestion des comptes publics.
« Giscard n’a pas la place qu’il mérite dans l’histoire contemporaine de notre pays », déplore Georges Valance dans l’avant-propos du livre qu’il lui consacre. Il est vrai que pléthore de biographies ont été consacrées à de Gaulle et Mitterrand, mais quasiment aucune n’avait été écrite sur Giscard. Pourtant son septennat et l’ensemble de son parcours méritent d’être racontés. Le livre de Georges Valance comble d’autant mieux cette lacune qu’il ne s’agit pas d’une hagiographie, l’auteur n’hésitant pas à critiquer son personnage et à souligner ses petitesses et ses insuffisances. Le sous-titre de l’ouvrage, Une vie, renvoie au célèbre roman de Maupassant, l’écrivain préféré de Giscard.
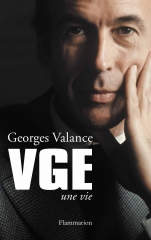 Par le passé, on a abondamment glosé sur les origines faussement aristocratiques de Giscard. Valance ne fait pas l’impasse là-dessus et retrace l’historique des démarches administratives effectuées par Edmond Giscard, père de Valéry, pour relever le nom de famille d’Estaing. Si les prétentions nobiliaires de VGE sont notoires, ce qui est moins connu, en revanche, c’est sa participation à la Seconde Guerre mondiale.
Par le passé, on a abondamment glosé sur les origines faussement aristocratiques de Giscard. Valance ne fait pas l’impasse là-dessus et retrace l’historique des démarches administratives effectuées par Edmond Giscard, père de Valéry, pour relever le nom de famille d’Estaing. Si les prétentions nobiliaires de VGE sont notoires, ce qui est moins connu, en revanche, c’est sa participation à la Seconde Guerre mondiale.
En octobre 1944, alors âgé de dix-huit ans, il rejoignit la Ière armée commandée par le général de Lattre de Tassigny ; il se battit courageusement en Allemagne, obtint une citation à l’ordre de l’armée et se vit décerner la croix de Guerre. Valance analyse cet engagement comme l’« acte fondateur de son destin politique. Sans cet engagement, poursuit-il, ce grand bourgeois issu d’une famille aux relents vichyssois ne serait jamais sans doute devenu président de la République. »
En tant qu’ancien combattant, Giscard bénéficia du droit de passer le concours d’entrée à l’école Polytechnique dans le cadre d’une « session spéciale », et fut brillamment reçu. Puis, quelques années plus tard, en vertu d’une loi nouvelle le dispensant de l’épreuve du concours, il obtint d’intégrer la toute nouvelle Ecole nationale d’administration, l’Ena. Les relations que sa famille entretenait avec de hautes personnalités donnèrent un coup de fouet à sa carrière.
« Ce n’était pas le bon M. Pinay qui travaillait le plus.
Giscard d’Estaing faisait tout le boulot derrière lui. »
En 1959, à l’avènement de la Ve République, il fut nommé, à seulement trente-deux ans, secrétaire d’Etat aux Finances. Il faut reconnaître que le jeune homme est brillant et actif. Il fait souvent le travail du ministre en titre, Antoine Pinay, trop content de se décharger sur lui pour aller, par exemple, défendre le budget devant les députés. De Gaulle ne s’y trompe pas, il apprécie son jeune secrétaire d’Etat qui, très habilement, lui explique en quoi les finances sont, pour la défense nationale, aussi importantes que les armées. De Gaulle déclara : « En réalité, ce n’était pas le bon M. Pinay qui travaillait le plus, mais son secrétaire d’Etat, VGE […]. Giscard d’Estaing faisait tout le boulot derrière lui. »
En janvier 1966, Giscard était ministre des Finances quand il fut brusquement remercié de la Rue de Rivoli. Ayant le sentiment d’avoir été congédié comme un domestique, il n’hésita plus à critiquer de Gaulle en public ; il y eut le fameux « oui mais », puis la dénonciation de l’ « exercice solitaire du pouvoir » et enfin le « non » au Général à l’occasion du référendum de 1969.
A l’été 1968, François Mauriac se montre prophétique quand il voit en Giscard le « plus jeune président de la République qu’il sera, s’il plaît à Dieu et s’il n’y a pas d’accident de parcours. »
Rallié à Pompidou à l’élection présidentielle de 1969, Giscard retrouva ses chères Finances et devint un serviteur loyal du nouveau chef de l’Etat. La France vivait encore dans la prospérité des Trente Glorieuses. Mais une époque se termina quand en 1971 les Etats-Unis dénoncèrent les accords de Bretton-Woods et firent flotter le dollar. Ce fut le début de l’instabilité monétaire qui allait conduire au premier choc pétrolier et à la crise économique. A priori Giscard est très à l’aise pour traiter ces questions, car, selon Valance, il a une « expertise incontestée des questions monétaires […] qui se révèlera des plus précieuses ».
L’élection de Giscard en 1974
fut l’une des plus spectaculaires victoires de l’histoire politique
En 1974, à la mort de Pompidou, Giscard est l’outsider de la campagne présidentielle qui s’ouvre et qui s’annonce très courte. Les sondages le place loin derrière Mitterrand et Chaban-Delmas. Mais, pendant les trois semaines que dure cette campagne, Giscard rattrape son retard, et finalement c’est lui qui gagne l’élection. Georges Valance, dithyrambique, parle de « brillante victoire électorale », « une des plus spectaculaires » de l’histoire politique, qui plus est emportée après une campagne menée avec « une certaine dose d’improvisation ». Mais Valance ajoute aussitôt au sujet du vainqueur : « Peut-être d’ailleurs en tirera-t-il une confiance excessive en soi, ce qui sera pour une part à l’origine de la défaite de 1981. »
Une fois à l’Elysée, Giscard, jeune président de quarante-huit ans, se donna pour mission d’adapter la législation à l’évolution des mœurs. Il fit voter un train de réformes qu’on qualifierait aujourd’hui de sociétales. Ainsi la première décision adoptée en conseil des ministres fut l’abaissement de l’âge de la majorité de vingt-et-un ans à dix-huit ans. Suivirent de très nombreuses autres mesures : légalisation de l’avortement ; instauration du divorce par consentement mutuel ; première loi en faveurs des handicapés ; mise en place de la retraite à soixante ans pour les métiers pénibles... Valance insiste sur le fait que le nouveau président est sincère dans sa volonté de changement : « Giscard conceptualise lui-même ses réformes, alors que la plupart des hommes politiques dits réformateurs ne font que mettre en œuvre des idées soufflées par leurs conseillers ou des experts. » Pour étayer son propos, Valance cite Yves Cannac, ancien collaborateur du président : « Les réformes venaient vraiment de lui. Il attendait de ses collaborateurs des conseils pratiques sur des textes et leur mise en œuvre. Pas des idées. »
Mais très vite, le jeune président réformateur est rattrapé par la crise économique consécutive au choc pétrolier de 1973. Et, comme beaucoup de ses contemporains, il peine à comprendre ce qui se passe, et met du temps à percevoir la nature et la portée de la crise. Alors que les prix s’envolent (plus de 15% d’inflation en 1974), Giscard demande à son ministre des Finances, Jean-Pierre Fourcade, de mettre au point un « plan de "refroidissement de l’inflation" ». « Mais, écrit Georges Valance, dans sa logique de frigidaire, il réussit à la fois trop bien et trop mal, car il refroidit en fin de compte davantage la croissance que l’inflation. » Et, sur ce point, Valance conclut : « Le plan Fourcade a bel et bien cassé la croissance. »
Le président fait alors un virage à 180° degrés et met en place un plan de relance, ainsi que le réclame son bouillonnant premier ministre, Jacques Chirac. C’est à nouveau l’échec.
Jamais Giscard ne lâcha Barre
Giscard change à nouveau son fusil d’épaule. Il fait appel à Raymond Barre qu’il proclame « meilleur économiste français, en tout cas un des tous premiers ». En août 1976, Barre est nommé premier ministre et le demeurera jusqu’à l’élection présidentielle de 1981. Pour Giscard, il est le « Joffre de l’économie », chargé d’arrêter l’inflation comme Joffre arrêta les Allemands sur la Marne. Barre impose à la fois le blocage des prix et des tarifs, ainsi qu’une cure d’austérité. Le cap est définitivement fixé et Giscard ne changera plus de route. « Malgré les critiques, précise Valance, jamais Barre ne calera et jamais Giscard ne le lâchera. »
Le pouvoir trouva un nouveau souffle avec une victoire inattendue aux élections législatives de 1978. L’année suivante, Giscard enregistra un nouveau succès : les élections européennes furent marquées par le triomphe de l’UDF, parti du président, et par le piètre score du RPR et de Jacques Chirac, devenu son opposant. Cependant, il s’agit, selon Valance de « victoires à la Pyrrhus » dont Giscard n’arriva pas à tirer parti. L’affaire des Diamants, révélée par Le Canard enchaîné et reprise en une du Monde, ternit la réputation du président, qui ne sut pas répondre aux attaques. Le second choc pétrolier, en 1979, cassa la reprise de la croissance et aggrava la crise. Et la rébellion de Chirac et de son RPR compliqua la donne. L’impopularité de Giscard (à relativiser) s’accrut d’autant plus qu’il refusa toute mesure à caractère électoraliste, malgré l’approche de l’élection de 1981. Valance voit dans son refus d’un virage électoraliste une « décision courageuse et risquée ». Dans ces conditions, la défaite de Giscard en 1981 n’apparaît pas, avec le recul, comme une surprise. Valance fait une comparaison : « En 1974, Giscard avait emmené ses troupes au galop. En 1981, Murat est devenu Gamelin, menant une "drôle de guerre" au grand désappointement de ses lieutenants. »
Après avoir évoqué le narcissisme du personnage et son intelligence si analytique qu’elle ne lui a pas permis de comprendre un caractère comme celui de Chirac, Georges Valance rend hommage à Giscard, notamment pour sa gestion des comptes publics : « Sa gestion budgétaire a toujours été rigoureuse, et si les deux chocs pétroliers conduisirent le pays à s’endetter pour faire face à la ponction étrangère, ce fut toujours dans les limites du supportable. » Valance poursuit en constatant la pérennité de ses réformes : « Quant aux réformes intérieures, il n’est pas de plus bel hommage que de remarquer qu’elles ont subi sans dommage l’épreuve du temps, alors que celles de son successeur François Mitterrand ont été rabiotées (parfois par les socialistes eux-mêmes) ou corrigées. »
A lire Georges Valance, on peut avoir l’impression que, selon lui, la France se serait mieux portée si Giscard avait été à l’Elysée de 1981 à 1988.
VGE, Une vie, de Georges Valance, 2011, éditions Flammarion.
08:49 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : vge, giscard, georges valance | Lien permanent | Commentaires (0)
20/04/2015
Thiers, bourgeois et révolutionnaire, de Georges Valance
Fossoyeur de la Commune ou artisan de la république ?
Thiers
bourgeois et révolutionnaire
Adolphe Thiers a eu une carrière politique d’une longévité exceptionnelle. Deux fois président du Conseil sous le règne de Louis-Philippe, il revient au pouvoir en 1871 et négocie la paix avec Bismarck. Georges Valance dresse le portrait d’un homme peu sympathique, mais qui ne fut pas le tyran sanguinaire que l’on pourrait croire.
De nos jours, Adolphe Thiers a mauvaise presse, notamment auprès de ceux qui voient en lui le fossoyeur de la Commune. Déjà en 1848, il avait acquis une mauvaise réputation auprès du peuple, qu’il avait qualifié, avec mépris, de « vile multitude », expression qui l’a poursuivi de son vivant et au-delà. Pourtant, si on les examine de près, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Si vraiment Thiers avait été le fusilleur du peuple, comment expliquer que, selon Jules Ferry, un million de Parisiens suivirent ses obsèques à travers les rues de Paris ? Et comment expliquer que plus de cent villes de France s’empressèrent de baptiser de son nom une place ou une avenue ?
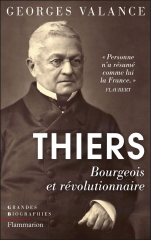 Dans sa biographie de Thiers, Georges Valance essaye de faire la part des choses. Il dresse le portrait d’un homme assez peu sympathique, mais qui ne mérite pas l’opprobre. Thiers s’est trompé dans un certain nombre de cas, mais dans d’autres il a eu raison avant tout le monde. Sa longévité politique fut exceptionnelle : il fut président du Conseil des ministres en 1836, à nouveau en 1840, et redevint chef de l’exécutif trente ans plus tard, en 1871. En près de cinquante ans d’engagement politique, il eut le temps de se faire de nombreux ennemis.
Dans sa biographie de Thiers, Georges Valance essaye de faire la part des choses. Il dresse le portrait d’un homme assez peu sympathique, mais qui ne mérite pas l’opprobre. Thiers s’est trompé dans un certain nombre de cas, mais dans d’autres il a eu raison avant tout le monde. Sa longévité politique fut exceptionnelle : il fut président du Conseil des ministres en 1836, à nouveau en 1840, et redevint chef de l’exécutif trente ans plus tard, en 1871. En près de cinquante ans d’engagement politique, il eut le temps de se faire de nombreux ennemis.
« Monsieur Thiers a toujours voulu la même chose. Il n’a jamais eu qu’une seule pensée, un seul système, un seul but ; tous ses efforts y ont constamment tenu ; il a toujours songé à Monsieur Thiers. » Ces mots de Balzac sont durs, mais ils sonnent juste. A la lecture du livre de Valance, on comprend que Thiers avait une revanche à prendre sur la vie. Il est moqué pour sa petite taille, un mètre cinquante-cinq, et Louis-Philippe l’appelle familièrement « mon petit président. » Il est né hors-mariage, c’est-à-dire bâtard, selon le terme de l’époque, et il en souffre. Après sa jeunesse passée à Marseille, il monte à Paris, bien décidé à faire carrière. D’après Valance, qui s’appuie sur les travaux de Félicien Marceau, Thiers a en partie inspiré à Balzac le personnage de Rastignac, ce jeune provincial qui veut se faire un nom dans la capitale. Thiers et Rastignac partagent la même ambition et tous deux épousent la fille de leur maîtresse. La belle-mère de Thiers, madame Dosne, restera, jusqu’à sa mort, auprès de son gendre et sera son plus fidèle soutien. Si Balzac est sévère sur Thiers, Chateaubriand en fait un portrait plus nuancé. Cependant il reste sur ses gardes et note, avec prémonition si l’on songe à la Commune qui éclatera trente ans plus tard, que le caractère de Thiers « ne l’empêcherait pas de nous faire étrangler le cas échéant. »
Hugo se moque des prétentions littéraires de Thiers
Thiers se fait connaître en publiant Histoire de la Révolution, puis Histoire du Consulat et de l’Empire. Le tout fait plusieurs dizaines de tomes et devient un succès de librairie. Le travail de Thiers ne fait cependant pas l’unanimité. Dans ses carnets, Victor Hugo se moque des prétentions littéraires de Thiers et considère qu’il écrit en « style de journal », c’est-à-dire mal.
En 1830, quand les Trois Glorieuses se produisent, Thiers se situe à la gauche de l’échiquier politique. Il est journaliste, il se bat pour la liberté de la presse et contribue à la chute de Charles X et des Bourbons. Il se rallie au nouveau roi, Louis-Philippe, et entre au gouvernement. Une fois au pouvoir, il oublie ses idées de jeunesse. Suite à un attentat contre le roi, Thiers, ministre de l’Intérieur, s’appuie sur l’émotion populaire pour faire voter une législation nouvelle. Ce sont les fameuses « lois scélérates »,qui réduisent la liberté de la presse. En agissant ainsi, il brûle ce qu’il a adoré, et se brouille avec certains de ses amis.
Quand, en 1848, l’insurrection éclate à Paris, Thiers y va de ses conseils auprès du roi. Ancien ministre de l’Intérieur, il a déjà acquis une certaine expérience en matière de répression ; c’est lui qui, en 1834, a mis fin à la révolte des Canuts. En ce mois de février 1848, il propose à Louis-Philippe de quitter Paris et « de se retirer à Saint-Cloud où l’on appellerait des forces suffisantes pour prendre l’offensive. », mais le roi des Français préfère abdiquer.
Revenu à la gauche de l’échiquier politique, Thiers apporte son soutien à Louis-Napoléon Bonaparte de retour d’exil. Le prince donne l’impression d’être un personnage falot et sans grand caractère, que l’on peut facilement manœuvrer. En réalité, Louis-Napoléon Bonaparte cache bien son jeu. Elu président, il entend bien garder le pouvoir et déclenche un coup d’Etat le 2 décembre 1851.
Opposant à l’Empire, Thiers prononce un discours mémorable en 1867. Tel un Cassandre, il dénonce la politique des nationalités chère à Napoléon III, et prédit les pires catastrophes. Thiers dit craindre la perte prochaine de l’Alsace et s’exclame : « Cette héroïque Alsace […], faudra-t-il lui dire : “Vous parlez allemand, donc il faut vous séparer !” » Trois ans plus tard, en juillet 1870, alors que la France vient de déclarer la guerre à la Prusse, Thiers est hué à la Chambre, parce qu’il déclare que le pays va vers de grands malheurs.
Face à la Commune, Thiers met en pratique les conseils
que Louis-Philippe avait refusé de suivre en 1848
Quelques semaines plus tard, c’est la débâcle. Thiers, l’homme qui avait averti du désastre, est rappelé aux affaires pour négocier la paix avec Bismarck. Il est contraint de céder l’Alsace et la Moselle, mais sauve Belfort qui n’a jamais parlé allemand et qui a résisté héroïquement. Belfort restera français, mais, en échange, Thiers consent à ce que les troupes prussiennes entrent dans Paris pour y défiler. Quand les Parisiens apprennent la nouvelle, ils se sentent trahis et se révoltent. C’est donc bien une réaction patriotique qui est à l’origine de la Commune.
Face à l’insurrection, Thiers met en pratique les conseils qu’il avait donnés à Louis Philippe en 1848. Il quitte Paris et transporte l’Assemblée à Versailles. Il se montre patient et rassemble le maximum de troupes. Quand il estime la situation mûre, il fait entrer l’armée dans Paris et la laisse mener des opérations de représailles. Mais le désordre était devenu tel, que la population éprouve un sentiment de soulagement. Flaubert ne trouve aucune excuse à la Commune, et Jules Ferry, républicain s’il en est, n’est pas scandalisé de la répression.
La Commune écrasée, Thiers est conforté dans son pouvoir et reçoit le titre de président de la République. Mais il n’en a pas fini avec la tâche de terminer la guerre, qui lui incombe. Il doit régler l’indemnité imposée par l’Allemagne, que Bismarck a fixée à six milliards de francs. C’est une somme énorme pour l’époque. L’objectif du chancelier allemand est clair : il veut ruiner la France pour l’empêcher de se relever. Thiers et son gouvernement font preuve d’imagination pour trouver des recettes exceptionnelles. Ils lancent un emprunt qui rencontre un succès inattendu, jusqu’en Amérique. A la surprise générale, les six milliards de francs sont vite réunis et, l’indemnité réglée, les troupes prussiennes évacuent le territoire national.
Le « sale boulot » accompli, les monarchistes, qui sont majoritaires à l’Assemblée, entendent se débarrasser de Thiers. Décidés à lui faire payer son ralliement à la république, ils provoquent sa chute. En 1877, le député Thiers reçoit un hommage solennel à l’Assemblée, quand Gambetta, du haut de la tribune, le désigne de la main et proclame : « Le libérateur du territoire, le voilà ! » La même année, Thiers, âgé de quatre-vingt ans, repart en campagne électorale à côté de Gambetta, quand il meurt subitement.
Thiers, bourgeois et révolutionnaire, de Georges Valance, 2007, Flammarion.
07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : thiers, bourgeois et révolutionnaire, georges valance | Lien permanent | Commentaires (0)


