16/10/2017
Thérèse Raquin, de Zola
Livre-vaccin contre le crime
Thérèse Raquin
C’est l’histoire de deux amants qui accomplissent le crime parfait. Un garçon nommé Laurent supprime Camille Raquin, le mari de Thérèse sa maîtresse. Dans ce roman, Laurent et Thérèse ne tuent pas par plaisir, mais par nécessité. Ensuite il leur faudra vivre avec les séquelles de leur crime impuni.
Avant le cycle des Rougon-Macquart il y eut Thérèse Raquin. C’est une œuvre de jeunesse écrite par Zola en 1867, alors qu’il avait vingt-sept ans. Dans ce drame les événements s’enchaînent comme si les personnages ne disposaient pas de leur libre arbitre ; leur comportement est presque mécanique ; ils en sont réduits à agir par nécessité, pour répondre à une situation sans cesse changeante.
 Le personnage principal, Thérèse Raquin, est une jeune femme « au profil pâle et grave », nous dit Zola. Son mari, Camille, est âgé d’une trentaine d'années ; c’est un être « petit et chétif », qui ressemble à « un enfant malade et gâté » sur lequel veille sa mère ; car madame Raquin vit avec le jeune ménage. Thérèse est la fille du défunt frère de madame Raquin, fruit d’une aventure qu’il eut en Afrique avec une indigène. Madame a élevé sa nièce avec son fils, leur faisant partager le même lit et allant jusqu’à donner à Thérèse les mêmes médicaments que ceux prescrits à Camille, qui est un malade chronique. Pendant toute son enfance Thérèse s’est laissé faire et a accepté sans protestation que sa tante l’élève avec et comme Camille ; « elle allait, écrit Zola, où ils allaient, elle faisait ce qu’ils faisaient, sans une plainte, sans un reproche. » Pourtant Thérèse est très différente de Camille : elle jouit d’une santé de fer et possède un sang-froid suprême.
Le personnage principal, Thérèse Raquin, est une jeune femme « au profil pâle et grave », nous dit Zola. Son mari, Camille, est âgé d’une trentaine d'années ; c’est un être « petit et chétif », qui ressemble à « un enfant malade et gâté » sur lequel veille sa mère ; car madame Raquin vit avec le jeune ménage. Thérèse est la fille du défunt frère de madame Raquin, fruit d’une aventure qu’il eut en Afrique avec une indigène. Madame a élevé sa nièce avec son fils, leur faisant partager le même lit et allant jusqu’à donner à Thérèse les mêmes médicaments que ceux prescrits à Camille, qui est un malade chronique. Pendant toute son enfance Thérèse s’est laissé faire et a accepté sans protestation que sa tante l’élève avec et comme Camille ; « elle allait, écrit Zola, où ils allaient, elle faisait ce qu’ils faisaient, sans une plainte, sans un reproche. » Pourtant Thérèse est très différente de Camille : elle jouit d’une santé de fer et possède un sang-froid suprême.
Thérèse a accepté d’épouser Camille, dans le but d’exaucer le vœu de sa tante, qui souhaitait donner à son fils « un ange gardien ». Elle a également accepté de tenir avec sa belle-mère la mercerie qu’elle a ouverte à Paris, dans le passage du Pont-Neuf.
La vie de Thérèse bascule quand son mari introduit Laurent dans le foyer. Laurent est un vieux camarade qu’il a retrouvé à Paris, c’est un garçon qui est « grand, fort, le visage frais ». Thérèse le trouve beaucoup plus attirant que son mari, avec lequel physiquement il tranche. En réalité, prévient Zola, Laurent est « un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances faciles et durables. » Très vite il comprend le parti qu’il peut tirer de la famille Raquin, qui a tôt fait de l’adopter. En quelques semaines il devient « l’amant de la femme, l’ami du mari, l’enfant gâté de la mère ».
Les rendez-vous clandestins de Thérèse et de Laurent deviennent réguliers. Mais Camille reste un obstacle sur leur chemin, pour qu’ils puissent librement s’aimer. Voulant se débarrasser de l’encombrant mari, Laurent demande à Thérèse si elle ne pourrait pas l’envoyer en voyage. La jeune femme lui répond alors : « Il n’y a qu’un voyage dont on ne revient pas… »
Le passage le plus réussi du livre
est le récit de l’ « accident » organisé par Laurent
Lors d’une soirée entre amis organisée par madame Raquin, un commissaire de police en retraite évoque ce qu’on pourrait appeler le crime parfait ; il déclare : « Que de crimes restent inconnus ! Que d’assassins échappent à la peine des hommes ! […] Si on ne les arrête pas, c’est qu’on ignore qu’ils ont assassiné. » Ces paroles ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd et incitent Laurent à réfléchir à un plan.
Le passage le plus réussi du livre est le récit de l’ « accident » organisé par Laurent pour faire disparaître Camille. C’est « un crime sournois, accompli sans danger », mais avec une grande habileté. Laurent le commet volontairement sous les yeux de Thérèse, afin d’en faire sa complice. Au cours d’une promenade en barque, il noie Camille, qui ne sait pas nager. Le plan se déroule comme prévu, sauf qu’en se débattant, Camille arrive à mordre Laurent au cou. Cette blessure a priori insignifiante ne cesse de poursuivre l’assassin, car elle ne cicatrice pas et devient lancinante. Zola fait preuve d’insistance en la faisant revenir régulièrement comme un rappel du crime impuni : il parle de « plaies creusées dans la chair », puis de « cuisson ardente », de « picotements aigus »… Qui plus est, au lieu d’être endurci par son crime, Laurent est frappé de poltronnerie et devient peureux : « Maintenant, au moindre bruit, il tremblait, il pâlissait comme un petit garçon. »
La Morgue est un lieu de spectacle pour les Parisiens
qui se délectent de cet étalage de chair humaine
Dans les jours qui suivent leur crime, les deux amants attendent que le corps de Camille soit repêché. Régulièrement, Laurent va à la Morgue dans l’espoir d’y reconnaître enfin son cadavre. Zola fait une description saisissante de la Morgue, qu’il décrit comme un lieu de distraction pour les Parisiens qui se délectent de ce « bel étalage de chair humaine ». Il poursuit : « La Morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses, que se paient gratuitement les personnes pauvres et riches. La porte est ouverte, entre qui veut. » Les enfants ne sont pas, selon Zola, les derniers à profiter de ce spectacle : « Par moments, arrivaient des bandes de gamins ; des enfants de douze à quinze ans, ne s’arrêtant que devant les cadavres de femmes. »
Laurent et Thérèse sont dépourvus de sens moral. La notion de Bien et de Mal leur est étrangère. S’ils se sont décidés à tuer, ce n’est pas par plaisir, ce n’est pas dans le but de faire du mal à autrui. Ils sont passés à l’acte par besoin, parce que Camille était devenu un obstacle à leur amour. Zola fait comprendre qu’ils ne pouvaient pas faire autrement. Dès lors il est difficile pour le lecteur de les accabler pour un crime commis au nom de la nécessité. Mais Zola insiste tellement sur les séquelles dont sont victimes les deux meurtriers que son roman en devient une espèce de livre-vaccin contre le crime. Nul repos ne leur est accordé.
A la différence des romans appartenant au cycle des Rougon-Macquart, Thérèse Raquin est un roman relativement court. Il est facile de se repérer dans cette histoire centrée sur madame Raquin, Camille, Thérèse, Laurent et leurs quelques amis. Le fait que les personnages soient peu nombreux rend non seulement la lecture plus aisée, mais ajoute de la force à l’intrigue. Quiconque n’a jamais lu de Zola peut donc commencer par Thérèse Raquin et ensuite se lancer dans le cycle des Rougon-Macquart.
Thérèse Raquin, de Zola, 1867, collections Pocket, Folio et Le Livre de poche.
08:42 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : zola, thérèse raquin | Lien permanent | Commentaires (0)
25/04/2016
Germinal, de Zola
Célèbre roman sur la condition ouvrière
Germinal
La crise économique frappe de plein fouet les industries du nord de la France. Pour rester compétitive, la Compagnie des mines de Montsou décide de baisser le coût du travail. Les ouvriers se mettent en grève. Le mouvement s’annonce dur. Plus de cent ans après sa publication, Germinal reste le roman synonyme de la condition ouvrière.
Germinal est l’un des romans les plus célèbres de Zola, sinon le plus célèbre, publié dans le cycle des Rougon-Macquart. De nos jours encore, pour qualifier des conditions de travail déplorables, les expressions telles que « On se croirait chez Zola » ou « C’est digne de Germinal » sont éloquentes et clairement connotées. Il faut dire que Zola est l’un des premiers écrivains à s’être intéressé de près à la classe ouvrière, ici aux mineurs de fond du nord de la France. Il montre que, par leurs sacrifices au travail, les ouvriers ont rendu possibles la Révolution industrielle et l’enrichissement de la bourgeoisie sous le Second Empire.
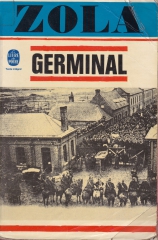 Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
C’est la famille Maheu qui est au cœur du roman. Le couple a sept enfants, âgés de vingt-et-un ans à trois mois. Chez les Maheu, dès qu’un enfant est en âge de travailler, il descend à la mine, qu’il soit fille ou garçon. C’est ainsi que Lydie, « chétive fillette de dix ans » va au puits. L’argent que chacun rapporte est nécessaire à ce foyer qui a du mal à joindre les deux bouts. Le sort de leurs voisins n’est guère plus enviable, au point que le coron du Voreux a été surnommé par ses habitants le « coron Paie-tes-Dettes ». Les mineurs sont payés à la quinzaine ; et le dimanche, jour chômé, n’est bien sûr pas rémunéré.
Ce qui étonne le plus Lantier,
ce sont les brusques changements de température au fond du puits
Les Maheu hébergent un locataire âgé d’une vingtaine d’années, Etienne Lantier, qui vient d’être embauché à la mine. C’est avec lui, qui n’était jamais descendu dans un puits, que le lecteur découvre le quotidien du mineur. Le matin, les Maheu se lèvent à quatre heures pour boire un café préparé avec une mauvaise eau qui donne la colique. En leur compagnie, Etienne pénètre l’univers souterrain de la mine ; il ne cesse de se heurter la tête au plafond, tandis que pas un de ses camarades, à force d’habitude, ne se cogne. Il souffre du sol glissant et traverse de véritables mares. Zola insiste sur les chauds et froids : « Mais ce qui l’étonnait surtout, c’étaient les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage, par où passait l’air de la mine, soufflait un vent glacé, dont la violence tournait à la tempête, entre les muraillements étroits. Ensuite, à mesure qu’on s’enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d’aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante, d’une pesanteur de plomb. » Zola poursuit : « C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés, l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue demeurait mortel. » A trois heures de l’après-midi, quand les Maheu remontent, leur journée finie, ils sont relayés par une autre équipe, car la mine tourne vingt-quatre heures sur vingt-quatre : « Jamais la mine ne chômait, il y avait nuit et jour des insectes humains finissant la roche à six-cents mètres sous les champs de betterave. »
Le puits est exploité par la Compagnie des mines de Montsou. Le directeur général, M. Hennebeau, n’en est pas le propriétaire ; « il est payé comme nous », précise un ouvrier. Son neveu Paul Négrel, âgé de vingt-six ans, est l’ingénieur de la fosse. Il passe ses journées au fond du puits, au milieu des ouvriers. Zola écrit : « Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon ; et, pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou. »
Alors que le salariat n’a pas encore trouvé sa forme,
les ouvriers sont payés à la tâche
Mais la crise est là. La surproduction menace. Pour rester compétitive, la Compagnie doit baisser ses coûts. On dirait aujourd’hui que l’entreprise doit faire un effort de compétitivité qui passe par la baisse du coût du travail. Pour ce faire, à une époque où le salariat n’a pas encore trouvé sa forme, la rémunération se faisant à la tâche, la Compagnie organise la concurrence entre ouvriers en mettant aux enchères les tailles. Il s’agit d’enchères inversées qui favorisent, pour prendre une expression actuelle, le « dumping social ». Quarante marchandages sont offerts aux mineurs, et, face à l’ingénieur qui procède aux adjudications, Maheu a peur de ne rien obtenir s’il ne baisse pas suffisamment la rémunération qu’il réclame ; car : « Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. » A la sortie, Etienne a ce commentaire : « En voilà un égorgement !... Alors, aujourd’hui, c’est l’ouvrier qu’on force à manger l’ouvrier ! » Le propriétaire de la mine voisine de Montsou se montre lucide et honnête quand, en privé, il déclare : « L’ouvrier a raison de dire qu’il paie les pots cassés. »
La colère monte dans le coron du Voreux. Les femmes, qui gèrent le ménage et donc la pénurie, sont en première ligne. La Maheu, très remontée, ne cesse de répéter : « Il faudra que ça pète. »
La colère monte contre les bourgeois qui auraient confisqué à leur profit les révolutions de 1789, 1830 et 1848 : « L’ouvrier ne pouvait tenir le coup, la révolution n’avait fait qu’aggraver ses misères. C’étaient les bourgeois qui s’engraissaient depuis 89. » A Montsou, il existe pourtant des bourgeois généreux. Ainsi, les Grégoire, actionnaires de la Compagnie qui vivent de leur rente, pratiquent la charité, mais à leur manière : « Il fallait être charitable, ils disaient eux-mêmes que leur maison est la maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillés de la continuelle crainte d’être trompés et d’encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d’argent, jamais ! pas dix sous, pas deux sous, car c’était un fait connu, dès qu’un pauvre avait deux sous, il les buvait. » A la place, les Grégoire ne font que des dons en nature, non en nourriture, mais sous forme de vêtements chauds.
Sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail,
l’employeur organise une baisse déguisée des rémunérations
Devant tant d’injustice, Etienne décide d’agir. Il s’enflamme en apprenant la création, à Londres, de l’Association internationale des travailleurs, la fameuse Internationale : « Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s’unissant, pour assurer à l’ouvrier le pain qu’il gagne. » Il entreprend de fonder une section à Montsou et de mettre en place une caisse de prévoyance. Cette caisse servirait des secours en cas de grève. Or un conflit éclate quand, sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail, la Compagnie décide d’un nouveau mode de rémunération : « Devant le peu de soin apporté au boisage, lasse d’infliger des amendes inutiles, elle avait pris la résolution d’appliquer un nouveau mode de paiement, pour l’abattage de la houille. Désormais, elle paierait le boisage à part […]. Le prix de la berline de charbon abattu serait naturellement baissé […]. » Les ouvriers, comprenant qu’il s’agit là d’une baisse déguisée des rémunérations, décident la grève, avec Lantier pour meneur. Le garçon est fort de ses idées socialisantes. Il abreuve ses camarades de paroles, mais il a mal assimilé ses lectures et manque de bases intellectuelles solides, nous dit Zola. Le cabaretier Rasseneur, qui avait jadis été licencié de la mine, se pose en concurrent de Lantier et propose une voie qu’il veut plus raisonnable ; il met en garde les ouvriers qui seraient tentés de faire main basse sur les moyens de production : « Il expliquait que la mine ne pouvait être la propriété du mineur, comme le métier est la propriété du tisserand, et il disait préférer la participation aux bénéfices, l’ouvrier intéressé, devenu l’enfant de la maison. » Mais Rasseneur ne sera pas écouté.
Lantier lui-même finit par être dépossédé de la grève qui tourne à l’émeute. Les femmes sont les plus hargneuses. Lors d’une manifestation, elles veulent déshabiller une bourgeoise qu’elles trouvent sur leur passage, et s’écrient : « Le cul à l’air ! » Puis il y a du sang. Un acte de sabotage est même commis à la mine, provoquant une catastrophe dont des ouvriers sont les premières victimes. Quand les régisseurs de la Compagnie apprennent l’origine criminelle de l’incident, ils préfèrent la taire et parler d’accident, quitte à être accusés de négligence, afin d’éviter tout effet d’imitation ; il s’agit de ne pas donner de mauvaises idées à des apprentis criminels.
La grève n’a pas que du mauvais pour la Compagnie, car elle contribue à nettoyer le marché en faisant succomber les sociétés trop faibles pour résister à un mouvement aussi dur. Une fois la grève finie, la Compagnie peut escompter acheter à prix cassé ceux de ses concurrents qui auront fait faillite entre-temps. C’est ainsi qu’une espèce de darwinisme économique est à l’œuvre.
Avec le recul, il parait évident que Germinal ne pouvait que choquer le lecteur bourgeois de l’époque, à cause du langage employé et des situations décrites. D’une certaine manière, Zola, c’est l’écrivain bourgeois qui bouscule sa classe sociale, quitte à l’effrayer, afin de la mettre en garde contre les conséquences que pourrait avoir son indifférence au sort de la classe ouvrière.
Germinal, de Zola, 1883, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Economie, Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : germinal, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2015
L'Assommoir, de Zola
Docu-fiction sur les ravages de l’alcool dans la France d’en-bas
L’Assommoir
L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste, tel que Zola le concevait. L’auteur plonge le lecteur au milieu du petit peuple des faubourgs de Paris. Le personnage principal, Gervaise, épouse un ouvrier zingueur qui, suite à un accident du travail, tombe sous la dépendance de l’alcool. A l’époque, Zola choqua nombre de lecteurs par les situations décrites et le vocabulaire employé.
Dans L’Assommoir, Zola charge son histoire en détails qui peuvent donner l’impression d’alourdir l’ensemble, si bien que de nombreux lecteurs risquent de s’impatienter. Ils pourraient être tentés de sauter des pages, ce qui n’est guère aisé et risque de les faire passer à côté de l’essentiel. Le mieux, pour ne pas s’ennuyer, est de considérer L’Assommoir comme un documentaire-fiction. L’intérêt du livre est de plonger le lecteur dans une classe sociale précise, celle des milieux populaires des faubourgs de Paris, sous le Second Empire. Zola a accompli tout un travail d’enquête qu’il restitue au lecteur sous forme de fiction. L’abondance de détails qu’il donne devient alors une force, ce sont des détails qui « font vrai » et qui permettent de partager la vie quotidienne des ouvriers et des artisans. En cela, L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste et social.
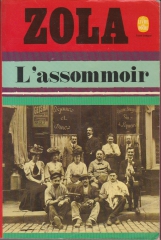 Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »
Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »
Un jour, Lantier la quitte et lui laisse leurs deux petits garçons sur les bras. Abandonnée, Gervaise se marie, par dépit, avec Coupeau, un brave garçon, zingueur de son état.
Quelques temps plus tard, sur un chantier, Coupeau fait une grave chute. Il survit et se remet d’aplomb petit à petit. Mais ce n’est plus le même homme. Il ne veut plus travailler, et alors qu’il était sobre auparavant, il se met à boire et tombe sous la dépendance de l’alcool.
L’alcool est au centre du roman. Selon Zola, le vin est consubstantiel à l’ouvrier : « L’ouvrier n’aurait pu vivre sans le vin », écrit-il. Une consommation raisonnable de rouge lui paraît naturelle, tant qu’elle aide l’ouvrier à tenir le coup. En revanche, les choses se gâtent quand il va au-delà d’une quantité raisonnable de vin et prend goût aux alcools forts : « Le vin nourrit l’ouvrier ; les alcools, au contraire, étaient des saletés, des poisons qui ôtaient à l’ouvrier le goût du pain. » Or Coupeau passe de plus en plus de temps à l’Assommoir, l’établissement du père Colombe, qui est un lieu de perdition. On y trouve la machine à saouler, qui sert un vitriol qui fait des ravages et cause la déchéance de Coupeau.
Gervaise, son mari Coupeau et son amant Lantier
font ménage à trois
On comprend que nombre de situations décrites par Zola aient pu choquer à l’époque. A un moment de l’histoire, les Coupeau font ménage à trois avec Lantier. L’ancien concubin de Gervaise vient s’installer dans leur logement et redevient son amant. D’une manière générale, les personnages ne sont guère charitables entre eux. L’une des scènes les plus fortes se trouve au début du livre, avec deux lavandières qui se battent à coups de baquets et de battoirs. L’une des deux femmes finit dans une posture honteuse et n’est pas près d’oublier l’humiliation subie ce jour-là. Dans ce milieu tel que Zola le décrit, il n’y a guère de place pour l’amour filial. Coupeau héberge sa mère âgée et malade, qui finit par devenir un poids. Certes il n’est pas question de l’euthanasier, mais ses proches, nous dit l’auteur, ne serait pas fâchés de la voir mourir : « Bien sûr, ses enfants ne l’auraient pas achevée ; seulement, elle traînait depuis si longtemps, elle était si encombrante qu’on souhaitait sa mort, au fond, comme une délivrance pour tout le monde. »
Zola ne nous épargne rien. Dans son roman, en été, quand il fait chaud, il fait très chaud et la chaleur est suffocante ; de la même manière, en hiver, quand il fait froid, il fait très froid et l’alcool constitue le seul réconfort possible. Même la noce entre Gervaise et Coupeau est gâchée par la pluie, comme si la fatalité devait s’abattre sur les pauvres.
Gervaise ne sort pas épargnée de l’histoire. Dès les premières pages, Zola prévient qu’à vingt-deux ans elle a les « traits fins, déjà tirés par la vie. » Suite à son mariage avec Coupeau, le lecteur la voit s’épuiser et vieillir prématurément. Elle fait des journées de douze heures au travail, et le soir, une fois rentrée à la maison, elle soit s’occuper de ses deux enfants et préparer à dîner pour son mari. Elle travaille beaucoup, ce qui lui permet d’accomplir son vieux rêve de s’établir à son compte, en ouvrant une blanchisserie. Au début, les affaires marchent, car elle est travailleuse. Et en plus elle est gentille. Et pourtant Zola recommande de ne pas nous faire des illusions sur elle ; selon lui, elle manque de caractère, ce qui l’amène à céder à la facilité et à ne pas savoir dire non : « On avait tort de lui croire une grosse volonté ; elle était très faible, au contraire ; elle se laissait aller où on la poussait, par crainte de causer de la peine à quelqu’un. »
Au Louvre, Gervaise et ses compagnons
sont émerveillés par les dorures des tableaux
Plus encore que les situations décrites, le style de Zola était en mesure de choquer le lecteur bourgeois soucieux des convenances. Son langage est volontairement relâché et sans élégance. Il utilise des mots ou des expressions tels que « bouffer », « boustifailler », « rigolade à mort », « gueuler »… Zola parle comme ses personnages et ses personnages parlent comme les ouvriers qu’ils sont censés être ; et ils n’hésitent pas à se montrer grivois. Pourtant ils ont aussi soif de culture. Le jour de la noce de Coupeau et de Gervaise, pour échapper à la pluie, les mariés et les invités décident de visiter le musée du Louvre, ce qui donne l’un des passages les plus piquants du livre. Zola nous dit que « des siècles d’art passaient devant leur ignorance ahurie. » Ils traversent très vite les collections et sont nettement moins émerveillées par les toiles elles-mêmes que par les dorures des encadrements des tableaux. Zola poursuit : « Gervaise demanda le sujet des Noces de Cana ; c’était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. Coupeau s’arrêta devant la Joconde, à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes. »
L’Assommoir a donc choqué, mais, pourtant, si l’on va au-delà des apparences on découvre un livre dont la substance est, au fond, très morale. Zola ne cesse de mettre en garde contre les méfaits de l’alcool. Ainsi le médecin-chef de l’hôpital Sainte-Anne examine Coupeau dont le corps et l’esprit sont ravagés par l’alcool, puis il livre sa conclusion à Gervaise : « Vous buvez ! Prenez garde, voyez où mène la boisson… Un jour ou l’autre, vous mourrez ainsi. »
L’Assommoir est plus qu’un roman, c’est un document sur les ouvriers et les artisans des faubourgs de Paris, à une époque qui voit la capitale bouleversée par les travaux du baron Haussmann. A la fin du livre, Gervaise ne reconnaît plus son faubourg, percé de larges boulevards bordés d’immeubles qui ont des airs de palais. Tout cela sent le neuf. Le boulevard Magenta et le boulevard d’Ornano sont, dit Zola, « deux vastes avenues encore blanches de plâtre. » Le Paris d’Haussmann ressemble à un décor de théâtre qui contraste avec la crudité des faubourgs : « Sous le luxe montant de Paris, la misère du faubourg crevait et salissait ce chantier d’une ville nouvelle, si hâtivement bâtie. »
Par son réalisme, sa crudité et son absence voulue de souffle épique, L’Assommoir est à l’opposé des Misérables publié quinze ans plus tôt. Zola prend Hugo à contre-pied et enterre le romantisme une fois pour toutes.
L’Assommoir, de Zola, 1876, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : l'assommoir, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)


