24/04/2017
La Malédiction d'Edgar, de Marc Dugain
Hoover : la fin d’un mythe
La Malédiction d’Edgar
Marc Dugain brise une légende. Selon lui, contrairement à ce que l’on a longtemps cru, Edgar Hoover, fondateur du FBI, n’était pas un policier modèle. C’était un être complexe, obsédé par les valeurs morales, ce qui le conduisit à commettre les pires turpitudes. Au lieu de combattre le crime organisé, il préférait surveiller les prétendus ennemis de l’Amérique et constituer des dossiers compromettants pour tenir en ses mains le Tout-Washington.
Edgar Hoover fonda le FBI en 1924, et le dirigea jusqu’à sa mort. De son vivant, il fut présenté comme un policier modèle et un modèle de policier. Aujourd’hui, depuis que certains faits ont été révélés, la réalité apparaît toute autre. Au lieu de combattre le crime organisé, Hoover préféra s’attaquer aux prétendus ennemis de l’Amérique. Il pourchassa les communistes et mit sous écoute des personnalités comme Martin Luther King, qui, à ses yeux, représentaient pour les Etats-Unis un danger plus important que la Mafia. D’une manière générale, Hoover mit à profit ses fonctions pour se constituer des dossiers compromettants sur l’ensemble des hommes politiques de l’époque, ce qui lui permettait de tenir en ses mains le Tout-Washington.
Plutôt qu e d’écrire une biographie, Marc Dugain a imaginé ce qu’eussent pu être les souvenirs personnels de Clyde Tolson, qui fut, pendant quarante ans, l’adjoint de Hoover, et même plus que son adjoint. Dans ses mémoires apocryphes, Tolson fait pénétrer le lecteur dans l’intimité d’Edgar, un homme profondément solitaire, qui considérait son adjoint comme le seul membre de sa famille. Hoover n’était ni svelte ni gracieux, il avait un physique ingrat et ne s’aimait pas. « J’ai toujours une tête de gros et un cou de vieux taureau », confia-t-il à Clyde. Edgar avait fait don de sa personne au Bureau et n’aima qu’une seule femme, Annie Hoover, sa mère.
e d’écrire une biographie, Marc Dugain a imaginé ce qu’eussent pu être les souvenirs personnels de Clyde Tolson, qui fut, pendant quarante ans, l’adjoint de Hoover, et même plus que son adjoint. Dans ses mémoires apocryphes, Tolson fait pénétrer le lecteur dans l’intimité d’Edgar, un homme profondément solitaire, qui considérait son adjoint comme le seul membre de sa famille. Hoover n’était ni svelte ni gracieux, il avait un physique ingrat et ne s’aimait pas. « J’ai toujours une tête de gros et un cou de vieux taureau », confia-t-il à Clyde. Edgar avait fait don de sa personne au Bureau et n’aima qu’une seule femme, Annie Hoover, sa mère.
Il se sentait investi d’une mission première, celle de sauvegarder l’Amérique des êtres subversifs et des personnes dépravées. Son combat était avant tout moral, il se considérait comme étant l’ « immuable gardien des valeurs de ce pays ». Si, malgré son poids et sa puissance, il ne ressentait aucune ambition présidentielle, il confia cependant être prêt à détruire tout candidat qui lui eût paru dangereux : « Il y a un pouvoir que j’accepte qu’on me prête, c’est éventuellement celui de défaire un président ou de nuire à sa réélection, de barrer la route à un candidat qui me paraitrait inadéquat pour le pays. Tous ces hommes politiques à la petite semaine sous-estiment mon pouvoir de nuisance. »
Hoover détestait tout ce que représentaient les Kennedy
Hoover eut dans le collimateur une famille, ou plutôt un clan : les Kennedy ; lesquels représentaient tout ce qu’il détestait. Il abhorrait le patriarche, Joseph, dont la fortune reposait sur une série de malhonnêtetés, et qui pourtant rêvait d’être élu président des Etats-Unis. Avec ironie, Hoover disait que Joseph Kennedy était « prêt à tout, y compris à l’honnêteté, pour accéder à la magistrature suprême. » Pour Hoover, Joseph Kennedy représentait le comble du cynisme et de l’arrivisme, avec ses maximes telles que : « Qu’importe ce qu’on est, ce qui compte c’est l’image qu’on donne. »
Concernant John, Clyde Tolson se montre, pour sa part, plus mesuré. John Kennedy, concède-t-il, « paraissait très différent de son père. A l’inverse de lui, il éprouvait un intérêt sincère pour les autres, pourvu bien sûr qu’ils aient un minimum de charme intellectuel. Il préférait aussi débattre d’un sujet plutôt que de s’ancrer dans des opinions sans y avoir réfléchi. » Mais ses qualités ne trouvaient pas grâce aux yeux de Hoover, selon qui John était « trop riche, trop désinvolte, trop intellectuel, trop coureur de femmes, et au fond, trop immoral. »
Pour Hoover et de Tolson, le pire du clan Kennedy était représenté par Robert Kennedy, nommé ministre de la Justice par son frère après son élection à la présidence des Etats-Unis. Tolson le qualifie de « petit jeune homme nerveux à la voix haut perchée dont le comportement de roquet ne passait inaperçu chez personne. » En tant que ministre de tutelle de Hoover, Bob ne cessa de l’humilier en lui infligeant de petites vexations. Même John se serait montré réservé à l’égard de son frère en le considérant comme un idéaliste.
Dans une déclaration à la presse,
Hoover nia l’existence du crime organisé
C’est sur le terrain de la lutte contre le crime organisé que les choses se jouèrent. Dans une déclaration à la presse, Hoover avait, contre toute évidence, nié l’« existence du crime organisé sur le territoire des Etats-Unis. » Dans une conversation privée avec Tolson, Edgar s’était justifié de cette dénégation en faisant valoir que la moindre affirmation de sa part eût pu être prise par la Mafia comme une déclaration de guerre. La prudence recommandait donc le silence.
Une fois nommé ministre de la Justice, Robert Kennedy se mit en tête de s’attaquer au crime organisé et se lança dans une croisade contre la Mafia, oubliant un peu vite le rôle de celle-ci dans l’élection de son frère. A lire Dugain, la contradiction dans laquelle s’enfoncèrent les Kennedy allait aboutir à l’assassinat de John, suivi, quelques années plus tard, de celui de Bob. Pour leur part, Hoover et Tolson ne versèrent aucune larme sur les cercueils des deux frères ; car, ainsi que l’écrit Clyde, « avec les Kennedy nous avons croisé les pires malfaiteurs déguisés en gendres idéaux. »
Ni John Kennedy, ni Richard Nixon, ni aucun autre président avant eux, n’osèrent se débarrasser de Hoover. Il en savait trop sur eux : « la richesse des informations recueillies, écrit Tolson, devait nous permettre de nous maintenir indéfiniment à la tête du FBI. » Et c’est effectivement ce qui se produisit. Hoover se maintint à son poste pendant quarante-huit années consécutives et mourut directeur du FBI. A son décès, en 1972, le fidèle Clyde Tolson préféra se retirer et prit sa retraite.
Dans son livre, Marc Dugain fait de Hoover un être complexe, prisonnier de ses contradictions. Son obsession des valeurs morales le conduisit à commettre des turpitudes, comme s’il voulait faire oublier les moments d’égarements qu’il avait lui-même connus. Selon Dugain, la Mafia possédait des photos compromettantes qui lui permettait de tenir Hoover, ce qui pourrait expliquer sa tiédeur à combattre le crime organisé.
La Malédiction d’Edgar se lit assez facilement. Le style de Dugain n’est peut-être pas très élégant, mais il est diablement efficace.
La Malédiction d’Edgar, de Marc Dugain, 2006, collection Folio.
08:49 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la malédiction d'edgar, marc dugain, edgar hoover | Lien permanent | Commentaires (0)
10/04/2017
Europe 51, de Rossellini
La vie édifiante de sainte Ingrid-des-Pauvres
Europe 51
Une jeune femme superficielle et mondaine, interprétée par Ingrid Bergman, perd brutalement son fils. Elle éprouve alors un sentiment de culpabilité et change radicalement de vie. Elle va vers les pauvres pour les décharger d’une part de leur fardeau, espérant ainsi trouver le chemin de la rédemption. Dans Europe 51, Rossellini imagine ce qui se passerait si saint François d’Assise revenait parmi nous. Selon le cinéaste, il serait déclaré fou et envoyé à l’asile.
Irene Girard est l’épouse du directeur de la filiale italienne d’une multinationale. Elle vit dans un immeuble luxueux de Rome, avec son mari et leur fils Michel, un garçon d’une dizaine d’années. Elle est une jeune femme futile, une mondaine pour laquelle seuls comptent les relations et les dîners en ville. Elle n’a guère de temps de s’occuper de son fils ; or c’est un enfant sensible qui ne s’est jamais complètement remis de ses années passées à Londres sous les bombardements. Il ne s’intéresse à rien et, quand des invités arrivent avec un cadeau à son intention, il ne prend même pas la peine de l’ouvrir.
Un jour c’est le d rame : Michel est retrouvé agonisant au bas de la cage d’escalier de leur immeuble. Il meurt quelques heures plus tard. Quand Irene apprend la vérité sur les circonstances de l’« accident » de son fils, elle se sent aussitôt coupable de sa mort. Dans les semaines qui suivent, elle reste dans un état prostration et se montre incapable de refaire surface, malgré l’insistance de son mari qui la supplie de se montrer forte et de reprendre goût à la vie.
rame : Michel est retrouvé agonisant au bas de la cage d’escalier de leur immeuble. Il meurt quelques heures plus tard. Quand Irene apprend la vérité sur les circonstances de l’« accident » de son fils, elle se sent aussitôt coupable de sa mort. Dans les semaines qui suivent, elle reste dans un état prostration et se montre incapable de refaire surface, malgré l’insistance de son mari qui la supplie de se montrer forte et de reprendre goût à la vie.
C’est alors qu’un journaliste ami de la famille la persuade que sa vie n’est pas finie, car elle peut se rendre utile aux autres. Il lui ouvre les yeux sur l’humanité qui l’entoure et les misères à soulager. Il l’emmène visiter un couple d’ouvriers qui n’a pas suffisamment d’argent pour acheter les médicaments nécessaires à l’un de ses enfants qui est gravement malade.
Irene n’a pas besoin de courir la terre pour découvrir un monde inconnu. Il lui suffit de prendre l’autobus et d’aller à l’autre bout de Rome. Une fois arrivée dans un faubourg de la ville, elle se trouve confrontée à une réalité sociale qui la laissait indifférente auparavant. Irene la superficielle change alors de vie ; elle se met au service des pauvres et les aide à porter leur fardeau, espérant ainsi trouver le chemin de la rédemption. Sous nos yeux, Irene se métamorphose et acquiert une conscience sociale.
Les scènes en usine sont directement inspirées
du témoignage de la philosophe Simone Weyl
Rossellini eut l’idée de son film en se demandant ce qui se passerait si saint François d’Assise revenait aujourd’hui. Selon le cinéaste, on le déclarerait fou et on l’enverrait à l’asile. Dans le film, saint François d’Assise, c’est Irene incarnée par Ingrid Bergman. Sa volonté de secourir les pauvres est incomprise de son entourage, lequel est stupéfait d’apprendre qu’elle est allée travailler quelques jours en usine pour remplacer une ouvrière. Son mari, dans un premier temps, la soutient avant de se convaincre qu’elle a perdu la raison. Pour lui et son entourage, elle est folle, non parce qu’elle soulage les pauvres, mais parce qu’elle ne respecte plus les conventions sociales. Peu importe qu’elle fasse le bien autour d’elle, peu importe que son attitude soit hautement morale ; ses proches, eux, constatent que son comportement est anormal, dans le sens qu’il n’est pas conforme à la norme. Irene compromet l’équilibre de l’édifice social.
Les scènes d’Irene en usine sont directement inspirées du témoignage de Simone Weyl. Intellectuelle agrégée de philosophie, elle avait rompu avec son milieu pour aller travailler comme manœuvre au milieu des ouvriers. On retrouve certaines de ses idées dans le film, notamment quand Irene découvre que le travail à la chaîne aliène l’homme. C’est à ce moment-là que la jeune femme a un premier point de désaccord avec son ami journaliste. En tant que communiste, celui-ci voit le travail comme un moyen de libération, tandis qu’Irene, se rappelant la phrase « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », y voit une damnation. Elle s’écarte définitivement de lui quand il l’invite à construire le paradis sur terre ; cette proposition ne la satisfait pas, car ce paradis sur terre exclurait Michel qui est mort. Irene, elle, ne veut pas que le paradis soit réservé aux vivants, elle veut travailler pour Michel, c’est-à-dire pour l’éternité.
Pour Rossellini, ce n’est pas la jeunesse,
mais les morts qui dominent le monde
C’est là l’une des idées maîtresses de Rossellini, selon qui ce n’est pas la jeunesse, mais les morts qui dominent le monde. Ce sont ceux qui nous ont précédés qui décident de nos actes, nous sommes dépendants de l’héritage qu’ils nous ont laissé. C’est ainsi que le souvenir de Michel guide quotidiennement les gestes d’Irene.
Convaincue que la mort de son fils est la conséquence de son manque d’amour pour lui, elle en tire la conclusion que le mal en ce monde naît du manque d’amour et tente dorénavant d’y remédier.
Commentant son film deux ans après sa sortie, Rossellini déclara : « J’ai eu l’impression de m’exprimer avec un maximum de sincérité. Mon message est un message de foi, d’espoir et d’amour… un appel à l’humanité. Dans mes films il y a un anxieux désir de foi, d’espoir et d’amour… Il y a toujours le problème de la spiritualité, du déclin des valeurs humaines. » D’où le titre Europe 51 voulu par le cinéaste, le film étant censé mettre l’accent sur le vide spirituel de l’Europe d’après-guerre.
Europe 51 n’est pas le meilleur film de Rossellini, il n’est pas aussi abouti qu’Allemagne année zéro. La construction souffre de discontinuité et d’un manque d’unité. De fait, il y a deux parties distinctes dans ce film : la première partie, celle qui montre Irene la superficielle se désintéressant de son fils, est la plus réussie ; la seconde partie, qui la montre sur le chemin de la rédemption, peut paraître surchargée en considérations philosophiques. Et pourtant, elle est passionnante à suivre, car elle met en scène des personnages qui ne sont pas d’un bloc. Rossellini dépeint des caractères riches et complexes : Irene elle-même ne sait pas très bien où elle va ; son mari se persuade, à tort, qu’elle le trompe avec leur ami journaliste ; sa mère croit qu’elle est devenue communiste ; et l’un des spécialistes qui l’examine est gagné par le doute, il ne sait plus très bien s’il a affaire à une exaltée ou à une missionnaire, et il se rappelle que, par le passé, beaucoup de personnes ont été condamnées au bûcher pour avoir eu raison contre tout le monde.
L’interprétation d’Ingrid Bergman fait oublier tous les défauts que le film peut contenir. Elle est émouvante dans le rôle d’Irene, dont certains disent qu’elle est folle, tandis que d’autres la prennent pour une sainte. Le plan montrant Ingrid Bergman derrière les barreaux frappe l’imaginaire du spectateur.
Europe 51, de Roberto Rossellini, 1952, avec Ingrid Bergman, Alexander Knox, Ettore Giannini, Giuletta Massina et Sandro Franchina, DVD Tamasa Diffusion.
08:56 Publié dans Etude de moeurs, Film, Religion, Société | Tags : europe 51, rossellini, ingrid bergman, alexander knox, ettore giannini, giuletta massina, sandro franchina | Lien permanent | Commentaires (0)
03/04/2017
Les Dieux ont soif, d'Anatole France
Mise en garde contre le fanatisme
Les Dieux ont soif
Evariste Gamelin, un jeune citoyen vertueux, est nommé juré au Tribunal révolutionnaire. Parce qu’il a une vision mystique de sa charge, il se montre terrible en multipliant les condamnations à mort. Pour Anatole France, la Terreur révolutionnaire n’est pas le produit de l’athéisme, mais le fruit d’un excès de religiosité.
« Le tribunal révolutionnaire ressemble à une pièce de Guillaume Shakespeare, qui mêle aux scènes les plus sanglantes les bouffonneries les plus triviales », déclare l’un des personnages des Dieux ont soif. Ce commentaire résume l’esprit qu’Anatole France a voulu insuffler à son roman, dont l’histoire se passe au cours de l’année 1793-94, sous le règne de la Terreur.
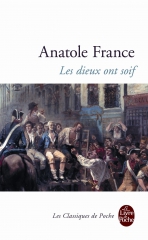 Tout en étant foncièrement républicain, Anatole France rejetait le fanatisme. Dans Les Dieux ont soif, il essaye de comprendre, et de faire comprendre au lecteur, comment la machine s’est emballée, c’est-à-dire comment d’honnêtes citoyens ont pu se transformer en monstres sanguinaires, en tant que jurés des tribunaux révolutionnaires.
Tout en étant foncièrement républicain, Anatole France rejetait le fanatisme. Dans Les Dieux ont soif, il essaye de comprendre, et de faire comprendre au lecteur, comment la machine s’est emballée, c’est-à-dire comment d’honnêtes citoyens ont pu se transformer en monstres sanguinaires, en tant que jurés des tribunaux révolutionnaires.
Le personnage principal, Evariste Gamelin, est un artiste peintre médiocre, qui essaye de « contenter le goût du vulgaire ». Le jeune homme habite avec sa mère et aime en secret Elodie, la fille d’un marchand d’estampes. Révolutionnaire sincère, il est inscrit à la section du Pont-Neuf. Un jour, l’une de ses riches protectrices, déplorant qu’il vive dans le dénuement, fait jouer ses relations et lui obtient un siège de juré au Tribunal révolutionnaire, afin de lui procurer un traitement. « On le façonnera », se dit-elle en lui faisant part de sa nomination. Mais elle se fourvoie, car elle n’a pas compris la personnalité du jeune homme. Le voisin de Gamelin, Brotteaux, lui, sait à qui il a affaire et, quand il apprend la nomination du garçon, il déclare à son propos : « Il est vertueux : il sera terrible. »
Brotteaux ci-devant des Ilettes (« ci-devant » = « précédemment » en langage révolutionnaire) est le double littéraire d’Anatole France ; ses opinions reflètent celles de l’auteur. C’est un « philosophe épicurien », il veut profiter au maximum de la vie, car il ne croit pas en un au-delà ; aussi dit-il : « Ce qui suit la vie est comme ce qui la précède. » A l’image d’Anatole France, c’est un athée obsédé par les questions religieuses, dont il aime à discuter. Ainsi, quand il cache chez lui le père Longuemarre, prêtre réfractaire menacé d’arrestation, il en profite pour avoir avec lui des entretiens approfondis portant sur la théologie.
Par souci d’égalité,
Gamelin ne réserve pas la guillotine aux aristocrates
et tient à montrer que le peuple est digne d’être envoyé à l’échafaud
En tant que philosophe, Brotteaux est accoutumé à raisonner ; mais, parce que c’est un homme sage, il se méfie du culte de la Raison, que la République veut instaurer. Ainsi il déclare à Gamelin : « J’ai l’amour de la raison, je n’en ai pas le fanatisme. La raison nous guide et nous éclaire ; quand vous en aurez fait une divinité, elle vous aveuglera et vous persuadera des crimes. »
Homme peu cultivé, Gamelin ne partage pas les préventions de Brotteaux. Il a vénéré et chéri Marat, et croit en un peuple qui, régénéré, répudiera « tous les legs de la servitude ». Un soir, au club des Jacobins, il a une révélation en entendant Robespierre discourir sur les « crimes et les infamies de l’athéisme ». Le grand homme souligne le caractère perfide de l’athéisme, qui a pris naissance dans les salons de l’aristocratie et dont le but est de démoraliser et asservir le peuple. C’est alors que Gamelin commence à se faire du châtiment une « idée religieuse et mystique, à lui prêter une vertu, des mérites propres. Il pensait, écrit Anatole France, qu’on doit la peine aux criminels et que c’est leur faire tort que de les en frustrer. » Par souci d’égalité, il ne réserve pas la guillotine aux aristocrates et tient à montrer la même sévérité à l’égard des porte-faix et des servantes, et les trouve dignes d’être envoyés à l’échafaud : « Il eût jugé méprisant, insolent pour le peuple, de l’exclure du supplice. C’eût été le considérer, pour ainsi dire, comme indigne du châtiment. »
Gamelin a beau croire au culte de la Raison, il ne fait guère preuve de raison et de réflexion quand il siège au Tribunal révolutionnaire. La plupart des autres jurés et des magistrats ne valent guère mieux, à tel point que Brotteaux, appelé à comparaître, comprend qu’il est inutile pour un accusé d’essayer de les émouvoir, car, dit-il, « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des choses : on ne s’explique pas avec les choses. »
En dépit de l’athéisme de son auteur,
ce livre n’a rien d’anticlérical
Cette justice expéditive n’a rien à envier à la justice du roi, ce qui n’est pas très étonnant, car nombre de « ces magistrats de l’ordre nouveau » exerçaient déjà sous l’Ancien Régime, à commencer par le terrible Fouquier-Tinville qui fut procureur du roi au Châtelet.
Anatole France décrit avec minutie le déroulement des procès, et, comme dans les pièces de Shakespeare, il y introduit de la bouffonnerie. Le Tribunal a un caractère « odieux et ridicule » que souligne Brotteaux. Ses jugements sont binaires. C’est tout ou rien. Ou l’accusé est un scélérat, un fripon, et alors il est condamné à mort ; ou il est innocent, et alors le public l’applaudit pendant que le président du Tribunal proclame son acquittement et lui donne « l’accolade fraternelle ».
Avec l’accentuation de la terreur, les procès se multiplient : « On ne procédait plus que par fournées. L’accusateur public réunissait dans une même affaire et inculpait comme complices des gens qui souvent, au Tribunal, se rencontraient pour la première fois. » Fatigués par tant de besogne, les jurés jugent suivant les « impulsions de leur cœur », c’est-à-dire qu’en général ils condamnent à mort. Il faut dire que leur sort est maintenant étroitement lié à celui de la Révolution, alors que les armées étrangères menacent la France : « Sûrs de périr si la patrie périssait, ils faisaient du salut public leur salut propre. Et l’intérêt de la nation, confondu avec le leur, dictait leurs sentiments, leurs passions, leur conduite. » C’est la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, qui leur est fatale.
Anatole France développe une thèse originale en attribuant la Terreur, non à l’athéisme révolutionnaire, mais au contraire à un excès de religiosité. En dépit de l’athéisme de son auteur, ce livre n’a rien d’anticlérical, un prêtre réfractaire étant sous sa plume l’une des victimes du Tribunal. Dans le cas présent, ce n’est pas le christianisme, mais le culte robespierrien de la Raison qui conduit au pire fanatisme.
De nos jours, Anatole France est un écrivain tombé en désuétude. Pourtant Les Dieux ont soif est, si l’on peut dire, un récit vivant de la Terreur révolutionnaire. Cette mise en garde contre le fanatisme et le dévoiement de la raison mérite encore d’être lue.
Les Dieux ont soif, d’Anatole France, 1912, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
08:51 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : les dieux ont soif, anatole france | Lien permanent | Commentaires (0)


