25/01/2016
J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de Christine Arnothy
Le siège de Budapest vécu par une fillette
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir
Ce livre, qualifié d’autobiographie, est le récit au jour le jour du siège de Budapest, en 1945. L’auteur, Christine Arnothy, raconte le calvaire qu’elle vécut, alors qu’elle n’avait que quinze ans. Elle fait partager au lecteur ses émotions et sa peur de la mort, dans une ville en proie aux bombardements.
En 1954 paraissait J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Le succès du livre fut immédiat. Son auteur, Christine Arnothy, était une jeune réfugiée hongroise installée en France. Quelques années plus tôt, elle avait fui son pays natal, en compagnie de ses parents ; ils étaient partis sans bagage, elle-même emportant pour seul bien les feuillets de son journal, cousus dans son manteau. C’est ce journal qui est la source de J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Christine Arnothy y raconte au jour le jour comment elle vécut le siège de Budapest et le calvaire enduré par ses habitants au début de l’année 1945.
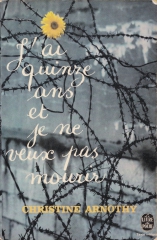 La fillette et ses parents habitaient alors un immeuble en bordure du Danube. Au début des combats, ils trouvèrent refuge dans la cave : « Les trois premiers jours passèrent assez vite. A chaque craquement de l’escalier, nous pensions : voilà les Russes, les combats ont pris fin près d’ici, nous pourrons remonter dans nos chambres et renouer le fil de notre existence […]. Au cinquième jour de notre exil dans les souterrains, il fut évident que les Allemands avaient décidé de défendre la ville. C’est alors que nous perdîmes toute notion du temps. Les journées mortelles, angoissantes, se succédèrent avec une lenteur accablante. » Les Allemands, qui n’ont plus rien à perdre, sont décidés à vendre chèrement leur peau et les bombardements deviennent presqu’incessants.
La fillette et ses parents habitaient alors un immeuble en bordure du Danube. Au début des combats, ils trouvèrent refuge dans la cave : « Les trois premiers jours passèrent assez vite. A chaque craquement de l’escalier, nous pensions : voilà les Russes, les combats ont pris fin près d’ici, nous pourrons remonter dans nos chambres et renouer le fil de notre existence […]. Au cinquième jour de notre exil dans les souterrains, il fut évident que les Allemands avaient décidé de défendre la ville. C’est alors que nous perdîmes toute notion du temps. Les journées mortelles, angoissantes, se succédèrent avec une lenteur accablante. » Les Allemands, qui n’ont plus rien à perdre, sont décidés à vendre chèrement leur peau et les bombardements deviennent presqu’incessants.
Les locataires de l’immeuble, qui s’ignoraient jusqu’ici, en sont réduits à vivre dans la même cave : « Ils dormaient, mangeaient, se lavaient et se chamaillaient dans la promiscuité la plus totale. » Et ensemble ils sont condamnés à affronter la peur de la mort, que chacun ressent individuellement à chaque bombardement. Quand un prêtre leur rend visite dans la cave, Christine se confesse à lui : « Je ne veux pas mourir, mon père, lui dis-je presqu’en pleurant. Je n’ai que quinze ans et j’ai affreusement peur de la mort. Je veux vivre encore. »
Suite à un vol de vivres, des soldats allemands menacent de fusiller tous les locataires de l’immeuble. Christine a alors très peur, mais le voisin de ses parents, un magistrat en retraite, a encore plus peur qu’elle : « Le procureur général criait qu’il voulait encore vivre. Je me disais qu’il avait déjà vécu quatre-vingt ans, tandis que, moi, je n’en avais que quinze, et j’avais plus de raison que lui de pleurer… » Et c’est le procureur général qui manifestera le plus vif soulagement à la perspective d’échapper à la mort.
Dans cette ville en ruines, les cœurs durs ont plus de chances
de survivre que les cœurs tendres
Le récit de Christine Arnothy montre bien à quel point la guerre bouleverse les relations sociales. Le chaos finit par s’installer dans la ville, et, dès que les Allemands sont partis, des habitants s’adonnent au pillage. Même le procureur général participe au sac du tribunal. Christine Arnothy le constate : « Toutes les notions morales sont bouleversées dans cette ville en ruine. Le vice compte pour la vertu et les cœurs durs ont plus de chances de survivre que les cœurs tendres. »
La peur ne disparaît pas avec l’arrivée des Russes, car ils ne sont pas les libérateurs que l’on croyait qu’ils seraient. Une femme de soixante-treize ans dit avoir été violée par cinq soldats russes, l’un après l’autre.
Christine et ses parents réussissent à s’échapper de Budapest occupé par les Russes, et gagnent la maison qu’ils possèdent en périphérie. Ils y retrouvent tante Julia à qui ils ont prêté leur maison. Quand elle les voit arriver, tante Julia n’est pas folle de joie. Au contraire, elle est ébahie et leur déclare : « Comment, vous n’êtes pas tous morts, vous autres ? » Elle semble très déçue qu’ils soient encore en vie. Comme le note Christine Arnothy, elle les avait probablement pleurés un moment, puis elle avait admis qu’ils étaient morts, et s’était consolée à la perspective de garder la maison pour elle et ses enfants. A Budapest et dans ses environs, règne le chacun pour soi. L’essentiel étant de survivre soi-même, cela devient un luxe de se soucier de son prochain.
Malgré tout, dans ce récit, il y a de rares moments d’humanité ; il n’y a alors plus d’Allemands, plus de Russes, plus de Hongrois, mais seulement des frères humains. Ces moments sont brefs et n’empêchent pas le tragique de se produire.
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir est un récit court et facile à lire, qui montre le vrai visage de la guerre. Un lecteur adolescent s’identifiera sans mal à la narratrice.
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de Christine Arnothy, 1954, collection Le Livre de Poche.
30/11/2015
Et dans l'éternité je ne m'ennuierai pas, de Paul Veyne
Un ancien professeur au Collège de France se raconte
Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas
Paul Veyne, grand spécialiste de la Rome antique, livre ses souvenirs en toute liberté. Il parle de sa vocation d’érudit, de son passage à l’Ecole normale supérieure et de son élection au Collège de France. Il évoque Aron, qui lui apporta son soutien avant de se brouiller avec lui. Enfin Paul Veyne, qui manifesta contre de Gaulle en 1958, lui rend aujourd’hui hommage.
En ouverture de son livre de souvenirs, Paul Veyne, professeur honoraire d’histoire romaine au Collège de France, fait une déclaration de patrimoine et de revenus. Il dit toucher une pension de 4500 euros par mois, à laquelle s’ajoutent des droits d’auteur variables selon les années. Cette transparence sur ses finances est signe que Paul Veyne ne veut pas cacher grand-chose de sa vie. Et il est vrai qu’il donne beaucoup d’éléments sur son parcours professionnel, sa vie privée et ses croyances.
 Né en 1930 dans le Midi de la France, Paul Veyne est le fils d’un négociant en vin. Sa famille était aisée et, pendant la guerre, son père fut favorable à la Collaboration, même si, par prudence, il évita de faire de la politique. Enfant, Paul Veyne découvrit sa vocation, celle de l’érudition. Pour lui, apprendre est un jeu ; il se passionne déjà pour Homère et ambitionne de devenir un être cultivé.
Né en 1930 dans le Midi de la France, Paul Veyne est le fils d’un négociant en vin. Sa famille était aisée et, pendant la guerre, son père fut favorable à la Collaboration, même si, par prudence, il évita de faire de la politique. Enfant, Paul Veyne découvrit sa vocation, celle de l’érudition. Pour lui, apprendre est un jeu ; il se passionne déjà pour Homère et ambitionne de devenir un être cultivé.
A dix-huit ans, le baccalauréat en poche, il monta à Paris et s’inscrivit en hypokhâgne au lycée Henri IV, pour préparer le concours de l’Ecole normale supérieure. Quelques temps auparavant, il ne connaissait pas l’existence de cette école, mais le notaire de ses parents leur avait dit qu’il fallait passer par Normale pour devenir professeur.
Après un échec, Paul Veyne fut reçu à l’ENS, à sa seconde tentative. Il fit son entrée à l’Ecole, qu’il qualifie de « monastère laïc de la rue d’Ulm » sans expliquer les raisons de cette appellation. Pendant ses études, il succomba à la tentation communiste et s’inscrivit au Parti, bien qu’il n’eût pas la foi :
Mais pourquoi adhérer au Parti, fût-ce sous l’effet de l’alcool, alors que je ne croyais pas à ces « lendemains qui chantent » dont parlait Aragon et que la politique ne m’intéressait pas ? […] Oui, mais avoir sa carte du Parti ! Participer à la croisade de mon époque ! Pouvoir répondre : « Oui, je l’ai. » […] Désormais, j’aurais le droit d’être heureux avec bonne conscience […]. »
Dans le débat opposant Sartre à Aron, il dit n’avoir pu prendre Sartre au sérieux. Cependant l’égoïsme social d’Aron lui glaçait le sang. Selon Paul Veyne, Aron se désintéressait complètement du sort du prolétariat.
En 1958, quand de Gaulle revint au pouvoir à la faveur des événements d’Algérie, le militant de gauche qu’est Paul Veyne participa naturellement à la manifestation du 28 mai, organisée au nom de la défense de la République. Avec le recul des années, Paul Veyne a radicalement changé d’avis sur de Gaulle. Aujourd’hui, il le vénère :
Oui, je vénère de Gaulle, je l’ai dit, pour avoir été le plus grand réformateur de gauche de notre siècle […] : décolonisation, vote des femmes, Sécurité sociale, et j’en passe. »
Au Collège de France, Paul Veyne fut traité de provocateur
pour avoir choisi un sujet d’étude qui sentait le souffre
En 1961, Paul Veyne fut nommé maître de conférences de latin à la faculté d’Aix-en-Provence. A trente-et-un ans, il est titularisé ; sa sécurité matérielle est assurée à vie.
Il se lança dans la préparation de sa thèse, consacrée à la Rome antique. Il décida de la faire précéder d’une préface, qu’il commença de rédiger et dans laquelle il glissa ses souvenirs personnels. La préface ne cessa de s’allonger et finit par former une œuvre à part, presqu’un livre, si bien que Paul Veyne décida d’en envoyer le manuscrit au Seuil. Cette jeune maison d’édition accepta le texte et le publia sous le titre Comment on écrit l’histoire. Le livre fut remarqué par Raymond Aron, qui en fit une critique élogieuse. Fort de son soutien, Paul Veyne monta régulièrement à Paris suivre son séminaire. En 1975, quand un poste se libéra au Collège de France, Aron obtint la création d’une chaire d’histoire de Rome qu’il destina à Paul Veyne. Avec un parrain aussi influent et après des visites protocolaires, Paul Veyne fut élu professeur au Collège de France. Lors de sa leçon inaugurale, il commit un impair en omettant de rendre hommage à Aron. Aron eut la rancune tenace, selon Veyne :
La conséquence fut plus amère : à la suite de ma leçon inaugurale, Aron s’écarta de moi, m’écarta de lui, lança contre moi ses élèves lorsque je revins parler à son séminaire. Il n’avait pas tort, je m’étais conduit plus que grossièrement avec lui.
Au Collège de France, Paul Veyne choisit un sujet qui, en 1975, sentait encore le souffre : l’amour et les pratiques homosexuelles dans la Rome antique. Cela fit réagir :
Dans un certain milieu, cela fit pousser des oh ! et des ah ! sur ma personne, voire sur mes mœurs ; au mieux, on me traitait de provocateur et ce qualificatif m’est longtemps resté.
Le livre peut paraître quelque peu désordonné, Paul Veyne passant sans cesse d’une idée à l’autre, pour revenir ensuite en arrière ; mais, après tout, il affirme lui-même n’avoir aucune ambition littéraire. En tout cas, il parle librement de sa vie et de ses passions, notamment pour l’escalade. Il évoque aussi les drames qui ont marqué sa vie de famille. Il parle, avec franchise, de sa peur de la mort et de son absence de foi religieuse. Il ajoute néanmoins :
J’aimerais qu’il existe « autre chose » qui nous dépasse. […] Je ne suis pas croyant, mais je voudrais bien croire en revanche à une sorte de l’immortalité de l’âme (ne me demandez pas de préciser) : à peine serai-je mort que « je » découvrirai que ce n’est pas le trou noir, le néant. Si bien que, dans l’éternité, « je » ne m’ennuierai pas.
Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas, de Paul Veyne, 2014, éditions Albin Michel.
28/09/2015
Hitchcock-Truffaut, d'Hitchcock et Truffaut
Hitchcock théoricien du cinéma
Hitchcock-Truffaut
Ce livre est constitué d’une série d’entretiens que Truffaut eut avec Hitchcock, principalement en 1966. Ce n’est pas une hagiographie, mais l’examen critique d’une œuvre. Hitchcock développe sa théorie du cinéma, explique pourquoi il a opté pour le suspense et ce qu’est le fameux Mac-Guffin.
Dans ce livre, Hitchcock, répondant aux questions de Truffaut, passe en revue les films qu’il a tournés. Il remonte à ses débuts en Angleterre, dans les années vingt, au temps du cinéma muet. En 1966, au moment où se déroulent les entretiens, il éprouve une véritable nostalgie pour le muet, qui faisait du cinéma un art cent pour cent visuel. On peut supposer que dans ses premiers films il fut influencé par Fritz Lang. Cependant, quand Truffaut lui demande quels films du cinéaste allemand il avait vus, Hitchcock ne répond pas vraiment à la question. Il reste évasif et préfère changer de sujet, comme s’il avait une gêne à parler de Fritz Lang, son aîné de quelques années, qui certainement l’a inspiré. En fait, Hitchcock préfère parler de lui, de son œuvre et de ses théories sur le cinéma.
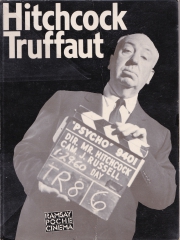 Hitchcock passe un long moment à s’expliquer sur le suspense, qui est au centre de son œuvre. Il oppose le suspense à la surprise et dit pourquoi il a préféré l’un à l’autre :
Hitchcock passe un long moment à s’expliquer sur le suspense, qui est au centre de son œuvre. Il oppose le suspense à la surprise et dit pourquoi il a préféré l’un à l’autre :
« La différence entre le suspense et la surprise est très simple et j’en parle très souvent. Pourtant, il y a fréquemment une confusion dans les films, entre ces deux notions. Nous sommes en train de parler, il y a peut-être une bombe sous cette table et notre conversation est très ordinaire, il ne se passe rien de spécial, et tout d’un coup : boum, explosion. Le public est surpris, mais, avant qu’il ne l’ait été, on lui a montré une scène absolument ordinaire, dénuée d’intérêt. Maintenant, examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public le sait, probablement parce qu’il a vu l’anarchiste la déposer. Le public sait que la bombe explosera à une heure et il sait qu’il est une heure moins le quart – il y a une horloge dans le décor ; la même conversation devient tout à coup intéressante parce que le public participe à la scène. Il a envie de dire aux personnages qui sont sur l’écran : « Vous ne devriez pas raconter des choses si banales, il y a une bombe sous la table, et elle va bientôt exploser. » Dans le premier cas, on a offert au public quinze secondes de surprise au moment de l’explosion. Dans le deuxième cas, nous lui offrons quinze minutes de suspense. »
La conclusion d’Hitchcock est qu’il faut préférer informer le public quand on le peut. Dans le même ordre d’idée, il explique ce qu’est le Mac-Guffin, qui est récurrent dans son œuvre. Le Mac-Guffin, c’est le prétexte qui permet de construire une intrigue. Il s’agit par exemple de papiers, de documents, de secrets, dont le contenu est important aux yeux des personnages du film ; mais, pour le réalisateur, ils ne sont qu’un prétexte pour mettre en danger son héros. Le principe du Mac-Guffin a été largement utilisé au cinéma, il a aussi été repris en bande dessinée, notamment dans les albums de Tintin ; ce sera le fétiche ou le sceptre royal que veulent arracher les bandits.
Selon Hitchcock, plus réussi est le méchant,
plus réussi sera le film
Hitchcock rappelle que son ambition première est de distraire les gens et qu’en conséquence filmer la vie quotidienne ne l’intéresse pas :
« Je ne filme jamais une tranche de vie car, cela, les gens peuvent très bien le trouver chez eux ou dans la rue, ou même devant la porte du cinéma. Ils n’ont pas besoin de payer pour voir une tranche de vie. […] Tourner des films, pour moi, cela veut dire d’abord, et avant tout, raconter une histoire. Cette histoire peut être invraisemblable mais elle ne doit jamais être banale. »
Hitchcock concède cependant que le spectateur accepte de s’ennuyer dans la première demi-heure d’un film, à condition qu’ensuite l’intensité dramatique suive une ligne ascendante. C’est ce qu’il appelle la courbe montante d’une histoire. Et toujours selon lui, il ne faut jamais négliger le personnage du méchant, car, dit-il, « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. »
Qu’on ne s’y méprenne pas, ce livre, n’est pas une hagiographie ; on n’y trouve aucune trace de vénération béate pour Hitchcock. Tout en étant un admirateur sincère de son œuvre, Truffaut n’hésite pas à la critiquer. Et Hitchcock lui-même, sous certaines conditions, accepte bien volontiers de se livrer à son autocritique. Truffaut en fait la remarque dans sa conclusion : « On l’a vu tout au long de ce livre, Hitchcock était plutôt sévère pour son travail, toujours lucide et volontiers autocritique… à condition toutefois que le film discuté soit ancien de quelques années et que son échec ait été compensé par une plus fraîche réussite. » Ainsi Hitchcock se félicite du succès universel de Psychose (Psycho), qui n’aura coûté que huit cent mille dollars et qui aura rapporté treize millions de bénéfices, et il émet un vœu à l’adresse de Truffaut : « J’aimerais que vous fassiez un film qui vous rapporterait autant d’argent à travers le monde ! » En revanche, il critique lourdement certains de ses films précédents ; il dit avoir honte d’avoir pris un gros salaire pour Les Amants du Capricorne (Under Capricorn), qui fut un échec ; et il dit du Faux Coupable (The Wrong Man) : « Classons ce film dans les mauvais Hitchcock », provoquant, sur ce point, le désaccord de Truffaut qui trouve des qualités à ce film.
Pour qui connaît un peu les films d’Hitchcock, ce livre est une porte d’entrée sur le monde du cinéma et le métier de réalisateur.
Hitchcock-Truffaut, d’Alfred Hitchcock et François Truffaut, 1983, collection Ramsay Poche Cinéma (épuisé) et éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre, Mémoires, autobiographie, témoignage | Tags : hitchcock, truffaut | Lien permanent | Commentaires (0)


