04/09/2017
Avril brisé, de Kadaré
Vendetta albanaise
Avril brisé
Un écrivain de Tirana emmène sa jeune épouse en voyage de noces dans les montagnes, afin de lui faire découvrir la pratique de la vendetta. Lui-même s’extasie devant la perpétuation de cette coutume sanglante qui excite son imagination de romancier, tandis que sa femme est horrifiée du nombre de morts que cela entraîne. Kadaré présente une Albanie hors du temps, qui fascine le lecteur.
Jusqu’à la chute du communisme, l’Albanie fut un pays à part, dont on ne savait pas grand-chose. Il avait la particularité de ne plus appartenir au bloc soviétique, depuis sa rupture avec l’URSS. Dénonçant toute évolution du dogme communiste, l’Albanie était alors le seul pays d’Europe à prétendre rester fidèle au stalinisme. Peu d’informations filtraient et parvenaient jusqu’à l’Ouest. Cependant, depuis la publication du Général de l’armée morte en 1969, le nom d’Ismaïl Kadaré était devenu familier des lecteurs occidentaux. Dans ces années-là, Kadaré, tout en étant surveillé, était honoré dans son pays. Il était l’auteur officiel du régime, membre de l’Union officielle des écrivains albanais et député au parlement de Tirana. Ses livres avaient la particularité d’arriver en France déjà traduits, ce qui est le cas d’Avril brisé, publié en 1982.
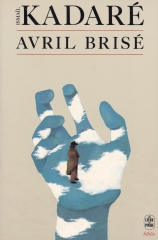 L’histoire se passe entre les deux guerres mondiales, pendant la courte période de la monarchie, sous le règne de Zog Ier. Malgré ces précisions historiques données par l’auteur, l’Albanie apparaît, sous sa plume, comme un pays hors du temps. Dans les régions montagneuses, ainsi que le découvre le lecteur, la vendetta reste couramment pratiquée. Mais elle obéit à des règles très strictes, codifiées dans un recueil appelé le Kanun.
L’histoire se passe entre les deux guerres mondiales, pendant la courte période de la monarchie, sous le règne de Zog Ier. Malgré ces précisions historiques données par l’auteur, l’Albanie apparaît, sous sa plume, comme un pays hors du temps. Dans les régions montagneuses, ainsi que le découvre le lecteur, la vendetta reste couramment pratiquée. Mais elle obéit à des règles très strictes, codifiées dans un recueil appelé le Kanun.
Gjorg des Berisha, un garçon de vingt-six ans, tue d’un coup de fusil un membre de la famille des Kryeqyqe ; il le fait, non par plaisir, mais par obligation. Tout a commencé, alors qu’il n’était même pas né, soixante-dix ans plus tôt : un soir, un voyageur inconnu fut hébergé par sa famille, puis, au petit matin, alors qu’il sortait de la maison des Berisha pour reprendre sa route, il fut tué par un Kryeqyqe ; c’était là une grave atteinte aux lois de l’hospitalité ; or le Kanun imposait aux Berisha de venger leur hôte ; c’est ainsi que la famille de Gjorg, jusqu’alors tranquille, fut prise dans le « grand mécanisme de la vendetta » et que « quarante-quatre tombes avaient été creusées depuis ».
Le Kanun est une véritable constitution de la mort
Pendant que Gjorg cherche à échapper à son tueur, Diane, une jeune femme venue de la ville, accomplit son voyage de noces dans le Rrafsh, le haut-plateau du nord. Son mari, un écrivain de Tirana du nom de Bessian Vorpsi, veut lui faire découvrir les particularités de la région. Le couple a été invité à séjourner chez le prince du sang, un notable qui recueille l’impôt dit du sang, dont doit s’acquitter auprès de lui tout meurtrier. Le versement de cet impôt doit suivre immédiatement l’homicide. Bessian Vorpsi est très fier de la persistance de ce droit coutumier, qu’il qualifie de « véritable constitution de la mort ». Il s’extasie devant la beauté du Kanun, qui excite son imagination de romancier. Face à sa jeune épouse, il déborde d’enthousiasme : « Le Rrafsh est la seule région d’Europe qui, tout en étant partie intégrante d’un Etat moderne, […] a rejeté les lois, les structures juridiques, la police, les tribunaux, bref tous les organismes d’un Etat ; qui les a rejetés, tu m’entends, car il y a été soumis une fois et il les a reniés pour les remplacer par d’autres règles morales qui sont tout aussi complètes, au point de contraindre les administrations des Etats étrangers, puis plus tard l’administration de l’Etat albanais indépendant, à les reconnaître et à laisser ainsi le plateau, soit près de la moitié du royaume, en dehors du contrôle de l’Etat. »
Dans son voyage, Bessian et Diane croisent Ali Binak, le grand exégète du Kanun, qui va de village en village régler les litiges entre les familles. Dans un cas de viol qui lui est soumis, c’est lui qui dira si la famille de la jeune fille est en droit de reprendre un sang. Le couple croise également Gjorg ; quand Diane apprend que, vraisemblablement, le jeune homme ne passera probablement pas le mois d’avril, elle est émue et s’en inquiète à voix haute. Son mari lui répond alors : « La fameuse formule que les vivants ne sont que des morts en permission dans cette vie trouve dans nos montagnes sa pleine signification. » Mais quand il mesure l’effroi provoqué chez sa femme par une telle coutume sanglante, Bessian, tel Hamlet, se met à douter.
Le lecteur est pris de sentiments contradictoires,
il est partagé entre l’effroi et la fascination
La mort est omniprésente dans ce roman qui peut paraître étrange à un lecteur occidental, tant les mœurs décrites paraissent appartenir à un autre monde, à un autre temps. Les personnages ne mettent pas le confort matériel et l’accumulation de biens au centre de leur existence, mais sont préoccupés par les questions d’honneur, quitte à mettre en jeu leur vie. Malgré son jeune âge, Gjorg des Berisha sait qu’il est condamné à très brève échéance par les Kryeqyqe, depuis qu’il leur a repris une vie. Mais au moins sait-il qu’il mourra en ayant accompli son devoir ; car, dans ce pays, il est souhaitable de mourir du fusil. Kadaré précise : « La mort naturelle, de maladie ou de vieillesse, était donc honteuse pour l’homme des hautes régions, et le seul but du montagnard dans sa vie était d’accumuler le capital d’honneur qui lui permettrait de voir ériger un petit monument à sa mort. »
Le lecteur est partagé entre des sentiments contradictoires. D’un côté il s’identifie sans mal à Diane et, comme elle, il trouve effroyables ces rites ancestraux ; mais d’un autre côté, comme Bessian, il ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine fascination devant une telle pratique.
On peut supposer que cette contradiction se retrouve chez Kadaré : si lui-même, il n’était pas quelque peu fasciné par la vendetta, jamais il n’aurait pu écrire un tel roman ; et, en même temps, il est conscient qu’il y a quelque chose de malsain dans son exaltation. Vers la fin du roman, un médecin interpelle Bessian et lui fait la leçon : « Vos livres, votre art sentent le crime. Au lieu de faire quelque chose pour les malheureux montagnards, vous assistez à la mort, vous cherchez des motifs exaltants, vous recherchez de la beauté pour alimenter votre art. Vous ne voyez pas que c’est une beauté qui tue, comme l’a dit un jeune écrivain que vous n’aimez sûrement pas. » Ce « jeune écrivain », c’est probablement Kadaré qui se cite lui-même, comme pour se remettre les idées en place et se rappeler que l’écrivain a une responsabilité morale dans la société.
Avril brisé, d’Ismaïl Kadaré, 1982, collection Le Livre de poche.
10:15 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : avril brisé, kadaré | Lien permanent | Commentaires (0)
16/03/2015
Le Général de l'armée morte, de Kadaré
Un roman envoûtant
Le Général de l’armée morte
Vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale, un général est chargé par son pays de rapatrier les corps des soldats tombés en Albanie. Dans sa mission, il est accompagné d’un prêtre. Ils voyagent dans un pays rude, au milieu d’un peuple hostile. Le Général de l’armée morte est le roman qui a fait connaître Kadaré à travers l’Europe.
« Il était une fois un général et un prêtre partis à l’aventure. Ils s’en étaient allés ramasser les restes de leurs soldats tués dans une grande guerre. Ils marchèrent, marchèrent, franchirent bien des montagnes et des plaines, cherchant et ramassant ces cendres. Le pays était rude et méchant. Mais ils ne rebroussèrent pas chemin et poussèrent toujours de l’avant. » C’est ainsi que Kadaré lui-même résume son roman en ouverture de l’un des chapitres.
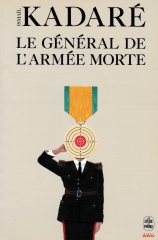 Vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale, un général se voit confier une mission : pour le compte de son pays, il doit se rendre en Albanie afin d’ouvrir les tombes des soldats enterrés sur place, l’objectif étant de rapatrier leurs dépouilles. Le nom du général n’est jamais mentionné, pas plus que sa nationalité. En tout cas, les Albanais le considèrent comme le représentant de la puissance fasciste les ayant envahis en 1939. Donc Il s’agit vraisemblablement d’un général italien, mais dans le livre l’Italie n’est jamais nommément citée, si bien qu’un doute subsiste.
Vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale, un général se voit confier une mission : pour le compte de son pays, il doit se rendre en Albanie afin d’ouvrir les tombes des soldats enterrés sur place, l’objectif étant de rapatrier leurs dépouilles. Le nom du général n’est jamais mentionné, pas plus que sa nationalité. En tout cas, les Albanais le considèrent comme le représentant de la puissance fasciste les ayant envahis en 1939. Donc Il s’agit vraisemblablement d’un général italien, mais dans le livre l’Italie n’est jamais nommément citée, si bien qu’un doute subsiste.
Dans sa mission, le général est accompagné d’un prêtre, probablement catholique, mais là encore un certain flou demeure. Leur tâche est macabre, et pourtant, selon Kadaré, le général est fier de la mission dont il est investi : « Des milliers de mères attendaient leurs fils. Il y avait plus de vingt ans qu’elles se morfondaient […]. C’est lui qui porterait à ces mères éplorées les cendres de leurs enfants que de sots généraux n’avaient pas su conduire habilement au combat. »
Le général doit retrouver une dépouille en particulier, celle du colonel Z. Le colonel Z était le chef du Bataillon bleu, un régiment redouté qui a mené des expéditions punitives et dévasté de nombreux villages albanais. Avant son départ, le général a rencontré la jeune veuve du colonel Z et lui a promis de faire tout son possible pour lui ramener les restes de son mari.
Le lecteur accompagne le général et le prêtre dans leur campagne de fouilles. Le dépaysement est entier. Les deux hommes voyagent à travers les montagnes albanaises. Le paysage et le climat sont rudes. Le général a froid, il souffre de l’humidité, il couche sous la tente, il roule sur des routes boueuses et traverse des villages hostiles. Mais il croit tellement en l’importance de sa mission. Et, petit à petit, il se laisse fasciner par la personnalité du colonel Z : qui état-il vraiment ? dans quelles circonstances est-il mort ? où son corps peut-il bien reposer ? Le général a peu d’indications à sa disposition ; il sait cependant que le colonel Z mesurait un mètre quatre-vingt-deux et, dès qu’il découvre un cadavre de cette taille, il ne peut s’empêcher de penser à lui.
Toutes les tombes
sont passées au désinfectant
L’ouverture des tombes n’est pas sans danger. Toutes les fosses sont systématiquement passées au désinfectant, car, au contact de l’air, les microbes se réveillent, même vingt ans après. Sous terre, ils n’ont fait que dormir et sont prêts à retrouver leur vigueur, d’où un risque réel d’infection pour les ouvriers.
Pendant les longs mois que dure leur mission, le général et le prêtre cohabitent et s’observent mutuellement. Le prêtre trouve que le général insiste trop sur la boisson, tandis que le général se demande quelle sorte de relation le prêtre a entretenue avec la jeune veuve du colonel Z, qu’il a fréquentée avant son départ. Les deux hommes ne sont pas les seuls à avoir été investis d’une mission telle que la leur. Sur leur route, ils croisent un lieutenant-général et un maire, représentant une autre puissance étrangère, chargés, eux aussi, de rapatrier leurs morts. Mais, du fait qu’ils sont moins bien organisés, le lieutenant-général et le maire ne sont pas très efficaces. Bientôt ils sont tentés de faire du chiffre et ne se montrent pas trop regardants sur la nationalité des cadavres qu’ils déterrent.
Le livre est l’occasion de découvrir l’Albanie, le pays de Kadaré, qui, dans les années soixante, vivait complètement coupée du monde. A l’époque, c’était un Etat communiste, mais qui ne faisait pas partie du bloc soviétique. C’est un pays de montagnes, c’est une terre rude qui est habitée, nous dit Kadaré, par un peuple rompu à la guerre. Le prêtre, qui lui-même parle l’albanais, s’en explique au général : « La guerre constitue, pour ainsi dire, une fonction organique de cette nation, elle lui a intoxiqué le sang comme chez d’autres l’alcool. Voilà pourquoi la guerre ici a été vraiment horrible. »
Le moment le plus macabre de l’histoire se situe paradoxalement au milieu d’une fête de mariage. Un soir, de passage dans un village, le général se sent las de sa mission, il veut se distraire et s’invite à une noce célébrée par des autochtones. Ces derniers sont d’abord choqués de l’impudence du général, qui vient sans être invité, mais au nom de la tradition ils ne lui refusent pas l’hospitalité et se montrent accueillants à son égard. Ce passage est le point culminant du roman. Il lui donne une dimension onirique, ou plutôt cauchemardesque.
Le Général de l’armée morte est un récit étrange enveloppé d’un halo de mystère. C’est vraiment un livre envoûtant.
Le Général de l’armée morte, d’Ismaïl Kadaré, 1969, collection Le Livre de poche.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : le général de l'armée morte, kadaré | Lien permanent | Commentaires (0)


