05/12/2016
VGE, une vie, de Georges Valance
Biographie comblant une lacune
VGE
Une vie
C’est l’une des rares biographies du plus jeune président de la Ve République. Georges Valance fait le portrait d’un chef d’Etat réformateur. Giscard voulut adapter la loi aux mœurs et fit passer des mesures qui étaient le fruit de sa réflexion personnelle. Bien qu’expert en matière monétaire, il peina à comprendre la nature et l’ampleur de la crise économique, mais il fit preuve de rigueur dans la gestion des comptes publics.
« Giscard n’a pas la place qu’il mérite dans l’histoire contemporaine de notre pays », déplore Georges Valance dans l’avant-propos du livre qu’il lui consacre. Il est vrai que pléthore de biographies ont été consacrées à de Gaulle et Mitterrand, mais quasiment aucune n’avait été écrite sur Giscard. Pourtant son septennat et l’ensemble de son parcours méritent d’être racontés. Le livre de Georges Valance comble d’autant mieux cette lacune qu’il ne s’agit pas d’une hagiographie, l’auteur n’hésitant pas à critiquer son personnage et à souligner ses petitesses et ses insuffisances. Le sous-titre de l’ouvrage, Une vie, renvoie au célèbre roman de Maupassant, l’écrivain préféré de Giscard.
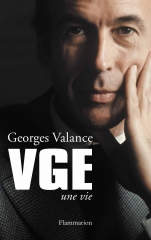 Par le passé, on a abondamment glosé sur les origines faussement aristocratiques de Giscard. Valance ne fait pas l’impasse là-dessus et retrace l’historique des démarches administratives effectuées par Edmond Giscard, père de Valéry, pour relever le nom de famille d’Estaing. Si les prétentions nobiliaires de VGE sont notoires, ce qui est moins connu, en revanche, c’est sa participation à la Seconde Guerre mondiale.
Par le passé, on a abondamment glosé sur les origines faussement aristocratiques de Giscard. Valance ne fait pas l’impasse là-dessus et retrace l’historique des démarches administratives effectuées par Edmond Giscard, père de Valéry, pour relever le nom de famille d’Estaing. Si les prétentions nobiliaires de VGE sont notoires, ce qui est moins connu, en revanche, c’est sa participation à la Seconde Guerre mondiale.
En octobre 1944, alors âgé de dix-huit ans, il rejoignit la Ière armée commandée par le général de Lattre de Tassigny ; il se battit courageusement en Allemagne, obtint une citation à l’ordre de l’armée et se vit décerner la croix de Guerre. Valance analyse cet engagement comme l’« acte fondateur de son destin politique. Sans cet engagement, poursuit-il, ce grand bourgeois issu d’une famille aux relents vichyssois ne serait jamais sans doute devenu président de la République. »
En tant qu’ancien combattant, Giscard bénéficia du droit de passer le concours d’entrée à l’école Polytechnique dans le cadre d’une « session spéciale », et fut brillamment reçu. Puis, quelques années plus tard, en vertu d’une loi nouvelle le dispensant de l’épreuve du concours, il obtint d’intégrer la toute nouvelle Ecole nationale d’administration, l’Ena. Les relations que sa famille entretenait avec de hautes personnalités donnèrent un coup de fouet à sa carrière.
« Ce n’était pas le bon M. Pinay qui travaillait le plus.
Giscard d’Estaing faisait tout le boulot derrière lui. »
En 1959, à l’avènement de la Ve République, il fut nommé, à seulement trente-deux ans, secrétaire d’Etat aux Finances. Il faut reconnaître que le jeune homme est brillant et actif. Il fait souvent le travail du ministre en titre, Antoine Pinay, trop content de se décharger sur lui pour aller, par exemple, défendre le budget devant les députés. De Gaulle ne s’y trompe pas, il apprécie son jeune secrétaire d’Etat qui, très habilement, lui explique en quoi les finances sont, pour la défense nationale, aussi importantes que les armées. De Gaulle déclara : « En réalité, ce n’était pas le bon M. Pinay qui travaillait le plus, mais son secrétaire d’Etat, VGE […]. Giscard d’Estaing faisait tout le boulot derrière lui. »
En janvier 1966, Giscard était ministre des Finances quand il fut brusquement remercié de la Rue de Rivoli. Ayant le sentiment d’avoir été congédié comme un domestique, il n’hésita plus à critiquer de Gaulle en public ; il y eut le fameux « oui mais », puis la dénonciation de l’ « exercice solitaire du pouvoir » et enfin le « non » au Général à l’occasion du référendum de 1969.
A l’été 1968, François Mauriac se montre prophétique quand il voit en Giscard le « plus jeune président de la République qu’il sera, s’il plaît à Dieu et s’il n’y a pas d’accident de parcours. »
Rallié à Pompidou à l’élection présidentielle de 1969, Giscard retrouva ses chères Finances et devint un serviteur loyal du nouveau chef de l’Etat. La France vivait encore dans la prospérité des Trente Glorieuses. Mais une époque se termina quand en 1971 les Etats-Unis dénoncèrent les accords de Bretton-Woods et firent flotter le dollar. Ce fut le début de l’instabilité monétaire qui allait conduire au premier choc pétrolier et à la crise économique. A priori Giscard est très à l’aise pour traiter ces questions, car, selon Valance, il a une « expertise incontestée des questions monétaires […] qui se révèlera des plus précieuses ».
L’élection de Giscard en 1974
fut l’une des plus spectaculaires victoires de l’histoire politique
En 1974, à la mort de Pompidou, Giscard est l’outsider de la campagne présidentielle qui s’ouvre et qui s’annonce très courte. Les sondages le place loin derrière Mitterrand et Chaban-Delmas. Mais, pendant les trois semaines que dure cette campagne, Giscard rattrape son retard, et finalement c’est lui qui gagne l’élection. Georges Valance, dithyrambique, parle de « brillante victoire électorale », « une des plus spectaculaires » de l’histoire politique, qui plus est emportée après une campagne menée avec « une certaine dose d’improvisation ». Mais Valance ajoute aussitôt au sujet du vainqueur : « Peut-être d’ailleurs en tirera-t-il une confiance excessive en soi, ce qui sera pour une part à l’origine de la défaite de 1981. »
Une fois à l’Elysée, Giscard, jeune président de quarante-huit ans, se donna pour mission d’adapter la législation à l’évolution des mœurs. Il fit voter un train de réformes qu’on qualifierait aujourd’hui de sociétales. Ainsi la première décision adoptée en conseil des ministres fut l’abaissement de l’âge de la majorité de vingt-et-un ans à dix-huit ans. Suivirent de très nombreuses autres mesures : légalisation de l’avortement ; instauration du divorce par consentement mutuel ; première loi en faveurs des handicapés ; mise en place de la retraite à soixante ans pour les métiers pénibles... Valance insiste sur le fait que le nouveau président est sincère dans sa volonté de changement : « Giscard conceptualise lui-même ses réformes, alors que la plupart des hommes politiques dits réformateurs ne font que mettre en œuvre des idées soufflées par leurs conseillers ou des experts. » Pour étayer son propos, Valance cite Yves Cannac, ancien collaborateur du président : « Les réformes venaient vraiment de lui. Il attendait de ses collaborateurs des conseils pratiques sur des textes et leur mise en œuvre. Pas des idées. »
Mais très vite, le jeune président réformateur est rattrapé par la crise économique consécutive au choc pétrolier de 1973. Et, comme beaucoup de ses contemporains, il peine à comprendre ce qui se passe, et met du temps à percevoir la nature et la portée de la crise. Alors que les prix s’envolent (plus de 15% d’inflation en 1974), Giscard demande à son ministre des Finances, Jean-Pierre Fourcade, de mettre au point un « plan de "refroidissement de l’inflation" ». « Mais, écrit Georges Valance, dans sa logique de frigidaire, il réussit à la fois trop bien et trop mal, car il refroidit en fin de compte davantage la croissance que l’inflation. » Et, sur ce point, Valance conclut : « Le plan Fourcade a bel et bien cassé la croissance. »
Le président fait alors un virage à 180° degrés et met en place un plan de relance, ainsi que le réclame son bouillonnant premier ministre, Jacques Chirac. C’est à nouveau l’échec.
Jamais Giscard ne lâcha Barre
Giscard change à nouveau son fusil d’épaule. Il fait appel à Raymond Barre qu’il proclame « meilleur économiste français, en tout cas un des tous premiers ». En août 1976, Barre est nommé premier ministre et le demeurera jusqu’à l’élection présidentielle de 1981. Pour Giscard, il est le « Joffre de l’économie », chargé d’arrêter l’inflation comme Joffre arrêta les Allemands sur la Marne. Barre impose à la fois le blocage des prix et des tarifs, ainsi qu’une cure d’austérité. Le cap est définitivement fixé et Giscard ne changera plus de route. « Malgré les critiques, précise Valance, jamais Barre ne calera et jamais Giscard ne le lâchera. »
Le pouvoir trouva un nouveau souffle avec une victoire inattendue aux élections législatives de 1978. L’année suivante, Giscard enregistra un nouveau succès : les élections européennes furent marquées par le triomphe de l’UDF, parti du président, et par le piètre score du RPR et de Jacques Chirac, devenu son opposant. Cependant, il s’agit, selon Valance de « victoires à la Pyrrhus » dont Giscard n’arriva pas à tirer parti. L’affaire des Diamants, révélée par Le Canard enchaîné et reprise en une du Monde, ternit la réputation du président, qui ne sut pas répondre aux attaques. Le second choc pétrolier, en 1979, cassa la reprise de la croissance et aggrava la crise. Et la rébellion de Chirac et de son RPR compliqua la donne. L’impopularité de Giscard (à relativiser) s’accrut d’autant plus qu’il refusa toute mesure à caractère électoraliste, malgré l’approche de l’élection de 1981. Valance voit dans son refus d’un virage électoraliste une « décision courageuse et risquée ». Dans ces conditions, la défaite de Giscard en 1981 n’apparaît pas, avec le recul, comme une surprise. Valance fait une comparaison : « En 1974, Giscard avait emmené ses troupes au galop. En 1981, Murat est devenu Gamelin, menant une "drôle de guerre" au grand désappointement de ses lieutenants. »
Après avoir évoqué le narcissisme du personnage et son intelligence si analytique qu’elle ne lui a pas permis de comprendre un caractère comme celui de Chirac, Georges Valance rend hommage à Giscard, notamment pour sa gestion des comptes publics : « Sa gestion budgétaire a toujours été rigoureuse, et si les deux chocs pétroliers conduisirent le pays à s’endetter pour faire face à la ponction étrangère, ce fut toujours dans les limites du supportable. » Valance poursuit en constatant la pérennité de ses réformes : « Quant aux réformes intérieures, il n’est pas de plus bel hommage que de remarquer qu’elles ont subi sans dommage l’épreuve du temps, alors que celles de son successeur François Mitterrand ont été rabiotées (parfois par les socialistes eux-mêmes) ou corrigées. »
A lire Georges Valance, on peut avoir l’impression que, selon lui, la France se serait mieux portée si Giscard avait été à l’Elysée de 1981 à 1988.
VGE, Une vie, de Georges Valance, 2011, éditions Flammarion.
08:49 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : vge, giscard, georges valance | Lien permanent | Commentaires (0)
21/11/2016
Mémoires d'outre-tombe, de Chateaubriand, Livres I à XII
Monument de la littérature
Mémoires d’outre-tombe
Livres I à XII
En écrivant les Mémoires d’outre-tombe Chateaubriand a érigé une statue à sa propre gloire dans le but de passer à la postérité. Il prend le lecteur par la main et celui-ci n’a qu’à se laisser guider. L’ensemble est vivant, les chapitres sont courts et le style de l’auteur est fluide. Dans les livres I à XII, Chateaubriand évoque son enfance à Combourg, les débuts de la Révolution et son voyage en Amérique.
Selon la volonté de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe furent publiés après sa mort, d’où leur titre. L’auteur narre les principaux épisodes de sa vie, il retrace également les grands événements de l’Histoire auxquels il a été mêlé et évoque les grands personnages qu’il a croisés sur sa route, donnant à son œuvre un aspect de fresque épique.
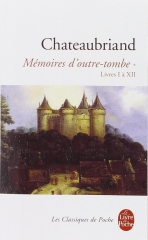 Chateaubriand a vécu la Révolution française, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet ; il a rencontré Washington en Amérique ; il a été en pèlerinage à Jérusalem ; il a assisté à la fin de la féodalité et aux débuts de la Révolution industrielle. Les Mémoires d’outre-tombe constituent un témoignage de première importance pour comprendre une époque qui a été marquée par de grandes transformations. Peu importe que son imagination débordante conduise Chateaubriand à se rappeler des faits qui ne sont peut-être jamais produits ; ce qui compte, c’est que par la force de son écriture et de ses évocations, il amène le lecteur à s’identifier à lui et à se plonger dans les périodes qu’il a traversées.
Chateaubriand a vécu la Révolution française, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet ; il a rencontré Washington en Amérique ; il a été en pèlerinage à Jérusalem ; il a assisté à la fin de la féodalité et aux débuts de la Révolution industrielle. Les Mémoires d’outre-tombe constituent un témoignage de première importance pour comprendre une époque qui a été marquée par de grandes transformations. Peu importe que son imagination débordante conduise Chateaubriand à se rappeler des faits qui ne sont peut-être jamais produits ; ce qui compte, c’est que par la force de son écriture et de ses évocations, il amène le lecteur à s’identifier à lui et à se plonger dans les périodes qu’il a traversées.
Les Mémoires d’outre-tombe sont une œuvre (constituée de trente-quatre livres) qui, par sa longueur, peut donner le vertige à qui voudrait se lancer dedans. Mais, en réalité, l’ensemble est aéré, car les chapitres sont courts. Et surtout, le style de l’auteur est fluide et vivant, ce qui rend la lecture aisée. On peut presque dire que Chateaubriand prend le lecteur par la main, et que celui-ci n’a qu’à se laisser guider, quitte à s’arrêter sur certaines phrases pour bien s’en imprégner.
Les Mémoires d’outre-tombe sont un monument de la littérature et sont aussi un monument que Chateaubriand a édifié à sa propre gloire dans le but de passer à la postérité, alors qu’il craignait d’être oublié des générations à venir.
***
Les livres I à XII, consacrés par Chateaubriand à ses années de jeunesse, ont été regroupés en un volume de la collection Le Livre de poche, l’ensemble des mémoires faisant quatre tomes.
La solitude de Combourg
François-René de Chateaubriand naquit en 1768 à Saint-Malo. Le petit René avait un frère et quatre sœurs, dont il était le cadet. Il était très proche de sa sœur Lucile ; tous deux vivaient auprès de leurs parents en Bretagne. M. de Chateaubriand, seigneur de l’Ancien Régime, s’était retiré dans son château de Combourg, au nord de Rennes (voyez l’illustration de couverture ci-dessus). Il y menait une vie triste et solitaire, ne recevant quasiment aucun visiteur. Selon René, son père était un homme redouté qui inspirait la crainte :
M. de Chateaubriand était grand et sec; il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits et pers ou glauques, comme ceux des lions ou des anciens barbares. Je n’ai jamais vu un pareil regard : quand la colère y montait, la prunelle étincelante semblait se détacher et venir vous frapper comme une balle.
Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. Son état habituel était une tristesse profonde que l’âge augmenta et un silence dont il ne sortait que par des emportements. Avare dans l’espoir de rendre à sa famille son premier éclat, hautain aux états de Bretagne, dur avec ses vassaux à Combourg, taciturne, despotique et menaçant dans son intérieur, ce qu’on sentait en le voyant était la crainte.
« Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été »
Chateaubriand introduit le lecteur dans le quotidien de Combourg. Son père était le premier levé le matin :
Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été : il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre, à l’entrée de l’escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à cinq heures ; il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu’à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre, à huit heures du matin. Je n’avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner ; j’étais censé étudier jusqu’à midi : la plupart du temps, je ne faisais rien.
Les soirées à Combourg se déroulaient dans une atmosphère lourde. Ni Lucille, ni René, ni leur mère, saisis de terreur, n’osaient avoir de conversation en présence de M. de Chateaubriand. Quand dix heures sonnaient à l’horloge du château, M. de Chateaubriand tirait sa montre, la montait, embrassait ses enfants et se retirait pour se coucher. Les portes se refermaient sur lui, et alors :
Le talisman était brisé ; ma sœur, ma mère et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles : si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher.
François-René de Chateaubriand est né dans une famille noble, mais, ainsi qu’il le souligne, cela fut le fruit du hasard. Il n’en tire aucune vanité et juge sans complaisance son milieu social :
Je suis né gentilhomme. Selon moi, j’ai profité du hasard de mon berceau, j’ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l’aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L’aristocratie a trois âges successifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités : sortie du premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier.
Chateaubriand est présenté au Roi à Versailles
« Obscur cadet de Bretagne », le jeune Chateaubriand, âgé de dix-huit ans, fait ses débuts à la cour à Versailles. Un matin de février 1787, dans le salon de l’Œil-de-Bœuf, au milieu des courtisans, il est là à attendre le lever du Roi. Sous le règne de Louis XVI, la cérémonie du lever semble réduite à une fonction symbolique :
La chambre à coucher du Roi s’ouvrit : je vis le Roi, selon l’usage, achever sa toilette, c’est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service.
Le lendemain, le « débutant » Chateaubriand est invité à chasser avec le Roi dans la forêt de Saint-Germain. Au cours de la chasse, après qu’un chevreuil eut été abattu, Louis XVI dit à Chateaubriand : « Il n’a pas tenu longtemps ! » Et, dans ses mémoires, Chateaubriand a ce commentaire : « C’est le seul mot que j’aie jamais obtenu de Louis XVI. »
Chateaubriand critique les dépenses de la monarchie,
les dettes des princes et les acquisitions de châteaux
Avec le recul des années, malgré son attachement aux Bourbons et à la monarchie, Chateaubriand critique sévèrement les excès de dépenses dans le budget de la maison du Roi et dénonce « les dettes des princes, les acquisitions de châteaux et les déprédations de la cour », le terme de déprédation devant s’entendre ici au sens de « détournement d’argent ». Par ailleurs, Chateaubriand a conscience des contradictions de la société française :
A cette époque, tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d’une révolution prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tournaient en moquerie la gravité de leurs pères. […] Le prêtre, en chair, évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du législateur des chrétiens ; les ministres tombaient les uns sur les autres ; le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d’être Américain à la ville, Anglais à la cour, Prussien à l’armée ; d’être tout, excepté Français. Ce que l’on faisait, ce que l’on disait était une suite d’inconséquences. On prétendait garder des abbés commendataires, et l’on ne voulait point de religion ; nul ne pouvait être officier s’il n’était gentilhomme, et l’on déblatérait contre la noblesse ; on introduisait l’égalité dans les salons et les coups de bâton dans les camps.
Chateaubriand spectateur des débuts de la Révolution
Le 14 juillet 1789, à Paris, Chateaubriand était le « spectateur » de la prise de la Bastille, qu’il qualifie d’« assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur ». Il décrit les « orgies » qui suivirent et ironise sur la multiplication des clefs qui se produisit : « Les clefs de la Bastille se multiplièrent ; on en envoya à tous les niais d’importance dans les quatre parties du monde. » Cependant, avec le recul, Chateaubriand mesure la portée de l’événement :
Tout événement, si misérable ou si odieux qu’il soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et qu’il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté : ce qu’il fallait voir dans la prise de la Bastille (et qu’on ne vit pas alors), c’était, non l’acte violent de l’émancipation d’un peuple, mais l’émancipation même, résultat de cet acte.
« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable,
de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste »
Quelques jours après le 14 juillet 1789, Chateaubriand était aux fenêtres de son hôtel avec ses sœurs, quand :
Nous entendons crier : « Fermez les portes ! Fermez les portes ! » Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue ; du milieu de ce groupe s’élevaient deux étendards que nous ne voyions pas bien de loin. Lorsqu’ils s’avancèrent, nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées, que les devanciers de Marat portaient au bout d’une pique : c’était les têtes de MM. Foulon et Bertier. […] Ces têtes, et d’autres que je rencontrai bientôt après, changèrent mes dispositions politiques ; j’eus horreur des festins de cannibales […].
Chateaubriand eut d’abord de la sympathie pour les idées nouvelles, mais il fut dégoûté par le déchainement de violence de la Révolution :
La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique, et je reculai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste.
Paradoxalement, malgré la violence des événements, la vie culturelle est intense et les Parisiens sortent beaucoup. Chateaubriand s’en explique :
Les effets de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. […] Dans tous les coins de Paris, il y avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des spectacles ; les renommées futures erraient dans la foule sans être connues, comme les âmes au bord du Léthé avant d’avoir joui de la lumière. J’ai vu le maréchal Gouvion Saint-Cyr remplir un rôle, sur le théâtre du Marais, dans la Mère coupable de Beaumarchais. […] Aux théâtres, les acteurs publiaient les nouvelles ; le parterre entonnait des couplets patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient la foule : un abbé paraissait sur scène ; le peuple lui criait : « Calotin ! calotin ! » et l’abbé répondait : « Messieurs, vive la nation ! »
Dans le Nouveau-Monde
Chateaubriand rencontre Washington
Dégoûté par la violence révolutionnaire, l’idée de quitter la France pour quelque pays lointain germait dans l’esprit de Chateaubriand. En 1791, il s’embarqua pour l’Amérique. Arrivé là-bas, il remarqua que d’autres Français l’avaient précédé, la jeune République offrant l’asile à des émigrés qui n’avaient pas les mêmes idées que lui. « Une terre de liberté, note Chateaubriand, offrait un asile à ceux qui fuyaient la liberté : rien ne prouve mieux le haut prix des institutions généreuses que cet exil volontaire du pouvoir absolu dans une pure démocratie. »
A Philadelphie, muni d’une lettre de recommandation, Chateaubriand se présente au palais du président des Etats-Unis : « une petite maison, ressemblant aux maisons voisines ». Il est introduit auprès du général Washington, un homme « d’une grande taille, d’un air calme et froid plutôt que noble. » Le président lui parla « par monosyllabes anglais et français », et l’invita à dîner le soir suivant. Or, ce soir-là, à table, les cinq ou six convives présents parlèrent des événements en France, et il se passa ceci :
La conversation roula sur la Révolution française. Le général nous montra une clef de la Bastille [envoyée par La Fayette]. Ces clefs, je l’ai déjà remarqué, étaient des jouets assez niais qu’on distribuait alors. […] Si Washington avait vu dans les ruisseaux de Paris les vainqueurs de la Bastille, il aurait moins respecté sa relique.
Chateaubriand déplore la quasi-absence
de la langue française en Amérique
Dans un passage des Mémoires rédigé en 1822, Chateaubriand est assez critique sur l’Amérique du Nord, notamment quant au sort réservé aux tribus indiennes, « car, note-il, les puissances civilisées, républicaines et monarchiques, se partagent sans façon en Amérique des terres qui ne leur appartiennent pas. »
Aux Etats-Unis, il fut « fort scandalisé de trouver partout le luxe des équipages, la frivolité des conversations, l’inégalité des fortunes, l’immoralité des maisons de banque et de jeu, le bruit des salles de bal et de spectacle. »
Cependant, dans la version des Mémoires revue en 1846, Chateaubriand reste fasciné par le prodigieux essor que connaissent les Etats-Unis et notamment leurs villes. Ainsi il souligne qu'en 1791, « New-York était loin d’être ce qu’elle est aujourd’hui, loin de ce qu’elle sera dans quelques années : car les Etats-Unis croissent plus vite que ce manuscrit. »
Chateaubriand déplore la quasi-absence de la France dans le Nouveau Monde, suite à la perte du Canada sous Louis XV et la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte ; et il laisse entrevoir le déclin du rayonnement de la langue française :
Nous sommes exclus du nouvel univers, où le genre humain recommence : les langues anglaise, portugaise, espagnole, servent en Afrique, en Asie, dans l’Océanie, dans les îles de la mer du Sud, sur les continents des deux Amériques, à l’interprétation de la pensée de plusieurs millions d’hommes ; et nous, déshérités des conquêtes de notre courage et de notre génie, à peine entendons-nous parler dans quelques bourgades de la Louisiane et du Canada, sous une domination étrangère, la langue de Colbert et de Louis XIV : elle n’y reste que comme un témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique.
Apprenant l’arrestation du Roi à Varennes, Chateaubriand décida de rentrer en France. Il débarqua en Bretagne, embrassa sa mère à Saint-Malo, et se maria ; ou plutôt, comme il le dit lui-même, on le maria. Puis il rejoignit l’armée des princes, se battit aux côtés des émigrés et passa en Angleterre. C’est en exil qu’il apprit l’arrestation de sa mère et de ses sœurs et l’exécution de son frère aîné.
Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand, 1848, Livres I à XII, collection Le Livre de poche.
08:39 Publié dans Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre, Mémoires, autobiographie, témoignage | Tags : mémoires d'outre-tombe, chateaubriand | Lien permanent | Commentaires (2)
11/10/2016
C'était les Daudet, de Stéphane Giocanti
Une histoire littéraire de la IIIème République
C’était les Daudet
L’histoire de la famille Daudet, telle que la raconte Stéphane Giocanti, se confond avec celle de la IIIème République. Alphonse Daudet devint un écrivain à succès suite à la défaite de 1870. Son fils aîné, Léon, fut d’abord le « fils privilégié de la République », avant d’en être son adversaire en tant que rédacteur en chef de L’Action française. Cependant le réactionnaire Léon Daudet surprit par ses choix esthétiques d’avant-garde.
Le jeudi 12 février 1891, MM. Jules Ferry, Georges Clemenceau, Victor Schœlcher, Emile Zola, Edmond de Goncourt et bien d’autres hautes personnalités, se retrouvent dans la salle des fêtes de la mairie du XVIème arrondissement de Paris. Ils sont invités à la célébration du mariage de M. Léon Daudet et Mlle Jeanne Hugo. Le fils aîné de l’écrivain Alphonse Daudet épouse la petite fille de Victor Hugo, immortalisée par le poème « Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir ». L’ombre du grand homme, mort six ans auparavant, plane sur la cérémonie. Conformément aux vœux laissés par le défunt, seul un mariage laïc est célébré. Cette journée offre, selon Stéphane Giocanti, « un grand moment de communion officielle en plein âge d’or de la IIIème République, à l’heure où le régime tout entier semble célébrer une stabilité durement acquise. »
 Le livre de Stéphane Giocanti montre l’importance prise par la famille Daudet dans la IIIème République naissante. Au départ, il y eut Alphonse, né en 1840, dans cette Provence à laquelle il resta attaché toute sa vie et qui inspira une bonne partie de son œuvre. En 1857, il monta à Paris rejoindre son frère aîné et devint le secrétaire du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III. Il publia Les Lettres de mon moulin, qui furent saluées par la critique, mais qui, dans un premier temps, ne rencontrèrent pas leur public.
Le livre de Stéphane Giocanti montre l’importance prise par la famille Daudet dans la IIIème République naissante. Au départ, il y eut Alphonse, né en 1840, dans cette Provence à laquelle il resta attaché toute sa vie et qui inspira une bonne partie de son œuvre. En 1857, il monta à Paris rejoindre son frère aîné et devint le secrétaire du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III. Il publia Les Lettres de mon moulin, qui furent saluées par la critique, mais qui, dans un premier temps, ne rencontrèrent pas leur public.
Le jeune Alphonse était un homme à femmes qui menait une vie de bohème. Sa rencontre avec Mlle Julie Allard allait le corriger. Ils se marièrent en 1867, et, dès lors, Mme Alphonse Daudet décida de faire de son mari un grand écrivain. Leur fils cadet, Lucien, reconnut, bien des années après, l’influence exercée par sa mère sur son père : « Jeune fille aussi belle que cultivée, elle avait décidé que ce bohème fantaisiste […] deviendrait, par sa volonté à elle, un homme rangé, un bon mari, un excellent père et le grand écrivain qu’il allait être. » L’importance prise par Madame dans le couple fut telle, que de mauvaises langues firent circuler la rumeur selon laquelle c’était elle qui écrivait les livres de Monsieur.
La défaite de 1870 donna aux œuvres d’Alphonse Daudet une résonnance particulière. Tout d’un coup il se trouva en phase avec les préoccupations de la société, et ses livres rencontrèrent de nombreux lecteurs. Dans Les Contes du lundi, Alphonse Daudet annonce, selon Stéphane Giocanti, « le patriotisme qui prévaudra tout au long des années 1880, lorsque l’Etat républicain sera consolidé, mais avec des touches merveilleusement poétiques, ici tendres, ailleurs acérées. » Sur le plan politique, Alphonse Daudet n’était ni royaliste, ni bonapartiste, ni même particulièrement républicain, mais c’était un ardent patriote qui pleurait les provinces perdues. Son conte La Dernière Classe est d’autant plus émouvant qu’il avait lui-même parcouru l’Alsace, sac au dos, avant la guerre.
Léon Daudet imposa Proust, se battit pour Céline,
défendit Gide et s’enthousiasma pour Debussy, puis Picasso
Dans ce contexte, le fils aîné des Daudet, Léon, devint, selon Stéphane Giocanti, « le fils privilégié de la République ». Il entama des études de médecine, mais les abandonna au bout de quelques années, après avoir échoué au concours d’internat. Il en tira un roman intitulé Les Morticoles, qui se révéla dévastateur pour l’académie de médecine et les mandarins. Comme son père, le jeune Léon n’avait pas d’idées politiques arrêtées. Son mariage avec Jeanne Hugo fut un échec. Ils divorcèrent, puis Léon épousa sa cousine Marthe Allard. N’ayant pas été marié religieusement à Jeanne Hugo, il put épouser sa cousine à l’église. C’est dans les années qui suivirent et sous l’influence de sa nouvelle femme, que Léon revint au catholicisme de sa jeunesse et épousa les idées royalistes. Il rencontra Maurras et devint rédacteur en chef de L’Action française.
A la tête du journal, Léon Daudet acquit une réputation de royaliste de choc et de pamphlétaire sans merci. Malgré tout, il garda une grande indépendance d’esprit et une liberté totale dans ses choix littéraires, qui purent heurter sa famille politique.
Son père avait été l’exécuteur testamentaire d’Edmond de Goncourt, mais était mort peu après. En conséquence, c’est Léon qui mit en place l’académie dont les frères Goncourt avaient rêvé. Il en devint le président à la suite d’Huysmans et voulut imposer ses choix. En 1919, il fit campagne pour que le prix Goncourt fût décerné à A la recherche du temps perdu : A l’ombre des jeunes filles en fleur. L’ardent patriote qu’il était, préféra, au lendemain de la Grande Guerre, récompenser l’œuvre de Proust, plutôt que Les Croix de bois, de Dorgelès. Il faut dire que Lucien son frère cadet lui avait fait découvrir Proust, dont il était plus que le confident.
« Les lettre ne sont point un divertissement de jeunes filles,
et la vraie bibliothèque n’est pas rose. »
Dans les années 1930, Léon Daudet se battit pour Céline ; mais, cette fois-ci, il échoua ; et le Goncourt alla aux Loups, de Mazeline. Il défendit également Gide, malgré les idées très différentes des siennes que ce dernier professait.
Conscient que ses choix esthétiques pouvaient déconcerter ses lecteurs, Léon Daudet se justifia en écrivant : « La question morale, en littérature et en art, m’importe peu, alors qu’en pédagogie, je la crois essentielle. » Plus tard, il ajouta : « Les lettre ne sont point un divertissement de jeunes filles ni de frères de lais, et la vraie bibliothèque n’est pas rose. » Stéphane Giocanti salue « la lucidité de son jugement littéraire » et rappelle que Léon Daudet s’intéressait à toutes les formes d’art. Jeune homme, il avait défendu Pelléas et Mélisande, pourtant sifflé à leur création, et avait qualifié Debussy de « musicien de génie ». Parvenu à l’âge mûr, il s’enthousiasma de la même manière pour Picasso.
C’était les Daudet est un livre touffu, mais riche en enseignements. A travers une grande famille d’écrivains, c’est l’histoire de la IIIème République que Stéphane Giocanti retrace. Léon Daudet mourut en 1942, deux ans après le sabordage de cette république dont il avait été le « fils privilégié ».
C’était les Daudet, de Stéphane Giocanti, 2013, éditions Flammarion.
08:22 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : c'était les daudet, stéphane giocanti | Lien permanent | Commentaires (0)


