11/03/2019
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable
Livre à lire tant qu’on est jeune et en bonne santé
Au-delà de cette limite
votre ticket n’est plus valable
Dans la France de Giscard, un industriel, Jacques Rainier, est confronté à la crise économique. Il voit son affaire péricliter et envisage la liquidation. Parallèlement, à la veille de son soixantième anniversaire, il doit faire face à un autre déclin, celui de son corps qui se déglingue déjà. La lecture de ce livre ne peut être recommandée qu’à des jeunes gens en bonne santé qui pensent avoir la vie devant soi et que n’embarrassent pas les « tout-à-l’égout de l’âme », que délivre Romain Gary.
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable fut publié en 1975, alors que la France sortait d’une longue période de croissance économique, qui allait être baptisée les Trente Glorieuses. Le narrateur, Jacques Rainier, est un industriel qui a vécu ces années exceptionnelles au cours desquelles, selon ses propres mots, « la prospérité économique européenne paraissait avoir découvert le secret de la croissance perpétuelle. » Il précise : « L’automobile régnait. Le crédit coulait à flots. Le pétrole allait de soi. La France était devenue une bonne affaire. »
 Mais la situation se retourne en 1973, quand les pays membres de l’OPEP (Organisation des pays producteurs de pétrole) décident d’augmenter fortement le prix du pétrole. Jacques Rainier, qui possède des usines de papier et de contre-plaqué, est confronté à une hausse sans précédent du coût des matières premières. Il craint de disparaître, victime de la crise économique, d’autant plus qu’il ne fait pas le poids face à la concurrence. Il est trop petit aux yeux de l’Etat, pour lequel il ne compte pas. Selon Rainier Jean-Pierre Fourcade, ministre des Finances de Giscard, a décidé que seuls les plus grosses entreprises méritent de survivre : « Fourcade joue à fond sur les gros : la concentration, les géants, pour faire face à la compétition, à la concurrence à l’échelle planétaire. […] Je suis trop petit. Je ne peux pas menacer le gouvernement de trente mille chômeurs. C’est foutu. »
Mais la situation se retourne en 1973, quand les pays membres de l’OPEP (Organisation des pays producteurs de pétrole) décident d’augmenter fortement le prix du pétrole. Jacques Rainier, qui possède des usines de papier et de contre-plaqué, est confronté à une hausse sans précédent du coût des matières premières. Il craint de disparaître, victime de la crise économique, d’autant plus qu’il ne fait pas le poids face à la concurrence. Il est trop petit aux yeux de l’Etat, pour lequel il ne compte pas. Selon Rainier Jean-Pierre Fourcade, ministre des Finances de Giscard, a décidé que seuls les plus grosses entreprises méritent de survivre : « Fourcade joue à fond sur les gros : la concentration, les géants, pour faire face à la compétition, à la concurrence à l’échelle planétaire. […] Je suis trop petit. Je ne peux pas menacer le gouvernement de trente mille chômeurs. C’est foutu. »
Jacques Rainier comprend que la situation est intenable et qu’il va devoir liquider son affaire en la vendant à un étranger. Il voit dans le déclin de son entreprise le reflet du déclin de la France. Il se confie à sa compagne, Laure : « Je ne peux plus tenir. J’ai le choix de passer la main à un Allemand ou peut-être à un Américain. C’est, comme tu vois, une situation typiquement française. » Jaques Rainier voit aussi dans cette crise une crise plus grave que les précédentes : « Ce n’est pas une crise comme une autre. Toutes nos structures sont usées. Ce n’est même pas l’économie : nous somme en retard d’une technologie. L’économie tombe en panne parce qu’elle demeure attelée à une technologie que la rapidité même de son développement a rendu anachronique. » Derrière le déclin français il voit celui de l’Europe : « L’Europe a perdu son histoire. Elle n’a plus de vitalité propre. »
Confronté à l’irréversibilité de son déclin physique et moral,
Rainier se résout « à partir »
Ce déclin de la France et de l’Europe est parallèle au déclin physique de Jacques Rainier. Car le narrateur frise la soixantaine. Il a ce que son médecin appelle des « angoisses vespérales », c’est-à-dire des angoisses du soir (de sa vie). Il parle de son « corps automnal » qui « se déglingue », et n’épargne aucun détail au lecteur, quand, dans de longues pages très crues, il conjugue ses pannes sexuelles à ses problèmes de prostate. Confronté à l’irréversibilité de son déclin physique et moral, Rainier se résout « à partir », fatigué qu’il est de mener « une lutte acharnée contre le corps usé ». Il met au point ce qu’il appelle la « solution finale » et s’adresse à lui-même une lettre de rupture : « Jacques Rainier, vous m’avez profondément déçu. […] Vous ne savez plus vivre dans le présent et le souci des lendemains est votre préoccupation constante. Lorsque vos pouvoirs sexuels déclinent, vous vous comportez comme un chef d’entreprise qui a peur de ne plus pouvoir faire face aux échéances et vous préférez vous retirer de l’affaire. […] J’ai donc pris la décision de rompre avec vous. » Dans son naufrage Jacques Rainier n’a qu’un seul point de repère, en la personne de Laura, une jeune fille pleine de fraicheur dont il est devenu l’amant. A vingt-deux ans, Laura fait son début dans la vie, elle est encore au printemps de son existence. L’amour qu’il porte pour Laura parviendra-t-il à sauver Jacques Rainier ?
Ce roman est largement autobiographique : Jacques Rainier est véritablement le double littéraire de Gary. Tous deux ont le même âge, tous deux partagent la même hantise de la vieillesse, et tous deux aiment une femme beaucoup plus jeune qu’eux : Laura, en ce qui concerne le narrateur, et Jean Seberg, en ce qui concerne l’auteur. Sur le plan politique, Romain Gary, gaulliste historique et Compagnon de la Libération, ne se reconnaît pas plus que Jacques Rainier dans la France de Giscard, lequel peut donner l’impression d’être résigné à ce que la France soit rabaissée en rang de puissance moyenne.
La lecture de ce livre ne peut être recommandée qu’à de jeunes gens en bonne santé qui pensent avoir la vie devant eux et que n’embarrassent pas les « tout-à-l’égout de l’âme », que délivre Romain Gary. Conséquemment, ce livre est à déconseiller à toute personne qui craint son entrée dans le grand âge. A cinquante-neuf ans, le narrateur estime déjà relever de la gérontologie.
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, de Romain Gary, 1975, collection Folio.
04/06/2018
L'Ile des Pingouins, d'Anatole France
Conte corrosif à déconseiller aux esprits bien-pensants
L’Ile des Pingouins
Sous forme de chronique, Anatole France raconte l’histoire de la Pingouinie à travers les siècles. Il se montre plein d’ironie, ne respecte rien et se moque de tout, notamment des institutions et en particulier de l’Eglise. A mots couverts, il livre une version parodique de l’histoire de France.
En ouverture de son livre, Anatole France, athée passionné de théologie, s’interroge sur les sacrements de l’Eglise et leur validité. Pour bien se faire comprendre, il propose sa propre version de la légende de saint Maël, lequel baptisa les pingouins. Venu de Bretagne, il échoua sur leur île, située quelque part dans l’ « océan de glace » ; il les évangélisa et leur donna le baptême. Le sacrement leur fut accordé précipitamment, ce qui causa, dit Anatole France, « une extrême surprise » au Paradis. En effet, le baptême donné à des animaux est-il valide ? Le Seigneur, lui-même embarrassé, réunit une assemblée pour en discuter. Au cours de la réunion, saint Patrick prit la parole et déclara : « Le sacrement du baptême est nul quand il est donné à des oiseaux, comme le sacrement du mariage est nul quand il est donné à un eunuque. » Saint Augustin soutint l’idée contraire : « C’est la forme qui opère », dit-il ; et saint Gal précisa : « La validité d’un sacrement dépend uniquement de la forme ». Saint Maël ayant respecté la forme, comment sortir de l’impasse ? Sainte Catherine, appelée à la rescousse, proposa une solution correcte au Seigneur ; elle lui dit : « Je vous supplie, Seigneur, de donner aux pingouins du vieillard Maël une tête et un buste humain, afin qu’ils puissent vous louer dignement, et leur accorder une âme immortelle, mais petite. » C’est ainsi que les pingouins opérèrent leur métamorphose et sortirent de la zoologie pour entrer dans l’histoire des hommes.
Se f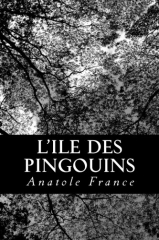 aisant chroniqueur, Anatole France raconte (de manière un peu décousue, il est vrai) l’histoire de la Pingouinie. Il s’intéresse notamment à la mise en place de la fiscalité. Au cours d’une assemblée de notables présidée par Maël, l’institution d’un système de contribution est discutée. Mario, un riche laboureur, se fait le porte-parole des plus aisés ; et, devant saint Maël, il se dit prêt à donner tout ce qu’il possède. Mais, très habilement, il écarte tout projet d’impôt sur le revenu et plaide pour l’instauration de ce que nous appelons, de nos jours, la TVA. Sa déclaration est assez longue ; en voici l’essentiel, qu’il est bon de lire à voix haute : « O Maël, ô mon père, j’estime qu’il est juste que chacun contribue aux dépenses publiques et aux frais de l’Eglise. Pour ce qui est de moi, je suis prêt à me dépouiller de tout ce que je possède, dans l’intérêt de mes frères pingouins et, s’il le fallait, je donnerais de grand cœur jusqu’à ma chemise. Tous les Anciens du peuple sont disposés, comme moi, à faire le sacrifice de leurs biens ; et l’on ne saurait douter de leur dévouement absolu au pays et à la religion. Il faut donc considérer uniquement l’intérêt public et faire ce qu’il commande. Or, ce qu’il commande, ô mon père, ce qu’il exige, c’est de ne pas demander beaucoup à ceux qui possèdent beaucoup ; car alors les riches seraient moins riches et les pauvres plus pauvres. Les pauvres vivent du bien des riches ; c’est pourquoi ce bien est sacré. N’y touchez pas : ce serait méchanceté gratuite. A prendre aux riches, vous ne retireriez pas grand profit, car ils ne sont guère nombreux ; et vous vous priveriez, au contraire, de toutes ressources, en plongeant le pays dans la misère. Tandis que, si vous demandez un peu d’aide à chaque habitant, sans égard à son bien, vous recueillerez assez pour les besoins publics, et vous n’aurez pas à vous enquérir de ce que possèdent les citoyens, qui regarderaient toute recherche de cette nature comme une odieuse vexation. En chargeant tout le monde également et légèrement, vous épargnerez les pauvres, puisque vous leur laisserez le bien des riches. […] Imposez les gens d’après ce qu’ils consomment. Ce sera la sagesse et ce sera la justice. »
aisant chroniqueur, Anatole France raconte (de manière un peu décousue, il est vrai) l’histoire de la Pingouinie. Il s’intéresse notamment à la mise en place de la fiscalité. Au cours d’une assemblée de notables présidée par Maël, l’institution d’un système de contribution est discutée. Mario, un riche laboureur, se fait le porte-parole des plus aisés ; et, devant saint Maël, il se dit prêt à donner tout ce qu’il possède. Mais, très habilement, il écarte tout projet d’impôt sur le revenu et plaide pour l’instauration de ce que nous appelons, de nos jours, la TVA. Sa déclaration est assez longue ; en voici l’essentiel, qu’il est bon de lire à voix haute : « O Maël, ô mon père, j’estime qu’il est juste que chacun contribue aux dépenses publiques et aux frais de l’Eglise. Pour ce qui est de moi, je suis prêt à me dépouiller de tout ce que je possède, dans l’intérêt de mes frères pingouins et, s’il le fallait, je donnerais de grand cœur jusqu’à ma chemise. Tous les Anciens du peuple sont disposés, comme moi, à faire le sacrifice de leurs biens ; et l’on ne saurait douter de leur dévouement absolu au pays et à la religion. Il faut donc considérer uniquement l’intérêt public et faire ce qu’il commande. Or, ce qu’il commande, ô mon père, ce qu’il exige, c’est de ne pas demander beaucoup à ceux qui possèdent beaucoup ; car alors les riches seraient moins riches et les pauvres plus pauvres. Les pauvres vivent du bien des riches ; c’est pourquoi ce bien est sacré. N’y touchez pas : ce serait méchanceté gratuite. A prendre aux riches, vous ne retireriez pas grand profit, car ils ne sont guère nombreux ; et vous vous priveriez, au contraire, de toutes ressources, en plongeant le pays dans la misère. Tandis que, si vous demandez un peu d’aide à chaque habitant, sans égard à son bien, vous recueillerez assez pour les besoins publics, et vous n’aurez pas à vous enquérir de ce que possèdent les citoyens, qui regarderaient toute recherche de cette nature comme une odieuse vexation. En chargeant tout le monde également et légèrement, vous épargnerez les pauvres, puisque vous leur laisserez le bien des riches. […] Imposez les gens d’après ce qu’ils consomment. Ce sera la sagesse et ce sera la justice. »
A chaque fois que l’extrême-droite veut renverser la république,
elle ne réussit qu’à la renforcer un peu plus
Anatole France enjambe les siècles. Les chapitres les plus féroces de l’histoire de la Pingouinie concernent ce qu’il appelle les Temps modernes. Il y fait le récit de la crise boulangiste et de l’affaire Dreyfus. Bien que les identités aient été modifiées par l’auteur, le général et la capitaine sont aisément reconnaissables. Il faut avoir en tête que les deux affaires sont encore très récentes à l’époque, L’Ile des pingouins ayant été écrite en 1907. Dans l’un et l’autre cas, on y voit un réactionnaire, le révérend père Agaric, qui s’agite dans tous les sens pour renverser la république et rendre à l’Eglise ses privilèges perdus. Il fait part de son projet de complot à un autre ecclésiastique, le père Cornemuse ; mais celui-ci, beaucoup plus modéré, essaie de le rendre à la raison et lui déclare : « Prenez garde, mon ami. La république est peut-être plus forte qu’il ne semble. Il se peut aussi que nous raffermissions ses forces en la tirant de la molle quiétude où elle repose à cette heure. » Le père Cornemuse fait également valoir au père Agaric que la république, même si elle manque de respect et de soumission à l’égard de l’Eglise, la laisse cependant vivre. Mais, peine perdue, le père Agaric se lance dans l’action, et, ainsi que l’avait prévu le père Cornemuse, il parvient au résultat inverse de celui escompté. Dans ce livre, à chaque fois que l’extrême-droite veut renverser la république, elle ne réussit qu’à la renforcer un peu plus.
Anatole France est plein d’ironie quand il retrace en détail l’affaire Pyrot (comprenez Dreyfus), du nom de ce capitaine accusé d’avoir détourné quatre-vingt mille bottes de foin destinées à l’armée. Quand, devant la justice, l’écrivain Colomban (comprenez Zola) plaide que l’armée a condamné le capitaine sans avoir la moindre preuve, le général Panther, chef d’état-major (comprenez le général de Boisdeffre), contre-attaque et insiste sur la quantité de preuves accumulées par les autorités militaires. Il dépose en ces termes : « L’infâme Colomban prétend que nous n’avons pas de preuves contre Pyrot. Il en a menti : nous en avons ; j’en garde dans mes archives sept cent trente-deux mètres carrés, qui, à cinq cents kilos chaque, font trois-cent soixante-six-mille kilos. »
Ces preuves sont bien sûr des faux fabriqués pour la circonstance. Le ministre de la Guerre, tout en se félicitant de la production de ces pièces ayant permis la condamnation du capitaine, ne peut cacher son inquiétude et en fait part au général Panther : « Je crains qu’on ôte à l’affaire Pyrot sa belle simplicité. […] Pour tout vous dire, je crains qu’en voulant trop bien faire, vous n’ayez fait moins bien. Des preuves ! sans doute il est bon d’avoir des preuves, mais il est peut-être meilleur de n’en avoir pas. » Face aux preuves « appropriées » apportées par le général, le ministre admet cependant : « Il y en a d’appropriées, tant mieux ! Ce sont les bonnes. Comme preuves, les pièces fausses valent mieux que les vraies, d’abord parce qu’elles ont été faites exprès, pour les besoins de la cause, sur commande et sur mesure, et qu’elles sont enfin exactes et justes. »
Dans ce conte publié sept ans avant la Première Guerre mondiale, Anatole France se fait sans illusion quand il conclut son histoire par la multiplication des bruits de guerre, l’escalade entre la Pingouinie et son ennemie la Marsouinie, la mobilisation générale et la guerre : « La guerre devint universelle et le monde entier fut noyé dans le sang. »
L’Ile des Pingouins est l’œuvre d’un érudit féru de théologie et d’histoire de France. C’est aussi une œuvre qui peut apparaître vieillie à certains égards, d’autant plus que plusieurs allusions à l’actualité de l’époque peuvent échapper au lecteur d’aujourd’hui. Par ailleurs, l’auteur n’hésite pas à enjamber les siècles, ce qui donne, nous l’avons souligné, un caractère décousu à son histoire.
Ce conte corrosif est à déconseiller aux esprits bien-pensants qui ne veulent pas voir remis en cause les institutions ; car Anatole France ne respecte rien, il se moque de tout, notamment de l’Eglise, mais aussi de l’armée, des capitalistes et même des socialistes. En revanche, celui qui accepte l’ironie de l’auteur prend du plaisir à la lecture de L’Ile des Pingouins.
L’Ile des Pingouins, d’Anatole France, 1907, collections CreateSpace Independent Publishing Platform et Tredition classics.
09:05 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : anatole france, l'ile des pingouins | Lien permanent | Commentaires (0)
04/12/2017
Salammbô, de Flaubert
Péplum littéraire
Salammbô
Dans ce roman d’aventure et d’évasion, Flaubert ressuscite la Carthage de l’Antiquité. La cité punique est assiégée par des mercenaires dont le chef convoite Salammbô, fille d’Hamilcar, l’un des principaux magistrats carthaginois. Même si les descriptions sont nombreuses, le lecteur passe un bon moment en compagnie des personnages et se passionne pour ce récit rempli de scènes d’atrocités.
Il y eut au XIXe siècle une vague de romans historiques ayant pour cadre l’Antiquité, parmi lesquels Le Roman de la momie, de Théophile Gautier. C’est ce livre-ci qui aurait donné à Flaubert l’idée de se plonger à son tour dans l’Antiquité. Il choisit pour théâtre de son histoire la Carthage du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c’est-à-dire l’orgueilleuse cité des Guerres puniques qui tint tête à Rome. Fidèle à sa méthode, il lut de nombreux livres sur le sujet, et, en 1858, il fit un voyage en Tunisie. Il se rendit sur les ruines de Carthage afin de mieux s’imprégner de son sujet. La gestation fut encore longue et difficile, et occupa Flaubert pendant plusieurs années. Le livre fut achevé en 1862. A sa sortie, il fut vivement critiqué par les spécialistes, mais rencontra le succès.
 La description que Flaubert fait de Carthage est particulièrement réussie. Pour plus de clarté, un plan de la ville est placé en tête du livre. Le lecteur n’a aucun mal à imaginer la cité au bord de la mer et à visualiser les différentes ceintures de murailles, les temples, les jardins d’Hamilcar et l’aqueduc, copié sur les Romains, lequel joue un rôle capital dans l’histoire. La Carthage de Flaubert ne se résume cependant pas à ses monuments, elle est pleine de vie et grouille d’animation.
La description que Flaubert fait de Carthage est particulièrement réussie. Pour plus de clarté, un plan de la ville est placé en tête du livre. Le lecteur n’a aucun mal à imaginer la cité au bord de la mer et à visualiser les différentes ceintures de murailles, les temples, les jardins d’Hamilcar et l’aqueduc, copié sur les Romains, lequel joue un rôle capital dans l’histoire. La Carthage de Flaubert ne se résume cependant pas à ses monuments, elle est pleine de vie et grouille d’animation.
« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. » Telle est la phrase d’ouverture de roman de Flaubert. Donc, ce jour-là, dans les jardins d’Hamilcar, un grand banquet est donné pour célébrer le jour anniversaire de la victoire en Sicile. Des milliers de mercenaires y participent. Ils sont allongés sur des coussins, accroupis ou debout contre des arbres. Des viandes leur sont servies et le vin coule à flot. Ils attendent le versement de leur solde. Or, la République, épuisée par la guerre, rechigne à payer. Pour tromper leur attente, elle a organisé ce festin et a expressément choisi le palais d’Hamilcar pour les recevoir. C’est une manière pour le Conseil de se venger d’Hamilcar, chef du Parti de la guerre ; car les Mercenaires entendent bien être payés. « Hamilcar, précise Flaubert, leur avait fait des promesses exorbitantes, vagues il est vrai, mais solennelles et réitérées. »
Les Mercenaires ont des sentiments ambigus à l’égard de Carthage : « Ils l’admiraient, ils l’exécraient, ils auraient voulu tout à la fois l’anéantir et l’habiter. » Leur chef se nomme Mâtho ; ce Lybien est obsédé par le visage de Salammbô depuis qu’il l’a aperçue dans les jardins d’Hamilcar son père. Dès lors il veut conquérir Carthage afin de posséder Salammbô, tous deux finissant par se confondre dans son esprit. Mâtho, écrit Flaubert, « était jaloux de cette Carthage enfermant Salammbô, comme quelqu’un qui l’aurait possédée. » Guidé par Spendius le Grec, il quitte le campement des Mercenaires et pénètre de nuit dans la cité en s’introduisant par l’aqueduc. Les deux hommes entrent dans le temple de Tanit et y volent le zaïmph, le voile sacré des Carthaginois. Or le zaïmph est censé donner la victoire à celui qui le possède.
On peut quasiment dire que le zaïmph est à Flaubert ce que le McGuffin est à Hitchcock : un objet que les protagonistes se disputent et qui sert de prétexte au déroulement de l’intrigue. Une fois le zaïmph dérobé, les Carthaginois mettront tout en œuvre pour le récupérer.
Le chapitre le plus atroce
est celui consacré aux sacrifices de petits garçons
Les scènes de bataille son nombreuses et haletantes. Elles sont presqu’en cinémascope, avec leurs cavaliers, leurs fantassins, leurs catapultes et surtout leurs éléphants qui, sur leur passage, écrasent les combattants adverses. Flaubert ne nous épargne aucune cruauté : les têtes tombent ; les cervelles sautent ; on marche dans le sang des cadavres ; pour survivre on pratique le cannibalisme ; et après la bataille les Carthaginois prennent plaisir à mutiler méthodiquement les prisonniers.
Le chapitre le plus atroce est celui consacré aux sacrifices de petits garçons, que pratiquent les Carthaginois pour apaiser la colère de Moloch-le-Dévorateur, alors que la ville assiégée souffre de la sécheresse. Sur décret des Anciens, des petits garçons sont enlevés à leurs parents pour être donnés en sacrifice. Le jour de la cérémonie, la statue de Baal est ôtée de son temple et installée sur la place, face à la population rassemblée. Les enfants, enveloppés de voiles noirs, sont placés en cercle autour de la statue, laquelle est une espèce de machine infernale. Une fois que le grand-prêtre de Moloch a dit les paroles rituelles, un homme paraît et offre un enfant à la divinité. Il le pousse dans l’ouverture et les bras articulés de la statue se referment. Un panache noir de fumée s’élève alors. Et la cérémonie continue. A la fin de la journée, plusieurs dizaines d’enfants auront été jetés en sacrifice dans la fournaise.
A la sortie du livre, Sainte-Beuve
fut très dur dans sa critique
Flaubert ne délivre aucun message moral ou religieux. La société antique telle qu’il la voit n’a rien de civilisé, du moins au sens où nous l’entendons nous-mêmes. Les Carthaginois ne sont guidés que par leurs propres intérêts. Son avarice aura conduit la cité punique à ne pas respecter la parole donnée aux Mercenaires pour le règlement de leurs soldes. Carthage n’épargne pas non plus les villes voisines : « Elle exténuait ces peuples, écrit Flaubert. Elle en tirait des impôts exorbitants. » Au moindre revers dans la fortune de Carthage, ses voisins, dont Tunis, n’hésiteront pas à la lâcher.
Les Carthaginois sont tellement méfiants qu’ils suspectent les réussites individuelles. Selon Flaubert, « Le génie politique manquait à Carthage. » Pour éviter la tentation du pouvoir personnel, il n’y a pas un seul chef à la tête de la cité, mais deux magistrats appelés sulfètes, dont Hamilcar, chef du Parti de la guerre, qui est sulfète-de-la-mer.
A la sortie du livre, Sainte-Beuve fut très dur dans sa critique. Il fit la leçon à Flaubert en écrivant : « On la restitue, l’Antiquité, on ne le ressuscite pas. » Précisément, Flaubert a su éviter l’écueil d’une restitution archéologique qui eût été froide et déshumanisée. Il a voulu rendre son récit probable, mais, chez lui, l’harmonie prime l’archéologie. Contrairement à ce que lui reprocha Sainte-Beuve, le génie de Flaubert est d’avoir voulu ressusciter l’Antiquité et d’avoir fait de ses personnages des êtres de chair. Peut-être peut-on lui reprocher un abus de descriptions dans ce roman. Mais si le lecteur les accepte, alors il passe un bon moment et finit par se passionner pour Salammbô, Hamilcar, Mâtho et Spendius. Il est admirable que le même auteur ait su autant varier les genres au cours de sa carrière d’écrivain. Flaubert est passé du roman dit réaliste, avec Madame Bovary, au roman d’aventure et d’évasion, avec Salammbô. Dans ce livre il fait preuve d’une grande capacité d’innovation. Salammbô n’a rien à envier aux plus grands péplums tournés dans les années cinquante et soixante.
PS : Salammbô a grandement inspiré Les Aventures d’Alix, de Jacques Martin, aux éditions Casterman, certains passages du roman étant repris dans les albums Le Tombeau étrusque et Le Sceptre de Carthage.
Salammbô, de Flaubert, 1862, collection Folio.
08:27 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : salammbô, flaubert | Lien permanent | Commentaires (0)


