04/01/2016
L627, de Tavernier
Immersion dans une brigade des Stups
L627
A sa sortie, en 1992, L627 dépoussiérait l’image de la police en montrant le travail au quotidien d’une brigade des Stupéfiants. Le film faisait apparaître la misère matérielle des policiers et l’obsession de la hiérarchie pour les résultats chiffrés. Plus de vingt ans après, le réalisateur Bertrand Tavernier se dit fier de son film.
L627 n’est pas un film policier comme les autres. L’intrigue traditionnelle fait défaut, il n’y pas de fil d’Ariane. Au lieu d’emmener le spectateur d’un point A à un point B, Tavernier lui fait partager la vie quotidienne d’une brigade de policiers. Il a coécrit son scénario avec Michel Alexandre, un ancien enquêteur, et le résultat fait penser aux reportages d’immersion que la télévision affectionne tant depuis quelques années. Mais, attention, L627 est bien une fiction, avec des personnages inventés pour la circonstance.
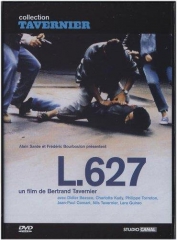 Lucien Marguet est le personnage principal du film. Après avoir été un temps dans un commissariat d’arrondissement, il est affecté aux Stups en tant qu’enquêteur de deuxième classe. Le spectateur découvre la brigade avec les yeux de Marguet ; et ce qui frappe d’abord, c’est le manque de moyens. Les policiers sont parqués dans un étroit module préfabriqué. Ils sont sous-équipés en matériels ; ainsi leurs véhicules tombent souvent en panne. Les frais d’enquête sont remboursés le plus souvent avec retard, et en liquide. L’obsession de la hiérarchie, c’est de faire du chiffre. Pour être bien vu de ses supérieurs, un policier doit savoir bien mettre les bâtons dans les cases et faire les additions de façon à ce que les stats tombent juste. Les membres de la brigade se plaignent des lenteurs de la justice et de la lourdeur de la procédure qui rend leur action inefficace. Ainsi, dans une affaire, le Parquet réussit à égarer les pièces du dossier.
Lucien Marguet est le personnage principal du film. Après avoir été un temps dans un commissariat d’arrondissement, il est affecté aux Stups en tant qu’enquêteur de deuxième classe. Le spectateur découvre la brigade avec les yeux de Marguet ; et ce qui frappe d’abord, c’est le manque de moyens. Les policiers sont parqués dans un étroit module préfabriqué. Ils sont sous-équipés en matériels ; ainsi leurs véhicules tombent souvent en panne. Les frais d’enquête sont remboursés le plus souvent avec retard, et en liquide. L’obsession de la hiérarchie, c’est de faire du chiffre. Pour être bien vu de ses supérieurs, un policier doit savoir bien mettre les bâtons dans les cases et faire les additions de façon à ce que les stats tombent juste. Les membres de la brigade se plaignent des lenteurs de la justice et de la lourdeur de la procédure qui rend leur action inefficace. Ainsi, dans une affaire, le Parquet réussit à égarer les pièces du dossier.
Ce film, sorti au début des années quatre-vingt-dix, aura fait date en mettant en lumière la grande misère matérielle de la police et l’obsession du résultat (quantitatif), qui n’ont fait que s’amplifier depuis. Au-delà, l’intérêt de L627 est de montrer de l’intérieur le travail des policiers au quotidien. Leur tache n’est pas toujours spectaculaire, ils traitent plusieurs dizaines d’affaires en parallèle, ils s’égarent quelques fois sur des fausses pistes et ne savent pas à l’avance sur quel résultat, ou absence de résultat, ils déboucheront.
Dans L627, les policiers doivent se confondre
avec les truands qu’ils poursuivent
Par certains aspects, L627 peut faire penser à Serpico, de Sidney Lumet. En 1971, ce film montrait que le policier moderne ne devait plus être repérable à cent mètres à la ronde, avec son chapeau et son pardessus. Il devait, au contraire, se confondre avec les délinquants qu’il était chargé de poursuivre. Dans L627, les policiers sont à des années-lumière du commissaire Maigret. Ils s’habillent comme les truands, parlent le même langage et ont la même absence de manière. Les policiers ne sont pas du tout policés et ont du mal à résister à la tentation de se conduire en cow-boys. On les voit, lors d’une traque, faire irruption dans un lycée. Quand Mme le censeur, mise au courant de leur intrusion, se trouve en face d’eux, elle n’arrive pas à croire qu’elle a affaire à des policiers, tant elle est choquée de leur comportement et de leur accoutrement. Elle se permet une réflexion sur leur tenue, ce à quoi Marguet lui rétorque : « Ce n’est pas en costume trois-pièces qu’on arrête les dealers. » Bref, Marguet ne ressemble pas du tout à Maigret.
Le chef de la brigade, Dodo, n’est pas du tout distingué. Quand il est énervé, il frappe. Pour se détendre, il use d’un pistolet à eau et se montre capable de comportement encore plus puéril. Il est vrai que les policiers sont soumis à des moments de grande tension, si bien qu’ils ont besoin de se relâcher de temps en temps. Les heures de planque dans un sous-marin paraissent interminables et, quelques fois, ne débouchent sur rien. Une fin d’après-midi, enfermé dans la fourgonnette qui sert à la surveillance, Dodo est tellement pressé de finir sa journée qu’il ne résiste pas à la tentation de conclure, même prématurément, l’affaire qu’ils sont en train de suivre.
L’une des scènes les plus fortes du film se déroule dans une station de métro. Les policiers, équipés de talkies-walkies, ont monté un dispositif dans le but d’arrêter des dealers en flagrant délit. Il leur faut faire preuve de doigté, garder leur sang-froid et avoir des qualités de sportif.
En voyant ce film, on comprend aussi comment des policiers puissent franchir la ligne jaune, tant les limites sont floues. On voit Marguet laisser un peu de drogue à un indicateur qui le met sur la piste d’une grosse saisie, et lui-même s’est pris d’affection pour une toxicomane, Cécile, qu’il essaye de remettre sur le droit chemin.
Par sa longueur – plus de deux heures, comme souvent chez Tavernier – L627 peut rebuter plus d’un spectateur. Pourtant, ce film permet, mieux que n’importe quel reportage télévisé, de saisir le métier de policier et les difficultés de son exercice. Aujourd’hui Tavernier se dit fier de cette œuvre tournée en 1992. Il est vrai que, par bien des aspects, L627 n’a pas pris une ride.
L627, de Bertrand Tavernier, 1992, avec Didier Bezace, Jean-Pierre Comart, Charlotte Kady, Philippe Torreton, Jean-Roger Milo, Nils Tavernier, Lara Guirao et Claude Brosset, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense, Société | Tags : l627, tavernier, didier bezace, jean-pierre comart, charlotte kady, philippe torreton, jean-roger milo, nils tavernier, lara guirao, claude brosset | Lien permanent | Commentaires (0)
03/11/2014
Le Juge et l'assassin, de Tavernier
Noiret fait passer Galabru aux aveux
Le Juge et l’assassin
Le film de Tavernier se passe en pleine affaire Dreyfus. Dans une petite ville de province, le juge Rousseau, brillamment interprété par Philippe Noiret, enquête sur une série de crimes horribles. Il croit tenir l’assassin en la personne de Bouvier, un chemineau joué par Michel Galabru. Le juge va utiliser des méthodes très personnelles pour atteindre la vérité.
Sorti en 1976, Le Juge et l’assassin est le troisième film réalisé par Bertrand Tavernier. Tavernier a coutume de dire que dans ses films il montre des gens dans leur travail au quotidien, qu’ils soient policiers, professeurs ou ministres. Dans Le Juge et l’assassin, le spectateur suit un juge dans l’instruction d’une affaire criminelle.
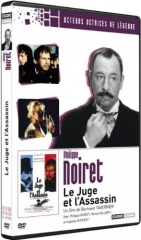 L’action démarre en 1895, dans le contexte de l’affaire Dreyfus et des tensions croissantes entre cléricaux et anticléricaux. Le juge Rousseau est en poste dans une petite ville de province du sud de la France. Confronté à une série de meurtres dont des jeunes filles et des enfants sont les victimes, il progresse très vite dans son travail d’enquête. Il suspecte un dénommé Bouvier, un chemineau qui s’est toujours trouvé à proximité du lieu du crime au moment où il était commis.
L’action démarre en 1895, dans le contexte de l’affaire Dreyfus et des tensions croissantes entre cléricaux et anticléricaux. Le juge Rousseau est en poste dans une petite ville de province du sud de la France. Confronté à une série de meurtres dont des jeunes filles et des enfants sont les victimes, il progresse très vite dans son travail d’enquête. Il suspecte un dénommé Bouvier, un chemineau qui s’est toujours trouvé à proximité du lieu du crime au moment où il était commis.
Même si les apparences sont contre Bouvier et même si de lourdes présomptions pèsent sur lui, cela ne suffit pas au juge Rousseau. Il veut des éléments matériels et des aveux circonstanciés, afin que son travail soit complet et ne souffre nulle contestation. A priori le juge est une âme pure qui se met au service de la vérité, sauf qu’il va utiliser des méthodes très personnelles. Il se met à l’écoute de Bouvier, passe beaucoup de temps avec lui et se montre très compréhensif à son égard. Il lui promet que, s’il collabore, il sera déclaré fou et échappera à l’échafaud. En réalité, il ne s’agit là que d’une manœuvre destinée à obtenir des aveux. Car, au même moment, Rousseau déclare à d’autres qu’il est persuadé que Bouvier est sain d’esprit. Très moderne dans ses méthodes, il n’hésite pas à médiatiser l’affaire et à utiliser la presse. Le juge n’est pas regardant sur la nature des moyens quand il s’agit d’atteindre la vérité.
Le juge Rousseau est brillamment interprété par Philippe Noiret, l’assassin par Michel Galabru. Quant à Jean-Claude Brialy, il incarne un ancien magistrat, M. de Villedieu, qui donne au juge sa vision de l’affaire : qu’importe que Bouvier soit coupable ou innocent, puisqu’il appartient au vagabondage, c'est-à-dire au désordre et à l’anarchie. Villedieu fait sien le propos d’Octave Mirbeau qui a dit : « Nous sommes tous des meurtriers en puissance et ce besoin de meurtre, nous le concilions par des moyens légaux : l’industrie, le commerce colonial, la guerre, l’antisémitisme. »
A la fin du film, le spectateur découvrira qu’il arrive au juge d’avoir un comportement guère éloigné de celui de l’assassin.
La reconstitution de la France de 1895 est réussie. Le décor nous fait plonger en pleine affaire Dreyfus ; ainsi, au début et à la fin du film, la caméra nous montre, accolé à un mur, un placard publicitaire qui proclame : « Lisez La Croix, le journal le plus antisémite de France. » Des chants patriotiques sont entonnés dans des salons bourgeois, tandis que la rue fait entendre des chansons ouvrières. Jean-Roger Caussimon interprète une ballade spécialement écrite sur l’affaire Bouvier.
Malgré le côté scabreux des crimes, le Juge et l’assassin est un film agréable à regarder. Le film est long : un peu plus de deux heures, comme souvent chez Tavernier.
Le Juge et l’assassin, de Bertrand Tavernier, 1976, avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy et Isabelle Hupert, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : le juge et l'assassin, tavernier, galabru, jean-claude brialy, caussimon, noiret | Lien permanent | Commentaires (0)
18/11/2013
Quai d'Orsay, de Tavernier
La vie quotidienne au Quai sous Villepin
Quai d’Orsay
Le film de Bertrand Tavernier est fidèle à la bande dessiné de Blain et Lanzac. On y découvre le Quai d’Orsay sous Dominique de Villepin et comment il a géré la crise irakienne de 2003. S’inspirant des comédies américaines de la grande époque, Tavernier a su donner du rythme à son film et maîtrise la direction d’acteurs.
Arthur Vlaminck, jeune homme sachant écrire, entre au cabinet du ministre des Affaires étrangères Alexandre Taillard de Vorms, pour s’occuper des « langages ». Mais, au Quai d’Orsay, la vie n'est pas de tout repos. Les conseillers travaillent dans l’urgence et sont soumis à un stress permanent. Servi par un physique avantageux, Taillard de Vorms est flamboyant et porte le verbe haut, mais il se montre fantasque dans le travail de tous les jours. Arthur croit lui donner satisfaction dans la préparation des discours en suivant ses recommandations à la lettre, mais le ministre n’est jamais content, disant une chose puis son contraire. Malgré tout, Arthur tombe sous son charme, car, sous des apparences fantasques, Taillard de Vorms est porté par une vision et sait très bien où il va. Il veut empêcher les Américains de déclencher la guerre au Lousdémistan.
 Chacun l’aura compris, le Lousdémistan, c’est l’Irak ; et Alexandre Taillard de Vorms, c’est Dominique Galouzeau de Villepin. Quai d’Orsay raconte, vue du côté français, la gestion diplomatique de la crise irakienne, qui culmina avec le discours de Villepin au conseil de sécurité de l’Onu en février 2003. Au-delà du rappel de faits qui appartiennent maintenant à l’histoire, le film a le grand mérite de nous montrer la vie quotidienne à l’intérieur d’un cabinet ministériel. Nous savons maintenant à quoi un ministre et ses collaborateurs passent leurs journées, de réunions en réunions en passant par la préparation de discours et la gestion de crises. Nous voyons aussi les rivalités au grand jour et les petits pièges que peuvent se tendre entre eux les conseillers pour briller auprès de leur maître.
Chacun l’aura compris, le Lousdémistan, c’est l’Irak ; et Alexandre Taillard de Vorms, c’est Dominique Galouzeau de Villepin. Quai d’Orsay raconte, vue du côté français, la gestion diplomatique de la crise irakienne, qui culmina avec le discours de Villepin au conseil de sécurité de l’Onu en février 2003. Au-delà du rappel de faits qui appartiennent maintenant à l’histoire, le film a le grand mérite de nous montrer la vie quotidienne à l’intérieur d’un cabinet ministériel. Nous savons maintenant à quoi un ministre et ses collaborateurs passent leurs journées, de réunions en réunions en passant par la préparation de discours et la gestion de crises. Nous voyons aussi les rivalités au grand jour et les petits pièges que peuvent se tendre entre eux les conseillers pour briller auprès de leur maître.
Lhermitte survolté
Bertrand Tavernier a réalisé une adaptation fidèle de la bande dessinée de Blain et Lanzac, reprenant l’essentiel des situations et des dialogues de l’album. Son pari d’adaptation était osé, car l’expérience a montré qu’il est très difficile de transposer à l’écran des héros de papier. Ici, l’ensemble fonctionne. La direction d’acteurs, souvent déficiente dans les films actuels, est maîtrisée. Thierry Lhermitte est survolté dans le rôle du ministre ; il débite son dialogue en rafales de mitraillette tout en restant très compréhensible. On notera cependant que dans son discours à l’Onu il adopte un ton moins lyrique et moins grandiloquent que le vrai Villepin. Niels Arestrup, dans le rôle de directeur de cabinet, se montre complémentaire de son ministre. Alors que Taillard de Vorms, emporté par ses élans et ses intuitions, est souvent tenté de foncer, son numéro deux, plus posé et plus réfléchi, s’efforce de le freiner. Mention spéciale pour Bruno Raffaelli, qui semble sorti tout droit de l’album et qui ressemble trait pour trait au personnage qu’il incarne, à savoir Cahut conseiller Moyen-Orient.
Le film va à cent à l’heure. Le rythme est soutenu. Les répliques fusent de tous côtés sans que le spectateur soit égaré. Probablement Tavernier s’est-il souvenu des comédies américaines d’Ernst Lubitsch et de Howard Hawks. On peut cependant émettre une petite réserve propre à ce genre de films directement inspirés de faits politiques précis (on pense à la Conquête ou à The Queen), il n’y pas de surprise à attendre dans le dénouement. Il y manque ce qu’Hitchcock appelait la courbe montante, qui fait que l’intérêt du spectateur augmente à mesure que le film avance.
Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier (2013), avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup, Anaïs Demoustier et Bruno Raffaeli, d’après la bande dessinée de Blain et Lanzac, actuellement dans les salles.
09:20 Publié dans Comédie, Film | Tags : quai d'orsay, tavernier, raphaël personnaz, niels arestrup, anaïs demoustier, bruno raffaeli, lhermitte | Lien permanent | Commentaires (0)


