10/11/2014
Jules Ferry, la liberté et la tradition, de Mona Ozouf
L’un des pères de l’identité française
Jules Ferry,
la liberté et la tradition
En 2012, François Hollande a placé son quinquennat sous la bannière de Jules Ferry père de l’école publique, tout en renvoyant dans les ténèbres Ferry le colonisateur. Piquée au vif, l’historienne Mona Ozouf veut rétablir Jules Ferry dans son unité en montrant la cohérence de sa pensée. De nombreuses réformes qu’il a mises en place ont traversé le temps et nous paraissent aujourd’hui naturelles.
Ce livre n’est pas une biographie de Jules Ferry, mais un court essai cherchant à cerner l’homme et ses idées. Mona Ozouf considère que l’exemple de Ferry peut, de nos jours, éclairer le débat qui a lieu, au sein de la société française, sur l’identité nationale. L’auteur estime que Ferry fut un artisan de cette identité. Il est l’auteur de nombreuses réformes qui ont traversé le temps et qui aujourd’hui nous paraissent naturelles. Il est bien sûr le père de l’école publique, mais, en tant que président du Conseil, il fut aussi à l’origine de la loi sur la liberté de la presse et de la loi sur la liberté de réunion. C’est encore lui qui a fait voter la loi municipale prévoyant, non plus la nomination, mais l’élection des maires, et dotant chaque commune d’un hôtel de ville et d’une mairie. Et puis, il est aussi à l’origine de l’institution du mariage civil.
Malgré l’importance de son legs, il fut haï de son vivant. Mona Ozouf nous rappelle que Ferry eut notamment contre lui :
- la droite catholique, opposée à son école sans Dieu ;
- la gauche radicale, avec à sa tête Clemenceau ;
- le peuple de Paris, qui se souvenait qu’il avait été maire de la ville sous la Commune ;
- et de nombreux patriotes qui l’accusaient de sacrifier les provinces perdues au profit de sa politique coloniale.
Pour couronner le tout, Ferry ne pouvait se glorifier d’actions héroïques, à la manière de Gambetta qui avait organisé la défense héroïque de 1870 contre l’envahisseur prussien.
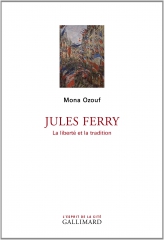 De nos jours, Jules Ferry a trouvé une certaine popularité, mais il existe une fâcheuse tendance à vouloir le couper en deux. Ainsi, n’hésite-t-on pas à opposer le bon Ferry, père de l’école publique, au mauvais Ferry, dont l’action extérieure a eu pour résultat de soumettre des peuples lointains qui n’avaient rien demandé à personne. Même François Hollande, quand il a placé son quinquennat sous sa bannière après son élection en 2012, a cru nécessaire de renvoyer aux ténèbres son action coloniale, comme si la politique de Ferry ne formait pas un tout cohérent. Et pourtant, ainsi que le montre Mona Ozouf, Ferry avait beaucoup réfléchi et avait mûri ses projets politiques.
De nos jours, Jules Ferry a trouvé une certaine popularité, mais il existe une fâcheuse tendance à vouloir le couper en deux. Ainsi, n’hésite-t-on pas à opposer le bon Ferry, père de l’école publique, au mauvais Ferry, dont l’action extérieure a eu pour résultat de soumettre des peuples lointains qui n’avaient rien demandé à personne. Même François Hollande, quand il a placé son quinquennat sous sa bannière après son élection en 2012, a cru nécessaire de renvoyer aux ténèbres son action coloniale, comme si la politique de Ferry ne formait pas un tout cohérent. Et pourtant, ainsi que le montre Mona Ozouf, Ferry avait beaucoup réfléchi et avait mûri ses projets politiques.
Un héritier respectueux de la tradition,
qui ne croit pas en la politique de la table rase
Jules Ferry, bien qu’épris de liberté, est un héritier respectueux de la tradition. Il ne croit ni en la politique de la table rase, ni en l’avènement d’un homme nouveau. Jules Ferry est un homme enraciné dans sa Lorraine natale. Il a souvent parcouru sa province à pied, muni d’un carnet de croquis, à la recherche d’un cloître ou d’une ruine. Il est respectueux des saisons et sait qu’il faut faire preuve de patience avant de récolter le fruit de sa semence. Il est admiratif des paysans… et des prêtres, qui, dans leur majorité, sont « des fils de la charrue et des sillons ». Enfant, Jules Ferry « avait même fait une si bonne première communion », soupirait l’abbé Voizelat, qui s’était occupé de lui ; mais, devenu jeune homme, il s’était détaché de la religion. Cependant il continuait de considérer la France comme un pays dont le catholicisme fait partie des racines. Devenu président du Conseil, il se montre hostile à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et reste favorable au concordat… qui permet au gouvernement de nommer les évêques.
D’une manière générale, Ferry se montre hostile aux changements radicaux. Il fait partie du groupe dit des Opportunistes, qui pratique une politique de petits pas pour installer progressivement la République et y rallier la majorité de la population, notamment la bourgeoisie et les catholiques, qu’il ne veut pas effrayer.
Mona Ozouf ne manque pas de passer au crible la très contestée politique coloniale de Jules Ferry. Son grand adversaire Clemenceau railla son discours dans lequel il faisait valoir le droit des races supérieures de civiliser les races inférieures. Mona Ozouf remet les choses dans leur contexte et rappelle que le mot « race » était d’usage courant à l’époque. Dans l’esprit de Ferry, la colonisation n’a pas pour but d’asservir les faibles, mais de leur apporter la justice et les lumières. Sur ce dossier, le défenseur de la tradition et de l’enracinement est même logique avec lui-même. Quand, en 1881, il doit fixer le statut de la Tunisie, il ne la transforme pas en départements français, ainsi que l’avaient fait ses prédécesseurs pour l’Algérie ; il choisit le protectorat. Grâce à Ferry, la Tunisie gardera une large autonomie administrative, ainsi que ses traditions.
Ferry, natif de Saint-Dié, n’oublie pas
les provinces perdues
De nombreux patriotes, dont Clemenceau, déploraient que la politique coloniale de la France fût encouragée par Bismarck, afin de détourner son attention des provinces perdues. Pourtant, Ferry, natif de Saint-Dié, n’oublie pas l’Alsace-Lorraine. Mais il veut d’abord refaire la France et lui redonner toute sa puissance en la dotant d’un empire colonial.
Pour refaire la France, l’instruction doit occuper une place primordiale. Par l’enseignement qu’ils reçoivent, les enfants doivent apprendre à connaitre la France ; d’où les cartes de géographie qui font leur apparition sur les murs des salles de classe. Ferry n’oublie pas les jeunes filles, à qui il ouvre les portes des écoles. Il les envoie au chef-lieu de canton passer le même certificat d’études que les garçons.
Il encourage la lecture chez l’enfant. Ses adversaires s’inquiètent alors des ravages moraux que pourrait provoquer un accès généralisé aux livres. Ferry leur répond que le contenu du livre importe peu, puisque l’acte de lire est en lui-même émancipateur. Pour cette raison, il ne rechigne pas à ce que des filles apprennent à lire dans L’Imitation de Jésus-Christ.
Mona Ozouf parvient à rendre toute sa cohérence à la pensée et à la politique de Ferry. Il fut ce pendant la proie de quelques contradictions. Ainsi, d’un côté, il voulut débarrasser l’enseignement du discours latin afin de faire plus de place à l’enseignement des sciences, de façon à ce que la France soit une grande puissance industrielle. Mais, d’un autre côté, l’homme enraciné qu’il était, restait attaché au latin et craignait qu’il n’y ait quelques dangers à se couper de la tradition des humanités.
Jules Ferry, la liberté et la tradition, de Mona Ozouf, 2014, éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : jules ferry, la liberté et la tradition, mona ozouf | Lien permanent | Commentaires (0)
29/09/2014
Guillaume II, le dernier empereur allemand, de Charles Zorgbibe
Un souverain brillant, mais brouillon
Guillaume II,
le dernier empereur allemand
Le livre de Chalres Zorgbibe permet de mieux saisir la personnalité de Guillaume II. Né avec un bras atrophié, le Kaiser dut faire preuve d’énergie et de volonté pour surmonter son handicap. Il ne fut pas le va-t-en-guerre que l’on pourrait croire, mais, du fait de son caractère instable, il joua avec le feu.
La scène se passe dans les années 1890. Le conseiller Knesebeck, du cabinet de l’impératrice allemande, est invité pour une croisière à bord du Hohenzollern, le yacht du couple impérial. Il est installé dans sa cabine quand il reconnait la voix de Guillaume II. Le Kaiser va et vient sur le pont et parle à voix haute. Il s’exprime alternativement en français, en anglais et en italien, et se livre à une analyse de la situation politique, abordant aussi bien les débats au Reichstag que ses relations avec les autres monarques européens. De sa cabine, Knesebeck ne peut apercevoir l’interlocuteur du Kaiser. Il s’agit vraisemblablement d’une haute personnalité, peut-être un lord anglais ou un grand-duc russe. Une fois que Guillaume II et son interlocuteur ont disparu, Knesebeck sort de sa cabine pour se renseigner. Il aperçoit un marin auquel il demande l’identité du mystérieux interlocuteur de l’empereur. Le marin esquisse un sourire et répond : « Mais c’est le pilote que nous avons embarqué à Bari pour Corfou ».
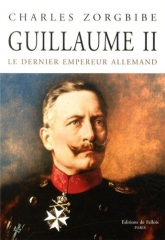 Cette anecdote est révélatrice du caractère de Guillaume II. C’est une personnalité brillante, ayant de l’esprit, capable de passer d’un sujet à l’autre et d’une langue à l’autre, mais c’est aussi un homme brouillon, impulsif, terriblement bavard, et capable de se confier au premier venu.
Cette anecdote est révélatrice du caractère de Guillaume II. C’est une personnalité brillante, ayant de l’esprit, capable de passer d’un sujet à l’autre et d’une langue à l’autre, mais c’est aussi un homme brouillon, impulsif, terriblement bavard, et capable de se confier au premier venu.
Le livre de Charles Zorgbibe contient de nombreux faits permettant de comprendre qui était Guillaume II : l’homme n’était pas fou, mais d’un caractère instable.
Il était né avec un bras atrophié, handicap gênant pour un homme destiné à régner sur un peuple militarisé. Il fut élevé à la dure et des méthodes brutales lui furent imposées pour surmonter son infirmité. A force d’énergie et de volonté, Guillaume réussit à devenir un tireur, un nageur et un cavalier de qualité.
Devenu empereur allemand et roi de Prusse, Guillaume Il se heurte au chancelier de Bismarck. Le nouveau souverain est un jeune homme de vingt-neuf ans, et il ne supporte pas la tutelle exercé par le vieil homme. Imprégné de social-protestantisme, il veut marquer son avènement par de grandes réformes, comme l’instauration d’un jour de repos hebdomadaire. Mais, pour Bismarck, il n’en est pas question. Le chancelier, excédé, finit par démissionner, et lui qui était un fervent partisan de la toute puissance du pouvoir impérial, se met sur le tard à découvrir des vertus au parlementarisme.
Le récit hallucinant
de la signature du traité de Björko
Guillaume se heurte aussi à sa mère Victoria, que l’on appelle Vicky et qui est la fille de la reine Victoria d’Angleterre. Il ne partage pas ses idées libérales, sa mère étant, il est vrai, plus anglaise qu’allemande. Même s’il est plus ou moins brouillé avec elle, Guillaume a le sens de la famille. Il se permet d’écrire à sa grand-mère Victoria pour lui donner des conseils sur l’usage de la flotte britannique. Avec Nicolas II, plus jeune et moins brillant que lui, il joue au grand frère ; il l’inonde de recommandations et finit par l’irriter.
Le récit de la signature du traité de Björko est hallucinant. Alors que l’alliance franco-russe a été conclue, ainsi que l’Entente cordiale, ce 24 juillet 1905 Nicolas II est à bord de son yacht « L’Etoile polaire » qui mouille dans les eaux du golfe de Finlande, quand Guillaume II, qui croise à proximité, se présente à lui. En l’absence de leurs ministres, les deux cousins ont un entretien. Et là, l’impossible se produit. Se montrant très persuasif, le Kaiser réussit à retourner le tsar. Willy sort de sa poche un projet de traité d’alliance entre leur deux pays et convainc Nicky de le signer. Quelques jours plus tard, la Russie autocratique dénoncera le traité signé par son tout puissant tsar, le document étant en totale contradiction avec l’alliance franco-russe.
Zorgbibe nous livre aussi le compte-rendu détaillé de la visite de Guillaume II au Vatican, en 1902. Le courant passe bien entre le Kaiser, souverain protestant, et Léon XIII, grand pape réformateur. Le souverain pontife se livre à son visiteur : « Vos principes de gouvernement, je les connais et je les ratifie. […] J’ai fait un rêve : vous empereur d’Allemagne, vous receviez de moi, pape Léon XIII, la mission de combattre les idées socialistes et athées, et de ramener l’Europe au christianisme. »
Sous son règne, Guillaume entretient une obsession : la flotte. Il veut disposer d’une marine de guerre capable de rivaliser avec l’Angleterre. Il multiplie le nombre de navires de ligne, jusqu’à inquiéter les Britanniques sur ses intentions.
Guillaume paye pour
la faute commise par Bismarck
Guillaume II est un être inconséquent et l’Allemagne joue avec le feu. En 1909, quand la situation devient explosive dans les Balkans, Berlin hausse le ton vis-à-vis de la Russie, qui se veut la championne de la cause slave. Un ultimatum est adressé à Saint-Pétersbourg et, contre toute attente, le tsar cède aux exigences allemandes. Comme le fait remarquer Zorgbibe, la passivité de la Russie en 1909 aveuglera les puissances centrales et leur fera croire, en 1914, que l’histoire allait se répéter. Elles penseront à tort que le tsar allait à nouveau céder dans l’affaire des Balkans.
Cependant, quand l’orage menace d’éclater au cœur de l’été 1914, le Kaiser ne se montre pas le va-t-en-guerre que l’on pourrait croire, il cherche un règlement pacifique à la crise. Quand les opérations militaires commencent, c’est lui qui, officiellement, prend le commandement en chef de l’armée allemande. Dans la réalité, affaibli nerveusement, il est vite dépassé par les événements et s’en remet aveuglement à ses généraux. En 1918, quand l’Allemagne est battue, le Kaiser déchu est poursuivi par les puissances alliées qui entendent le traduire en justice. Il trouve refuge aux Pays-Bas, qui refusent de l’extrader.
Chose étonnante, par moment, durant son règne, Guillaume II, qui d’ailleurs parlait parfaitement le français, caressa l’espoir d’une entente avec la France. Mais, d’une certaine manière, c’est lui qui paya la faute originelle commise par Bismarck en 1871, l’annexion de l’Alsace-Lorraine, qui rendait impossible toute entente avec Paris.
Le lecteur peu connaisseur de l’histoire européenne des années 1900 sera peut-être perdu dans l’écheveau des relations diplomatiques exposées par Zorgbibe, mais la présence de nombreux dialogues, en fait des minutes d’entretien, rendent le livre vivant et, somme toute, facile à lire. On peut seulement regretter que l’éditeur n’ait pas cru nécessaire d’ajouter un cahier photos qui aurait permis d’illustrer les propos du biographe.
Une fois le livre refermé, le lecteur saisit mieux la personnalité complexe de Guillaume II, dernier empereur allemand.
Guillaume II, le dernier empereur allemand, de Charles Zorgbibe, 2013, éditions de Fallois.
07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : guillaume 2, le dernier empereur allemand, charles zorgbibe | Lien permanent | Commentaires (0)
30/06/2014
Lincoln, l'homme qui sauva les Etats-Unis, de Bernard Vincent
Un Lincoln profondément humain
Lincoln,
l’homme qui sauva les Etats-Unis
L’intérêt du livre de Bernard Vincent est de nous faire découvrir un Lincoln profondément humain. Abraham Lincoln était un géant d’un mètre quatre-vingt-douze, qui avait fait tous les métiers dans sa jeunesse. Autodidacte, il fit preuve de persévérance et accéda à la profession d’avocat. Entré en politique, il fut élu président des Etats-Unis. Il se montra à la hauteur de la fonction, alliant l’efficacité à l’honnêteté, et gagna la guerre de Sécession.
Lincoln est entré dans l’histoire pour avoir été le président des Etats-Unis qui a gagné la guerre de Sécession et aboli l’esclavage. Mais sa figure semble lointaine aujourd’hui, presque figée dans sa statue de père de la nation américaine. Le mérite du livre de Bernard Vincent est de nous faire découvrir l’être de chair, sa personnalité et son intimité.
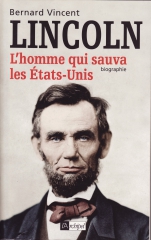 Abraham Lincoln, « Abe », est grand, très grand pour l’époque, il mesure un mètre quatre-vingt-douze. Il n’est pas beau : son visage est buriné et ses oreilles sont en forme de chou. Il n’est pas élégant : sa redingote est mal coupée, son pantalon trop large descend à peine jusqu’aux chevilles, et son éternel haut-de-forme accentue son apparence décharnée.
Abraham Lincoln, « Abe », est grand, très grand pour l’époque, il mesure un mètre quatre-vingt-douze. Il n’est pas beau : son visage est buriné et ses oreilles sont en forme de chou. Il n’est pas élégant : sa redingote est mal coupée, son pantalon trop large descend à peine jusqu’aux chevilles, et son éternel haut-de-forme accentue son apparence décharnée.
Le juriste Edwin Stanton avait refusé de collaborer avec lui quand tous deux exerçaient la profession d’avocat, sous prétexte qu’il ne s’abaisserait pas à travailler avec « ce grand singe aux longs bras ». Cela n’empêcha pas le même Stanton de devenir plus tard secrétaire à la Guerre du président Lincoln et de lui rester fidèle dans les mauvais jours.
En feuilletant le cahier photo du livre, le lecteur découvre un Lincoln imberbe jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans. Son collier de barbe légendaire n’apparait qu’après son élection à la présidence, en 1860. Bernard Vincent nous donne l’explication de ce changement d’apparence. Lors de la campagne électorale, une petite fille de onze ans lui recommanda de se laisser pousser la barbe ; elle lui écrivit : « Vous seriez plus beau, car votre visage est si maigre ! » Quelques mois plus tard, c’est un Lincoln barbu qui alla à la rencontre de la fillette.
Le jeune Lincoln avait été bûcheron
Si le visage de Lincoln est osseux, l’homme est musclé. Il avait été bûcheron dans sa jeunesse. Il avait d’ailleurs fait tous les métiers : écrivain public, commerçant, receveur des postes, aventurier et avocat. Lincoln est un autodidacte, il n’avait pas fréquenté d’université, et c’est par son goût de la lecture allié à la persévérance qu’il put accéder au barreau.
Devenu avocat, il se fit vite la réputation d’être efficace et rigoureux. Il fut d’autant plus demandé qu’aucun dossier ne le rebutait. Ce n’était pas un homme d’argent, il lui arrivait même de plaider gratuitement. Il gagna le surnom d’Honest Abe et, lors d’une allocution prononcée en 1850, il prodigua des conseils à de jeunes avocats, des conseils qui restent valables : « Choisissez d’être honnête en toute circonstance et, si vous estimez ne pouvoir être un avocat honnête, alors optez pour l’honnêteté et abstenez vous d’être avocat. »
Plus surprenant, Lincoln est un être mélancolique, en proie à la dépression. En 1842, il se rendit à son mariage comme à l’abattoir, pressentant peut-être le déséquilibre psychologique de celle qui allait devenir son épouse.
En 1850, la tragédie frappe le couple : l’un de leurs enfants, Eddie, meurt. A ce moment-là, les Lincoln, n’étant pas croyants, ne purent compter sur le secours de la religion. Suite à ce deuil, ils se rapprochèrent du christianisme. En 1862, la mort frappa à nouveau : un second fils, Willie, décéda, à la Maison-Blanche. Abraham Lincoln devint alors un homme profondément religieux, citant Dieu dans ses discours. Quant à son épouse Mary, elle commença de sombrer dans la folie. La situation devint tellement pénible pour Abe qu’il trouva dans la conduite de la guerre un dérivatif à ses soucis conjugaux et à son chagrin.
Bernard Vincent insiste sur le fait que Lincoln, avant sa victoire à la présidentielle, n’avait pas eu une carrière politique particulièrement brillante. Certes il avait emporté des victoires, mais il avait aussi subi d’humiliantes défaites. En 1859, il avait été battu par le démocrate Stephen Douglas dont il disputait la réélection au sénat fédéral. Un an plus tard, il prenait sa revanche sur le même Stephen Douglas en le battant à l’élection présidentielle de 1860. Mais la victoire de Lincoln fut étroite, il ne gagna qu’à la majorité relative des voix, si bien qu’il fut surnommé le minority president.
Lincoln, un président faible qui s’installe à la Maison Blanche
C’est un président faible qui s’installa à la Maison Blanche en mars 1861. Les conditions de son élection et sa réputation d’anti-esclavagiste déclencha la sécession des Etats du Sud. Pourtant Lincoln avait fait le maximum pour les rassurer. Tout en rappelant son hostilité à l’extension de l’esclavage dans les Etats entrant dans l’Union, il confirma dans son discours d’investiture qu’il n’était pas question pour lui de contester aux Etats existants le droit de détenir des esclaves.
Cette tentative de compromis ne suffit pas à empêcher la guerre civile. Le maintien de l’Union fut alors la priorité de Lincoln. Ainsi, en 1862, il écrivit : « Si je pouvais sauver l’Union sans libérer un seul esclave, je le ferais ; si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais ; et si je pouvais y parvenir en libérant certains sans toucher aux autres, je le ferais aussi. » En réalité, au moment où il publiait ce texte dans la presse, en homme politique habile il travaillait déjà à un projet d’émancipation générale qui fut voté en 1865, quelques mois avant la fin de la guerre.
Ce qui frappe dans la personne de Lincoln, c’est sa rigueur morale associée à la lucidité et au souci d’efficacité. Il tance les généraux qui ne poussent pas leur avantage pour emporter la victoire finale, mais il sait rester à sa place en ne se mêlant pas du commandement opérationnel. Il fait preuve de constance en se battant pour la sauvegarde de l’Union et l’abolition de l’esclavage, tout en tâtonnant dans la recherche, au jour le jour, de solutions. Il se trompe quelques fois et reconnaît ses erreurs. Ainsi, dans les derniers jours de la guerre, il reconnut l’assemblée rebelle de Virginie, espérant ainsi hâter le retour de cet Etat dans l’Union. Puis, devant les réactions courroucées des membres de son cabinet, il se ravisa.
Le discours de Gettysburg dura deux minutes
Le sommet de la carrière de Lincoln fut peut-être le discours de Gettysbourg, prononcé sur le lieu de la célèbre bataille, victoire du Nord sur le Sud et surtout énorme massacre, avec un homme en moyenne tombant à chaque seconde de la confrontation. Le 19 novembre 1864, Lincoln arriva à Gettysbourg pour inaugurer le cimetière militaire des morts de la bataille. Un vénérable sénateur prononça un discours soporifique de plus de deux heures. Puis le président prit la parole et s’exprima pendant seulement deux minutes. Dans son très bref discours, Lincoln ne parla ni de la bataille, ni du Sud, ni du Nord, ni de l’esclavage ; au lieu de cela, il prononça une allocution à connotation religieuse sur la liberté et la démocratie. Son discours frappa tellement les esprits qu’encore aujourd’hui les écoliers américains l’apprennent par cœur.
Lincoln n’eut guère le temps de savourer sa victoire. Lui qui disait ne pas savoir s’il sortirait vivant de la Maison Blanche, fut assassiné le vendredi saint de l’année 1865, quelques jours après la reddition du général Lee.
Il y a quelque chose de prophétique, presque de messianique dans le destin de Lincoln. Il croyait fermement en l’avenir des Etats-Unis, il était plein d’espérance quand en 1862, en pleine guerre civile, il annonça dans son discours au Congrès un avenir prometteur pour le pays. Alors que les Etats-Unis étaient encore peu peuplés à l’époque, Lincoln, fort confiant, prévoyait qu’ils compteraient deux-cent-cinquante millions d’habitants en 1930.
Le lecteur qui connaît déjà un peu la guerre de Sécession trouvera beaucoup d’intérêt au livre de Bernard Vincent. Celui qui connaît moins bien l’histoire des Etats-Unis aura peut-être plus de mal à se repérer dans le conflit entre le Nord et le Sud, mais il sera fasciné par la personne de Lincoln, que Bernard Vincent décrit très bien. En plus, le livre contient un cahier photos assez complet.
Lincoln, l’homme qui sauva les Etats-Unis, de Bernard Vincent (2009), éditions de l’Archipel.
08:00 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : lincoln, l’homme qui sauva les etats-unis, bernard vincent | Lien permanent | Commentaires (0)


