15/02/2016
La Recherche de l'absolu, de Balzac
Le monomaniaque à la passion dévorante
La Recherche de l’absolu
A Douai, un notable, Balthazar Claës, se livre à des expériences de chimie dans son laboratoire. Cet homme est à la recherche de l’absolu, qui lui apportera gloire et fortune. Il ne fait plus attention ni à sa femme, ni à ses enfants, ni au monde qui l’entoure, et ne s’intéresse plus qu’à ses expériences. Le portrait que fait Balzac de cet être monomaniaque est remarquable.
Dès la première page du roman, Balzac informe le lecteur qu’il ne le fera pas entrer tout de suite dans l’action. Il va d’abord lui infliger des pages d’exposition, que, déjà à l’époque, certains critiques trouvaient fastidieuses. Et Balzac de se justifier en évoquant « la nécessité de ces préparations didactiques contre lesquelles protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui voudraient des émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l’enfant sans la gestation. » Le lecteur est donc prié de se montrer patient dans sa lecture des pages d’exposition, qui peuvent paraître longues et ardues. Mais ensuite, il se félicitera de s’être montré patient, tant il finira par s’attacher aux personnages et à l’histoire.
 A Douai, monsieur Balthazar Claës-Molina de Nourho, qui se fait tout simplement appeler Balthazar Claës, appartient à l’une des plus vieilles familles de la ville. En 1812, il est âgé d’une cinquantaine d’années et a tout pour être heureux : une femme aimante, de beaux enfants et de l’argent. Pourtant, depuis trois ans, il a beaucoup changé. Alors qu’il était auparavant un caractère noble et attentionné, il s’est renfermé sur lui-même. Il passe l’essentiel de ses journées à l’intérieur du laboratoire qu’il s’est aménagé dans sa vaste demeure. Il ne prend même plus soin de lui-même, nous dit Balzac : « Ses mains poilues étaient sales, ses longs ongles avaient à leurs extrémités des lignes noires très foncées. »
A Douai, monsieur Balthazar Claës-Molina de Nourho, qui se fait tout simplement appeler Balthazar Claës, appartient à l’une des plus vieilles familles de la ville. En 1812, il est âgé d’une cinquantaine d’années et a tout pour être heureux : une femme aimante, de beaux enfants et de l’argent. Pourtant, depuis trois ans, il a beaucoup changé. Alors qu’il était auparavant un caractère noble et attentionné, il s’est renfermé sur lui-même. Il passe l’essentiel de ses journées à l’intérieur du laboratoire qu’il s’est aménagé dans sa vaste demeure. Il ne prend même plus soin de lui-même, nous dit Balzac : « Ses mains poilues étaient sales, ses longs ongles avaient à leurs extrémités des lignes noires très foncées. »
Devenu très distrait comme le sont bien des savants, Balthazar ne s’aperçoit pas de sa crasse, pas plus qu’il ne se rend compte de la présence de sa femme et de ses enfants, ou qu’il n’a conscience qu’il est en train de brûler dans ses expériences la fortune de la maison Claës. Tout son esprit est tourné vers les travaux de chimie qu’il mène dans son laboratoire. Depuis plusieurs années maintenant, il s’est lancé dans la recherche de l’absolu : « une substance commune à toutes les créations, modifiée par une force unique. » Plus concrètement, il mène des expériences qui le conduisent à décomposer le diamant, pour en avoir le secret et en fabriquer ensuite. Or il est sur le point d’aboutir. Plein d’enthousiasme, il s’en ouvre à sa femme Joséphine, qui commençait d’être inquiète de tout cet argent dépensé en vaines expériences. Il veut lui faire partager sa joie et lui déclare : « Mais demain, mon ange, notre fortune sera peut-être sans bornes. Hier en cherchant des secrets bien plus importants, je crois avoir trouvé le moyen de cristalliser le carbone, la substance du diamant. O ma chère femme !... dans quelques jours tu me pardonneras mes distractions. » Régulièrement, Balthazar est sur le point de conclure brillamment sa série d’expériences. Ainsi, quelques temps plus tard, à nouveau il se montre plein d’enthousiasme et dit à sa femme : « Je n’osais te dire qu’entre l’absolu et moi, à peine existe-t-il un cheveu de distance. » Et, encore un autre jour, il déclare que « dans six semaines tout sera fini ! » Il lui suffirait d’un rien pour atteindre le résultat escompté. Mais, en attendant, il lui faut encore disposer de numéraire pour financer ses ultimes expériences. C’est ainsi qu’il aliène la fortune de sa famille au profit d’une chimère.
Balthazar se montre séduisant comme le serpent,
pour extorquer de l’argent à ses proches
Les intentions de Balthazar sont nobles, il veut donner à sa famille gloire et fortune. Mais, comme le fait remarquer Marthe, sa bonne, « il est possédé par le démon, cela se voit ! » Et, après tout, il est bien connu que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Entièrement centré sur lui-même et ses expériences, Balthazar se coupe progressivement du monde extérieur. Il est devenu monomaniaque. Seule la recherche de l’absolu stimule son cerveau. Il ne s’intéresse à rien d’autre. Même les graves événements politiques de l’époque ne retiennent pas son attention. En 1812, la Retraite de Russie le laisse complètement indifférent. Ainsi que l’écrit Balzac : « il n’était ni mari, ni père, ni citoyen, il fut chimiste. »
Par contraste, dans cette histoire, les femmes se montrent admirables. Joséphine est parfaitement lucide sur l’état de son mari et déplore sa monomanie. Elle le met en garde en lui disant que, par ses expériences, il poursuit l’impossible. Cependant elle accepte de le voir engloutir la fortune de la famille. Son amour pour son mari est tel, qu’elle finira par se sacrifier entièrement à lui. Peut-être plus admirable encore est leur fille Marguerite, une jeune femme digne, réfléchie et volontaire, qui aime tellement son père qu’elle voudrait le voir revenir à la raison. Mais la voie est étroite, car il est devenu un être redoutable. Il flatte autrui et se montre séduisant comme le serpent, pour extorquer de l’argent à ses proches. Et s’ils refusent, il se raidit et les accuse d’être égoïstes, alors que lui ne l’est pas, car, comme il le souligne lui-même, « il travaille pour l’humanité ».
Comme souvent chez Balzac, il est beaucoup question d’argent et les notaires sont de la partie. Mais ce qui fait l’originalité de l’histoire, c’est le portrait que fait Balzac d’un monomaniaque dévoré par sa passion, tel qu’on en trouvera plus tard dans l’œuvre de Stefan Zweig. A cela s’ajoutent les peintures de femmes amoureuses, l’une de son mari, l’autre de son père, qui sont aussi très réussies.
La Recherche de l’absolu, de Balzac, 1834, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : la recherche de l'absolu, balzac, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)
11/01/2016
Le Joueur, de Dostoïevski
Récit d’une addiction
Le Joueur
Pour savoir à quoi ressemble l’addiction au jeu dont peuvent être victimes les clients des casinos, il n’est pas besoin de lire une savante étude, il suffit de lire Le Joueur, de Dostoïevski. On y voit le narrateur tomber dans la dépendance et ne plus s’intéresser à rien, « hors gagner au jeu ».
L’histoire se passe à Roulettenbourg la bien nommée, une ville d’eau imaginaire, située en Allemagne, qui possède un casino. Le personnage principal, Alexis Ivanovitch, est le précepteur du « général », un veuf de cinquante-sept ans, dont le nom de famille n’est pas mentionné. Le général est très endetté, il a hypothéqué son domaine auprès du marquis Des Grieux, un aristocrate français. Pour redresser sa situation, il ambitionne de se remarier avec mademoiselle Blanche de Cominges, une jeune femme proche du marquis. Et surtout, il attend avec impatience le décès de celle qui est appelée, dans le roman, « la grand-mère », mais qui est en réalité la tante du général. La grand-mère est âgée et malade, et, le jour où le général recevra le télégramme annonçant son décès, il héritera de son immense fortune. Il pourra alors rembourser Des Grieux et épouser Melle Blanche, qui, tous les deux, viennent de le rejoindre à Roulettenbourg.
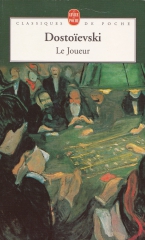 Mais, comme souvent dans la vie, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un lieu va être le théâtre de bien des événements, c’est le casino de Roulettenbourg. Le lecteur qui n’est jamais allé au casino de sa vie est au même niveau de connaissance qu’Alexis au début du roman. Dans un premier temps, pour ses débuts au casino, Alexis, qui sert de narrateur au récit, observe les autres joueurs et ne mise que des petites sommes : « On s’écrasait dans les salles de jeu. Ils sont tous si impudents, si avides ! Je me faufilai vers la table centrale et me plaçai à côté du croupier. Je me mis à tâter à la roulette, timidement, en ne risquant que deux ou trois pièces à la fois. Entre-temps, j’observais et je notais. » Et Alexis, par son observation, découvre que le hasard n’a pas de mémoire : « C’est vraiment curieux. Tel jour, il arrive, par exemple, que rouge alterne avec noir à chaque instant, sans régularité, de telle sorte que rouge ou noir ne sortent pas plus de deux, trois fois de suite. Mais le lendemain matin, ou le soir même, rouge sort sans discontinuer, jusqu’à vingt-deux fois de suite ; et ainsi pendant un certain temps, voire toute une journée. »
Mais, comme souvent dans la vie, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un lieu va être le théâtre de bien des événements, c’est le casino de Roulettenbourg. Le lecteur qui n’est jamais allé au casino de sa vie est au même niveau de connaissance qu’Alexis au début du roman. Dans un premier temps, pour ses débuts au casino, Alexis, qui sert de narrateur au récit, observe les autres joueurs et ne mise que des petites sommes : « On s’écrasait dans les salles de jeu. Ils sont tous si impudents, si avides ! Je me faufilai vers la table centrale et me plaçai à côté du croupier. Je me mis à tâter à la roulette, timidement, en ne risquant que deux ou trois pièces à la fois. Entre-temps, j’observais et je notais. » Et Alexis, par son observation, découvre que le hasard n’a pas de mémoire : « C’est vraiment curieux. Tel jour, il arrive, par exemple, que rouge alterne avec noir à chaque instant, sans régularité, de telle sorte que rouge ou noir ne sortent pas plus de deux, trois fois de suite. Mais le lendemain matin, ou le soir même, rouge sort sans discontinuer, jusqu’à vingt-deux fois de suite ; et ainsi pendant un certain temps, voire toute une journée. »
Quelques jours plus tard, un fait inattendu bouleverse les plans établis par le général ; la grand-mère, que l’on croyait mourante, débarque à l’impromptu. Les pages les plus réussies du roman sont celles consacrées au séjour de la vieille dame à Roulettenbourg. Elle est, dit Des Grieux, « rétive, autoritaire et tombée en enfance ». Tout le monde la craint et tremble devant elle, notamment son neveu de général qui a peur de perdre son héritage. Une fois arrivée à Roulettenbourg, elle a hâte de découvrir le casino dont on lui a tant parlé. C’est Alexis qui lui sert de guide. Elle décide de jouer… et elle gagne ! Mais, au lieu de se satisfaire de son gain, elle déplore de ne pas avoir misé davantage et s’en prend à Alexis : « Tu vois, tu vois, nous avons gagné, mais, si au lieu de dix florins, nous en avions placé quatre mille, nous aurions reçu quatre mille florins, tandis que maintenant… Et c’est tout de ta faute, oui, de ta faute ! »
La grand-mère reste sept à huit heures d’affilée
à la table de jeu sans quitter son fauteuil
Quand elle perd, la vieille dame reste à la table dans l’espoir de « se refaire » ; et quand effectivement elle se reprend à gagner, elle est requinquée et n’a plus de raison de s’arrêter dans son élan, tant que la chance lui sourit. Alexis n’en revient pas : « Je fus stupéfait qu’elle eût pu rester sept à huit heures d’affilée dans son fauteuil sans s’éloigner de la table, mais Potapych [son serviteur] me dit que, par trois fois, elle avait recommencé à gagner de très fortes sommes : régénérée par un nouvel espoir, il n’était plus question qu’elle quittât le jeu. » En quelques jours, la grand-mère brûle une bonne partie de la fortune dont le général espérait tant hériter. Le général croit devenir fou, mais, comme le lui fait remarquer la grand-mère, l’argent qu’elle perd est le sien : « Qu’est-ce que ça peut vous faire ? C’est mon argent que j’ai perdu, pas le vôtre ! »
Alexis lui-même prend goût au jeu, d’autant plus qu’il a tendance à gagner. C’est le début de la dépendance dans laquelle il finit par tomber. On peut supposer que son état nerveux le prédisposait à un tel dérèglement. Lui-même a conscience de son état : « Ces derniers temps, depuis deux ou trois semaines, je ne me sens pas bien : je suis malade, nerveux, irritable, fantasque et parfois, dans certaines circonstances, il m’arrive de perdre tout contrôle sur moi-même. » Il parle de son « état d’énervement indescriptible », et reconnaît avoir été « comme ivre ». Dans le roman, Alexis se montre bavard et s’enivre de paroles, comme, par la suite, il s’enivre au jeu. Une fois au casino, il ne sait plus se maîtriser : « Dès que je m’approche de la roulette, je puis encore en être séparé par d’autres salles, au seul tintement des pièces qui s’entrechoquent en roulant, je suis presqu’en transe ! »
Le jeu devient l’obsession d’Alexis qui est gagné par une espèce d’exaltation. Il a renoncé à tout et ne s’intéresse plus à rien, « hors gagner au jeu ». La fièvre du jeu s’est emparé de lui et l’a transformé en un être monomaniaque.
Le Joueur n’est peut-être pas le grand roman qu’il eût pu être. Il est d’ailleurs assez court pour un Dostoïevski, avec moins de deux-cents pages dans l’édition de la collection Le Livre de poche. Les chapitres consacrés à la dépendance dans laquelle est tombé Alexis eussent pu être plus développés. En revanche, tout ce qui concerne la grand-mère est piquant et mordant, voire drôle.
Ce roman constitue un document de première importance pour comprendre le monde du casino et les mécanismes qui peuvent rendre un joueur dépendant et le conduire à sa perte.
Le Joueur, de Dostoïevski, 1866, collection Le Livre de Poche
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : le joueur, dostoïevski | Lien permanent | Commentaires (0)
14/12/2015
L'Emprise, de Marc Dugain
La comédie humaine du pouvoir
L’Emprise
(Trilogie de l’emprise, tome 1)
L’Emprise est le tome 1 de la trilogie du même nom. Marc Dugain entend démonter les rouages du système politique français. Dans ce House of cards tricolore, les hommes politiques ne pensent qu’à l’Elysée, mais sont impuissants à régler les problèmes des Français. L’Emprise est riche à la fois en rebondissements et en réflexions.
A l’origine, L’Emprise devait être une série télévisée. Marc Dugain avait monté un projet qu’il avait proposé à une chaîne de télévision ; sur le modèle de House of cards dans sa version britannique, il avait prévu de tourner une fiction démontant les rouages du système politique français. Selon Dugain, son commanditaire eut une première réaction enthousiaste avant de se raviser et d’abandonner l’idée. Convaincu que son projet dérangeait, Dugain décida d’en faire une trilogie sous forme de livres. L’Emprise est à la fois le titre de la trilogie et de son tome 1.
 L’Emprise tient du roman-feuilleton, les chapitres sont courts, riches en action et en rebondissements ; ils possèdent chacun leur unité, si bien qu’ils eussent pu être publiés dans la presse quotidienne, à la manière des romans du XIXème siècle. Dans cette comédie humaine qui se joue autour du pouvoir, il y a tout une galerie de portraits. Les personnages sont très nombreux, si bien que, comme chez Balzac, le lecteur se doit d’être attentif pour mémoriser leur nom et leur identité.
L’Emprise tient du roman-feuilleton, les chapitres sont courts, riches en action et en rebondissements ; ils possèdent chacun leur unité, si bien qu’ils eussent pu être publiés dans la presse quotidienne, à la manière des romans du XIXème siècle. Dans cette comédie humaine qui se joue autour du pouvoir, il y a tout une galerie de portraits. Les personnages sont très nombreux, si bien que, comme chez Balzac, le lecteur se doit d’être attentif pour mémoriser leur nom et leur identité.
Sans être top fastidieux, on peut citer les principaux personnages : Philippe Launay, candidat à l’élection présidentielle et favori des sondages ; Lubiak, son grand rival qui accepte de se retirer de la course à la candidature à condition que Launay s’engage à n’accomplir qu’un seul mandat ; Charles Volone, puissant président de la Française d’électricité ; son numéro deux, Humbert Deloire, au style de vie flamboyant, qui fait de nombreux déplacements en Chine ; Li, maîtresse de Deloire, jeune Chinoise qui s’adonne à la peinture. On peut encore citer Lorraine, agent de la DCRI, chargée de surveiller Li ; elle a un fils, Gaspard, un garçon de seize ans au comportement singulier.
Dans L’Emprise, il y a des meurtres, des accidents et beaucoup de coups bas. Il se peut que, par moments, le lecteur soit un peu perdu dans le dédale d’affaires politico-financières, mais il reste accroché à l’histoire, d’autant plus qu’aucune longue description ne vient casser le rythme. Dugain n’a peut-être pas un style relevé, ses phrases sont souvent saccadées, mais au moins elles sont claires et se comprennent dès la première lecture.
Vis-à-vis de la société, les hommes politiques
ne sont pas des meneurs, mais des suiveurs
Au-delà de toutes les péripéties contenues dans son histoire, Dugain propose toute une réflexion sur la société actuelle. Il montre des hommes politiques, Launay et Lubiak en tête, obsédés par la conquête de l’Elysée. Ils sont entourés de communicants et d’experts en sondage qui guident leurs choix en les sous-pesant. Ils ont peu de prise sur les événements et, face à la société et à ses évolutions, ils sont moins des meneurs que des suiveurs. Selon Dugain, Launay est lucide quand il constate l’inefficacité de l’action politique : « Il était conscient qu’une fois au sommet de l’Etat il ne pourrait rien changer en profondeur. Le pouvoir était désormais ailleurs, partiellement insaisissable, et le reprendre exigeait des sacrifices qu’on ne pouvait demander à personne dans le pays. Il se voyait au mieux l’arbitre pondéré entre des égoïsmes contradictoires et antagonistes dissimulant leur véritable nature sous des contours généreux. » Dans L’Emprise, les hommes politiques ne cessent d’avoir le mot « rassemblement » à la bouche, mais il s’agit seulement d’une incantation, car, dans la réalité, le mot qui représente le mieux l’état de fait, c’est le mot « impuissance ».
Dugain déplore que, depuis la chute du communisme, « l’avidité » soit devenu le seul modèle qui régisse la planète. D’ailleurs, du fait de leur avidité, ses hommes politiques traînent beaucoup de « casseroles » qui pourraient compromettre leurs ambitions. Assez pessimiste, Dugain met en garde les nations « civilisées » contre la Chine, qui, par sa puissance, menace les grands équilibres.
On peut se féliciter d’avoir en Dugain l’un des rares écrivains français contemporains capables d’écrire des fictions, destinées au grand public, permettant de comprendre la réalité d’une époque. Une fois L’Emprise refermé, on n’a qu’une seule envie, attaquer le tome II de la trilogie : Quinquennat.
L’Emprise (Trilogie de l’emprise, tome 1), de Marc Dugain, 2014, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Policier, thriller, Société, XXe, XXIe siècles | Tags : l'emprise, trilogie de l'emprise, marc dugain | Lien permanent | Commentaires (0)


