20/01/2014
La Peur, de Stefan Zweig
Histoire de la femme adultère
La Peur
Cette nouvelle, qui se lit presque d’une traite, est une œuvre de jeunesse de Stefan Zweig. A Vienne, l’épouse d’un grand avocat trompe son mari avec un pianiste. Un jour, elle est surprise par l’amie du musicien qui va se transformer en maître-chanteuse. La peur envahit la femme adultère.
La Peur est l’une des nombreuses nouvelles de Stefan Zweig. Elle est facile à lire et se dévore presque d’une traite. Comme d’habitude, l’auteur fait preuve d’une économie de moyens : il n’y a ni lourdeur ni longueur, la construction du récit étant très rigoureuse. Tout est concentré, ce qui donne à l’histoire toute son efficacité. La Peur a été écrite en 1913, c’est une œuvre de jeunesse de Zweig que l’on peut qualifier de balzacienne. L’auteur nous décrit avec minutie les ravages de la peur qui envahit une épouse infidèle, issue de la bonne société.
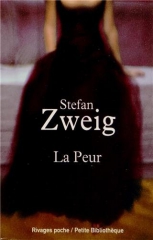 A Vienne, dans les années 1900, madame Irene Wagner, épouse d’un grand avocat, vit une aventure avec un pianiste de renom. Au sortir d’un rendez-vous avec son amant, elle est surprise par l’amie du musicien, une femme de basse extraction, qui l’accuse de lui avoir volé son homme. Aussitôt, madame Wagner ressent une montée d’adrénaline qui a pour effet d’imprimer le visage de cette femme-là dans son cerveau : « l’horreur de ce souvenir […] restait fiché dans son cerveau comme un hameçon ». Elle va être victime d’un chantage, sous la menace que sa liaison soit révélée à son mari. Elle sait bien qu’il ne faut jamais céder à un maître-chanteur, mais sous le coup de l’émotion elle perd ses moyens. La peur s’empare de tout son être, avec toute une série de symptômes qui l’accompagnent : nervosité, spasmes, émotions exacerbées, sommeil perturbé, mauvais rêves, crises d’hystérie…
A Vienne, dans les années 1900, madame Irene Wagner, épouse d’un grand avocat, vit une aventure avec un pianiste de renom. Au sortir d’un rendez-vous avec son amant, elle est surprise par l’amie du musicien, une femme de basse extraction, qui l’accuse de lui avoir volé son homme. Aussitôt, madame Wagner ressent une montée d’adrénaline qui a pour effet d’imprimer le visage de cette femme-là dans son cerveau : « l’horreur de ce souvenir […] restait fiché dans son cerveau comme un hameçon ». Elle va être victime d’un chantage, sous la menace que sa liaison soit révélée à son mari. Elle sait bien qu’il ne faut jamais céder à un maître-chanteur, mais sous le coup de l’émotion elle perd ses moyens. La peur s’empare de tout son être, avec toute une série de symptômes qui l’accompagnent : nervosité, spasmes, émotions exacerbées, sommeil perturbé, mauvais rêves, crises d’hystérie…
Irene ne connait pas son mari
Madame Wagner ne sait quelle attitude adopter face à son mari. Elle aimerait lui avouer la vérité, lui dire qu’elle l’a trompé et qu’aujourd’hui une odieuse femme la fait chanter, mais elle n’ose pas franchir le pas. Son mari lui paraît plein de bonté et de sagesse. Elle se souvient qu’un soir il était rentré à la maison en déclarant « Aujourd’hui, on a condamné un innocent ». Et Zweig de poursuivre, comme si les idées de l’avocat reflétaient les siennes : « Un voleur venait d’être condamné pour un larcin commis trois ans auparavant, et à tort selon lui, car après trois années ce crime n’était plus le sien. On condamnait quelqu’un qui était devenu autre et on le punissait doublement car il avait passé trois ans dans la prison de sa propre peur, dans l’inquiétude permanente d’être découvert. » Le mari de madame Wagner est un homme d’une grande humanité dans sa vie professionnelle, mais montrera-t-il la même compassion face à une affaire d’adultère dans laquelle sa femme est coupable ? C’est alors que madame Wagner prend conscience qu’après huit ans de mariage et d’intimité partagée, elle ne connait pas vraiment son mari et se sent incapable de prévoir sa réaction.
Envahie par la peur, craignant de croiser sa maître-chanteuse dans la rue si elle met le nez dehors, madame Wagner décide de se cloître dans son appartement. Mais, faisant ainsi, privée de toute relation sociale, elle perd sa raison de vivre, car dans son milieu on n’existe que par rapport aux autres : « Irene appartenait à cette élégante bourgeoisie viennoise dont l’emploi du temps semble régi par un accord tacite qui fait que tous les membres de cette alliance invisible se retrouvent toujours aux mêmes heures à s’intéresser aux mêmes choses, au point que s’observer mutuellement et se rencontrer étaient peu à peu devenu le sens de leur existence. » Livrée à elle-même, rongée par la peur et confrontée au vide de son existence, madame Wagner se dirige vers la solution du suicide.
Les lecteurs de Zweig sont habitués à ce que ses histoires terminent mal, tant le pessimisme est présent dans son œuvre ; en sera-t-il de même cette fois ?
La Peur, de Stefan Zweig (1913), collections Rivages Poche / Petite Bibliothèque.
09:15 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la peur, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)
09/12/2013
Lettres, notes et portraits / 1928-1974, de Georges Pompidou
Pour lever le mystère Pompidou
Lettres, notes et portraits / 1928-1974, de Georges Pompidou
Ce recueil contient des écrits inédits rédigés par Georges Pompidou, de sa jeunesse à sa mort. Il permet de mieux cerner la personnalité d’un président méconnu. On découvre un Pompidou humaniste, lucide et visionnaire, qui peut malgré tout se montrer dur dans certains de ses jugements.
Ce livre contribue à lever le voile sur Georges Pompidou, qui reste peut-être le président le plus mystérieux de la Vème République, tant les contradictions semblent nombreuses dans sa personnalité et son parcours : socialiste dans sa jeunesse, il passa pour être un président conservateur ; féru d’art moderne et convaincu de l’importance de la contestation dans l’art, il n’en resta pas un moins un homme d’ordre ; voulant moderniser la France et la couvrir d’autoroutes, il accorda beaucoup d’importance à l’environnement et à la protection des paysages ; salarié d’une banque privée, il se considéra comme serviteur de l’Etat ; ami de membres de la jet-set, il fut imprégné de la grandeur de la fonction de président… La liste des contradictions apparentes serait longue à dresser et ce livre permet de mieux les comprendre.
 Une bonne part de l’ouvrage est constituée de la correspondance de Pompidou avec Robert Pujol, son ami de jeunesse et frère spirituel, professeur comme lui, avec qui il a échangé pendant plus de quarante ans. Sans tabou, Pompidou évoque avec lui de très nombreux sujets et livre, avec franchise, le fond de sa pensée. Ainsi, en 1934, il écrit à Pujol que la perspective du professorat l’ennuie profondément, mais reconnaît un avantage certain à son futur métier : la longueur des vacances. En 1967, alors qu’il est premier ministre, Pompidou écrit sans ambages : « En réalité, la politique serait idéale si on avait trois mois de vacances […] ». Ancien professeur, il suit de près les dossiers d’éducation et, en 1961, il écrit à Pujol qui se plaint de sa situation dans l’enseignement : « […] Je me suis parfois senti tenté de prendre le ministère de l’Education nationale pour tout foutre en l’air. Et puis je me suis dit que c’était une tâche surhumaine. »
Une bonne part de l’ouvrage est constituée de la correspondance de Pompidou avec Robert Pujol, son ami de jeunesse et frère spirituel, professeur comme lui, avec qui il a échangé pendant plus de quarante ans. Sans tabou, Pompidou évoque avec lui de très nombreux sujets et livre, avec franchise, le fond de sa pensée. Ainsi, en 1934, il écrit à Pujol que la perspective du professorat l’ennuie profondément, mais reconnaît un avantage certain à son futur métier : la longueur des vacances. En 1967, alors qu’il est premier ministre, Pompidou écrit sans ambages : « En réalité, la politique serait idéale si on avait trois mois de vacances […] ». Ancien professeur, il suit de près les dossiers d’éducation et, en 1961, il écrit à Pujol qui se plaint de sa situation dans l’enseignement : « […] Je me suis parfois senti tenté de prendre le ministère de l’Education nationale pour tout foutre en l’air. Et puis je me suis dit que c’était une tâche surhumaine. »
Pompidou sauve la tête de Jouhaud,
mais refuse de gracier Buffet et Bontemps
Pompidou a aussi échangé une correspondance assez étonnante avec François Mauriac, auquel il confie ses états d’âme. A la mort de l’homme de lettres, il écrit à sa veuve que son mari fut un peu son confesseur. C’est un Georges Pompidou très humain qui apparaît au fil des pages du recueil. Tout frais premier ministre, en 1962, il met sa démission dans la balance pour sauver la tête du général Jouhaud, l’un des auteurs du putsch d’Alger, condamné à mort et que de Gaulle tient absolument à faire exécuter. De Gaulle finira par céder et acceptera de gracier Jouhaud. Autre preuve d’humanité, au lendemain de la guerre d’Algérie, Pompidou écrit au père Régamey, l’un des porte-parole du mouvement des objecteurs de conscience, et lui annonce la mise en place d’un service civil. Mais attention, Pompidou l’humain n’est pas un faible. S’il a tenu tête à de Gaulle pour sauver Jouhaud, il reste néanmoins favorable à la peine mort. En 1972, dans une longue note argumentée destinée à ses archives, il se justifie d’avoir refusé la grâce pour Buffet et Bontemps, et épingle au passage maître Badinter, avocat de Bontemps. Selon la procédure alors en vigueur, Pompidou reçoit les avocats des condamnés : « Ce qui me frappe, c’est que tous bien sûr sont contre la peine de mort (encore que Badinter, pour défendre Bontemps, me paraisse prêt à expédier Buffet sans remords). ». Sur le fond du dossier, Pompidou justifie son refus de grâce au nom de la précaution, sachant que, lors de leur tentative d’évasion de la centrale de Clairvaux, Bontemps et Buffet ont égorgé deux personnes. Pompidou écrit : « Si on met Buffet, dément, dans un asile, combien de médecins, d’infirmiers ou d’infirmières, mettra-t-il à son tableau de chasse, ne pensant bien sûr qu’à s’évader ? Il a été prouvé que la prison n’était pas une précaution. »
Le Pompidou le plus inattendu est celui qui veut moderniser la France sans la défigurer. Il écrit son désespoir après avoir découvert, en passant en voiture, la construction de la tour de la faculté de Jussieu. Contre son premier ministre et son administration, il défend la sauvegarde des alignements d’arbres le long des routes dans une lettre à Jacques Chaban-Delmas : « Il ressort que l’abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. […] Quelle que soit l’importance des problèmes de circulation et de sécurité routière, cela ne doit pas conduire à défigurer notre pays. […] Le maintien de nos routes plantées d’arbres est essentiel pour la beauté de la France, la protection de la nature, pour la sauvegarde d’un environnement humain. […] Le sauvetage du paysage français doit être une de nos préoccupations. »
Même le Pompidou féru d’art contemporain n’est pas celui qu’on croit quand il écrit que, de toutes les œuvres qu’il a achetées, c’est quatre aquarelles de Rodin qui le touchent le plus. Mais il ajoute aussitôt qu’il veut être de son temps en suivant la recherche et l’aventure en matière d’art.
Un portrait cruel de Jacques Chaban-Delmas
Il y a aussi le Pompidou qui, fort de son expérience, livre ses réflexions sur le fonctionnement de l’Etat. Au lendemain de son départ de Matignon, il se livre à une analyse du rôle du premier ministre et admet la difficulté de la charge : « Son rôle n’est pas […] facile. D’abord, pour être à l’aise et en repos avec sa conscience, il faut jamais n’être en désaccord avec les décisions importantes du chef de l’Etat. Le premier ministre doit, si j’ose dire, être sur la même longueur d’onde que le président de la République. ». Dans ces réflexions émises en 1968, on peut voir les prémisses de la confrontation qu’il aura avec son premier ministre Jacques Chaban-Delmas, dont il dresse un portrait cruel : « Il travaille peu, ne lit pas de papiers, en écrit encore moins encore, préférant discuter avec ses collaborateurs et s’en remet essentiellement à eux qu’il choisit bien, pour ce qui est des affaires publiques s’entend. » De Mitterrand Pompidou écrit à plusieurs reprises qu’il n’est pas socialiste : « Comment peindre quelqu’un que je ne connais pas ? Je ne puis formuler que des impressions liées à son comportement physique et politique. […] Il suffit de le voir pour se rendre compte qu’il n’est pas socialiste. » Quelques fois Pompidou varie : dans un premier temps, il défend le septennat, pour ensuite, avec des arguments inversés, défendre le quinquennat, peut-être sous l’effet de la maladie.
Pompidou le banquier n’est pas un homme d’argent. Il dépense tout ce qu’il gagne et ne court pas après les indemnités. Quand, en 1959, de Gaulle le nomme au Conseil constitutionnel, il lui répond favorablement mais lui demande à ne pas être rémunéré dans l’exercice de cette fonction publique, alors qu’il continue d’exercer son activité professionnelle au service des Rothschild : « Je souhaite pour ma part pouvoir renoncer à ce traitement [de membre du Conseil] dans sa totalité. Le cumul même partiel avec mes émoluments privés m’apparaîtrait excessif et serait critiqué. Je pense, mon Général, que vous partagerez ce point de vue et que si vous donnez suite à votre projet de me nommer, vous voudrez bien m’autoriser à exercer ces fonctions à titre purement bénévole. »
Le livre présente un écrit atypique : une auto-interview de Pompidou intitulée Entretien imaginaire. Pompidou y livre ses goûts, notamment en matière de littérature. Sur une île déserte, il emporterait tout Balzac, mais pas Zola (« Il écrit vraiment trop mal »). Par ailleurs, dans une lettre à Mauriac qui avait évoqué Les Possédés de Dostoïevski dans son Bloc-notes, Pompidou écrit qu’il considère « ce livre comme peut-être le chef d’œuvre de la littérature romanesque ». Plus jeune, en 1931, Pompidou évoque son goût prononcé pour Baudelaire « Et plus je réfléchis, plus je me sens près de Baudelaire. […] Je m’aperçois qu’il avait les mêmes goûts que moi. »
Le recueil est complété d’un témoignage d’Alain Pompidou. Enfant adopté, il rend hommage à ses parents, qui lui ont « prodigué une affection débordante », si bien qu’il n’a jamais cherché à connaître ses origines.
Il est dommage que les lettres publiées ne soient pas précédées de quelques lignes explicatives qui les remettent dans leur contexte. Néanmoins, le livre est passionnant et permet de se rendre compte de la richesse de la personnalité de Pompidou. Son souvenir ne saurait se limiter à l’affaire Markovic et à la maladie qui l’emporta en 1974.
Lettres, notes et portraits / 1928-1974 de Georges Pompidou (2012), aux éditions Robert Laffont.
07:01 Publié dans Carnets, correspondance, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : pompidou, lettres notes et protraits | Lien permanent | Commentaires (0)
25/11/2013
Le Désert des Tartares, de Dino Buzzati
Le soldat et la mort
Le Désert des Tartares
L'histoire racontée dans ce livre est maintenant bien connue : affecté dans un fort lointain, un soldat attend l’ennemi qui le fera héros. Au-delà, Dino Buzzati nous propose une réflexion sur la vie et sur la mort.
C’est un livre captivant, bien qu’il ne contienne quasiment pas d’action. Il est peu épais et rythmé par des chapitres courts. Le Désert des Tartares nous apporte en premier lieu le dépaysement. L’histoire se déroule dans un pays imaginaire, le royaume du Nord. Le jeune lieutenant Drogo reçoit sa première affectation : le fort Bastiani. Bien que le roi Pietro III ait déclaré le fort Bastiani sentinelle avancée de sa couronne, nous nous apercevons vite de son isolement. Le lieu est aux confins du royaume, dans une zone montagneuse, coincé entre la lointaine ville et le désert des Tartares, d’où l’ennemi peut surgir à tout moment. Mais, comme nulle armée ne s’est montrée depuis des années, plus personne ne croit à la menace.
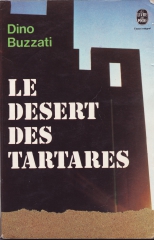 Dans un premier temps, Drogo n’a qu’une idée en tête, quitter le fort où il a été affecté contre son gré. Mais, au bout de quatre mois, quand la possibilité de départ s’offre à lui, il préfère rester, non par héroïsme, mais parce qu’il a pris ses habitudes : il est devenu prisonnier de la routine du fort et reste par facilité. Et pourtant, que la vie y est étriquée, régie par le règlement jusqu’à l’absurdité. Un soir, un soldat de la garnison qui avait manqué à l’appel se présente aux portes du fort. La sentinelle croit reconnaître un camarade, ce qui ne l’empêche pas de tirer sur lui après les sommations d’usage, ainsi que le règlement l’exige. Le soldat s’effondre, touché à mort. Le sous-officier de semaine est catastrophé, non parce qu’un homme est mort, mais parce qu’il risque d’être sanctionné pour cette bavure. Quant au commandant, il se réjouit de ce que la sentinelle ait fait mouche du premier coup malgré l’obscurité.
Dans un premier temps, Drogo n’a qu’une idée en tête, quitter le fort où il a été affecté contre son gré. Mais, au bout de quatre mois, quand la possibilité de départ s’offre à lui, il préfère rester, non par héroïsme, mais parce qu’il a pris ses habitudes : il est devenu prisonnier de la routine du fort et reste par facilité. Et pourtant, que la vie y est étriquée, régie par le règlement jusqu’à l’absurdité. Un soir, un soldat de la garnison qui avait manqué à l’appel se présente aux portes du fort. La sentinelle croit reconnaître un camarade, ce qui ne l’empêche pas de tirer sur lui après les sommations d’usage, ainsi que le règlement l’exige. Le soldat s’effondre, touché à mort. Le sous-officier de semaine est catastrophé, non parce qu’un homme est mort, mais parce qu’il risque d’être sanctionné pour cette bavure. Quant au commandant, il se réjouit de ce que la sentinelle ait fait mouche du premier coup malgré l’obscurité.
En attendant l’arrivée bien improbable de l’ennemi, le lieutenant Drogo mène la vie de caserne sans s’apercevoir qu’il y laisse sa jeunesse et, nous lecteur, nous comprenons alors que Dino Buzzati nous propose une réflexion sur la vie et la mort. Le fort est situé entre la ville et le désert : la ville, avec son animation, représente la vie ; tandis que le désert, dans son immense solitude et avec la menace ennemie, représente la mort, dont nul ne sait ni le jour ni l’heure. Usant d’une image, Buzzati nous montre d’abord Drogo dans l’insouciance de la jeunesse, cheminant placidement sur la route de la vie sous un soleil resplendissant ; du seuil de leurs maisons, les grandes personnes lui font des signes amicaux et lui montrent l’horizon avec des sourires complices. Puis, à mesure que Drogo vieillit, le soleil se déplace et se fait plus pâle, tandis que des portes se ferment derrière lui ; aux fenêtres il n’aperçoit plus que des visages immobiles et indifférents. Quand, après quatre ans passés au fort, Drogo retourne en ville pour sa première permission, il retrouve sa mère et ses proches. Mais il se rend compte amèrement que plus rien n’est comme avant. Certes, sa mère est toujours là et sa chambre d’enfant est restée intacte. Mais, après avoir été éloigné de ses proches pendant quatre ans, il comprend que sa route s’est écartée de la leur. Les personnes qui lui étaient familières sont maintenant comme des étrangers pour lui. Il ne reste plus à Drogo qu’à retourner au fort en espérant une attaque ennemie qui lui permette une action héroïque, car, comme le fait remarquer un officier : « Nous désirons la guerre, nous attendons l’occasion favorable, nous crions à la malchance parce qu’il n’arrive jamais rien ». Au fort Bastiani Drogo attendra que son destin s’accomplisse.
PS : Le Désert des Tartares a inspiré à Jacques Brel la chanson Zangra.
Le Désert des Tartares de Dino Buzzati (1949), collection Le Livre de poche (épuisé) et Press Pocket.
09:20 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : le désert des tartares, buzzati | Lien permanent | Commentaires (1)


