22/11/2021
Illusions perdues, de Balzac
L’œuvre capitale dans l’œuvre de Balzac
Illusions perdues
Lucien de Rubempré, un jeune homme très beau et plein d’esprit, rêve de devenir un écrivain célèbre. Monté à Paris, il se lance dans le journalisme, espérant ainsi obtenir la gloire, la puissance et l’argent. Mais il finira par se brûler les ailes. Dans ce roman foisonnant et riche en intrigues, Balzac démonte les rouages de la presse, s’inquiète de sa puissance, pointe ses dérives et prédit que le journalisme sera la folie de notre temps.
Lucien de Rubempré est un garçon de vingt-deux ans, beau comme un dieu grec. Il est mince, blond, aux yeux bleus ; sa beauté est féminine, nous précise Balzac. En tout cas, les dames de la bonne société de son Angoulême natale se pâment devant lui. Il est plein d’esprit et écrit avec talent. La nature l’a gâté, mais il possède un défaut qui pourrait gâcher toutes ses qualités : il est vaniteux et a une haute idée de lui-même. Son véritable nom est Lucien Chardon, mais il prétend s’appeler Lucien de Rubempré, Rubempré étant le nom de jeune fille de sa mère, qu’il entend relever. Il veut acquérir la gloire, la puissance et l’argent. Ne doutant pas de son talent, il croit que son recueil de vers Les Marguerites et son roman L’Archer de Charles IX, s’ils étaient édités, rencontreraient tout de suite le succès et lui procureraient la gloire littéraire.
 Plein d’ambition, Lucien monte à Paris, bien décidé à percer dans les milieux littéraires. Ses manuscrits à la main, il va voir Dauriat, libraire-éditeur. Mais ce dernier dédaigne ses œuvres : il ne veut pas prendre le risque d’éditer un inconnu. Dauriat privilégie les écrivains qui ont déjà un nom connu et dont la notoriété assure le succès : « On n’entre ici qu’avec une réputation faite ! Devenez célèbre, et vous y trouverez des flots d’or » déclare Dauriat à Lucien ; lequel, dépité, répond : « Mais, Monsieur, si tous les libraires (libraires=éditeurs, NDLA] disent ce que vous dites, comment peut-on publier un premier livre ? »
Plein d’ambition, Lucien monte à Paris, bien décidé à percer dans les milieux littéraires. Ses manuscrits à la main, il va voir Dauriat, libraire-éditeur. Mais ce dernier dédaigne ses œuvres : il ne veut pas prendre le risque d’éditer un inconnu. Dauriat privilégie les écrivains qui ont déjà un nom connu et dont la notoriété assure le succès : « On n’entre ici qu’avec une réputation faite ! Devenez célèbre, et vous y trouverez des flots d’or » déclare Dauriat à Lucien ; lequel, dépité, répond : « Mais, Monsieur, si tous les libraires (libraires=éditeurs, NDLA] disent ce que vous dites, comment peut-on publier un premier livre ? »
Balzac prend le contre-pied de Walter Scott
Lucien rencontre un jeune écrivain, Daniel d’Arthez : celui-ci accepte de lire le manuscrit de L’Archer de Charles IX, puis donne à Lucien quelques conseils pour améliorer son style narratif. C’est l’occasion pour Balzac, à travers d’Arthez, d’exposer sa conception du roman et de son mode de construction. Balzac, ou plus précisément d’Arthez, prend le contre-pied de Walter Scott : il déconseille à Lucien d’ouvrir son roman par un dialogue, la forme littéraire la plus facile ; il lui recommande de commencer par des descriptions qui doivent précéder le dialogue : « Que chez vous le dialogue soit la conséquence attendue qui couronne vos préparatifs ». Balzac en profite pour s’en prendre aux libraires-éditeurs, qui ont peur du risque et veulent absolument dénicher un Walter Scott à la française qui leur assurerait le succès ; il nous dit qu’ils ont tout faux et feraient mieux de faire preuve d’originalité : « Une des plus grandes niaiseries du commerce parisien est de vouloir trouver le succès dans les analogues, quand il est dans le contraire. » En conclusion, d’Arthez conseille à Lucien de remanier son manuscrit et de beaucoup travailler ; la route sera longue, mais à la longue, sa peine sera récompensée.
Il n’y a pas de meilleure publicité qu’une bonne polémique
Parallèlement, Lucien fait une autre rencontre, celle d’un jeune journaliste, Etienne Lousteau, qui écrit des critiques de livres et de spectacles. Aussitôt, Lucien est fasciné par le métier de journaliste et les facilités qu’il procure : Lousteau entre sans payer dans les théâtres, et les gens importants sont pleins d’égard pour lui. Il fait miroiter à Lucien les possibilités que procure le métier, un métier facile à exercer, le journaliste n’ayant pas à faire preuve d’originalité. Comme le précise Lousteau, il est là pour relater et commenter le travail des autres : « Mon cher, travailler n’est pas le secret de la fortune en littérature, il s’agit d’exploiter le travail d’autrui. »
Les journalistes font la pluie et le beau temps, et leur arme suprême est de faire l’impasse totale sur un sujet, car il n’y pas de meilleure publicité qu’une bonne polémique pour assurer la notoriété d’un roman ou d’une pièce, selon Lousteau : « Les actrices payent aussi les éloges, mais les plus habiles payent les critiques, le silence est ce qu’elles redoutent le plus. Aussi une critique, faite pour être retoquée ailleurs, vaut-elle mieux et se paye-t-elle plus cher qu’un éloge tout sec, oublié le lendemain. La polémique, mon cher, est le piédestal des célébrités. »
Dès qu’il a compris le pouvoir de la presse, Lucien veut en être et s’exclame : « Je triompherai ! » Daniel d’Arthez et ses amis du Cénacle le mettent en garde : « Tu serais si enchanté d’exercer le pouvoir, d’avoir droit de vie et de mort sur les œuvres de la pensée, que tu serais journaliste en deux mois. […] Tu n’as que trop les qualités du journaliste : le brillant et la soudaineté de la pensée. Tu ne refuseras jamais un trait d’esprit, dût-il faire pleurer ton ami. Je vois les journalistes aux foyers des théâtres, ils me font horreur. » Mais Lucien est décidé, sa voie est tracée ; il s’accroche et s’incruste dans Le Journal, où travaille Lousteau.
« Des articles lus aujourd’hui, oubliés demain,
ça ne vaut à mes yeux que ce qu’on les paye. »
Le journaliste dispose d’un pouvoir sur les autres : si un libraire-éditeur déplaît à un rédacteur, alors, même s’il publie un chef-d’œuvre, son livre sera assommé par la critique. Ainsi, quand le nommé Nathan publie un livre qui plaît particulièrement à Lucien, celui-ci a de bonnes raisons de vouloir le « démolir », mais il se sent incapable de dire du mal d’un livre auquel il a trouvé de grandes qualités. Or, « le journaliste est un acrobate », selon Lousteau, qui montre à Lucien par quel tour de force il peut changer les qualités du livre en défauts, tout en lui trouvant des mérites, afin de convaincre le lecteur de l’impartialité de sa critique.
Cette attitude, qui consiste à écrire le contraire de ce que l’on pense, est-elle choquante ? Non, répondent les journalistes ; car, comme le souligne un confrère nommé Blondet, « tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. Les idées sont binaires. » Blondet, s’appuyant sur l’exemple de Rousseau, apostrophe Lucien : « Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, a écrit une lettre pour et une lettre contre le duel, oserais-tu prendre sur toi de déterminer sa véritable opinion ? » Somme tout, un journaliste sage et raisonnable ne doit pas mettre trop de lui-même dans ses articles, car, ainsi que le souligne un journaliste du nom de Vernou, « des articles lus aujourd’hui, oubliés demain, ça ne vaut à mes yeux que ce qu’on les paye. » Selon lui, les journalistes sont « des marchands de phrase ».
Balzac nous montre les journalistes travaillant dans l’urgence. A dix heures du soir, aucun article à publier le lendemain n’est encore écrit. Les rédacteurs se mettent au travail dans la nuit et « bâclent » leurs articles en quelques minutes. Un bon journaliste est un journaliste qui écrit rapidement et qui sait s’adapter à toute situation.
Lucien apprend vite. Il publie un premier article bien ficelé, salué par ses confrères. « Il a de l’esprit », dit un rédacteur ; « Son article est bien », dit un autre. En étalant ses qualités professionnelles, Lucien croit qu’il sera récompensé par une ascension rapide. Bien au contraire ; car Lousteau, celui-là même qui l’avait introduit au Journal, va le jalouser : « En regardant Lousteau, [Lucien] se disait : « Voilà un ami ! » sans se douter que déjà Lousteau le craignait comme un dangereux rival. Lucien avait eu le tort de montrer tout son esprit : un article terne l’eût admirablement servi. »
Lucien sera victime de la jalousie de ses confrères, mais aussi de lui-même, de sa vanité et de ses faiblesses de caractère. Pourtant plein d’esprit, il prend tout au premier degré ; il boit les compliments qui lui sont adressés, sans douter de leur sincérité ; et il ne comprend pas qu’il affronte des adversaires qui voient plus loin que lui et jouent, si l'on peut dire, du billard à trois bandes.
Balzac nous met en garde contre la presse,
« ce cancer qui dévorera peut-être le pays »
« Le journalisme sera la folie de notre temps ! » s’exclame, dans un élan visionnaire, un personnage du roman, qui anticipe le développement à venir de la presse. Dans la préface du livre, Balzac lui-même nous met en garde contre la presse, « ce cancer qui dévorera peut-être le pays ». Il s’inquiète de la puissance de la presse et pointe des dérives qui, deux siècles après la publication de son livre, n’ont fait que s’amplifier.
Balzac accordait une importance première aux Illusions perdues, dont il disait que c’est « l’œuvre capitale dans l’œuvre ». Pourtant c’est un roman qui, au premier abord, semble difficile à lire. Le livre est épais, l’intrigue est foisonnante, et les personnages sont nombreux. Si le lecteur ne se montre pas patient, il aura du mal à accrocher et se découragera vite. Si, en revanche, il a l’esprit disponible, alors il se passionnera pour les aventures et les mésaventures de Lucien de Rubempré ; il sera emporté dans un tourbillon d’intrigues et de manipulations qui ne cesse d’enfler au fil des pages ; il trouvera le roman si riche que, après l’avoir refermé, toute lecture d’un autre auteur risque de lui paraître fade. Illusions perdues est une œuvre maîtresse de Balzac : son génie romanesque et son talent visionnaire éclatent au fur et à mesure que l’histoire avance.
Déjà très riche en péripéties, les Illusions perdues sont la porte d’entrée de Splendeurs et misères des courtisanes, roman qui racontent la suite de l’histoire de Lucien de Rubempré, et qui s’annonce tout aussi passionnant. A la fin des Illusions perdues, le lecteur s’est tellement attaché à Lucien qu’il est navré d’avoir assisté à son naufrage. Il le laisse en si fâcheuse position, qu’il n’a qu’une envie : savoir ce qu’il advient de lui.
Illusions perdues de Balzac (1843), collections Folio, Garnier et Le Livre de Poche (On pourra préférer l’édition du Livre de Poche plus aérée, qui reprend la division en chapitres tels qu’ils furent publiés en feuilleton dans la presse.)
08:43 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : illusions perdues, balzac, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)
20/11/2017
Balzac, le roman de sa vie
L’homme qui voulut concurrencer Dieu
Balzac
Le roman de sa vie
Stefan Zweig consacra à Balzac une biographie dans laquelle il montra l’étendue et la puissance de son œuvre. Il raconta sa vie, qui fut un véritable roman, et toutes ses mésaventures, qui nourrirent nombre de ses livres. La Comédie humaine était une œuvre titanesque dont l’accomplissement finit par épuiser ses forces, si bien que Balzac est mort d’avoir voulu concurrencer Dieu.
Stefan Zweig avait fait de Balzac l’un de ses principaux maîtres. Non sans déférence, il l’appelait le « Grand Balzac ». Il était fasciné par sa personnalité hors du commun, sa puissance créatrice, sa force, sa volonté, qui lui paraissaient surhumaines. Il voyait en lui un concurrent de Dieu qui avait créé « à côté du monde réel un autre cosmos », celui de la Comédie humaine.
 Le Balzac de Zweig est un homme qui entend soumettre le réel à sa volonté. C’est ainsi que, pour commencer, il modifia son patronyme. Né Honoré Balzac, sans particule, il décida, à trente ans, de se l’attribuer et de devenir Honoré de Balzac aux yeux de ses contemporains et pour la postérité. Très en avance sur son temps à cet égard, il transforma son nom en une marque destinée à rencontrer le succès littéraire et commercial.
Le Balzac de Zweig est un homme qui entend soumettre le réel à sa volonté. C’est ainsi que, pour commencer, il modifia son patronyme. Né Honoré Balzac, sans particule, il décida, à trente ans, de se l’attribuer et de devenir Honoré de Balzac aux yeux de ses contemporains et pour la postérité. Très en avance sur son temps à cet égard, il transforma son nom en une marque destinée à rencontrer le succès littéraire et commercial.
Ce sont les femmes qui contribuèrent à forger le destin de Balzac. La première d’entre elles fut Mme de Berny, une aristocrate ayant quinze ans d’âge de plus que lui et dont il fit la connaissance dans ses années d’apprentissage. Dans un écrit, Balzac reconnut la dette qu’il lui devait : « elle a été une mère, une amie, une famille, un ami, un conseil. Elle a fait l’écrivain, elle a consolé le jeune homme […]… sans elle, je serais mort. » C’est Mme de Berny qui lui inspira La Femme de trente ans, l’un de ses premiers succès ; à travers l’Europe, des milliers de lectrices qui étaient malheureuses dans leur mariage se reconnurent dans le personnage principal et eurent l’impression qu’il se trouvait enfin un écrivain pour comprendre leur désarroi.
De toutes les femmes de Balzac, Zulma Carraud fut, selon Zweig la plus pure. Bourgeoise de province, elle était cultivée et surtout très lucide, notamment quand elle poussa Balzac à nettoyer son style de ses lourdeurs. Plein de reconnaissance à son égard, il la remercia de l’aider à « arracher les mauvaises herbes de son champ ». Avant tout le monde, elle avait compris la puissance de l’œuvre de Balzac et lui déclara avec beaucoup de pertinence : « Vous êtes le premier prosateur de l’époque et, pour moi, le premier écrivain. Vous seul vous êtes semblable et tout paraît fade après vous. »
Si elle admirait l’écrivain,
Mme de Hanska n’avait que mépris pour l’homme
Il y eut beaucoup d’autres conquêtes dans la vie de Balzac, lequel, selon les mots de Zweig, « change de femme plus souvent que de chemise. » Néanmoins Balzac eut l’intention de se marier ; il voulait, disait-il, « une femme et la fortune » pour assurer sa sécurité matérielle. Or, un jour de 1831, Balzac, qui était habitué à recevoir des lettres d’admiratrices, en reçut une provenant d’Ukraine, mystérieusement signée « l’Etrangère ». Son auteur se révèle être Mme de Hanska, épouse d’un aristocrate russe ; il entama avec elle une correspondance régulière, et ils se rencontrèrent, pour la première fois, à Genève en présence de M. de Hanski, lequel voyait en Balzac un ami de la famille, sans percevoir qu’il entretenait une liaison avec sa femme. Les deux amants s’engagèrent et attendirent patiemment la mort du mari, beaucoup plus âgé que sa femme.
Mais ensuite, au lieu d’épouser aussitôt Balzac, Mme de Hanska, devenue libre, le fit lanterner ; car, si elle admirait l’écrivain, elle n’avait que mépris pour l’homme Balzac, individu d’un rang social largement inférieur au sien. Zweig se montre sévère pour Mme de Hanska, en qui il voit une femme gâtée par la fortune et ne pensant qu’à son propre plaisir. Elle traita Balzac comme s’il était un serf lui appartenant ; et lui-même accepta son statut d’inférieur : il se présentait, dans ses lettres, comme étant « son fidèle et obéissant moujik ». Elle consentit à l’épouser, mais seulement après avoir acquis la certitude que leur union serait brève, Balzac étant gravement malade.
Zweig perce le grand secret de Balzac
Balzac vécut mille aventures et mésaventures au cours de son existence. Il se lança dans de nombreuses entreprises commerciales (imprimerie, édition, spéculation foncière, exploitation de mines d’or…), et à chaque fois il échoua, non qu’il eût tort sur le fond, mais parce qu’il était d’un caractère trop impatient : après avoir semé, il ne parvenait pas à attendre le temps de la récolte. Sur le long terme, toutes ses intuitions se révélèrent justes. Mais ce furent d’autres que lui qui en tirèrent profit. Lui-même passa sa vie criblé de dettes et harcelé par ses créanciers. Pour leur échapper, il inventa mille stratagèmes, possédant par exemple plusieurs demeures à Paris, dans lesquelles un visiteur ne pouvait pénétrer sans avoir donné le mot de passe au domestique.
Le lecteur doit se féliciter des multiples échecs qu’essuya Balzac, car ils servirent de matériaux à nombre de ses romans, dont César Birotteau ou Illusions perdues. Zweig note : « Pour avoir travaillé avec les ouvriers, lutté contre les usuriers, marchandé sans répit avec les fournisseurs, il a acquis une connaissance infiniment plus précise des rapports et des conflits sociaux que ses grands contemporains : Victor Hugo, Lamartine et Alfred de Musset. » Plus loin, Zweig perce le grand secret de Balzac : « tout est sujet » ; « La réalité est une mine inépuisable quand on s’entend à la fouiller. Il n’est besoin que d’observer comme il faut et chaque homme devient un acteur de La Comédie humaine. Il n’y a pas de haut ni de bas : on peut tout choisir et – c’est là pour Balzac le point capital – on doit tout choisir. Qui veut peindre le monde ne peut laisser de côté aucun de ses aspects, tous les échelons de l’échelle sociale doivent être représentés, le peintre tout comme l’avocat et le médecin, le vigneron, la concierge, le général et le fantassin, la comtesse, la petite prostituée des rues, le porteur d’eau, le notaire et le banquier. »
« Plus Balzac devient amer sous les coups de l’expérience,
plus il devient vrai »
La Comédie humaine, telle que la concevait Balzac, était une œuvre titanesque, dont l’accomplissement finit par épuiser ses forces : « C’est le seul homme peut-être dont on peut dire sans exagération qu’il s’est tué au travail. » Sa monomanie conduisit Balzac à un rythme quotidien hors du commun : il se couchait tous les soirs à six heures, se levait à minuit et écrivait de minuit à huit heures quand Paris dormait. Le jour levé, il ne ralentissait pas son rythme de travail et relisait les épreuves apportées de l’imprimerie. Ses corrections étaient si nombreuses qu’il indisposait les typographes, lesquels refusaient de « faire plus d’une heure de Balzac par jour ».
Zweig n’hésite pas à critiquer certaines imperfections dans nombre de romans de Balzac. Ainsi il déplore que Louis Lambert fut écrit trop vite, mais il reste admiratif devant Le Père Goriot et César Birotteau, écrits dans les années 1830 ; et il fait observer que ses dernières œuvres sont les plus percutantes : « Plus Balzac devient amer sous les coups de l’expérience, plus il devient vrai. » Pour Zweig, Une ténébreuse affaire et La Rabouilleuse, écrits dans les années 1840, sont des « œuvres grandioses ». Balzac eut le temps de finir Le Cousin Pons et La Cousine Bette, qui sont, aux yeux de Zweig, ses « deux plus grands romans ».
Vers 1847, son cerveau soumis à trop de tensions refusa d’obéir à sa volonté créatrice. Balzac, qui perdait peu à peu la vue, cessa définitivement d’écrire et mourut, riche et marié. Sur sa tombe, Victor Hugo prononça une oraison funèbre que Zweig reproduit et dans laquelle le poète qualifia Balzac d’ «homme de génie », ce que nombre de contemporains ne mesuraient pas.
Notre époque a trop tendance à réduire Balzac à l’état d’écrivain un peu ennuyeux, réservé aux programmes scolaires. Le livre de Zweig permet de découvrir l’étendue et la richesse de son œuvre. Qui doute encore du génie de Balzac n’a qu’à lire La Messe de l’athée, qui fait une trentaine de pages et qui n’exige pas plus d’une heure de lecture ; Zweig qualifie cette nouvelle de « chef-d’œuvre en miniature ».
Balzac, le roman de sa vie, de Stefan Zweig, 1942, collection Le Livre de poche.
08:37 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre | Tags : balzac le roman de sa vie, balzac, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)
18/09/2017
Louis Lambert, de Balzac
Livre hermétique, mais fondamental
Louis Lambert
A travers le personnage de Louis Lambert qu’il présente comme un ancien camarade de collège, Balzac parle de Dieu, de l’homme et du monde. Pour parvenir au bout de ce roman qui peut paraître hermétique, le lecteur doit fournir un effort qui n’est pas vain, s’il garde en tête que certaines intuitions de Balzac furent ensuite confirmées par la science.
Louis Lambert n’est pas le meilleur roman de Balzac, ni le plus connu. Bien qu’assez court, il est difficile à lire, car il ne contient pas de véritable intrigue et il est truffé de réflexions d’ordre scientifique, philosophique et religieux, qui bien souvent dépassent l’entendement du lecteur. Pourtant ce livre mérite d’être lu, car il tient une place centrale dans l’œuvre de Balzac et permet d’approcher son système de pensée.
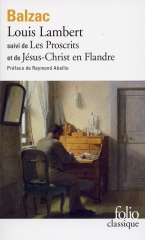 Procédé rarement utilisé par Balzac, ici il y a un narrateur qui raconte l’histoire à la première personne du singulier, ce qui donne au roman un caractère personnel. Le narrateur, donc Balzac, se fait le biographe de Louis Lambert, qu’il présente comme un ancien camarade de collège dont il aurait été l’ami intime. En 1811, le narrateur avait douze ans et était pensionnaire chez les Oratoriens de Vendôme, quand, en cours d’année, il vit débarquer, dans sa classe de quatrième, un nouveau nommé Louis Lambert, âgé de quatorze ans. Les deux garçons se découvrirent beaucoup de points en commun : « Nous ne savions, se souvient l’auteur, ni jouer à la balle, ni courir, ni monter sur les échasses. » En revanche, ils aimaient à discuter ensemble et se découvrirent complémentaires l’un de l’autre ; devenus inséparables comme des frères, ils furent vite surnommés le Poète-et-le-Pythagore.
Procédé rarement utilisé par Balzac, ici il y a un narrateur qui raconte l’histoire à la première personne du singulier, ce qui donne au roman un caractère personnel. Le narrateur, donc Balzac, se fait le biographe de Louis Lambert, qu’il présente comme un ancien camarade de collège dont il aurait été l’ami intime. En 1811, le narrateur avait douze ans et était pensionnaire chez les Oratoriens de Vendôme, quand, en cours d’année, il vit débarquer, dans sa classe de quatrième, un nouveau nommé Louis Lambert, âgé de quatorze ans. Les deux garçons se découvrirent beaucoup de points en commun : « Nous ne savions, se souvient l’auteur, ni jouer à la balle, ni courir, ni monter sur les échasses. » En revanche, ils aimaient à discuter ensemble et se découvrirent complémentaires l’un de l’autre ; devenus inséparables comme des frères, ils furent vite surnommés le Poète-et-le-Pythagore.
Louis Lambert était ce qu’on appellerait aujourd‘hui un enfant surdoué : il lisait énormément et avait une mémoire prodigieuse. Ses connaissances étaient encyclopédiques ; mais, ne connaissant la société que par les livres, il planait au-dessus d’elle. Louis Lambert confia un jour au narrateur : « Je préfère la pensée à l’action, une idée à une affaire, la contemplation au mouvement. » Au collège, il entreprit l’écriture d’un Traité de la volonté, mais il fut surpris par un surveillant idiot, qui lui confisqua son manuscrit et le détruisit.
Si ce traité est définitivement perdu, les conversations que son auteur eut avec Balzac permettent de connaître quelques unes de ses idées. Louis Lambert était un spiritualiste, adepte des préceptes de Swedenborg, un mystique suédois qui fit grand bruit au XVIIIème siècle. Selon Swedenborg, l’homme a une vocation d’ange ; s’il « fait prédominer l’action corporelle, rapporte Balzac, au lieu de corroborer sa vie intellectuelle, toutes ses forces passent dans le jeu de ses sens extérieurs, et l’ange périt lentement. » A la mort, l’ange se dégage de son enveloppe : alors « commence la vraie vie. »
Louis Lambert hésite entre spiritualisme et matérialisme
En réalité, à la manière de Balzac, Louis Lambert hésitait entre spiritualisme et matérialisme : « Son œuvre, précise le narrateur, portait les marques de la lutte que se livraient dans cette belle âme, ces deux grands principes, le spiritualisme, le matérialisme, autour desquels ont tourné tant de beaux génies, sans qu’aucun d’eux n’ait osé les fondre en un seul. D’abord spiritualiste pur, Louis avait été conduit invinciblement à reconnaître la matérialité de la pensée. » Ainsi Louis Lambert reconnut lui-même l’importance de la « substance électrique » dans la manifestation de la volonté, comme si elle-même, elle obéissait, non à une loi morale, mais à une loi physique ; d’ailleurs le narrateur parle de l’électricité comme étant le « roi des fluides ». Même si Louis Lambert peine à trouver et définir un système unitaire qui expliquerait le monde, il ne veut pas opposer la « pensée matérielle » à une forme de croyance spirituelle. Il croit bon de préciser : « A ce système Dieu ne perd aucun de ses droits. »
Louis Lambert avait beaucoup réfléchi aux questions religieuses, même si cet esprit indépendant ne pouvait se reconnaître d’aucune obédience, selon Balzac : « Quoique naturellement religieux, Louis n’admettait pas les minutieuses pratiques de l’Eglise romaine. » Il revendique une espèce de syncrétisme peu orthodoxe qui relie les religions entre elles, que ce soit le christianisme, l’islam, le vichnouvisme, le brahmaïsme : « L’homme, écrivit Louis Lambert, n’a jamais eu qu’une religion. […] La trimouti [hindoue], c’est notre trinité. »
Louis Lambert enfant avait conscience que sa vie serait courte, et elle le fut. Peut-être parce qu’il avait soumis son cerveau à trop de tensions, il finit par tomber dans un état de quasi-prostration. En fait, Louis Lambert n’avait pas sa place dans une société qui n’avait aucune considération pour ses travaux de recherche. Comme le déplore Balzac, « ici, tout doit avoir un résultat immédiat, réel ; l’on se moque des essais infructueux qui peuvent mener aux plus grandes découvertes et l’on n’estime pas cette étude constante et profonde qui veut une longue concentration des forces. » Louis Lambert n’était pas un être comme les autres, or, poursuit Balzac, « en province, un original passe pour un homme à moitié fou. »
Avec un siècle d’avance, Balzac annonce Teilhard de Chardin
Comme nous l’avons souligné, Louis Lambert est un roman difficile à lire, tant il contient d’idées pouvant paraître hermétiques. Balzac se rendait bien compte que certains lecteurs risquaient de l’abandonner en cours de route ; aussi, au passage, croit-il bon de s’adresser à « ceux auxquels ce livre ne sera pas tombé des mains. »
Le mieux pour le lecteur est de piocher dans Louis Lambert des passages qui retiennent son attention. C’est ce que recommande Raymond Abellio, auteur de la préface dans la collection Folio. Ainsi lui-même s’est-il arrêté sur la phrase : « Et la chair se fera le Verbe, elle deviendra LA PAROLE DE DIEU » ; cette phrase biblique, inversée et conjuguée au futur, annonce, selon Abellio, les thèses défendues un siècle plus tard par Teilhard de Chardin, pour qui l’homme évoluait vers un être spirituel qui connaîtrait l’amour total.
En tout cas, il ne faudrait pas prendre ce livre uniquement pour une série d’élucubrations, car il faut toujours garder en tête que certaines intuitions de Balzac, concernant notamment la transformation des espèces, furent confirmées par la science.
Comme le fait très justement observer Samuel de Sacy, auteur de la notice, aucune étude approfondie du système de pensée de Balzac n’a été faite ; car, pour la mener à bien, son auteur devrait être à la fois spécialiste de Balzac, expert en philosophie mystique et en religions, mais aussi expert en sciences naturelles ainsi qu’en histoire des sciences naturelles. Or il est difficile de trouver autant de spécialisations en une seule personne.
Balzac pensait que Dieu est incompréhensible à l’homme. C’est peut-être pour cette raison que Louis Lambert est difficilement compréhensible au lecteur.
Louis Lambert, de Balzac, 1832, préface de Raymond Abellio, 1968, édition de Samuel S. de Sacy, 1979, collections Folio.
08:36 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XIXe siècle | Tags : louis lambert, balzac, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)


