30/01/2017
La Ruée vers l'Ouest (Cimarron), d'Anthony Mann
Œuvre mutilée, mais spectaculaire
La Ruée vers l’Ouest
(Cimarron)
Anthony Mann casse le mythe de la conquête de l’Ouest. Pour lui, ce n’est pas la soif de liberté, mais l’appât du gain qui fut la principale motivation des pionniers. Bien que mutilée par la Metro-Goldwin-Mayer, La Ruée vers l’Ouest reste un spectacle grand public contenant des scènes puissantes dans lesquelles on reconnaît la patte du réalisateur.
Le 22 avril 1889 au matin, des dizaines de milliers de colons étaient rassemblés aux frontières de l’Oklahoma. Venus avec leurs chariots, ils répondaient à l’appel du président des Etats-Unis, qui avait proclamé le territoire ouvert aux home seekers (les chercheurs de terre). Ce 22 avril, ce fut à midi précises que l’armée donna les coups de pistolet autorisant les colons à pénétrer en Oklahoma. Dès que le signal fut donné, les chevaux tirant les chariots s’élancèrent, dégageant d’impressionnants nuages de poussière. C’est le land run, la ruée vers la terre ; le premier arrivé est le premier servi ; le simple fait de planter un piquet sur une parcelle permet d’en revendiquer la propriété. Les colons, dont certains n’étaient arrivés qu’avec un dollar en poche, espéraient trouver en Oklahoma la terre promise, source de prospérité.
 La ruée sur ce territoire reste une grande page de l’histoire américaine et a contribué au mythe de la conquête de l’Ouest. Dès 1931, l’un des premiers westerns parlants, Cimarron, d’après le roman d’Edna Ferber, racontait les conditions de la colonisation de l’Oklahoma. Ce film avait été l’un des grands succès de la MGM. Près de trente ans plus tard, à la fin des années cinquante, Edmund Granger, l’un des producteurs du célèbre studio, décida de tourner une nouvelle version de Cimarron, en couleur et en cinémascope. Il confia la mise en scène à Anthony Mann, réalisateur réputé de westerns, qui, quelques années plus tôt, avaient relancé la carrière de James Stewart.
La ruée sur ce territoire reste une grande page de l’histoire américaine et a contribué au mythe de la conquête de l’Ouest. Dès 1931, l’un des premiers westerns parlants, Cimarron, d’après le roman d’Edna Ferber, racontait les conditions de la colonisation de l’Oklahoma. Ce film avait été l’un des grands succès de la MGM. Près de trente ans plus tard, à la fin des années cinquante, Edmund Granger, l’un des producteurs du célèbre studio, décida de tourner une nouvelle version de Cimarron, en couleur et en cinémascope. Il confia la mise en scène à Anthony Mann, réalisateur réputé de westerns, qui, quelques années plus tôt, avaient relancé la carrière de James Stewart.
Anthony Mann bénéficia de moyens importants. Le film fut entièrement tourné en extérieurs et en décors naturels, sans faire appel aux fameuses transparences chères au Hollywood de l’époque. De très nombreux figurants furent recrutés et trois-cents chariots furent nécessaires pour tourner la séquence de la ruée sur l’Oklahoma. Le résultat à l’écran est spectaculaire.
Le héros s’appelle Yancey Cravat ; il a reçu le surnom de Cimarron, parce qu’il est, nous dit-on, tête brûlée et indompté. Après avoir fait tous les métiers, il s’est marié, et avec sa jeune épouse il compte prendre possession d’une parcelle en Oklahoma. Il souhaite se stabiliser en cultivant la terre et en élevant des enfants. Mais un jour il est témoin du lynchage d’un Indien. Furieux d’avoir été le spectateur impuissant d’un crime, il est décidé à ne plus laisser passer la moindre injustice. Il prend la direction du journal local et entame un combat contre la violence, l’intolérance et l’inégalité.
Pendant qu’il se bat pour ses idées, d’autres colons, plus pragmatiques, travaillent la terre à la sueur de leur front, capitalisent… et font fortune. Quand Tom, un paysan mal dégrossi, a besoin d’un coup de main, il s’adresse à Yancey Cravat. Celui-ci, très avisé, lui recommande de prospecter le sous-sol. Le conseil s’avère judicieux, car Tom finit par trouver du pétrole. C’est ainsi qu’en quelques années le simple fermier qu’il était devient l’un des plus gros industriels de l’Oklahoma. Sa fortune faite, il devient un notable cynique et plein de morgue.
Pour Yancey Cravat, un compte en banque bien fourni n’est en rien
l’indicateur de l’accomplissement d’une vie
Anthony Mann montre la rapidité de la transformation de ce nouveau territoire. Au début du film, les colons se déplacent à cheval et dorment à la belle étoile. A la fin du film, ils circulent en automobile, communiquent par téléphone et édifient les premiers gratte-ciel, dotés d’ascenseurs. Ce fulgurant développement a été possible du fait de la dureté au travail de certains colons, mais aussi du fait de leur avidité. Leurs motivations sont uniquement matérielles, un quelconque idéal de liberté et de justice leur est complètement étranger. D’où l’ambiguïté du film.
Yancey Cravat, lui, ne veut pas entrer dans ce jeu. Au grand désespoir de sa femme, il refuse le fauteuil de gouverneur que lui a proposé un comité de notables, qui cherchaient à récupérer une part de sa notoriété. Il est vrai que l’offre n’était pas dénuée d’arrière-pensées : les notable attendaient de lui une contrepartie, à savoir un certain degré de « coopération » de sa part. Pour Cravat, qui est un incorruptible, de telles conditions sont inacceptables. Il décline le poste afin de garder sa liberté. Quand sa femme lui fait observer que tous leurs amis sont devenus millionnaires, Yancey lui répond qu’un compte en banque bien fourni n’est en rien l’indicateur de l’accomplissement d’une vie.
En réalité, Yancey Cravat est un éternel insatisfait qui ne tient pas en place. Quand on le croit encore ici, il est déjà là-bas. Il abandonne sa femme et son fils pour défendre le pauvre et combattre l’injustice. En 1914, lorsque la guerre éclate en Europe, il s’engage comme volontaire dans l’armée britannique.
Ironie de l’histoire : des années plus tard, quand les notables voudront célébrer ce que fut l’esprit pionnier, ils édifieront une statue en mémoire de Yancey Cravat, alors que celui-ci se sera battu, toute sa vie, pour des valeurs qu’eux-mêmes auront allègrement piétinées.
Quand il comprit les intentions d’Anthony Mann,
le producteur s’affola et interrompit le tournage
Anthony Mann, fidèle à lui-même, ne se borna pas à tourner un livre d’images. Il voulut donner une dimension politique à son film et introduisit de la complexité dans les caractères. En plein tournage, le producteur Edmund Granger découvrit les intentions d’Anthony Mann et prit conscience qu’il était en train de s’éloigner du projet initial, qui était de célébrer un mythe de l’histoire américaine. Edmund Granger s’affola et interrompit le tournage. Il coupa des scènes au montage et en intercala d’autres, qu’il fit tourner par d’autres réalisateurs, et qui sont les moins réussies du film.
Anthony Mann, tenu à l’écart, ne reconnut pas son œuvre et la désavoua. La Ruée vers l’Ouest est donc une œuvre mutilée qui ne correspond pas au film qu’il avait en tête. Cependant l’ensemble est agréable à regarder et contient des scènes puissantes dans lesquelles on reconnaît la patte du réalisateur. Les puristes préfèrent en général ses précédents westerns, qui sont beaucoup plus personnels ; mais celui-ci touche davantage le public amateur de films à grand spectacle.
La Ruée vers l’Ouest (Cimarron), d’Anthony Mann, 1960, avec Glenn Ford, Maria Schell et Anne Baxter, DVD Warner Home Vidéo.
09:28 Publié dans Film, Western | Tags : la ruée vers l’ouest, cimarron, anthony mann, glenn ford, maria schell, anne baxter | Lien permanent | Commentaires (0)
23/01/2017
Hitler m'a dit, d'Hermann Rauschning
Hitler tel qu’il est
Hitler m’a dit
En 1939, Hermann Rauschning, un ancien dignitaire nazi, publiait Hitler m’a dit pour alerter le monde sur les véritables desseins du chancelier allemand. L'auteur fait le portrait d’un Hitler chef de gang, prêt à sacrifier des millions de vies pour parvenir à ses fins.
Hermann Rauschning naquit en 1887 en Prusse Orientale. Fils d’un propriétaire terrien, il était appelé à hériter du domaine familial ; mais la défaite de l’Allemagne, en 1918, bouleversa son destin. Ses terres étant situées dans la partie de la Prusse annexée par la Pologne, il se trouva dépossédé.
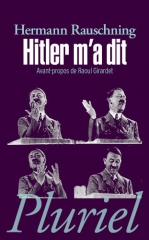 Humilié et blessé, il adhéra au parti nazi et fut élu au Sénat de la Ville libre de Dantzig. Au lendemain de la Grande Guerre, Dantzig ne faisait plus partie du Reich et avait reçu un statut spécial sous protection de la SDN (Société des nations).
Humilié et blessé, il adhéra au parti nazi et fut élu au Sénat de la Ville libre de Dantzig. Au lendemain de la Grande Guerre, Dantzig ne faisait plus partie du Reich et avait reçu un statut spécial sous protection de la SDN (Société des nations).
De 1933 à 1934, pendant un peu plus d’un an, Hermann Rauschning fut président du Sénat de Dantzig, et, à ce titre, il fut le chef du gouvernement de la Ville. En tant que haut responsable nazi, il fut amené à approcher Hitler à plusieurs reprises, avant et après l’accession de celui-ci à la chancellerie du Reich.
A l’occasion de ces rencontres, Rauschning fut défavorablement impressionné par Hitler. De plus en plus inquiet, il fuit l’Allemagne en 1935 et se réfugia en Suisse, puis aux Etats-Unis. En 1939, il publia Hitler m’a dit dans le but d’alerter ses contemporains sur les desseins d’Hitler et sa personnalité.
A la question « Quelle impression Hitler produit-il ? », Rauschning répond qu’il éveilla en lui des impressions contradictoires. En août 1932, il fut reçu à l’Oberzsalzberg, le chalet d’Hitler dans les Alpes bavaroises, et pénétra son intimité. Or, le portrait qu’il fait du Führer n’est pas celui d’un être charismatique. « Dans ce cadre, écrit Rauschning, le grand tribun disparaissait, s’effaçait jusqu’à n’être plus qu’un bourgeois insignifiant. […] Hitler n’a vraiment rien qui puisse attirer. » Rauschning parle de son regard fixe et éteint, et déplore sa « voix criarde, gutturale, menaçante et frénétique ». Il évoque aussi sa manie de se curer les dents d’un « geste affreusement vulgaire ».
Hitler aurait pu être inventé par Dostoïevski
Pourtant Hitler a déclenché l’enthousiasme de certains. Rauschning s’interroge donc pour savoir comment cet homme « gauche et embarrassé » peut subjuguer les masses, et comment même des hommes cultivés et intelligents tombent en extase dès qu’ils le rencontrent. « On est obligé de penser aux médiums », écrit Rauschning. Selon lui, les médiums sont des hommes ordinaires et insignifiants, qui subitement se trouvent dotés de pouvoirs qui les élèvent au-dessus du commun. Rauschning confesse lui-même qu’en présence d’Hitler il fut victime d’une « sorte d’emprise hypnotique ».
Rauschning évoque à plusieurs reprises l’instabilité du caractère d’Hitler : « A la moindre contradiction, il entrait dans de violentes colères » ; mais ses accès de fureur étaient « soigneusement prémédités ». Suite à un incident mineur, Rauschning le vit vociférer : « Il criait à perdre voix, il trépignait et frappait du poing sur la table et contre les murs. Sa bouche écumait ; il haletait comme une femme hystérique et éructait des exclamations entrecoupées : "Je ne veux pas !... F…ez le camp ! traitres !" Ses cheveux étaient en désordre, son visage contracté, ses yeux hagards et sa face cramoisie. Sur le moment, j’eus peur qu’il ne tombât victime d’une attaque. » Par certains aspects, Hitler fait penser aux Possédés de Dostoïevski. Rauschning écrit lui-même à propos du dictateur : « Cet être aurait pu être inventé par Dostoïevski. »
L’auteur ne se borne pas à livrer les clés de la psychologie d’Hitler, il raconte aussi les coulisses de son accession au pouvoir. A plusieurs reprises, Hitler donna l’impression d’hésiter sur la voie à suivre : la voie de la brutalité ou la voie de la légalité. Finalement il opta pour la seconde solution, quitte à donner l’impression d’être velléitaire et quitte à être critiqué par certains de ses camarades du Parti.
Pour Rauschning, les Nazis sont des gangsters
qui pratiquent le pillage et l’assassinat
En ce qui concerne les principaux chefs nazis, Rauschning déclare qu’ils ont des « méthodes de gangsters ». Leur objectif principal est de s’enrichir au maximum dans le minimum de temps. Leur slogan pourrait être, selon Rauschning, « Enrichissez-vous » ; et il poursuit : « Les nazis s’emplissaient les poches à une allure si scandaleuse qu’on n’arrivait plus à suivre la cadence du pillage. […] Pendant ce temps, le Führer renonçait à son traitement de chancelier. Il donnait, lui, le bon exemple. Il n’avait besoin de rien. En une nuit, il était devenu l’éditeur le plus riche du monde, cousu de millions, l’auteur le plus lu, le plus obligatoirement lu. » Ici Rauschning fait allusion à l’obligation qu’avait chaque foyer allemand de posséder dans sa bibliothèque un exemplaire de Mein Kampf, ce qui assura à Hitler la vente de plusieurs millions d’exemplaires de son livre.
Chez les gangsters, la vie ne tient qu’à un fil. Depuis la nuit des Longs-Couteaux et la liquidation de Rœhm, chef des SA, chacun sait que l’assassinat est une solution qui, à tout instant, permet de résoudre les problèmes. En conséquence, chaque chef nazi constitue des dossiers sur ses camarades, qu’il dépose chez un notaire, afin de disposer d’une police d’assurance.
En février 1933, le Reichstag fut incendié. Les communistes furent accusés. Sur le moment, Rauschning fut persuadé que le Komintern avait commandité l’incendie. Mais, quelques jours plus tard, alors qu’il patiente dans une antichambre de la chancellerie du Reich, il surprit une conversation entre Gœring et Himmler. Goering racontait avec force détails comment ses « garçons » avaient utilisé un passage souterrain pour pénétrer dans le Reichstag et l’incendier. « Eclats de rire de satisfaction, plaisanteries, fanfaronnades, telles étaient les réactions de ces "conjurés". »
« Hitler n’a jamais pu terminer une conversation
sans éclater au moins une fois en imprécations contre les juifs »
Dans le livre, il est question de l’antisémitisme du régime. Selon Rauschning, la plupart des chefs nazis, très pragmatiques, voient dans l’élimination des juifs l’occasion de s’enrichir à bon compte en les expropriant. Quelques uns d’entre eux cherchent aussi à satisfaire leurs « rêves sadiques ». Quant à Hitler, il croit profondément que « le juif est tout simplement le Mal ». Rauschning poursuit : « Hitler ne manquait pas de raisons pour exprimer sa haine. Il en était comme possédé au point qu’il n’a jamais pu terminer une conversation sans éclater au moins une fois en imprécations contre les juifs. »
Selon Rauschning, Hitler parlait de ses projets devant tel ou tel collaborateur, seulement dans la mesure où celui-ci était concerné; mais il se gardait bien de lui donner une vision d’ensemble de ses intentions. Devant Rauschning cependant, Hitler alla assez loin en lui dévoilant une bonne partie de ses plans. Un jour, il lui déclara : « Il nous faut l’Europe et ses colonies. […] Notre espace complet, à nous, c’est l’Europe. Celui qui la conquerra imprimera son empreinte au siècle à venir. Nous sommes désignés pour cette tâche. Si nous ne réussissons point, nous succomberons, et tous les peuples européens périront avec nous. » Hitler précisa qu’il était prêt à « sacrifier toute une génération de la jeunesse allemande », et ajouta : « Même si tel doit être le prix, je n’hésiterai pas une seconde à me charger la conscience de la mort de deux ou trois millions d’Allemands. » Et concernant les peuples dont il s’apprêtait à saisir les territoires, il conclut : « Nous aurons le devoir d’éliminer ces peuples. »
Cependant, pour arriver à ses fins, Hitler n’écartait de passer un pacte avec l’Union Soviétique : « Peut-être ne pourrai-je pas éviter l’alliance avec la Russie. Mais je garde cette possibilité comme mon dernier atout. […] Et si jamais je me décide à miser sur la Russie, rien ne m’empêchera de faire encore volte-face et de l’attaquer lorsque mes buts à l’Occident seront atteints. » Rappelons qu’Hitler m’a dit fut publié en 1939 et que la rupture du pacte germano-soviétique eut lieu en 1941.
Sur un plan philosophique et religieux, Hitler déclara à Rauschning : « Le national-socialisme est plus qu’une religion : c’est la volonté de créer un nouvel Homme. » Et il fit part de son intention d’ « extirper le christianisme d’Allemagne ». Rauschning, appartenant à une vieille famille protestante de Prusse, dit que c’est suite à ces propos en particulier qu’il commença de se détacher d’Hitler et du nazisme.
Installé aux Etats-Unis, Rauschning y mourut en 1982, à l’âge de quatre-vingts quatorze ans.
Après la guerre et encore ces dernières années, certains historiens ont contesté l’authenticité des entretiens rapportés par Rauschning. Pourtant, avec le recul, son livre apparaît à bien des égards prophétiques. Et, en tout cas, personne ne conteste le fait que Rauschning l'a publié en 1939, à l’apogée d’Hitler et du nazisme, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale et avant l’écrasement du Troisième Reich. Il ne s’agit en rien d’un texte apocryphe.
Le mieux est de lire Hitler m’a dit comme un témoignage écrit et publié sur le vif. Le plus important, ce ne sont pas les erreurs que l’ouvrage peut contenir, mais le fait que bien souvent il approche la vérité. Quiconque aurait lu ce livre à sa parution, en 1939, aurait su à quoi s’en tenir sur Hitler et n’aurait pas été complètement surpris par le cours des événements.
Hitler m’a dit, d’Hermann Rauschning, 1939, collection Pluriel.
08:49 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : hitler m'a dit, hitler, hermann rauschning | Lien permanent | Commentaires (0)
16/01/2017
Docteur Françoise Gailland, de Jean-Louis Bertucelli
Annie Girardot en lutte contre le cancer
Docteur Françoise Gailland
Annie Girardot est au sommet de sa carrière quand elle tourne Docteur Françoise Gailland. Elle s’identifie pleinement à cette femme volontaire et libérée qui affronte le cancer. Ce film, qui donne une leçon d’espoir, accrut la popularité de l’actrice.
A sa sortie, en 1976, Docteur Françoise Gailland fit date. Pour la première fois dans l’histoire du cinéma, un film évoquait clairement le cancer, cette terrible maladie dont on n’osait à peine prononcer le nom. Les malades eux-mêmes ignoraient bien souvent la nature du mal dont ils souffraient, tant les médecins, à l’époque, étaient réticents à leur avouer la vérité.
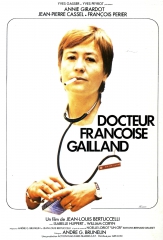 Au départ il y eut un livre, Un cri, de Noëlle Loriot (écrivain également connu sous le nom de plume de Laurence Oriol) qui racontait, sous forme romancée, l’histoire authentique d’une femme médecin d’un hôpital parisien, qui avait survécu à un cancer. Noëlle Loriot envoya son livre à Annie Girardot, qui aussitôt voulut le porter à l’écran. On comprend que l’actrice se soit enthousiasmée pour le personnage de Françoise Gailland, qui a tant de points communs avec elle. Annie Girardot, fille de sage-femme et ancienne élève-infirmière, connaissait bien le milieu médical ; et, comme Françoise Gailland, c’était une femme dynamique et émancipée.
Au départ il y eut un livre, Un cri, de Noëlle Loriot (écrivain également connu sous le nom de plume de Laurence Oriol) qui racontait, sous forme romancée, l’histoire authentique d’une femme médecin d’un hôpital parisien, qui avait survécu à un cancer. Noëlle Loriot envoya son livre à Annie Girardot, qui aussitôt voulut le porter à l’écran. On comprend que l’actrice se soit enthousiasmée pour le personnage de Françoise Gailland, qui a tant de points communs avec elle. Annie Girardot, fille de sage-femme et ancienne élève-infirmière, connaissait bien le milieu médical ; et, comme Françoise Gailland, c’était une femme dynamique et émancipée.
Ce film a tout d’abord une valeur historique sur la société et la médecine des années soixante-dix. Les centres hospitaliers universitaires, fruits de la réforme Debré, sont sortis de terre et font dorénavant partie du paysage des grandes villes. Ils sont équipés en appareils d’imagerie médicale, qui aujourd’hui apparaissent bien rudimentaires. Les malades ne sont plus rassemblés dans une salle commune, mais répartis dans des chambrées de cinq ou six. On fume encore beaucoup à l’hôpital, y compris dans les chambres : le docteur Françoise Gailland elle-même fume « comme un pompier » et n’hésite pas à proposer une cigarette à un malade.
Françoise Gailland est bien placée pour succéder à l’actuel chef de service, dont elle a été l’étudiante ; mais elle a deux handicaps : d’abord elle est femme, et ensuite elle ne mène pas une vie de famille « convenable ». Elle est certes mariée, qui plus est à un haut fonctionnaire du Quai-d’Orsay ; le couple habite un hôtel particulier et mène une vie de grands bourgeois ; mais ils font chambre à part, et chacun reste libre de fréquenter qui il veut. Ils ont deux enfants : un garçon et une fille. Le garçon a les cheveux longs et la fille prend la pilule ; ils s’opposent à leurs parents représentant la génération précédente, et leur reprochent de faire preuve d’hypocrisie en restant mariés dans le seul but de sauvegarder les apparences.
Françoise Gailland vit à cent à l’heure et se croit indestructible
Dans la première partie du film, Françoise Gailland est une femme qui respire la santé. Elle vit à cent à l’heure et se croit indestructible, presqu’immortelle. Au milieu de son équipe et de ses patients, elle est la « patronne », sans qui rien ne se fait et qui résout tous les problèmes. En réalité, elle se donne tant aux autres qu’elle finit par oublier sa propre personne, et son activisme incessant l’empêche de prendre du recul avec elle-même. Or, depuis quelques temps, elle tousse de plus en plus fréquemment. Après un malaise, elle se résout à se faire faire une radio des poumons, par simple précaution.
Ce jour-là, l’examen terminé, elle récupère ses clichés pour en prendre connaissance. Elle est toute seule, dans un local du service de radiologie. Elle a accroché aux murs les clichés et s’apprête à les examiner, quand un collègue survient et entre dans la pièce. Apercevant les radios et ignorant que ce sont celles de Françoise Gailland, il déclare : « C’est moche ! » Il diagnostique une opacité suspecte au niveau du lobe supérieur gauche et dit parier sur un cancer, tout en précisant à Françoise Gailland qu’elle n’osera pas dire la vérité à son patient. Et le collègue repart comme il était venu. Cette scène est la plus forte du film.
Par sa peur face à la maladie,
Françoise Gailland apparaît très humaine
Françoise Gailland l’indestructible apparaît alors très humaine en ayant peur de la maladie. Elle qui a réponse à tout ne sait comment faire part de la nouvelle à ses proches. Jusqu’ici les malades c’étaient ses patients, c’étaient les autres, mais ce n’était pas elle. Quand elle trouve enfin la force d’annoncer la nouvelle à son mari, elle éclate en sanglots et lui déclare : « Je suis malade, j’ai peur… »
Avec les infirmières les rôles sont maintenant inversés. Auparavant, en tant que patronne, elle leur donnait des ordres ; maintenant, en tant que malade, elle est tenue de leur obéir.
Bien que consciente de la gravité de son état, elle reste une battante et se raccroche à l’espoir de guérison, espoir qui n’est pas insensé. Elle accepte de se faire opérer, et c’est elle qui choisit le collègue qui l’opérera. En dépit de son statut de femme libérée, elle a alors besoin que son mari et ses enfants soient unis autour d’elle pour la soutenir dans l’épreuve.
Docteur Françoise Gailland contribua à l’évolution du regard que la société portait sur le cancer. L’objectif du film n’était pas d’effrayer le spectateur. L’angoisse est certes palpable, mais aucune scène pénible et aucune image crue ne sont infligées au spectateur pour le convaincre des ravages de la maladie. Le personnage de Françoise Gailland invite chacun à garder l’espoir et la volonté dans l’épreuve.
Une réserve peut être émise sur ce film : à sa sortie, il pouvait donner l’impression qu’il y avait le Cancer avec un « C » majuscule, c’est-à-dire qu’il existait une seule forme de cancer. De nos jours, on a davantage conscience qu’il y a des cancers au pluriel, qui présentent différents niveaux de gravité.
Annie Girardot prête toute son énergie au personnage de Françoise Gailland. François Périer joue son mari, Jean-Pierre Cassel son amant, et Isabelle Huppert sa fille. Annie Girardot se vit décerner le César de la meilleure actrice à la cérémonie de 1977, et le film, régulièrement diffusé à la télévision, accrut sa popularité. Docteur Françoise Gailland reste l’un des rôles les plus marquants de l’actrice, alors au sommet de sa carrière. Peut-être s’agit-il du personnage auquel elle s’est le plus identifiée.
Docteur Françoise Gailland n’est certainement pas un film majeur de l’histoire du cinéma, mais c’est un film à voir, rien que pour la prestation d’Annie Girardot.
Docteur Françoise Gailland, de Jean-Louis Bertucelli, 1975, avec Annie Girardot, François Périer, Jean-Pierre Cassel, Suzanne Flon et Isabelle Hupert, DVD Wild Side Video.
08:38 Publié dans Etude de moeurs, Film, Société | Tags : docteur françoise gailland, jean-louis bertucelli, annie girardot, françois périer, jean-pierre cassel, suzanne flon, isabelle hupert | Lien permanent | Commentaires (0)


