06/06/2016
Les Camarades, de Mario Monicelli
Germinal en Italie
Les Camarades
Marcello Mastroianni est presque méconnaissable dans le rôle du Professeur, un intellectuel qui mène des ouvriers à la grève. Le film de Monicelli se passe dans une usine italienne à la fin du XIXe siècle, et présente bien des points communs avec Germinal, de Zola.
Ce film est l’illustration des combats menés par la classe ouvrière pour la reconnaissance de ses droits. Ici la revendication porte sur le temps de travail. Dans une filature de Turin, à la fin du XIXe siècle, les ouvriers travaillent quatorze heures par jour. Ils n’ont pas le temps de récupérer de leur fatigue et baillent devant leurs machines, si bien qu’ils commettent des fautes d’inattention, d’où la fréquence des accidents du travail. Prenant conscience de leur situation, ils s’unissent pour revendiquer la journée de treize heures. Mais leur employeur fait la sourde oreille, car il ne voit aucune raison valable de leur donner satisfaction.
 Tout change quand arrive en ville un étranger appelé le Professeur. Il ne paie pas de mine avec sa barbe hirsute et ses cheveux en bataille, ses lunettes d’intellectuel et sa chemise dépourvue de faux-col. Qui plus est, sa démarche est légèrement voutée. Mais il est cultivé, réfléchi et a de l’éloquence. Un soir, il s’adresse aux ouvriers réunis en secret et les convainc que seule la grève peut produire des résultats, à condition qu’elle soit dure et totale, le patronat ne connaissant que les rapports de force. Dans cette perspective, il faut organiser le mouvement en amont afin de tenir le plus longtemps possible. Il recommande d’accumuler des stocks de vivres qui auront été achetés à crédit. Et surtout, dit-il, il faut rester unis. Cependant, une fois que la grève est déclenchée, un ouvrier dont la famille est dans une situation plus misérables que les autres, prétend aller à l’usine gagner son pain. Un dilemme se pose : faut-il l’autoriser à aller travailler ou faut-il le contraindre à se joindre au mouvement ? En d’autres termes, l’unité du mouvement prime-t-elle la liberté individuelle ?
Tout change quand arrive en ville un étranger appelé le Professeur. Il ne paie pas de mine avec sa barbe hirsute et ses cheveux en bataille, ses lunettes d’intellectuel et sa chemise dépourvue de faux-col. Qui plus est, sa démarche est légèrement voutée. Mais il est cultivé, réfléchi et a de l’éloquence. Un soir, il s’adresse aux ouvriers réunis en secret et les convainc que seule la grève peut produire des résultats, à condition qu’elle soit dure et totale, le patronat ne connaissant que les rapports de force. Dans cette perspective, il faut organiser le mouvement en amont afin de tenir le plus longtemps possible. Il recommande d’accumuler des stocks de vivres qui auront été achetés à crédit. Et surtout, dit-il, il faut rester unis. Cependant, une fois que la grève est déclenchée, un ouvrier dont la famille est dans une situation plus misérables que les autres, prétend aller à l’usine gagner son pain. Un dilemme se pose : faut-il l’autoriser à aller travailler ou faut-il le contraindre à se joindre au mouvement ? En d’autres termes, l’unité du mouvement prime-t-elle la liberté individuelle ?
Par bien des aspects, Les Camarades, de Monicelli, rappellent Germinal, de Zola. Certes celui-ci se passe dans la mine et celui-là dans une filature, mais il y a beaucoup de points communs aux deux œuvres. On retrouve à la base une forme de déterminisme social. Chez Monicelli, les ouvriers sont condamnés à travailler à la fabrique de père en fils et de mère en fille, comme chez Zola les ouvriers sont condamnés à la mine ; il n’y a pas d’échappatoire. Dans les deux cas, les femmes et les enfants travaillent au même titre que les hommes. Dans les deux œuvres, pendant que les ouvriers triment, la grande bourgeoisie vit dans l’oisiveté et se distrait dans des fêtes et des réceptions.
Côté patronat, le directeur tient à rappeler aux ouvriers qu’il est un salarié comme eux. D’une certaine manière, il est l’un des leurs. Mais, parce qu’il est salarié lui aussi, il doit rendre des comptes à son employeur, ce qui lui laisse une faible marge de négociation pour satisfaire les revendications. Surtout, et Zola et Monicelli montrent que le patronat dispose de cohortes de chômeurs qu’il peut mettre en concurrence avec les ouvriers grévistes. Pour faire redémarrer la production, le directeur de l’usine achemine des chômeurs prêts à travailler à un moindre coût. C’est ce qu’on appellerait aujourd’hui du dumping social.
Même si Les Camarades sont un film militant,
on ne saurait les réduire à une œuvre de propagande
Les Camarades ne sont pas à un paradoxe près, puisque, tandis que les ouvriers se plaignent de leur misère, les paysans, eux, rêvent de venir travailler à la ville pour bénéficier d’un revenu régulier. Les contrastes sont nombreux dans ce film, et certains d’entre eux sont savoureux. Lorsque le directeur daigne recevoir en conférence les meneurs du mouvement, il prend soin de les faire longuement patienter dans une antichambre. Puis, quand il les fait entrer, il reste assis derrière bureau et les laisse debout. Il les tutoie comme s’ils étaient ses enfants et leur parle comme s’ils étaient dans l’incapacité de savoir ce qui est bon pour eux. Après la conférence qui lui a permis de repérer les meneurs, il essaie de les diviser, d’autant plus que l’un des leurs commet l’erreur tactique de lui avouer que certains camarades sont à bout de force et sont à deux doigts de reprendre le travail.
Même si Les Camarades sont un film militant, on ne saurait les réduire à une œuvre de propagande. La mise en scène est particulièrement soignée et peut faire penser aux films de Visconti. Marcello Mastroianni est presque méconnaissable dans le rôle du Professeur. Annie Girardot joue une fille d’ouvrier qui a échappé à son sort en utilisant ses charmes. Quant à Bernard Blier, il joue l’un des meneurs du mouvement, mais se révèle un maillon faible.
Quand on repense à ce film après l’avoir vu, alors on prend conscience de l’aveuglement de la direction ; pourtant, dans le cas présent, les revendications sont purement matérielles et n’ont aucun contenu politique. Le patronat prend le risque d’attiser le feu révolutionnaire en refusant d’améliorer les conditions de travail des ouvriers ; et il ne voit pas que la mise en place de la journée de treize heures servirait ses intérêts : les ouvriers seraient ainsi moins fatigués et feraient davantage attention à leur travail, ce qui aboutirait à une réduction du nombre d’accidents du travail et à une augmentation de la productivité horaire.
Les Camarades, de Mario Monicelli, 1963, avec Marcelo Mastroianni, Annie Girardot, Renato Salvatori et Bernard Blier, DVD LCJ Edition.
07:30 Publié dans Economie, Etude de moeurs, Film | Tags : les camarades, mario monicelli, mastroianni, annie girardot, renato salavatori, bernard blier | Lien permanent | Commentaires (0)
09/05/2016
Alstom, scandale d'Etat, de Jean-Michel Quatrepoint
Les secrets du dépeçage d’Alstom
Alstom, scandale d’Etat
(dernière liquidation de l’industrie française)
Jean-Michel Quatrepoint a enquêté sur la vente à la sauvette de la branche énergie du groupe Alstom. Il accuse les autorités françaises d’avoir bradé un bijou de famille, privant le pays de la maîtrise d’une activité stratégique. Selon lui, General Electric a été choisi comme repreneur pour des raisons inavouables.
Après Péchiney, Arcelor, Lafarge et Alcatel, la France a perdu Alstom Energie, qui a été vendue aux Américains en 2015. Dans Alstom, scandale d’Etat, Jean-Michel Quatrepoint tire la sonnette d’alarme : année après année, la France se désindustrialise, elle perd ses fleurons les uns après les autres, ses dirigeants vendant les « bijoux de famille » dans l’indifférence générale. Selon lui, la vente à General Electric de la branche énergie d’Alstom constitue un cas d’école d’autant plus grave que la France se prive ainsi de la maîtrise d’une activité stratégique :
Dans la concurrence économique mondiale, ne pas être maître de sa filière énergétique va être un rude handicap. Voilà pourquoi la vente, à la sauvette, d’Alstom est une affaire d’Etat. Et les conditions de cette cession un scandale d’Etat. Car il était possible de faire autrement, voire de négocier des accords plus équilibrés.
 Jean-Michel Quatrepoint remonte aux heures glorieuses de l’industrie française. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Alsthom (avec un « h », à l’époque) était une filiale de la toute puissante CGE, Compagnie générale d’électricité. Ce vaste conglomérat était l’une des plus grosses entreprises au monde, valeur vedette du CAC40, l’une des fiertés de la France. La CGE était leader mondial des télécommunications et numéro un des câbles électriques. Dans cet empire, outre Alsthom, on trouvait Alcatel, Cegelec, les Câbles de Lyon, les Chantiers de l’Atlantique et même une branche médias avec L’Express et les Presses de la Cité. Rebaptisé Alcatel-Alsthom au début des années quatre-vingt-dix, le groupe a alors fière allure. Mais les apparences sont trompeuses. Son patron historique, Ambroise Roux, « grand maître de l’industrie française », n’a pas préparé l’avenir, il n’a pas vu venir la révolution numérique, qui va tout balayer sur son passage. Alcatel-Alsthom vit sur des acquis et n’est pas armé pour affronter le déferlement de la téléphonie mobile et de l’Internet. Pour trouver les milliards nécessaires au développement des activités de télécommunications, le groupe vend Alsthom (qui perd son « h » à cette occasion) et l’introduit en bourse, en 1999.
Jean-Michel Quatrepoint remonte aux heures glorieuses de l’industrie française. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Alsthom (avec un « h », à l’époque) était une filiale de la toute puissante CGE, Compagnie générale d’électricité. Ce vaste conglomérat était l’une des plus grosses entreprises au monde, valeur vedette du CAC40, l’une des fiertés de la France. La CGE était leader mondial des télécommunications et numéro un des câbles électriques. Dans cet empire, outre Alsthom, on trouvait Alcatel, Cegelec, les Câbles de Lyon, les Chantiers de l’Atlantique et même une branche médias avec L’Express et les Presses de la Cité. Rebaptisé Alcatel-Alsthom au début des années quatre-vingt-dix, le groupe a alors fière allure. Mais les apparences sont trompeuses. Son patron historique, Ambroise Roux, « grand maître de l’industrie française », n’a pas préparé l’avenir, il n’a pas vu venir la révolution numérique, qui va tout balayer sur son passage. Alcatel-Alsthom vit sur des acquis et n’est pas armé pour affronter le déferlement de la téléphonie mobile et de l’Internet. Pour trouver les milliards nécessaires au développement des activités de télécommunications, le groupe vend Alsthom (qui perd son « h » à cette occasion) et l’introduit en bourse, en 1999.
Devenu un groupe indépendant, Alstom possède deux activités différentes : les transports, avec notamment la fabrication des rames TGV, et l’énergie. C’est dans l’énergie qu’Alstom décide de se renforcer en entamant une politique d’acquisition, coûteuse et risquée. Pour éviter la catastrophe - en clair, la faillite -, Patrick Kron est appelé à la rescousse. Ce major de Polytechnique est nommé PDG. Son ancien patron, Louis Gallois, le dit « extraordinairement intelligent, travailleur et doté d’un humour caustique. » Dans sa tâche de redressement d’Alstom, Patrick Kron est soutenu par Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie et des finances, qui arrive à « tordre le bras » aux banquiers, de telle sorte qu’ils acceptent une restructuration de la dette du groupe.
En 2004, Alstom est sauvé, du moins en apparence.
L’arrestation aux Etats-Unis d’un cadre d’Alstom
fait l’effet d’une bombe parmi les dirigeants du groupe
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, le DoJ (Department of Justice) enquête sur une affaire de corruption. Alstom est soupçonné d’avoir versé une commission pour obtenir un (petit) marché en Indonésie. Dans un premier temps, les dirigeants du groupe ne s’inquiètent pas, à l’image des dirigeants de BNP-Paribas impliqués dans une autre affaire. Tout change en 2013, quand un cadre supérieur d’Alstom en voyage aux Etats-Unis est arrêté par la police. Son arrestation et les conditions de sa détention font l’effet d’une bombe à Paris. Les dirigeants d’Alstom comprennent que le groupe est menacé d’une lourde amende et qu’eux-mêmes risquent la prison. Dès lors, il faut réagir, avant que l’étau ne se resserre trop.
Dans son livre, Jean-Michel Quatrepoint se fait très clair. Il affirme que Patrick Kron s’est décidé à vendre l’activité énergie, moins pour désendetter le groupe que pour payer la lourde amende à laquelle la justice américaine ne manquerait pas de le condamner. Quatrepoint va plus loin en affirmant que, dès le début, le choix de Patrick Kron s’est porté sur General Electric, dans l’espoir d’obtenir l’indulgence du Department of Justice. L’auteur cependant porte un jugement nuancé sur les faits :
S’imaginer qu’il y a une relation directe, une concertation entre le DoJ et les grandes entreprises américaines serait une absurdité. La séparation des pouvoirs est l’un des principes de la Constitution américaine. Toutefois, rien n’empêche, dans les difficultés et face à l’adversité, de préférer se vendre à un groupe américain ayant pignon sur rue, dont l’entregent pourrait faciliter un arrangement avec la justice du pays.
Dès lors, les choses sont jouées. Jean-Michel Quatrepoint se fait d’autant plus accusateur que, selon lui, Patrick Kron n’a pas profité de l’offre concurrente formulée par l’Allemand Siemens pour « faire monter les enchères » et obtenir de General Electric qu’il améliore son offre. Jean-Michel Quatrepoint montre également comment le sommet de l’Etat, François Hollande en tête, a laissé faire.
Quatrepoint accuse la classe politique et médiatique
de se focaliser sur le sociétal et le compassionnel,
impuissante qu’elle est à traiter des vrais sujets
Par désintérêt et par manque de compétences, le gouvernement français a été complètement dépassé par les événements. Jean-Michel Quatrepoint reproche aux hommes politiques d’être plus à l’aise dans les dossiers dits « sociétaux » que dans les dossiers de politique industrielle. Il parle de « d’une classe politique – et médiatique- focalisée sur le compassionnel et le sociétal, impuissante qu’elle est à traiter des vrais sujets et à influer sur le cours du monde. » Certes, dans ce dossier, le gouvernement a sauvé les apparences en obtenant la constitution de co-entreprises détenues à la fois par General Electric et par Alstom. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, General Electric y sera majoritaire et contrôlera les finances, Alstom apportant ses compétences techniques, tant recherchées par les Américains. Et ce sont eux qui contrôleront Arabelle, l’une des turbines les plus sûres au monde, qui doit équiper les centrales nucléaires de type EPR.
Quatrepoint précise que ce sont en fait les contrats de maintenance détenus par Alstom que General Electric convoitait :
Dans l’énergie, on ne gagne pas d’argent sur la vente d’une centrale ou d’une turbine, ni sur celle de tous les équipements qui leur sont associés, mais sur la maintenance, le service après-vente. […] En achetant Alstom Energie, General Electric acquiert une base de clients captifs.
Alstom se retrouve aujourd’hui réduit à sa branche transports. Or les marges sont faibles dans cette activité, beaucoup moins rentable que l’énergie. Et la concurrence y est de plus en plus forte. Les Chinois, après avoir « volé » la technologie Siemens, sont attendus sur le marché et pèsent quatre fois plus lourd qu’Alstom. Quatrepoint entrevoit déjà un scénario inéluctable se dessiner : la vente de ce qui reste d’Alstom à un concurrent, probablement Siemens.
Alstom, scandale d’Etat, de Jean-Michel Quatrepoint, 2015, éditions Fayard.
07:30 Publié dans Economie, Essai, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre | Tags : jean-michel quatrepoint, alstom scandale d'etat | Lien permanent | Commentaires (0)
25/04/2016
Germinal, de Zola
Célèbre roman sur la condition ouvrière
Germinal
La crise économique frappe de plein fouet les industries du nord de la France. Pour rester compétitive, la Compagnie des mines de Montsou décide de baisser le coût du travail. Les ouvriers se mettent en grève. Le mouvement s’annonce dur. Plus de cent ans après sa publication, Germinal reste le roman synonyme de la condition ouvrière.
Germinal est l’un des romans les plus célèbres de Zola, sinon le plus célèbre, publié dans le cycle des Rougon-Macquart. De nos jours encore, pour qualifier des conditions de travail déplorables, les expressions telles que « On se croirait chez Zola » ou « C’est digne de Germinal » sont éloquentes et clairement connotées. Il faut dire que Zola est l’un des premiers écrivains à s’être intéressé de près à la classe ouvrière, ici aux mineurs de fond du nord de la France. Il montre que, par leurs sacrifices au travail, les ouvriers ont rendu possibles la Révolution industrielle et l’enrichissement de la bourgeoisie sous le Second Empire.
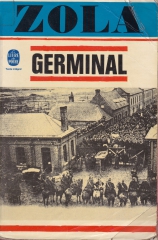 Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
C’est la famille Maheu qui est au cœur du roman. Le couple a sept enfants, âgés de vingt-et-un ans à trois mois. Chez les Maheu, dès qu’un enfant est en âge de travailler, il descend à la mine, qu’il soit fille ou garçon. C’est ainsi que Lydie, « chétive fillette de dix ans » va au puits. L’argent que chacun rapporte est nécessaire à ce foyer qui a du mal à joindre les deux bouts. Le sort de leurs voisins n’est guère plus enviable, au point que le coron du Voreux a été surnommé par ses habitants le « coron Paie-tes-Dettes ». Les mineurs sont payés à la quinzaine ; et le dimanche, jour chômé, n’est bien sûr pas rémunéré.
Ce qui étonne le plus Lantier,
ce sont les brusques changements de température au fond du puits
Les Maheu hébergent un locataire âgé d’une vingtaine d’années, Etienne Lantier, qui vient d’être embauché à la mine. C’est avec lui, qui n’était jamais descendu dans un puits, que le lecteur découvre le quotidien du mineur. Le matin, les Maheu se lèvent à quatre heures pour boire un café préparé avec une mauvaise eau qui donne la colique. En leur compagnie, Etienne pénètre l’univers souterrain de la mine ; il ne cesse de se heurter la tête au plafond, tandis que pas un de ses camarades, à force d’habitude, ne se cogne. Il souffre du sol glissant et traverse de véritables mares. Zola insiste sur les chauds et froids : « Mais ce qui l’étonnait surtout, c’étaient les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage, par où passait l’air de la mine, soufflait un vent glacé, dont la violence tournait à la tempête, entre les muraillements étroits. Ensuite, à mesure qu’on s’enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d’aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante, d’une pesanteur de plomb. » Zola poursuit : « C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés, l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue demeurait mortel. » A trois heures de l’après-midi, quand les Maheu remontent, leur journée finie, ils sont relayés par une autre équipe, car la mine tourne vingt-quatre heures sur vingt-quatre : « Jamais la mine ne chômait, il y avait nuit et jour des insectes humains finissant la roche à six-cents mètres sous les champs de betterave. »
Le puits est exploité par la Compagnie des mines de Montsou. Le directeur général, M. Hennebeau, n’en est pas le propriétaire ; « il est payé comme nous », précise un ouvrier. Son neveu Paul Négrel, âgé de vingt-six ans, est l’ingénieur de la fosse. Il passe ses journées au fond du puits, au milieu des ouvriers. Zola écrit : « Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon ; et, pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou. »
Alors que le salariat n’a pas encore trouvé sa forme,
les ouvriers sont payés à la tâche
Mais la crise est là. La surproduction menace. Pour rester compétitive, la Compagnie doit baisser ses coûts. On dirait aujourd’hui que l’entreprise doit faire un effort de compétitivité qui passe par la baisse du coût du travail. Pour ce faire, à une époque où le salariat n’a pas encore trouvé sa forme, la rémunération se faisant à la tâche, la Compagnie organise la concurrence entre ouvriers en mettant aux enchères les tailles. Il s’agit d’enchères inversées qui favorisent, pour prendre une expression actuelle, le « dumping social ». Quarante marchandages sont offerts aux mineurs, et, face à l’ingénieur qui procède aux adjudications, Maheu a peur de ne rien obtenir s’il ne baisse pas suffisamment la rémunération qu’il réclame ; car : « Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. » A la sortie, Etienne a ce commentaire : « En voilà un égorgement !... Alors, aujourd’hui, c’est l’ouvrier qu’on force à manger l’ouvrier ! » Le propriétaire de la mine voisine de Montsou se montre lucide et honnête quand, en privé, il déclare : « L’ouvrier a raison de dire qu’il paie les pots cassés. »
La colère monte dans le coron du Voreux. Les femmes, qui gèrent le ménage et donc la pénurie, sont en première ligne. La Maheu, très remontée, ne cesse de répéter : « Il faudra que ça pète. »
La colère monte contre les bourgeois qui auraient confisqué à leur profit les révolutions de 1789, 1830 et 1848 : « L’ouvrier ne pouvait tenir le coup, la révolution n’avait fait qu’aggraver ses misères. C’étaient les bourgeois qui s’engraissaient depuis 89. » A Montsou, il existe pourtant des bourgeois généreux. Ainsi, les Grégoire, actionnaires de la Compagnie qui vivent de leur rente, pratiquent la charité, mais à leur manière : « Il fallait être charitable, ils disaient eux-mêmes que leur maison est la maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillés de la continuelle crainte d’être trompés et d’encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d’argent, jamais ! pas dix sous, pas deux sous, car c’était un fait connu, dès qu’un pauvre avait deux sous, il les buvait. » A la place, les Grégoire ne font que des dons en nature, non en nourriture, mais sous forme de vêtements chauds.
Sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail,
l’employeur organise une baisse déguisée des rémunérations
Devant tant d’injustice, Etienne décide d’agir. Il s’enflamme en apprenant la création, à Londres, de l’Association internationale des travailleurs, la fameuse Internationale : « Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s’unissant, pour assurer à l’ouvrier le pain qu’il gagne. » Il entreprend de fonder une section à Montsou et de mettre en place une caisse de prévoyance. Cette caisse servirait des secours en cas de grève. Or un conflit éclate quand, sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail, la Compagnie décide d’un nouveau mode de rémunération : « Devant le peu de soin apporté au boisage, lasse d’infliger des amendes inutiles, elle avait pris la résolution d’appliquer un nouveau mode de paiement, pour l’abattage de la houille. Désormais, elle paierait le boisage à part […]. Le prix de la berline de charbon abattu serait naturellement baissé […]. » Les ouvriers, comprenant qu’il s’agit là d’une baisse déguisée des rémunérations, décident la grève, avec Lantier pour meneur. Le garçon est fort de ses idées socialisantes. Il abreuve ses camarades de paroles, mais il a mal assimilé ses lectures et manque de bases intellectuelles solides, nous dit Zola. Le cabaretier Rasseneur, qui avait jadis été licencié de la mine, se pose en concurrent de Lantier et propose une voie qu’il veut plus raisonnable ; il met en garde les ouvriers qui seraient tentés de faire main basse sur les moyens de production : « Il expliquait que la mine ne pouvait être la propriété du mineur, comme le métier est la propriété du tisserand, et il disait préférer la participation aux bénéfices, l’ouvrier intéressé, devenu l’enfant de la maison. » Mais Rasseneur ne sera pas écouté.
Lantier lui-même finit par être dépossédé de la grève qui tourne à l’émeute. Les femmes sont les plus hargneuses. Lors d’une manifestation, elles veulent déshabiller une bourgeoise qu’elles trouvent sur leur passage, et s’écrient : « Le cul à l’air ! » Puis il y a du sang. Un acte de sabotage est même commis à la mine, provoquant une catastrophe dont des ouvriers sont les premières victimes. Quand les régisseurs de la Compagnie apprennent l’origine criminelle de l’incident, ils préfèrent la taire et parler d’accident, quitte à être accusés de négligence, afin d’éviter tout effet d’imitation ; il s’agit de ne pas donner de mauvaises idées à des apprentis criminels.
La grève n’a pas que du mauvais pour la Compagnie, car elle contribue à nettoyer le marché en faisant succomber les sociétés trop faibles pour résister à un mouvement aussi dur. Une fois la grève finie, la Compagnie peut escompter acheter à prix cassé ceux de ses concurrents qui auront fait faillite entre-temps. C’est ainsi qu’une espèce de darwinisme économique est à l’œuvre.
Avec le recul, il parait évident que Germinal ne pouvait que choquer le lecteur bourgeois de l’époque, à cause du langage employé et des situations décrites. D’une certaine manière, Zola, c’est l’écrivain bourgeois qui bouscule sa classe sociale, quitte à l’effrayer, afin de la mettre en garde contre les conséquences que pourrait avoir son indifférence au sort de la classe ouvrière.
Germinal, de Zola, 1883, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Economie, Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : germinal, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)


