22/06/2015
L'Assommoir, de Zola
Docu-fiction sur les ravages de l’alcool dans la France d’en-bas
L’Assommoir
L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste, tel que Zola le concevait. L’auteur plonge le lecteur au milieu du petit peuple des faubourgs de Paris. Le personnage principal, Gervaise, épouse un ouvrier zingueur qui, suite à un accident du travail, tombe sous la dépendance de l’alcool. A l’époque, Zola choqua nombre de lecteurs par les situations décrites et le vocabulaire employé.
Dans L’Assommoir, Zola charge son histoire en détails qui peuvent donner l’impression d’alourdir l’ensemble, si bien que de nombreux lecteurs risquent de s’impatienter. Ils pourraient être tentés de sauter des pages, ce qui n’est guère aisé et risque de les faire passer à côté de l’essentiel. Le mieux, pour ne pas s’ennuyer, est de considérer L’Assommoir comme un documentaire-fiction. L’intérêt du livre est de plonger le lecteur dans une classe sociale précise, celle des milieux populaires des faubourgs de Paris, sous le Second Empire. Zola a accompli tout un travail d’enquête qu’il restitue au lecteur sous forme de fiction. L’abondance de détails qu’il donne devient alors une force, ce sont des détails qui « font vrai » et qui permettent de partager la vie quotidienne des ouvriers et des artisans. En cela, L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste et social.
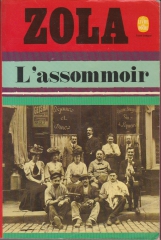 Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »
Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »
Un jour, Lantier la quitte et lui laisse leurs deux petits garçons sur les bras. Abandonnée, Gervaise se marie, par dépit, avec Coupeau, un brave garçon, zingueur de son état.
Quelques temps plus tard, sur un chantier, Coupeau fait une grave chute. Il survit et se remet d’aplomb petit à petit. Mais ce n’est plus le même homme. Il ne veut plus travailler, et alors qu’il était sobre auparavant, il se met à boire et tombe sous la dépendance de l’alcool.
L’alcool est au centre du roman. Selon Zola, le vin est consubstantiel à l’ouvrier : « L’ouvrier n’aurait pu vivre sans le vin », écrit-il. Une consommation raisonnable de rouge lui paraît naturelle, tant qu’elle aide l’ouvrier à tenir le coup. En revanche, les choses se gâtent quand il va au-delà d’une quantité raisonnable de vin et prend goût aux alcools forts : « Le vin nourrit l’ouvrier ; les alcools, au contraire, étaient des saletés, des poisons qui ôtaient à l’ouvrier le goût du pain. » Or Coupeau passe de plus en plus de temps à l’Assommoir, l’établissement du père Colombe, qui est un lieu de perdition. On y trouve la machine à saouler, qui sert un vitriol qui fait des ravages et cause la déchéance de Coupeau.
Gervaise, son mari Coupeau et son amant Lantier
font ménage à trois
On comprend que nombre de situations décrites par Zola aient pu choquer à l’époque. A un moment de l’histoire, les Coupeau font ménage à trois avec Lantier. L’ancien concubin de Gervaise vient s’installer dans leur logement et redevient son amant. D’une manière générale, les personnages ne sont guère charitables entre eux. L’une des scènes les plus fortes se trouve au début du livre, avec deux lavandières qui se battent à coups de baquets et de battoirs. L’une des deux femmes finit dans une posture honteuse et n’est pas près d’oublier l’humiliation subie ce jour-là. Dans ce milieu tel que Zola le décrit, il n’y a guère de place pour l’amour filial. Coupeau héberge sa mère âgée et malade, qui finit par devenir un poids. Certes il n’est pas question de l’euthanasier, mais ses proches, nous dit l’auteur, ne serait pas fâchés de la voir mourir : « Bien sûr, ses enfants ne l’auraient pas achevée ; seulement, elle traînait depuis si longtemps, elle était si encombrante qu’on souhaitait sa mort, au fond, comme une délivrance pour tout le monde. »
Zola ne nous épargne rien. Dans son roman, en été, quand il fait chaud, il fait très chaud et la chaleur est suffocante ; de la même manière, en hiver, quand il fait froid, il fait très froid et l’alcool constitue le seul réconfort possible. Même la noce entre Gervaise et Coupeau est gâchée par la pluie, comme si la fatalité devait s’abattre sur les pauvres.
Gervaise ne sort pas épargnée de l’histoire. Dès les premières pages, Zola prévient qu’à vingt-deux ans elle a les « traits fins, déjà tirés par la vie. » Suite à son mariage avec Coupeau, le lecteur la voit s’épuiser et vieillir prématurément. Elle fait des journées de douze heures au travail, et le soir, une fois rentrée à la maison, elle soit s’occuper de ses deux enfants et préparer à dîner pour son mari. Elle travaille beaucoup, ce qui lui permet d’accomplir son vieux rêve de s’établir à son compte, en ouvrant une blanchisserie. Au début, les affaires marchent, car elle est travailleuse. Et en plus elle est gentille. Et pourtant Zola recommande de ne pas nous faire des illusions sur elle ; selon lui, elle manque de caractère, ce qui l’amène à céder à la facilité et à ne pas savoir dire non : « On avait tort de lui croire une grosse volonté ; elle était très faible, au contraire ; elle se laissait aller où on la poussait, par crainte de causer de la peine à quelqu’un. »
Au Louvre, Gervaise et ses compagnons
sont émerveillés par les dorures des tableaux
Plus encore que les situations décrites, le style de Zola était en mesure de choquer le lecteur bourgeois soucieux des convenances. Son langage est volontairement relâché et sans élégance. Il utilise des mots ou des expressions tels que « bouffer », « boustifailler », « rigolade à mort », « gueuler »… Zola parle comme ses personnages et ses personnages parlent comme les ouvriers qu’ils sont censés être ; et ils n’hésitent pas à se montrer grivois. Pourtant ils ont aussi soif de culture. Le jour de la noce de Coupeau et de Gervaise, pour échapper à la pluie, les mariés et les invités décident de visiter le musée du Louvre, ce qui donne l’un des passages les plus piquants du livre. Zola nous dit que « des siècles d’art passaient devant leur ignorance ahurie. » Ils traversent très vite les collections et sont nettement moins émerveillées par les toiles elles-mêmes que par les dorures des encadrements des tableaux. Zola poursuit : « Gervaise demanda le sujet des Noces de Cana ; c’était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. Coupeau s’arrêta devant la Joconde, à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes. »
L’Assommoir a donc choqué, mais, pourtant, si l’on va au-delà des apparences on découvre un livre dont la substance est, au fond, très morale. Zola ne cesse de mettre en garde contre les méfaits de l’alcool. Ainsi le médecin-chef de l’hôpital Sainte-Anne examine Coupeau dont le corps et l’esprit sont ravagés par l’alcool, puis il livre sa conclusion à Gervaise : « Vous buvez ! Prenez garde, voyez où mène la boisson… Un jour ou l’autre, vous mourrez ainsi. »
L’Assommoir est plus qu’un roman, c’est un document sur les ouvriers et les artisans des faubourgs de Paris, à une époque qui voit la capitale bouleversée par les travaux du baron Haussmann. A la fin du livre, Gervaise ne reconnaît plus son faubourg, percé de larges boulevards bordés d’immeubles qui ont des airs de palais. Tout cela sent le neuf. Le boulevard Magenta et le boulevard d’Ornano sont, dit Zola, « deux vastes avenues encore blanches de plâtre. » Le Paris d’Haussmann ressemble à un décor de théâtre qui contraste avec la crudité des faubourgs : « Sous le luxe montant de Paris, la misère du faubourg crevait et salissait ce chantier d’une ville nouvelle, si hâtivement bâtie. »
Par son réalisme, sa crudité et son absence voulue de souffle épique, L’Assommoir est à l’opposé des Misérables publié quinze ans plus tôt. Zola prend Hugo à contre-pied et enterre le romantisme une fois pour toutes.
L’Assommoir, de Zola, 1876, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : l'assommoir, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)
30/03/2015
Les Employés, de Balzac
La réforme de l’Etat vue par Balzac
Les Employés
Il était une fois un haut fonctionnaire nommé Rabourdin, qui rêvait de réformer l’Etat. Il envisageait une réduction du nombre d’employés des ministères. Ainsi la France ferait des économies et serait mieux gouvernée. Mais M. Rabourdin va être confronté à bien des obstacles dans sa tentative de réforme. Les Employés est un roman méconnu de Balzac, dans lequel il nous livre ses réflexions sur le fonctionnement de l’administration.
Dans la France de la Restauration,Monsieur Rabourdin est haut fonctionnaire, il est chef de bureau dans un ministère, le ministère des Finances semble-t-il, bien que ce point ne soit pas précisé. Il aimerait monter en grade. Or son supérieur hiérarchique direct, M. de La Billardière, chef de division, est à l’article de la mort. M. Rabourdin est bien placé pour lui succéder. A cette occasion, deux divisions pourraient même être fusionnées en une seule entité dont il deviendrait le directeur.
 Mais M. Rabourdin est un homme d’honneur, c’est un être droit qui ne veut pas obtenir sa promotion à coups d’intrigues. Non, il veut faire valoir ses compétences et mériter son avancement. Pour cela, il veut convaincre le ministre qu’il est l’homme de la situation. Il prépare dans le plus grand secret une réforme de l’administration. M. Rabourdin en est persuadé, l’Etat peut faire de substantielles économies en mettant à plat sa fiscalité, en réduisant le nombre de ministres, et surtout en diminuant le nombre de fonctionnaires, couramment appelés employés. Mais, quand son projet va être révélé, M. Rabourdin va trouver beaucoup d’adversaires sur sa route, prêts à le faire trébucher, notamment tous ceux dont il a l’intention de supprimer le poste. Il va notamment se heurter au redoutable M. des Lupeaulx, puissant secrétaire général du ministère.
Mais M. Rabourdin est un homme d’honneur, c’est un être droit qui ne veut pas obtenir sa promotion à coups d’intrigues. Non, il veut faire valoir ses compétences et mériter son avancement. Pour cela, il veut convaincre le ministre qu’il est l’homme de la situation. Il prépare dans le plus grand secret une réforme de l’administration. M. Rabourdin en est persuadé, l’Etat peut faire de substantielles économies en mettant à plat sa fiscalité, en réduisant le nombre de ministres, et surtout en diminuant le nombre de fonctionnaires, couramment appelés employés. Mais, quand son projet va être révélé, M. Rabourdin va trouver beaucoup d’adversaires sur sa route, prêts à le faire trébucher, notamment tous ceux dont il a l’intention de supprimer le poste. Il va notamment se heurter au redoutable M. des Lupeaulx, puissant secrétaire général du ministère.
Les Employés est un roman méconnu de Balzac, mais plus que jamais d’actualité. L’auteur nous décrit la naissance de l’Etat moderne, le développement de l’administration et les tentatives, avortées, pour alléger la bureaucratie. Il y a de très nombreux personnages qui apparaissent dans ce roman, ce sont les employés du ministère, que Balzac décrit un par un. Le lecteur peut être perdu dans cette longue succession de portraits, mais ensuite il n’est pas déçu par l’intrigue qui multiplie les coups-fourrés dont il pourra se délecter. Assez curieusement, une bonne partie du roman est composée uniquement de dialogues, comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre. Peut-être Balzac veut-il ainsi nous montrer que le ministère ressemble à un théâtre vivant.
Et puis, ce qui finit par rendre la lecture excitante, ce sont toutes les remarques faites par Balzac sur le fonctionnement de l’Etat et surtout sur ses dysfonctionnements. Le premier chapitre est presqu’exclusivement consacré à la description de la machine administrative. D’emblée, Balzac se déchaine en dénonçant un mal qui ronge la France depuis Louis XIV : le rapport. Face à la moindre difficulté, tout ministre commande un rapport : « Il ne se présenta rien d’important dans l’Administration, que le ministre, à la chose la plus urgente, ne répondît : “J’ai demandé un rapport.” Le rapport devint ainsi, pour l’affaire et le ministre, ce qu’est le rapport à la Chambre des députés pour les lois : une consultation où sont traitées les raisons contre et pour avec plus ou moins de partialité. Le ministre, de même que la Chambre, se trouve tout aussi avancé avant qu’après le rapport. [Sous la Restauration,] il se faisait alors en France un million de rapports écrits par année ! Ainsi la Bureaucratie régnait-elle ! »
Quand elle apprend que son mari
veut réduire le nombre d’employés des ministères,
Mme Rabourdin est catastrophée
M. Rabourdin veut réformer l’administration, partant du principe que, selon lui, « Economiser, c’est simplifier. Simplifier, c’est supprimer un rouage inutile. » En conséquence, le nombre de ministères sera réduit de sept à trois, et le nombre d’employés de vingt mille à six mille. Les fonctionnaires seront moins nombreux, mais mieux payés, car « selon M. Rabourdin, cent employés à douze mille francs feraient mieux et plus promptement que mille employés à douze cent francs. »
Quand M. Rabourdin veut exposer son plan de réforme à sa femme, elle est catastrophée et croit devenir folle, elle qui veut voir son mari promu afin de satisfaire sa propre ambition. Comprenant qu’il va se faire beaucoup d’ennemis parmi les employés, elle refuse d’en savoir plus sur son plan et lui coupe sèchement la parole : « Ai-je besoin de connaitre un plan dont l’esprit est d’administrer la France avec six mille employés au lieu de vingt mille ? Mais, mon ami, fût-ce un plan d’homme de génie, un roi de France se ferait détrôner en voulant l’exécuter. On soumet une aristocratie féodale en abattant quelques têtes, mais on ne soumet pas une hydre à mille pattes. » Plus loin dans le roman, lors d’une conversation avec M. Des Lupeaulx, Mme Rabourdin se fait plus cruelle, en commentant le plan de réforme de son mari : « Bah ! des bêtises d’honnête homme ! Il veut supprimer quinze mille employés et n’en garder que cinq ou six mille, vous n’avez pas idée d’une monstruosité pareille […]. Il est de bonne foi. […] Pauvre cher homme ! »
Bixiou (prononcez Bisiou), un employé du ministère plein d’esprit, est convaincu de la justesse du plan de réforme quand il déclare : « Quel est l’Etat le mieux constitué, de celui qui fait beaucoup de choses avec peu d’employés, ou de celui qui fait peu de choses avec beaucoup d’employés ? » Pourtant, Bixiou se veut très lucide et parie sur l’échec de Rabourdin. Il s’en explique à ses collègues : « Il est juste que M. Rabourdin soit nommé ; car en lui, l’ancienneté, le talent et l’honneur sont reconnus, appréciés et récompensés. La nomination est même dans l’intérêt bien entendu de l’Administration. Eh bien, à cause de toutes ces convenances et de ces mérites, en reconnaissant combien la mesure est équitable et sage, je parie qu’elle n’aura pas lieu ! »
Il est vrai que, pour le ministre, M. Rabourdin est dans l’erreur quand il entend faire la chasse aux gaspillages, car, selon Son Excellence, il n’y pas de gaspillage du moment que l’argent circule et irrigue les canaux de l’économie. Le ministre précise : « Ordonner toute espèce de dépenses, même inutiles, ne constitue pas une mauvaise gestion. N’est-ce pas toujours animer le mouvement de l’argent dont l’immobilité devient, en France surtout, funeste […]. »
Employé zélé, Sébastien ne perçoit pas
que plus il en fera, plus on lui en demandera
Outre qu’il nous livre des réflexions sur le fonctionnement de l’Etat, Balzac nous fait partager la vie quotidienne des employés. Le matin, ils arrivent au ministère à partir de huit heures ; à la mi-journée, ils ont une coupure d’une heure pour déjeuner ; et l’après-midi, ils terminent leur journée à quatre heures ; mais dès trois heures et demie, ils rangent leurs affaires et sortent leur chapeau, si bien qu’ « à quatre heures, il ne reste plus que les véritables employés, ceux qui prennent leur état au sérieux. » Un nouvel employé, le jeune Sébastien, est plein de zèle : il arrive le premier le matin et repart le dernier le soir. Le vieil Antoine, un ancien du ministère, qui tient à calmer ses ardeurs, le met en garde : « Plus vous en ferez, plus on vous en demandera et l’on vous laissera sans avancement ! »
A l’époque de Balzac, il n’y a bien sûr pas de machine à café autour de laquelle se retrouver, mais il y a un poêle auprès duquel les employés se réchauffent, et c’est à cet endroit que les personnages du roman nouent la conversation. On peut presque dire que le destin de M. Rabourdin sera scellé devant le poêle.
Même si Les Employés n’est pas un roman majeur de Balzac, sa lecture est à recommander d’urgence à tout candidat aux élections en train de bâtir un plan de réforme de l’Etat et de l’administration.
Les Employés, de Balzac, 1844, édition d’Anne-Marie Meininger, 1985, collection Folio.
07:30 Publié dans Economie, Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : les employés, balzac, anne-marie meininger, bixiou, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)
05/01/2015
Le Rouge et le Noir, de Stendhal
Histoire d’un jeune homme pressé
Le Rouge et le Noir
Dans la France de la Restauration, un jeune ambitieux, Julien Sorel, est prêt à toutes les hypocrisies pour s’élever dans le monde. Il entre au séminaire en espérant devenir évêque à trente ans. Stendhal, pour construire son intrigue, s’est inspiré d’un fait divers authentique. Près de deux cents ans après sa publication, certains passages du roman sont restés très mordants.
Les faits suivants sont rigoureusement authentiques. Dans une petite ville de province, le jeune Antoine Berthet, recommandé par le curé de la paroisse, devient le précepteur des enfants d’une famille honorable, les Michoud de La Tour. Au bout de quelques temps, il est renvoyé pour avoir fait des avances à la jeune mère de famille. Le curé, qui continue de croire en lui, l’envoie au séminaire ; mais là encore, il finit par être renvoyé. Il obtient une place chez un notable de la région, qui, par précaution, préfère se renseigner auprès des Michoud de La Tour. Aussitôt que Mme Michoud de La Tour lui apprend la vérité sur le comportement du jeune homme, le notable le congédie à son tour. Antoine Berthet est furieux contre la jeune femme qui a dénoncé ses agissements. Il est décidé à se venger. Sachant que Mme Michoud de La Tour est très religieuse et connaissant ses habitudes, il surgit dans l’église où elle assiste à la messe et tire deux balles sur elle. L’événement fait la une des journaux. L’affaire se conclut par la condamnation à mort d’Antoine Berthet.
 Un écrivain qui s’est fait connaître par un essai sur l’amour et qui n’a jamais écrit de roman, se passionne pour l’affaire. Il décide d’en faire un livre. Jouant de ses relations haut placées, il rencontre le procureur et obtient un accès privilégié au dossier. Cet écrivain, c’est Stendhal, et ce roman, c’est Le Rouge et le Noir.
Un écrivain qui s’est fait connaître par un essai sur l’amour et qui n’a jamais écrit de roman, se passionne pour l’affaire. Il décide d’en faire un livre. Jouant de ses relations haut placées, il rencontre le procureur et obtient un accès privilégié au dossier. Cet écrivain, c’est Stendhal, et ce roman, c’est Le Rouge et le Noir.
Si ces faits se produisaient aujourd’hui, on peut supposer que la publication du roman soulèverait une belle polémique : un écrivain a-t-il le droit de s’inspirer autant de la réalité ? est-il normal que la Justice lui ait accordé un libre accès au dossier ? n’est-il pas choquant qu’il mette en cause la vie privée des gens ? a-t-il au moins pensé à ce que ressentiront les enfants de Mme Michoud de La Tour quand ils comprendront que le comportement de leur mère est exposé en place publique ? On peut supposer que le représentant de l’une des parties déposerait plainte contre Stendhal pour atteinte à la vie privée.
Mais, en 1830, la législation et les mœurs n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, et ces questions ne se posaient pas. Les écrivains n’hésitaient pas à s’inspirer de faits divers et, ici, Stendhal fait appel à la réalité pour bâtir une fiction. Dans le roman, le jeune séminariste est rebaptisé Julien Sorel, le choix du prénom renvoyant à Julien L’Apostat, empereur romain qui quitta le christianisme pour revenir à l’antique paganisme. Julien Sorel est un garçon de dix-huit ans, mais délicat et faible en apparence ; il n’est pas aussi robuste que ses frères. Son père, un charpentier, le bat. Julien est le seul de sa famille à savoir lire. Il dévore Le Mémorial de Sainte-Hélène et fait de Napoléon son héros. L’Empereur, parti de rien pour s’élever au sommet de la société, lui servira de modèle.
Le curé de la paroisse, qui croit en lui et l’a pris sous sa protection, lui trouve une place de précepteur chez M. de Rênal, maire de Verrières, petite commune imaginaire du Doubs, dans laquelle se situe l’action. Julien est chargé de l’instruction des enfants. Lui qui sait le latin, qui connaît bien les écritures et qui sait par cœur Virgile, fait très bonne impression sur ses employeurs. On peut même dire qu’il séduit Mme de Rênal. Bientôt un amour interdit l’unit à elle.
Le roi s’agenouille
devant l’évêque, serviteur
de ce Dieu tout puissant et terrible
Le roman devient vraiment mordant avec le chapitre XVIII intitulé Un roi à Verrières. Le roi de *** est attendu de passage dans la commune. Une messe sera célébrée en présence de l’évêque. Julien y est invité en tant que sous-diacre. Le jour dit, le clergé est réuni en l’église de Verrières. Le roi est sur le point d’arriver. Seul manque l’évêque qui se fait attendre. Un prêtre âgé charge Julien d’aller prévenir l’évêque. Julien quitte l’assemblée et pénètre dans l’appartement épiscopal. Là, il surprend un jeune homme se regardant dans un miroir, en train de s’entraîner à bénir la foule des fidèles. C’est l’évêque. Quand il aperçoit Julien, l’évêque lui demande si sa mitre est bien mise : « Elle n’est pas trop en arrière ? cela aurait l’air un peu niais ; mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un shako d’officier. »
Au cours de la cérémonie, Julien voit le puissant roi de *** s’agenouiller devant le jeune évêque. Ce dernier le fait publiquement remarquer aux jeune filles qui l’entourent : « N’oubliez jamais, jeunes chrétiennes, que vous avez vu l’un des plus grands rois de la terre à genoux devant les serviteurs de ce Dieu tout puissant et terrible. » A la vue de ce spectacle, Julien a la révélation de sa vocation : il sera prêtre avec la perspective d’être, lui aussi, sacré évêque à trente ans.
Dans la France de la Restauration, l’Eglise catholique occupe la première place. La Congrégation, avec un « C » majuscule, fondée pour servir le trône, est toute puissante. Elle peut accélérer des carrières comme elle peut les briser. Dans le roman, la Congrégation est omniprésente.
Stendhal considérait que le passage de Julien au séminaire correspond aux pages les plus remarquables du Rouge et le noir. Il est vrai que l’auteur s’y montre cinglant et dévastateur. Au séminaire de Besançon, où Julien a fait son entrée, les élèves sont fils de paysans et, pour eux, la vocation se limite à deux choses : bien dîner et porter l’habit. Julien, au milieu de ses médiocres condisciples, découvre qu’il est plus intelligent qu’eux et qu’il a le grand tort de vouloir raisonner. Il apprend aussi l’existence d’un second Dieu : « Quand on ne parlait pas de saucisses et de bonnes cures, on s’entretenait de la partie mondaine ; des doctrines ecclésiastiques ; des différends des évêques et des prélats ; des maires et des curés. Julien voyait apparaître l’idée d’un second Dieu, mais d’un Dieu bien plus à craindre et bien plus puissant que l’autre ; ce second Dieu était le pape. »
Après avoir quitté la vie de province et le séminaire, Julien découvre la vie parisienne en devenant le secrétaire du marquis de La Mole. Le garçon se rend compte que, non seulement il ne possède pas le privilège de la naissance, mais en plus il ne maîtrise pas les codes à connaître pour se hisser au sein de la haute société dont il voudrait faire partie. C’est dans ce contexte qu’il participe à ses premières soirées mondaines. Les récits qu’en fait Stendhal sont croquignolesques. Julien se rend compte qu’il ne possède pas l’art de briller dans un salon, et pourtant nombre de conversations qu’il y entend sont superficielles.
Le marquis conclut que dans cinquante ans
il n’y aura plus en Europe
que des présidents de république, et pas un roi
Le marquis de La Mole, satisfait des services que Julien lui rend, lui témoigne sa confiance en l’associant à une conspiration ultra-royaliste. Dans le chapitre Une note secrète, Julien assiste à une réunion des comploteurs, prélats et nobles, qui entendent renforcer le pouvoir de Charles X par un coup d’Etat royal. Devant l’hésitation de ses pairs à agir pour défendre le trône, le marquis de La Mole soupire et déclare dans un éclair de lucidité : « Dans cinquante ans il n’y aura plus en Europe que des présidents de république, et pas un roi. » La conspiration est l’occasion de s’apercevoir des limites de Julien. Bien que très intelligent, il se trompe quelques fois sur les gens. Quand un comploteur exalté déclare, la main sur le cœur, être investi de la haute mission de rétablir la monarchie, Julien se dit : « Voilà un bon acteur. » Mais, nous précise Stendhal, Julien « se trompait, toujours comme à l’ordinaire, en supposant trop d’esprit aux gens. » Le garçon veut tellement agir par calcul qu’il prête les mêmes desseins aux autres, sans voir la part de naïveté qui peut être la leur.
Au bout du compte, Julien finira par agir de manière impulsive, ce qui le conduira au geste fatal. Lui qui à force d’hypocrisie, pensait maîtriser les événements, finira par en être le jouet. C’est ce que le lecteur découvrira dans la dernière partie du roman, qui est vraiment palpitante.
Le Rouge et le noir contient plusieurs dimensions : histoire d’amour, fait divers, critique sociale, critique religieuse, critique politique… Au lecteur de privilégier la dimension qui retient le plus son attention. En tout cas, il peut difficilement être rebuté par le style de Stendhal, qui est sec, efficace et sans fioriture. D’une certaine manière, son écriture est très moderne.
Le Rouge et le Noir, de Stendhal, 1830, édition d’Anne-Marie Meininger, 2000, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XIXe siècle | Tags : le rouge et le noir, stendhal, anne-marie meininger | Lien permanent | Commentaires (0)


