07/09/2015
Pétain, de Bénédicte Vergez-Chaignon
Du héros de Verdun à l’homme de Vichy
Pétain
Le livre de Bénédicte Vergez-Chaigon est un pavé d’un millier de pages, aux caractères serrés. L’auteur montre comment Pétain a pu, en moins de trois ans, passer du grade de colonel à la fonction de commandant en chef de l’armée française, et comment le vainqueur de Verdun, héros national, a pu se transformer en l’homme de Vichy, chef de l’Etat français et collaborateur avec l’ennemi.
En ouverture de son livre, la très sérieuse historienne Bénédicte Vergez-Chaignon se livre à un exercice d’uchronie. Elle imagine que Pétain soit mort à la veille de la seconde guerre mondiale, en 1937 ou 1938 :
« Mort à quatre-vingt-deux ou quatre-vingt-trois ans, le maréchal Pétain aurait été comblé d’honneurs. Ses cendres auraient été transférées à l’ossuaire de Douaumont, parmi les morts de Verdun, selon ses dernières volontés. […] Des rues, des établissements scolaires, des hôpitaux porteraient son nom, sans que personne ne trouve à y redire. Mais, en véritable personnage faustien, Philippe Pétain a acheté ses années de vie supplémentaires au prix de sa gloire et de sa postérité historique. »
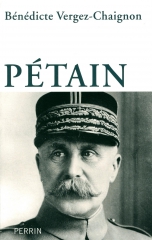 La lecture de cette biographie permet de mieux comprendre la personnalité de Pétain. Au printemps 1914, âgé de cinquante-huit ans, le colonel Pétain est un officier ordinaire, qui attend que l’heure de la retraite sonne. Il appartient à la génération qui se prépare à la revanche depuis plusieurs décennies. Etant âgé de quatorze ans en 1870, il était trop jeune pour combattre. Il s’apprête donc à partir en retraite sans avoir jamais fait la guerre. Mais, à l’été 1914, la guerre éclate et rebat les cartes.
La lecture de cette biographie permet de mieux comprendre la personnalité de Pétain. Au printemps 1914, âgé de cinquante-huit ans, le colonel Pétain est un officier ordinaire, qui attend que l’heure de la retraite sonne. Il appartient à la génération qui se prépare à la revanche depuis plusieurs décennies. Etant âgé de quatorze ans en 1870, il était trop jeune pour combattre. Il s’apprête donc à partir en retraite sans avoir jamais fait la guerre. Mais, à l’été 1914, la guerre éclate et rebat les cartes.
L’effectif de soldats mobilisés est tel, que le nombre d’officiers généraux n’est pas suffisant pour encadrer les divisions qui se mettent en place. Le grand quartier général est obligé de puiser dans le vivier des colonels. Ainsi le colonel Pétain est bombardé général et reçoit le commandement d’une division.
Le 6 septembre 1914, sa division est impliquée dans de violents combats. Le général Pétain pourrait choisir de rester chaudement à l’arrière. Au lieu de cela, il « choisit de montrer l’exemple en se portant en avant de la première ligne, accompagné de quelques officiers », note Bénédicte Vergez-Chagnon, qui poursuit : « Ainsi apparaît l’un des éléments de ce qui constituera sa légende. »
Pétain acquiert une réputation d’organisateur
qui prépare soigneusement ses offensives
L’ascension de Pétain est fulgurante. Simple colonel en 1914, il reçoit le commandement de l’armée de Verdun en 1916, puis, en 1917, il est nommé commandant en chef des armées du Nord et de l’Est, c’est-à-dire généralissime. Pétain a gagné une réputation d’organisateur, qui lui a permis de se distinguer. Avec lui, rien n’est improvisé, tout est réfléchi. Les offensives ne sont pas lancées prématurément, mais soigneusement organisées. Elles doivent être précédées de reconnaissance aérienne des positions ennemies, et de tirs d’artillerie précis et abondants.
Pétain s’est aussi acquis la réputation d’être économe du sang des soldats. Bénédicte Vergez-Chaignon insiste cependant sur le fait que c’est par réalisme que Pétain veut en finir avec les percées inutiles et coûteuses en hommes. Ce n’est pas la compassion qui l’anime, car lui-même sait faire preuve de cruauté. Ainsi en Artois, écrit l’auteur, « le général fait ligoter et jeter par-dessus le parapet de la tranchée des hommes qui se sont mutilés volontairement en se tirant dans un membre, les exposant à une mort atroce différée. »
En 1917, le nouveau commandant en chef Pétain est confronté à une grave crise qui touche l’armée : la guerre s’éternise et les mutineries se multiplient. Pétain fait face et apporte sa réponse : d’un côté il déclenche la répression contre ceux qu’il considère les meneurs et autorise les formes de justice expéditive avec condamnation à mort sans appel ; et d’un autre côté, une fois l’impression de terreur installée dans la troupe, il se préoccupe du quotidien des soldats, en améliorant notamment leur nourriture et leur équipement. Sans nul doute, cette méthode porte ses fruits. Mais, si Pétain redresse effectivement la situation, il n’est pas exagéré de dire que, fort de son succès, sa pensée s’est figée à la suite de Verdun et des mutineries. Dès cette époque, il acquiert la conviction d’avoir eu raison contre tout le monde et d’être le dernier recours pour faire face à une crise morale qui pourrait frapper le pays.
Le président Poincaré est effaré par le pessimisme de Pétain
Alors que Pétain estime que sa méthode a fait ses preuves, assez curieusement il ne fait pas l’unanimité. Raymond Poincaré, président de la République, est effaré par son pessimisme. Il est vrai que dans presque toutes les situations Pétain, tel un Cassandre, multiplie les mises en garde et prévoit le pire. Ainsi, en cas d’échec, note l’auteur, « on ne pourra pas dire qu’il n’avait pas prévenu. » Clemenceau, président du Conseil, continue d’apporter son soutien à Pétain, mais, quand il s’agit de nommer un chef suprême à la tête des armées alliées, il donne la préférence à Foch. Dans son livre Le Tigre, publié en 1930, Jean Martet, qui fut son secrétaire, rapporte cette confidence que lui fit Clemenceau après la Grande Guerre :
« A Doullens, je me suis trouvé entre deux hommes, l’un qui me disait que nous étions fichus, l’autre qui allait et qui venait comme un fou et qui voulait se battre. Je me suis dit : « Essayons Foch. Au moins, nous mourrons le fusil à la main. » J’ai laissé cet homme sensé, plein de raison, qu’était Pétain ; j’ai adopté ce fou qu’était Foch. C’est le fou qui nous a tirés de là. »
Après la victoire de 1918, Pétain est couvert d’honneurs. Elevé à la distinction de maréchal de France, il est maintenu à la tête de l’armée française. En 1922, il a soixante six ans et, déjà, le général Buat, son second, note que le maréchal vieillit et qu’ « il lui arrive d’être embrouillé et peu compréhensible. »
La méthode Pétain en politique internationale
consiste à proposer d’emblée des concessions
pour montrer sa bonne volonté
Dans les années qui suivent, le maréchal Pétain fait preuve de loyauté vis-à-vis de la République. Loin d’être un militaire factieux, il est au contraire un homme respectueux des institutions. Mais, pessimiste par nature, il voit la guerre approcher et se convainc que la France n’est pas prête. Il est très remonté contre le SNI, le syndicat national des instituteurs, et parle de « l’influence néfaste » qu’exercent certains maîtres sur leurs élèves. En 1934, pour la première fois, il parle de procéder au « redressement moral […] nécessaire au bien du pays. » Un an plus tard, le journal La Victoire lance l’appel : « C’est Pétain qu’il nous faut. »
En mars 1939, Pétain est nommé ambassadeur à Madrid, auprès du gouvernement franquiste. Face au risque de guerre avec l’Allemagne, Pétain a pour mission d’obtenir la neutralité de l’Espagne. Cette ambassade sert de laboratoire à sa méthode en matière de relations internationales. A Madrid, Pétain rencontre Franco et cède à toutes ses demandes. Il s’agit, selon Bénédicte Vergez-Chaignon, de « proposer d’emblée des concessions, y compris majeures, pour montrer sa bonne volonté, demander ensuite que le partenaire, rival ou adversaire, agisse de même, être prêt à de nouvelles concessions si la première passe n’a pas abouti. En somme, une politique du toujours plus faible au toujours plus fort […]. » Cette méthode que Pétain utilise face à Franco, il la reproduira face à Hitler et se lancera dans la politique de collaboration avec l’Allemagne.
En mai 1940, l’armée allemande envahit la France. Pétain est rappelé en France et entre au gouvernement. Devenu vice-président du Conseil, il est accablé par la débâcle et parle d’ « affreuse épreuve ». Il porte sa part de responsabilité, lui qui, quelques années auparavant, jugeait le massif des Ardennes infranchissable par l’armée ennemie. Pourtant, en juin 1940, Pétain apparaît comme le recours. Il ne croit plus du tout à un renversement de la situation militaire et se résigne à un armistice. Il veut le signer le plus tôt possible, de façon à ce qu’il soit assez avantageux. Selon l’auteur, « non seulement il pense que l’armistice préserve un avenir […], mais il pense être le mieux – le seul – pour en tirer quelque chose. » L’armistice signé, il fait voter une loi, le 11 juillet 1940, qui lui accorde les pleins pouvoirs, mais dans le cadre de la République. Dès le lendemain, un acte constitutionnel, outrepassant la loi votée la veille, fait de lui le chef de l’Etat et abolit la République.
La seconde partie du livre est essentiellement consacrée aux quatre années passées par Pétain à la tête de l’Etat français. Très détaillée, elle intéressera surtout les spécialistes. En revanche, les 400 premières pages, sur Pétain avant Vichy, peuvent être lues par un public assez large.
Pétain, de Bénédicte Vergez-Chaignon, 2014, éditions Perrin.
07:34 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : pétain, bénédicte vergez-chaignon | Lien permanent | Commentaires (0)
18/05/2015
Choses vues, d'Hugo
Hugo reporter du siècle
Choses vues
Choses vues dans la version proposée par Gallimard est un recueil de plus de 1400 pages de notes prises, au cours de sa vie, par Victor Hugo. Le lecteur entre dans son intimité et est mêlé aux principaux événements du siècle ; il suit la lente évolution politique d’Hugo qui fut royaliste dans sa jeunesse et mourut républicain ; et il côtoie ses contemporains : Louis-Philippe, Chateaubriand, Lamartine, Balzac… Le génie d’Hugo fait de Choses vues un document exceptionnel.
Choses vues est un ensemble de notes prises, au jour le jour, par Victor Hugo pendant sa vie. Le titre Choses vues a été donné par ses exécuteurs testamentaires, l’ouvrage ayant été publié après sa mort. Le nombre d’écrits varie d’une édition à l’autre et c’est le recueil publié dans la collection Quarto de Gallimard qui paraît le plus complet. Il reprend, sur plus de 1400 pages, des notes s’étalant de 1830 à 1885, année de la mort de l’écrivain. Dans ses carnets, Hugo parle de sa vie au quotidien, aussi bien de sa vie publique que de sa vie de famille, les deux formant un tout à ses yeux. Il évoque également ses fréquentations féminines, le plus souvent dans un langage codé cependant. Et puis, il évoque l’état de ses finances et fait une comptabilité précise de ses recettes et de ses dépenses. Il note les montants qu’il touche au titre de ses droits d’auteur, les sommes qu’il tire à la banque, les pourboires qu’il verse, ainsi que les aumônes qu’il pratique ; car Hugo, ancien élève de mathématiques spéciales à Louis-le-Grand, est un homme qui sait compter et qui est à l’aise avec les chiffres.
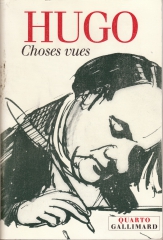 Le lecteur de Choses vues traverse une bonne partie du siècle. L’ensemble est très vivant, Hugo étant un reporter de génie. En sa compagnie, le lecteur a l’impression de vivre en direct de grands moments de l’histoire de France. Hugo assure le suivi au jour le jour de la Révolution de 1848, il est au milieu de l’émeute et des barricades, et fait partager ce qu’il voit et entend. Il rend également très compréhensible la guerre de 1870 et la naissance de la Commune.
Le lecteur de Choses vues traverse une bonne partie du siècle. L’ensemble est très vivant, Hugo étant un reporter de génie. En sa compagnie, le lecteur a l’impression de vivre en direct de grands moments de l’histoire de France. Hugo assure le suivi au jour le jour de la Révolution de 1848, il est au milieu de l’émeute et des barricades, et fait partager ce qu’il voit et entend. Il rend également très compréhensible la guerre de 1870 et la naissance de la Commune.
Au-delà, le lecteur assiste à la longue évolution des convictions d’Hugo. Jeune homme, il est royaliste. Mais déjà son positionnement apparaît ambigu. Ainsi, en août 1830, au lendemain de la chute de Charles X, il écrit : « Il nous faut la chose république et le mot monarchie. » En tout état de cause, il apporte son soutien au nouveau monarque, Louis-Philippe, qui saura le récompenser en le nommant pair de France, c’est-à-dire sénateur.
Sous la monarchie de Juillet, Hugo mène une vie mondaine qui le conduit au palais des Tuileries, au palais du Luxembourg, et au palais de l’Institut. La vie lui sourit et la question sociale n’est pas sa priorité. Cependant, en janvier 1841, quelques jours après son élection à l’Académie française, il fait le récit d’un épisode au cours duquel il se porte au secours d’une jeune femme arrêtée par la police pour avoir agressé un bourgeois. Hugo intervient auprès du commissaire et fait valoir que la malheureuse n’est pas la coupable mais la victime. Il atteste que le bourgeois lui a planté, sans raison, de la neige dans le dos et qu’elle n’a fait que se défendre. Sans nul doute, cet épisode aura été la source d’inspiration de l’écrivain dans la création de Fantine, personnage clé des Misérables.
En septembre 1843, le malheur s’abat sur Hugo. Il perd sa fille aînée Léopoldine, qui meurt en mer, en compagnie de son mari. Léopoldine avait vingt ans et venait de se marier. La blessure est profonde chez Hugo. Même si cela n’apparaît pas encore clairement, il semble que sa lente évolution politique et sociale voit le jour à ce moment-là.
En 1848, Hugo, pair de France, reste fidèle à la monarchie
Quand la Révolution de février 1848 éclate et renverse Louis-Philippe, Hugo, pair de France, reste fidèle à la monarchie et apporte son soutien à la Régence de la duchesse d’Orléans. En réalité, sa position est emberlificotée. Le 25 février, il rend visite à Lamartine, président du gouvernement provisoire de la République. Le recevant dans son bureau de l’hôtel de ville, Lamartine propose à Hugo, non une quelconque mairie d’arrondissement, mais un portefeuille ministériel. Voici le dialogue qui s’engage entre les deux hommes. Lamartine :
« - Ce n’est pas une mairie que je voudrais pour vous, c’est un ministère. Victor Hugo ministre de l’instruction publique de la République !... Voyons, puisque vous dites que vous êtes républicain !
- Républicain… en principe. Mais, en fait, j’étais hier pair de France, j’étais hier pour la Régence, et, croyant la République prématurée, je serais encore pour la Régence aujourd’hui. »
La toute nouvelle république, dominée par la bourgeoisie, est confrontée à la question brûlante des Ateliers nationaux. Ils ont été créés pour occuper les chômeurs. Mais leurs détracteurs y voient des écoles d’oisiveté. Parmi eux se trouve Hugo. Dans une note de mai 1848, il prend position contre ce qu’on appellerait aujourd’hui l’assistanat :
Ceci caractérise assez bien [les ateliers nationaux] ; des hommes en blouse jouaient au bouchon sous les arcades de la place Royale, qui s’appelle aujourd’hui place des Vosges. Jouer au bouchon, c’est un des travaux des ateliers nationaux. Un autre, en blouse aussi, dormait étendu le long du mur. Un des joueurs vient à lui, le pousse du pied et dit : « Qu’est-ce que tu fais là, toi ? » Le dormeur se réveille, se frotte les yeux, lève la tête, et répond : « Eh bien, je gagne mes 20 sous ! » Et il se recouche sur le pavé.
Voilà ce que c’est les Ateliers nationaux.
La majorité de l’Assemblée vote la fermeture des Ateliers nationaux. Furieux, les ouvriers se révoltent. Les journées de juin sont marquées par de nouvelles barricades. La répression est terrible. Dorénavant la bourgeoisie n’est plus du côté de la révolution, mais du côté de l’ordre.
Hugo revient bouleversé de sa visite des caves de Lille
Le véritable tournant, chez Hugo, se produit en 1849. Bien qu’élu représentant sur une liste de candidats conservateurs, il s’en détache en réclamant, en vain, une amnistie et la liberté de la presse. Accusé par ses amis d’hier d’être une girouette, Hugo se justifie dans une note rédigée le 18 décembre 1850 et destinée à la postérité. Il y cible ses adversaires conservateurs :
Ils me disent :
« Vous avez varié. Vous avez changé. En 1848, vous étiez contre les rouges ; en 1850, vous êtes pour les rouges. Donc, etc. »
Expliquons-nous.
En 1848, « les rouges » étaient les oppresseurs, je les combattais. En 1850, « les rouges » sont les opprimés, je les défends.
C’est là que vous appelez varier ?
Comme vous voulez ! »
Le 20 février 1851, à l’invitation d’Adolphe Blanqui, membre de l’Institut, Hugo se rend dans les caves de Lille, ghetto souterrain où sont parqués des pauvres. Il découvre la misère sociale dans sa crudité. Voici ce qu’il écrit :
Dialogue à Lille, dans une cave :
« Ah ! pauvre petite ! Déjà au travail. Mais elle a à peine quatre ans !
- Monsieur, j’ai huit ans.
- C’est égal. Elle n’est pas en état de travailler. Il faut le dire à ses parents, Madame, vous êtes sans doute sa grand-mère ?
- Monsieur, je suis sa mère. J’ai trente-cinq ans. »
Hugo revient bouleversé de sa visite des caves de Lille. Pour la première fois de sa vie, il a été confronté à l’extrême pauvreté. Sa vision de la misère qui était purement livresque jusqu’ici devient ancrée dans la réalité qu’il a vue de ses yeux. De ce jour, il est convaincu de la primauté de la question sociale.
Le 2 décembre 1851, il s’oppose au coup d’état du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte et tente de soulever le peuple de Paris. C’est l’échec. Il s’exile, d’abord en Belgique, d’où il est expulsé, puis à Jersey, d’où il est également expulsé. Il trouve refuge à Guernesey, où le suivent sa famille et sa chère Juliette Drouet.
En 1859, Napoléon III décrète l’amnistie. L’ensemble des opposants au régime profitent de cette largesse pour rentrer en France. Hugo refuse. Le 19 août 1859, il ironise sur l’amnistie :
Le coupable pardonne aux innocents, le bandit réhabilite les justes, le violateur des lois fait grâce aux défenseurs des lois ; c’est bien.
Je laisse l’Europe applaudir l’amnistie sur la joue de la justice et de la vérité.
A une certaine profondeur de dédain il semble qu’il n’y ait plus de possible que le silence.
Le proscrit de Décembre doit à l’Empire l’implacable guerre de la justice. Quand cette guerre finira-t-elle ? à la fin de l’Empire ou à la mort du proscrit.
J’entends rester libre.
Et je veux rester combattant.
Les années passent. Malgré l’éloignement et la réclusion, la proscription est féconde à Hugo, puisqu’elle lui permet de finir la rédaction des Misérables, qui sera un immense succès populaire.
En 1870, Hugo, député républicain,
lance un appel à la guerre à outrance
En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Le 9 août, Hugo, apprenant que trois batailles ont été perdues coup sur coup, décide de rentrer en France pour, écrit-il, « être à la disposition de mon devoir et des événements. »
Le 3 septembre, Hugo est à Bruxelles quand il apprend que Napoléon III est prisonnier et que plus rien ne s’oppose à son retour en France. Le 4 septembre, la République est proclamée. Le 5 septembre, Hugo s’apprête à prendre le train pour Paris quand, place de la Monnaie, un jeune homme l’aborde :
« - Monsieur, on me dit que vous êtes Victor Hugo ?
- Oui.
- Soyez assez bon pour m’éclairer. Je voudrais savoir s’il est prudent d’aller à Paris en ce moment.
- Monsieur, c’est très imprudent, mais il faut y aller. »
Ce même jour, le 5 septembre, après plus de dix-huit années d’exil, Hugo rentre à Paris. Le peuple lui a réservé un accueil triomphal. La foule chante La Marseillaise et Le Chant du départ, et crie « Vive Victor Hugo ! » Hugo lance à la foule : « Vous me payez en une heure vingt ans d’exil. » et il ajoute : « Citoyens ! Je ne suis pas venu ébranler le gouvernement provisoire de la République, mais l’appuyer. »
Hugo est élu député de la Seine. L’ancien pair de France siège maintenant à l’extrême-gauche. Mais l’homme qui présidait, l’année passée, le Congrès de la Paix n’admet pas la défaite. Le 16 septembre 1870, il publie l’Appel aux Français pour la guerre à outrance et note dans ses carnets :
Il y a aujourd’hui un an, j’ouvrais le Congrès de la paix à Lausanne. Ce matin, j’écris L’Appel aux Français pour la guerre à outrance contre l’invasion.
Mais son appel reste sans effet, l’assemblée de Versailles préférant signer la paix avec l’Allemagne. Après la Commune à laquelle il n’a pourtant pas apporté son soutien, Hugo réclame une amnistie générale, ce qui lui vaut l’hostilité de la droite.
On l’a vu, Victor Hugo aura effectué un virage à 180 degrés, en ce qui concerne ses idées politiques. Cependant, de 1830 à sa mort en 1885, il n’aura pas varié sur deux sujets : son opposition absolue à la peine de mort et son patriotisme. Le 27 décembre 1877, il écrit : « Malheur à qui fait mal à la France ! Je ne m’apaiserai pas. Je déclare que je mourrai fanatique de la patrie. »
*****
Dans Choses vues, Victor Hugo fait des portraits de ses illustres contemporains. Voici quelques personnalités qu’il évoque :
Louis-Philippe
Hugo, pair de France, était devenu un familier de Louis-Philippe, auquel il consacre de nombreuses notes. Il évoque notamment la mort accidentelle de son fils aîné. Le 13 juillet 1842, sur la route de Neuilly, le duc d’Orléans, héritier du trône, fait une mauvaise chute de cheval. Informé de l’accident, le roi se rend immédiatement sur place. Selon Hugo, Louis-Philippe voit son fils blessé et déclare : « C’est une chute cruelle ; il est encore évanoui, mais il n’a aucune fracture, tous les membres sont souples et en bon état. » Hugo poursuit : « Le roi avait raison ; tout le corps du prince était sain et intact, excepté la tête, laquelle, sans déchirure ni lésion extérieure, était brisée sous la peau comme une assiette. » Le duc d’Orléans meurt le jour même.
Sous son règne, Louis-Philippe aura été la cible de nombreux attentats. Hugo parle abondamment de la tentative commise, le 16 avril 1846, par le dénommé Pierre Leconte. Ce dernier tire sur le roi et le manque. Il est jugé par la chambre des pairs, qui le condamne à mort. Son avocat, maître Duvergier, se rend au Château pour demander la grâce de son client. Selon Hugo, qui soutient la démarche de l’avocat, Louis-Philippe, très remonté, déclare ceci :
« - J’examinerai, je verrai. Le cas est grave. Mon danger est le danger de tous. Ma vie importe à la France, c’est pour cela que je dois la défendre. Savez-vous comment il se fait qu’on tire sur moi ? C’est qu’on ne me connaît pas, c’est qu’on me calomnie ; on dit partout : - Louis-Philippe est un gueux, Louis-Philippe est un coquin, Louis-Philippe est un avare, Louis-Philippe fait le mal. Il veut des dotations pour ses fils, de l’argent pour lui. Il corrompt le pays. Il l’avilit au-dedans et l’abaisse au-dehors. C’est un vieux Anglais. A bas Louis-Philippe ! Que diable ! il faut bien que je protège un peu ce pauvre Louis-Philippe, maître Duvergier. C’est égal, je réfléchirai. »
Ce jour-là, il apparaît clairement que le roi n’est pas décidé à faire grâce ; et, effectivement, quelques jours plus tard, maître Duvergier reçoit un message du Château lui annonçant que « le roi avait cru devoir décider que la loi aurait son cours. »
La répétition d’affaires politico-financières mettant en cause de hautes personnalités mine la monarchie de Juillet. En 1847, la Chambre des pairs est chargée de juger Jean-Baptiste Teste, président de chambre à la Cour de cassation, accusé de s’être laissé corrompre quand il était ministre des Travaux publics. Le scandale est énorme. Teste est condamné, le régime est affaibli. A cela s’ajoute l’autoritarisme de Louis-Philippe, qui n’arrange pas les choses.
Louis-Philippe ne voit pas venir la Révolution de Février 1848, qui le renverse. Hugo nous fait le récit de la fuite du roi, et il n’est pas exagéré de dire qu’il a fui comme un voleur.
Chateaubriand
Hugo parle assez peu de Chateaubriand, dont il avait été le grand admirateur, presque le disciple. Mais, après la chute de Charles X, leurs relations se sont distendues. Hugo s’est rallié à Louis-Philippe, tandis que Chateaubriand refuse de reconnaître le nouveau roi. De plus, Chateaubriand ose critiquer le mouvement romantique, si bien qu’en 1836, dans ses notes, Hugo lâche :
M. de Chateaubriand vieillit par le caractère plus encore que par le talent. Le voilà qui devient bougon et hargneux.
Chateaubriand sera resté fidèle aux Bourbons tout en luttant pour la liberté de la presse. A sa mort le 4 juillet 1848, alors que la République a été proclamée, Hugo se rappelle ceci :
M. de Chateaubriand ne disait rien de la République, sinon : « Cela vous fera-t-il plus heureux ? »
On sait qu’à la fin de sa vie, Chateaubriand se préoccupa fort de l’édification de sa statue morale et intellectuelle et de l’image qu’il laisserait aux générations à venir.Lorsqu’il s’agit, à l’Académie, de pourvoir son siège devenu vacant, Hugo, quelque peu perfide, note, le 29 décembre 1848 :
[M. de Chateaubriand] haïssait tout ce qui pouvait le remplaçer et souriait à tout ce qui pouvait le faire regretter.
Pour succéder à Chateaubriand, Hugo soutient la candidature de Balzac. L’auteur de La Comédie humaine n’obtient que deux voix, celle d’Hugo et celle de Vigny. C’est un nouvel échec pour Balzac, qui n’aura jamais réussi à entrer à l’Académie française.
La mort de Balzac
Le 18 août 1850, Mme Hugo rend visite à Mme de Balzac. A son retour, elle annonce à son mari que Balzac se meurt. Le soir même, Hugo se rend au domicile de Balzac, où il est accueilli par sa sœur qui est en pleurs. Il est introduit dans la chambre du mourant :
Une odeur insupportable s’exhalait du lit. Je soulevai la couverture et pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression.
C’était cette même chambre où je l’étais venu voir un mois auparavant. Il était gai, plein d’espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure en riant.
Nous avions beaucoup causé et disputé politique. Il me reprochait « ma démagogie ». Lui était légitimiste. Il me disait : « Comment avez-vous pu renoncer avec tant de sérénité à ce titre de pair de France, le plus beau après celui de roi de France ! »
Il me disait aussi : « J’ai la maison de M. de Beaujon, moins le jardin, mais avec la tribune sur la petite église du coin de la rue. J’ai là dans mon escalier une porte qui ouvre sur l’église. Un tour de clef et je suis à la messe. Je tiens plus à cette tribune qu’au jardin. »
Quand je l’avais quitté, il m’avait reconduit jusqu’à cet escalier, marchant péniblement, et m’avait montré cette porte, et il avait crié à sa femme : « Surtout, fais bien voir à Hugo tous mes tableaux. »
La garde me dit :
« Il mourra au point du jour. »
Je redescendis, emportant dans ma pensée cette figure livide ; en traversant le salon, je retrouvai le buste [colossal en marbre de Balzac par David] immobile, impassible, altier et rayonnant vaguement, et je comparai la mort à l’immortalité.
Rentré chez moi, c’était un dimanche, je trouvai plusieurs personnes qui m’attendaient […]. Je leur dis : « Messieurs, l’Europe va perdre un grand esprit. »
Il mourut dans la nuit. Il avait cinquante et un ans.
Choses vues, de Victor Hugo, 1830-1885, édition d’Hubert Juin, 1972, collection Quarto Gallimard.
07:33 Publié dans Carnets, correspondance, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : hugo, choses vues | Lien permanent | Commentaires (0)
20/04/2015
Thiers, bourgeois et révolutionnaire, de Georges Valance
Fossoyeur de la Commune ou artisan de la république ?
Thiers
bourgeois et révolutionnaire
Adolphe Thiers a eu une carrière politique d’une longévité exceptionnelle. Deux fois président du Conseil sous le règne de Louis-Philippe, il revient au pouvoir en 1871 et négocie la paix avec Bismarck. Georges Valance dresse le portrait d’un homme peu sympathique, mais qui ne fut pas le tyran sanguinaire que l’on pourrait croire.
De nos jours, Adolphe Thiers a mauvaise presse, notamment auprès de ceux qui voient en lui le fossoyeur de la Commune. Déjà en 1848, il avait acquis une mauvaise réputation auprès du peuple, qu’il avait qualifié, avec mépris, de « vile multitude », expression qui l’a poursuivi de son vivant et au-delà. Pourtant, si on les examine de près, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Si vraiment Thiers avait été le fusilleur du peuple, comment expliquer que, selon Jules Ferry, un million de Parisiens suivirent ses obsèques à travers les rues de Paris ? Et comment expliquer que plus de cent villes de France s’empressèrent de baptiser de son nom une place ou une avenue ?
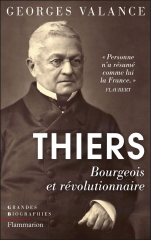 Dans sa biographie de Thiers, Georges Valance essaye de faire la part des choses. Il dresse le portrait d’un homme assez peu sympathique, mais qui ne mérite pas l’opprobre. Thiers s’est trompé dans un certain nombre de cas, mais dans d’autres il a eu raison avant tout le monde. Sa longévité politique fut exceptionnelle : il fut président du Conseil des ministres en 1836, à nouveau en 1840, et redevint chef de l’exécutif trente ans plus tard, en 1871. En près de cinquante ans d’engagement politique, il eut le temps de se faire de nombreux ennemis.
Dans sa biographie de Thiers, Georges Valance essaye de faire la part des choses. Il dresse le portrait d’un homme assez peu sympathique, mais qui ne mérite pas l’opprobre. Thiers s’est trompé dans un certain nombre de cas, mais dans d’autres il a eu raison avant tout le monde. Sa longévité politique fut exceptionnelle : il fut président du Conseil des ministres en 1836, à nouveau en 1840, et redevint chef de l’exécutif trente ans plus tard, en 1871. En près de cinquante ans d’engagement politique, il eut le temps de se faire de nombreux ennemis.
« Monsieur Thiers a toujours voulu la même chose. Il n’a jamais eu qu’une seule pensée, un seul système, un seul but ; tous ses efforts y ont constamment tenu ; il a toujours songé à Monsieur Thiers. » Ces mots de Balzac sont durs, mais ils sonnent juste. A la lecture du livre de Valance, on comprend que Thiers avait une revanche à prendre sur la vie. Il est moqué pour sa petite taille, un mètre cinquante-cinq, et Louis-Philippe l’appelle familièrement « mon petit président. » Il est né hors-mariage, c’est-à-dire bâtard, selon le terme de l’époque, et il en souffre. Après sa jeunesse passée à Marseille, il monte à Paris, bien décidé à faire carrière. D’après Valance, qui s’appuie sur les travaux de Félicien Marceau, Thiers a en partie inspiré à Balzac le personnage de Rastignac, ce jeune provincial qui veut se faire un nom dans la capitale. Thiers et Rastignac partagent la même ambition et tous deux épousent la fille de leur maîtresse. La belle-mère de Thiers, madame Dosne, restera, jusqu’à sa mort, auprès de son gendre et sera son plus fidèle soutien. Si Balzac est sévère sur Thiers, Chateaubriand en fait un portrait plus nuancé. Cependant il reste sur ses gardes et note, avec prémonition si l’on songe à la Commune qui éclatera trente ans plus tard, que le caractère de Thiers « ne l’empêcherait pas de nous faire étrangler le cas échéant. »
Hugo se moque des prétentions littéraires de Thiers
Thiers se fait connaître en publiant Histoire de la Révolution, puis Histoire du Consulat et de l’Empire. Le tout fait plusieurs dizaines de tomes et devient un succès de librairie. Le travail de Thiers ne fait cependant pas l’unanimité. Dans ses carnets, Victor Hugo se moque des prétentions littéraires de Thiers et considère qu’il écrit en « style de journal », c’est-à-dire mal.
En 1830, quand les Trois Glorieuses se produisent, Thiers se situe à la gauche de l’échiquier politique. Il est journaliste, il se bat pour la liberté de la presse et contribue à la chute de Charles X et des Bourbons. Il se rallie au nouveau roi, Louis-Philippe, et entre au gouvernement. Une fois au pouvoir, il oublie ses idées de jeunesse. Suite à un attentat contre le roi, Thiers, ministre de l’Intérieur, s’appuie sur l’émotion populaire pour faire voter une législation nouvelle. Ce sont les fameuses « lois scélérates »,qui réduisent la liberté de la presse. En agissant ainsi, il brûle ce qu’il a adoré, et se brouille avec certains de ses amis.
Quand, en 1848, l’insurrection éclate à Paris, Thiers y va de ses conseils auprès du roi. Ancien ministre de l’Intérieur, il a déjà acquis une certaine expérience en matière de répression ; c’est lui qui, en 1834, a mis fin à la révolte des Canuts. En ce mois de février 1848, il propose à Louis-Philippe de quitter Paris et « de se retirer à Saint-Cloud où l’on appellerait des forces suffisantes pour prendre l’offensive. », mais le roi des Français préfère abdiquer.
Revenu à la gauche de l’échiquier politique, Thiers apporte son soutien à Louis-Napoléon Bonaparte de retour d’exil. Le prince donne l’impression d’être un personnage falot et sans grand caractère, que l’on peut facilement manœuvrer. En réalité, Louis-Napoléon Bonaparte cache bien son jeu. Elu président, il entend bien garder le pouvoir et déclenche un coup d’Etat le 2 décembre 1851.
Opposant à l’Empire, Thiers prononce un discours mémorable en 1867. Tel un Cassandre, il dénonce la politique des nationalités chère à Napoléon III, et prédit les pires catastrophes. Thiers dit craindre la perte prochaine de l’Alsace et s’exclame : « Cette héroïque Alsace […], faudra-t-il lui dire : “Vous parlez allemand, donc il faut vous séparer !” » Trois ans plus tard, en juillet 1870, alors que la France vient de déclarer la guerre à la Prusse, Thiers est hué à la Chambre, parce qu’il déclare que le pays va vers de grands malheurs.
Face à la Commune, Thiers met en pratique les conseils
que Louis-Philippe avait refusé de suivre en 1848
Quelques semaines plus tard, c’est la débâcle. Thiers, l’homme qui avait averti du désastre, est rappelé aux affaires pour négocier la paix avec Bismarck. Il est contraint de céder l’Alsace et la Moselle, mais sauve Belfort qui n’a jamais parlé allemand et qui a résisté héroïquement. Belfort restera français, mais, en échange, Thiers consent à ce que les troupes prussiennes entrent dans Paris pour y défiler. Quand les Parisiens apprennent la nouvelle, ils se sentent trahis et se révoltent. C’est donc bien une réaction patriotique qui est à l’origine de la Commune.
Face à l’insurrection, Thiers met en pratique les conseils qu’il avait donnés à Louis Philippe en 1848. Il quitte Paris et transporte l’Assemblée à Versailles. Il se montre patient et rassemble le maximum de troupes. Quand il estime la situation mûre, il fait entrer l’armée dans Paris et la laisse mener des opérations de représailles. Mais le désordre était devenu tel, que la population éprouve un sentiment de soulagement. Flaubert ne trouve aucune excuse à la Commune, et Jules Ferry, républicain s’il en est, n’est pas scandalisé de la répression.
La Commune écrasée, Thiers est conforté dans son pouvoir et reçoit le titre de président de la République. Mais il n’en a pas fini avec la tâche de terminer la guerre, qui lui incombe. Il doit régler l’indemnité imposée par l’Allemagne, que Bismarck a fixée à six milliards de francs. C’est une somme énorme pour l’époque. L’objectif du chancelier allemand est clair : il veut ruiner la France pour l’empêcher de se relever. Thiers et son gouvernement font preuve d’imagination pour trouver des recettes exceptionnelles. Ils lancent un emprunt qui rencontre un succès inattendu, jusqu’en Amérique. A la surprise générale, les six milliards de francs sont vite réunis et, l’indemnité réglée, les troupes prussiennes évacuent le territoire national.
Le « sale boulot » accompli, les monarchistes, qui sont majoritaires à l’Assemblée, entendent se débarrasser de Thiers. Décidés à lui faire payer son ralliement à la république, ils provoquent sa chute. En 1877, le député Thiers reçoit un hommage solennel à l’Assemblée, quand Gambetta, du haut de la tribune, le désigne de la main et proclame : « Le libérateur du territoire, le voilà ! » La même année, Thiers, âgé de quatre-vingt ans, repart en campagne électorale à côté de Gambetta, quand il meurt subitement.
Thiers, bourgeois et révolutionnaire, de Georges Valance, 2007, Flammarion.
07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : thiers, bourgeois et révolutionnaire, georges valance | Lien permanent | Commentaires (0)


