06/11/2017
La Plaisanterie
Roman sur la foi dans le communisme
La Plaisanterie
Ludvik est un garçon qui aime à plaisanter, ce qui n’est pas bien vu dans la Tchécoslovaquie d’après-guerre au régime totalitaire. Pour avoir ironisé sur la construction du socialisme, il est exclu du Parti et renvoyé de l’Université. Le roman de Kundera est en partie autobiographique et permet de comprendre ce que fut la foi dans le communisme.
La Plaisanterie est un roman à la construction singulière : pas moins de cinq narrateurs se relaient au fil des pages, de chapitre en chapitre. Ces cinq narrateurs se retrouvent, un jour de 1967, à une fête folklorique intitulée la Chevauchée des Rois, qui se déroule dans les rues de la ville d’Ostrava. C’est l’occasion pour eux de se remémorer, chacun de son côté, les circonstances dans lesquelles l’un des leurs, Ludvik Jahn, fut jadis exclu du parti communiste.
 Le premier de ces narrateurs, qui n’est autre que Ludvik lui-même, se souvient que tout a commencé en 1948, au moment du Coup de Prague, c’est-à-dire lors de la prise du pouvoir par les communistes. Il était étudiant à l’université et souhaitait faire la conquête de Marketa, l’une de ses condisciples. Tous deux étaient de caractères très différents : Marketa était, aux dires de Ludvik, l’une de « ces femmes qui prennent tout au sérieux » ; tandis que lui-même, revendiquant le « sens de la plaisanterie », aimait à faire des blagues, ce qui le plaçait en contradiction avec le nouveau régime qui ne souffrait pas les facéties ou l’ironie. Certes, en cette période construction du socialisme, « l’optimisme de la classe ouvrière » est alors à l’ordre du jour, mais il s’agit d’une félicité grave, d’une espèce d’ascèse qui se résume au mot Joie écrit avec un « J » majuscule.
Le premier de ces narrateurs, qui n’est autre que Ludvik lui-même, se souvient que tout a commencé en 1948, au moment du Coup de Prague, c’est-à-dire lors de la prise du pouvoir par les communistes. Il était étudiant à l’université et souhaitait faire la conquête de Marketa, l’une de ses condisciples. Tous deux étaient de caractères très différents : Marketa était, aux dires de Ludvik, l’une de « ces femmes qui prennent tout au sérieux » ; tandis que lui-même, revendiquant le « sens de la plaisanterie », aimait à faire des blagues, ce qui le plaçait en contradiction avec le nouveau régime qui ne souffrait pas les facéties ou l’ironie. Certes, en cette période construction du socialisme, « l’optimisme de la classe ouvrière » est alors à l’ordre du jour, mais il s’agit d’une félicité grave, d’une espèce d’ascèse qui se résume au mot Joie écrit avec un « J » majuscule.
Or, à l’été 1948, alors que Marketa participait à un stage de formation du Parti, Ludvik, qui cherchait à la provoquer, lui envoya une carte postale sur laquelle il avait écrit : « L’optimisme est l’opium du genre humain », détournement de la célèbre formule de Marx : « La religion est l’opium du peuple. » Cette carte postale finit entre les mains de responsables communistes et valut à Ludvik une convocation devant le comité des étudiants du Parti. Ses juges, brandissant la carte postale incriminée, le harcelèrent de questions : « Et toi, l’optimisme qu’est ce que tu en penses ? Tu crois vraiment qu’il est possible de construire le socialisme sans optimisme ? Je serais curieux de savoir ce qu’en diraient nos ouvriers et nos travailleurs de choc qui dépassent les plans s’ils apprenaient que leur optimisme, c’est de l’opium. » Ce jour-là, devant ses juges, Ludvik refusa de tenir le rôle qu’on attendait de lui, c'est-à-dire le « rôle de l’accusé qui s’accusant lui-même avec passion, tentait d’implorer la pitié. »
Reconnu coupable de trotskisme, Ludvik fut exclu du Parti, renvoyé de la Faculté et, de fait, perdit le bénéfice de son sursis d’appel au service militaire, si bien qu’il fut aussitôt incorporé et envoyé dans un bataillon disciplinaire.
Etre exclu du Parti est vécu
comme un traumatisme
Ce qui est fascinant dans ce roman, c’est la foi des personnages dans le socialisme. Ludvik a du mal à admettre son exclusion, il a le sentiment, dit-il, d’être « rejeté hors du chemin de la vie ». « Tous les fils étaient cassés », précise-t-il. L’un de ses compagnons de chambrée au sein de l’unité disciplinaire vit son exclusion comme un véritable traumatisme ; car, croit-il, « à partir du moment où le Parti bannit un homme de son sein, cet homme n’a plus de raison de vivre. »
Kotska, un camarade de Ludvik qui croit au socialisme mais aussi en Dieu, fut à son tour exclu du Parti. Kotska voit dans le socialisme un « courant d’idées né du message de Jésus », ce qui lui vaut d’être fiché comme « clérical » et « élément suspect ». Il fut éjecté de l’Université et envoyé dans une ferme d’Etat, mais le dur traitement qui lui fut infligé ne modifia en rien ses convictions. Ce fut même l’occasion pour lui de renouveler sa profession de foi en ces termes : « L’homme dévoué à sa foi est humble et humblement il doit accepter le châtiment, même injuste. »
Le nouvel Etat tente bien de déchristianiser la société nouvelle. A Ostrava, Ludvik assiste à une cérémonie de « bienvenue dans la vie », censée se substituer au baptême chrétien. Mais tout cela sonne faux, est artificiel et ridicule. La cérémonie est organisée au Comité national de la ville, anciennement mairie de la commune. Dans une grande salle, des mères de famille sont assises, avec leurs maris à leurs côtés, et tiennent leurs bébés dans les bras. Un détachement d’enfants entre et prend place sur un podium. Des petits récitants se succèdent et enchaînent des banalités telles que « l’enfant c’est la paix ; l’enfant est une fleur » ; puis un adulte appelle publiquement les parents à faire de leurs enfants des « citoyens modèles ». En fin de cérémonie, les parents sont invités tour à tour à monter sur le podium pour apposer leurs signatures au registre.
Aragon tenait ce roman
pour « une œuvre majeure »
Ce qui est plus inattendu dans ce tableau de la Tchécoslovaquie communiste, c’est, à travers l’organisation de la chevauchée des Rois, la volonté du Parti de récupérer à son profit la tradition morave et le folklore national. Le gouvernement favorise l’enseignement de la musique et consacre des sommes colossales à la création d’ensembles, s’appuyant sur la définition qu’avait donnée Staline de l’art neuf : « un contenu socialiste dans une forme nationale ». Il est officiellement précisé que la pratique des arts populaires forme partie intégrante de l’éducation communiste.
Ce roman est en partie autobiographique. Ludvik ressemble beaucoup à Kundera. Tous deux ont le même âge, trente-sept ans en 1966 ; tous deux sont musiciens ; tous deux ont été exclus du PC pour avoir plaisanté mal à propos ; et tous deux ont été envoyés comme ouvriers mineurs à Ostrava.
La Plaisanterie fut publiée en France en 1968, au lendemain du Printemps de Prague. Aragon écrivit la préface de l’édition française : il exprima ses remerciements à Kundera et dit tenir son roman pour « une œuvre majeure ». Cette préface fut reproduite dans l’édition de poche de la collection Folio, puis fut supprimée quelques décennies plus tard.
De nos jours, alors que le communisme s’est effondré, La Plaisanterie a acquis une valeur historique pour comprendre ce que fut la foi dans le communisme. Le lecteur habitué aux formes classiques de la narration doit cependant faire un effort au début de chaque chapitre, pour déterminer, d’après les éléments donnés par Kundera, à quel narrateur il a affaire.
La Plaisanterie, de Milan Kundera, 1967, collection Folio.
09:01 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la plaisanterie, kundera | Lien permanent | Commentaires (0)
02/10/2017
Le Cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik
Les petitesses du génie du siècle
Le Cas Eduard Einstein
Auréolé de son prix Nobel de physique, Albert Einstein épousa toutes les justes causes de son temps. Mais, dans la vie privée, il ne se montra guère à la hauteur de sa réputation, et délaissa son fils cadet, Eduard, déclaré fou. Le livre de Laurent Seksik offre une étude passionnante de la folie.
Pour certains, ce serait une famille normale : il y avait un papa, une maman et des enfants. Et pourtant cette famille ne fut vraiment pas dans la norme. Le père, Albert Einstein, lauréat du prix Nobel de physique, fut considéré comme le génie du siècle ; Max Planck l’appelait « notre nouveau Galilée ». Il épousa les justes causes de son époque : il s’opposa au nazisme et brava la Gestapo ; en 1939, il écrivit personnellement au président Roosevelt pour lui apporter de précieuses informations sur la bombe atomique, puis il lui écrivit à nouveau, en 1945, pour le supplier de ne pas faire usage de la bombe ; il soutint le combat des Noirs américains et s’engagea personnellement contre la ségrégation… Bref, cet homme fut de tous les combats de son temps.
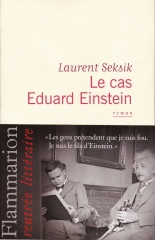 Dans sa vie, Albert Einstein eut tous les courages, sauf un, celui de s’occuper de sa femme et de ses enfants, notamment de son fils cadet, Eduard, déclaré fou. Il ne se sentait en rien responsable de son état psychique ; car, comme le rapporte Laurent Seksik, pour le grand homme, « il est des problèmes auxquels on ne peut rien. On ne peut blâmer ni soi ni personne. [Albert Einstein] range dans cette catégorie le mal qui frappe Eduard. » Après avoir passé des années en Amérique loin de son fils cadet, Albert Einstein n’hésita pas à affirmer, comme pour se donner bonne conscience, que s’il cherchait à le revoir, il ne ferait qu’aggraver son état.
Dans sa vie, Albert Einstein eut tous les courages, sauf un, celui de s’occuper de sa femme et de ses enfants, notamment de son fils cadet, Eduard, déclaré fou. Il ne se sentait en rien responsable de son état psychique ; car, comme le rapporte Laurent Seksik, pour le grand homme, « il est des problèmes auxquels on ne peut rien. On ne peut blâmer ni soi ni personne. [Albert Einstein] range dans cette catégorie le mal qui frappe Eduard. » Après avoir passé des années en Amérique loin de son fils cadet, Albert Einstein n’hésita pas à affirmer, comme pour se donner bonne conscience, que s’il cherchait à le revoir, il ne ferait qu’aggraver son état.
Einstein ordonna à sa femme de détruire
toute correspondance attestant la naissance de Lieserl
Cette histoire de famille singulière remonte au début du XXe siècle, quand Einstein fit la connaissance de Mileva Marvic, étudiante comme lui à l’Ecole polytechnique de Zürich. Il avait vingt ans, elle était un peu plus âgée que lui ; il était juif, elle était orthodoxe ; et sur le plan physique, elle était fragile et souffrait d’une infirmité : elle était boiteuse. Mais Mileva était très intelligente. Elle avait été la seule fille de sa promotion admise à l’Ecole polytechnique, et elle était également la seule fille du département de physique et de mathématiques. D’un point de vue intellectuel, elle n’avait rien à envier à Albert. Elle était tellement brillante que, selon certains, c’est elle qui, dans le couple, était le véritable génie. Pour illustrer ce propos, Laurent Seksik imagine, dans une ville de Serbie, une scène au cours de laquelle Mileva prend un taxi ; le chauffeur, apprenant son identité, lui déclare : « Allez, vous pouvez me le dire, le sieur Einstein a tout volé ! C’est vous qui avez tout inventé. La relativité et tout le tralala ! »
Albert et Mileva eurent un premier enfant, Lieserl, née en 1902. L’enfant ayant été conçue hors des liens du mariage, ils l’abandonnèrent. Elle mourut de la scarlatine peu après. Comme l’écrit Seksik, « une chape de plomb recouvrait cette disparition. » La pierre tombale de Lieserl ne comportait pas de nom, et Albert ordonna à Mileva de détruire toute correspondance attestant la naissance de l’enfant. Mais Mileva ne tint pas sa promesse, elle n’eut pas la force de brûler toutes les lettres, ce qui a permis, en 1985, de révéler l’existence de cette petite fille.
Une fois marié, le couple eut deux fils, Hans-Albert et Eduard. En 1914, Albert abandonna sa femme et ses enfants, puis se remaria avec une cousine de son ex-femme.
Le petit Eduard, dont la naissance avait été un calvaire pour sa mère, se révéla un enfant doué et précoce, qui avait lu toute la bibliothèque de son père. En 1930, il était étudiant en première année de médecine quand il fut atteint de schizophrénie. Il perdit la maîtrise de ses gestes, gifla sa mère et se mit à avoir d’étranges visions.
Dès lors Mileva consacra toute son énergie à Eduard. Elle essaya presque tout pour le guérir et n’hésita pas à lui faire prendre des risques. Elle le conduisit à Vienne dans la clinique du Dr Sakel, un médecin réputé pour pratiquer une thérapie audacieuse. Le Dr Sakel plonge ses patients dans le coma pendant trois heures ; ils perdent tout contrôle d’eux-mêmes et sont pris de spasmes ; et, après le calvaire qu’ils ont subi, « l’âme, certifie le médecin, revient apaisé. » Et il conclut : « C’est un mal pour un bien. »
Une fois installé aux Etats-Unis,
Einstein n’évoqua jamais l’existence de ses fils
De son côté, que fit Albert Einstein pour son fils cadet ? Rien, ou si peu. En 1933, alors qu’il était en partance pour l’Amérique, Albert s’arrêta à Zurich et fit ses adieux à Eduard. « Mon fils, concédait le génie du siècle, est le seul problème sans solution. » Il estimait n’être pour rien dans sa schizophrénie, la maladie provenant, selon lui, de la famille de Mileva. Une fois installé aux Etats-Unis, il n’évoqua jamais l’existence de ses fils, de crainte d’être amené à parler de la maladie du cadet, « la honte de la famille ». Il ne chercha jamais à revoir Eduard, resté en Europe. Comme l’écrit Seksik : « La seule idée de voir Eduard le terrifie lui, son propre père. »
Eduard passa l’essentiel de son existence enfermé dans un asile de Zurich. Délaissé par son père, il déclara à un journaliste : « Avoir pour père le génie du siècle ne m’a jamais servi à rien. »
Avec Le Cas Eduard Einstein, Laurent Seksik, qui est lui-même médecin, livre une étude passionnante sur la mesquinerie et les petitesses d’un grand esprit, et sur les limites, assez floues somme toute, entre la normalité et la folie.
Le Cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik, 2013, éditions Flammarion (épuisé) et collection J’ai lu.
09:03 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : le cas eduard einstein, einstein, laurent seksik | Lien permanent | Commentaires (0)
04/09/2017
Avril brisé, de Kadaré
Vendetta albanaise
Avril brisé
Un écrivain de Tirana emmène sa jeune épouse en voyage de noces dans les montagnes, afin de lui faire découvrir la pratique de la vendetta. Lui-même s’extasie devant la perpétuation de cette coutume sanglante qui excite son imagination de romancier, tandis que sa femme est horrifiée du nombre de morts que cela entraîne. Kadaré présente une Albanie hors du temps, qui fascine le lecteur.
Jusqu’à la chute du communisme, l’Albanie fut un pays à part, dont on ne savait pas grand-chose. Il avait la particularité de ne plus appartenir au bloc soviétique, depuis sa rupture avec l’URSS. Dénonçant toute évolution du dogme communiste, l’Albanie était alors le seul pays d’Europe à prétendre rester fidèle au stalinisme. Peu d’informations filtraient et parvenaient jusqu’à l’Ouest. Cependant, depuis la publication du Général de l’armée morte en 1969, le nom d’Ismaïl Kadaré était devenu familier des lecteurs occidentaux. Dans ces années-là, Kadaré, tout en étant surveillé, était honoré dans son pays. Il était l’auteur officiel du régime, membre de l’Union officielle des écrivains albanais et député au parlement de Tirana. Ses livres avaient la particularité d’arriver en France déjà traduits, ce qui est le cas d’Avril brisé, publié en 1982.
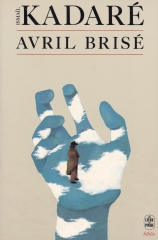 L’histoire se passe entre les deux guerres mondiales, pendant la courte période de la monarchie, sous le règne de Zog Ier. Malgré ces précisions historiques données par l’auteur, l’Albanie apparaît, sous sa plume, comme un pays hors du temps. Dans les régions montagneuses, ainsi que le découvre le lecteur, la vendetta reste couramment pratiquée. Mais elle obéit à des règles très strictes, codifiées dans un recueil appelé le Kanun.
L’histoire se passe entre les deux guerres mondiales, pendant la courte période de la monarchie, sous le règne de Zog Ier. Malgré ces précisions historiques données par l’auteur, l’Albanie apparaît, sous sa plume, comme un pays hors du temps. Dans les régions montagneuses, ainsi que le découvre le lecteur, la vendetta reste couramment pratiquée. Mais elle obéit à des règles très strictes, codifiées dans un recueil appelé le Kanun.
Gjorg des Berisha, un garçon de vingt-six ans, tue d’un coup de fusil un membre de la famille des Kryeqyqe ; il le fait, non par plaisir, mais par obligation. Tout a commencé, alors qu’il n’était même pas né, soixante-dix ans plus tôt : un soir, un voyageur inconnu fut hébergé par sa famille, puis, au petit matin, alors qu’il sortait de la maison des Berisha pour reprendre sa route, il fut tué par un Kryeqyqe ; c’était là une grave atteinte aux lois de l’hospitalité ; or le Kanun imposait aux Berisha de venger leur hôte ; c’est ainsi que la famille de Gjorg, jusqu’alors tranquille, fut prise dans le « grand mécanisme de la vendetta » et que « quarante-quatre tombes avaient été creusées depuis ».
Le Kanun est une véritable constitution de la mort
Pendant que Gjorg cherche à échapper à son tueur, Diane, une jeune femme venue de la ville, accomplit son voyage de noces dans le Rrafsh, le haut-plateau du nord. Son mari, un écrivain de Tirana du nom de Bessian Vorpsi, veut lui faire découvrir les particularités de la région. Le couple a été invité à séjourner chez le prince du sang, un notable qui recueille l’impôt dit du sang, dont doit s’acquitter auprès de lui tout meurtrier. Le versement de cet impôt doit suivre immédiatement l’homicide. Bessian Vorpsi est très fier de la persistance de ce droit coutumier, qu’il qualifie de « véritable constitution de la mort ». Il s’extasie devant la beauté du Kanun, qui excite son imagination de romancier. Face à sa jeune épouse, il déborde d’enthousiasme : « Le Rrafsh est la seule région d’Europe qui, tout en étant partie intégrante d’un Etat moderne, […] a rejeté les lois, les structures juridiques, la police, les tribunaux, bref tous les organismes d’un Etat ; qui les a rejetés, tu m’entends, car il y a été soumis une fois et il les a reniés pour les remplacer par d’autres règles morales qui sont tout aussi complètes, au point de contraindre les administrations des Etats étrangers, puis plus tard l’administration de l’Etat albanais indépendant, à les reconnaître et à laisser ainsi le plateau, soit près de la moitié du royaume, en dehors du contrôle de l’Etat. »
Dans son voyage, Bessian et Diane croisent Ali Binak, le grand exégète du Kanun, qui va de village en village régler les litiges entre les familles. Dans un cas de viol qui lui est soumis, c’est lui qui dira si la famille de la jeune fille est en droit de reprendre un sang. Le couple croise également Gjorg ; quand Diane apprend que, vraisemblablement, le jeune homme ne passera probablement pas le mois d’avril, elle est émue et s’en inquiète à voix haute. Son mari lui répond alors : « La fameuse formule que les vivants ne sont que des morts en permission dans cette vie trouve dans nos montagnes sa pleine signification. » Mais quand il mesure l’effroi provoqué chez sa femme par une telle coutume sanglante, Bessian, tel Hamlet, se met à douter.
Le lecteur est pris de sentiments contradictoires,
il est partagé entre l’effroi et la fascination
La mort est omniprésente dans ce roman qui peut paraître étrange à un lecteur occidental, tant les mœurs décrites paraissent appartenir à un autre monde, à un autre temps. Les personnages ne mettent pas le confort matériel et l’accumulation de biens au centre de leur existence, mais sont préoccupés par les questions d’honneur, quitte à mettre en jeu leur vie. Malgré son jeune âge, Gjorg des Berisha sait qu’il est condamné à très brève échéance par les Kryeqyqe, depuis qu’il leur a repris une vie. Mais au moins sait-il qu’il mourra en ayant accompli son devoir ; car, dans ce pays, il est souhaitable de mourir du fusil. Kadaré précise : « La mort naturelle, de maladie ou de vieillesse, était donc honteuse pour l’homme des hautes régions, et le seul but du montagnard dans sa vie était d’accumuler le capital d’honneur qui lui permettrait de voir ériger un petit monument à sa mort. »
Le lecteur est partagé entre des sentiments contradictoires. D’un côté il s’identifie sans mal à Diane et, comme elle, il trouve effroyables ces rites ancestraux ; mais d’un autre côté, comme Bessian, il ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine fascination devant une telle pratique.
On peut supposer que cette contradiction se retrouve chez Kadaré : si lui-même, il n’était pas quelque peu fasciné par la vendetta, jamais il n’aurait pu écrire un tel roman ; et, en même temps, il est conscient qu’il y a quelque chose de malsain dans son exaltation. Vers la fin du roman, un médecin interpelle Bessian et lui fait la leçon : « Vos livres, votre art sentent le crime. Au lieu de faire quelque chose pour les malheureux montagnards, vous assistez à la mort, vous cherchez des motifs exaltants, vous recherchez de la beauté pour alimenter votre art. Vous ne voyez pas que c’est une beauté qui tue, comme l’a dit un jeune écrivain que vous n’aimez sûrement pas. » Ce « jeune écrivain », c’est probablement Kadaré qui se cite lui-même, comme pour se remettre les idées en place et se rappeler que l’écrivain a une responsabilité morale dans la société.
Avril brisé, d’Ismaïl Kadaré, 1982, collection Le Livre de poche.
10:15 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : avril brisé, kadaré | Lien permanent | Commentaires (0)


