10/03/2014
Les Caves du Vatican, de Gide
Gide théorise l’acte gratuit
Les Caves du Vatican
Les Caves du Vatican est un bien curieux roman. Certains des personnages et des situations sont ridicules. Et surtout, Gide nous fait assister à un crime gratuit. Un jeune homme va pousser un voyageur hors d’un train en marche, sans mobile apparent. L’acte est horrible, mais le lecteur a bien du mal à prendre tout cela au sérieux.
En 1890, sous le pontificat de Léon XIII, Anthime Armand-Dubois vient à Rome soigner une maladie rhumatismale qui le fait horriblement souffrir de la jambe. Anthime est un grand scientifique ; franc-maçon et athée, il ricane de sa femme et de sa belle famille qui aimerait tant le voir se convertir au catholicisme. Mais une nuit, Anthime se lève de son lit et se met spontanément à genoux pour prier. Il se relève et, miracle, sa jambe est guérie. Anthime est touchée par la grâce et attribue sa guérison à l’intercession de la Vierge. Sa conversion devient un événement majeur que l’Eglise s’empresse de médiatiser.
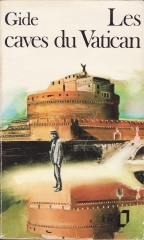 Parallèlement, le beau-frère d’Anthime, Julius de Baraglioul, grand écrivain catholique, publie un nouveau livre, L’Air des cimes, inspiré de la vie de son père, un ancien diplomate. Julius espère que cet ouvrage va le propulser à l’Académie française. En attendant, il rend visite à son père, mourant, qui lui demande un dernier service : savoir ce qu’est devenu un nommé Lafcadio Wluiki, aujourd’hui âgé de 19 ans et vivant à Paris. Julius comprend assez vite qu’il s’agit d’un enfant naturel que son père a eu alors qu’il était en poste à l’étranger.
Parallèlement, le beau-frère d’Anthime, Julius de Baraglioul, grand écrivain catholique, publie un nouveau livre, L’Air des cimes, inspiré de la vie de son père, un ancien diplomate. Julius espère que cet ouvrage va le propulser à l’Académie française. En attendant, il rend visite à son père, mourant, qui lui demande un dernier service : savoir ce qu’est devenu un nommé Lafcadio Wluiki, aujourd’hui âgé de 19 ans et vivant à Paris. Julius comprend assez vite qu’il s’agit d’un enfant naturel que son père a eu alors qu’il était en poste à l’étranger.
Une troisième intrigue vient se greffer au reste : la comtesse de Saint-Prix, sœur puinée de Julius, reçoit la visite d’un mystérieux prêtre : l’abbé de Salus, chanoine de Virmontal. L’homme d’Eglise s’entretient avec la comtesse et lui révèle un terrible secret concernant Sa Sainteté le pape.
Le lecteur, complice passif du crime
Les Caves du Vatican est célèbre pour la théorie de l’acte gratuit qu’y développe Gide. Dans l’une de ces mises en abyme qu’il affectionne, Gide fait parler Julius de Braglioul. Le grand écrivain a l’intuition d’un nouveau roman, à rebours de tous ses précédentes œuvres remplies de bons sentiments. Dans son prochain livre, le héros commettra un crime gratuit. Julius s’explique : « Il s’agit d’un jeune homme, dont je veux faire un criminel […]. Je ne veux pas de motif au crime […]. Oui ; je prétends l’amener à commettre gratuitement le crime ; à désirer commettre un crime parfaitement immotivé. […] Prenons-le tout adolescent : je veux qu’à ceci se reconnaisse l’élégance de sa nature, qu’il agisse surtout par jeu. » Et Julius précise que c’est le mobile du crime qui permet souvent de démasquer le coupable. Mais là, le criminel sera d’autant plus habile et difficile à trouver, qu’il aura commis son crime sans que rien ne le motive.
Gide met sa théorie en pratique et nous fait assister à un crime gratuit. C’est le jeune Lafcadio qui va le commettre. Dans le train Romes-Naples, il partage un compartiment avec un être ventripotent, transpirant de sueur, et franchement ridicule. Lafcadio, sans aucune raison, va le projeter hors du train en marche, rien que pour la beauté du geste.
Le pire, c’est que Gide fait du lecteur un complice passif du meurtrier. La victime était un personnage si répugnant par sa bêtise, qu’à vrai dire nous n’éprouvons aucun regret à le voir disparaître de l’histoire. Dans les pages précédentes, nous avions dû suivre, dans une chambre d’hôtel de Rome, son combat contre les punaises et les moustiques. Le lecteur ne peut éprouver qu’un lâche soulagement une fois qu’il est enfin débarrassé de ce personnage grotesque et encombrant.
Les Caves du Vatican, comme une partie de l’œuvre de Gide, est un bien curieux roman. Contrairement aux canons établis par Flaubert, Gide n’hésite pas à intervenir dans l’histoire et donne son sentiment personnel sur le comportement de tel ou tel personnage ; et, comme s’il voulait pasticher Balzac, il donne des détails très précis sur leur généalogie. Par exemple Gide nous fait savoir que, dans Baraglioul, « le gl se prononce en l mouillé, à l’italienne. » Lorsqu’il raconte la scène du crime gratuit, Gide se lâche en multipliant les rebondissements et les coïncidences dignes d’un roman-feuilleton dans le style d’Arsène Lupin. Plus profondément, en nous présentant la théorie de l’acte gratuit, Gide prend le contrepied de Dostoïevski dans Crime et châtiment. Lafcadio est l’anti-Raskolnikov. Il n’éprouve ni regret ni remord.
Les Caves du Vatican, d’André Gide (1914), collection Folio.
09:10 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XXe, XXIe siècles | Tags : les caves du vatican, gide, vatican | Lien permanent | Commentaires (0)
20/01/2014
La Peur, de Stefan Zweig
Histoire de la femme adultère
La Peur
Cette nouvelle, qui se lit presque d’une traite, est une œuvre de jeunesse de Stefan Zweig. A Vienne, l’épouse d’un grand avocat trompe son mari avec un pianiste. Un jour, elle est surprise par l’amie du musicien qui va se transformer en maître-chanteuse. La peur envahit la femme adultère.
La Peur est l’une des nombreuses nouvelles de Stefan Zweig. Elle est facile à lire et se dévore presque d’une traite. Comme d’habitude, l’auteur fait preuve d’une économie de moyens : il n’y a ni lourdeur ni longueur, la construction du récit étant très rigoureuse. Tout est concentré, ce qui donne à l’histoire toute son efficacité. La Peur a été écrite en 1913, c’est une œuvre de jeunesse de Zweig que l’on peut qualifier de balzacienne. L’auteur nous décrit avec minutie les ravages de la peur qui envahit une épouse infidèle, issue de la bonne société.
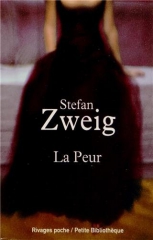 A Vienne, dans les années 1900, madame Irene Wagner, épouse d’un grand avocat, vit une aventure avec un pianiste de renom. Au sortir d’un rendez-vous avec son amant, elle est surprise par l’amie du musicien, une femme de basse extraction, qui l’accuse de lui avoir volé son homme. Aussitôt, madame Wagner ressent une montée d’adrénaline qui a pour effet d’imprimer le visage de cette femme-là dans son cerveau : « l’horreur de ce souvenir […] restait fiché dans son cerveau comme un hameçon ». Elle va être victime d’un chantage, sous la menace que sa liaison soit révélée à son mari. Elle sait bien qu’il ne faut jamais céder à un maître-chanteur, mais sous le coup de l’émotion elle perd ses moyens. La peur s’empare de tout son être, avec toute une série de symptômes qui l’accompagnent : nervosité, spasmes, émotions exacerbées, sommeil perturbé, mauvais rêves, crises d’hystérie…
A Vienne, dans les années 1900, madame Irene Wagner, épouse d’un grand avocat, vit une aventure avec un pianiste de renom. Au sortir d’un rendez-vous avec son amant, elle est surprise par l’amie du musicien, une femme de basse extraction, qui l’accuse de lui avoir volé son homme. Aussitôt, madame Wagner ressent une montée d’adrénaline qui a pour effet d’imprimer le visage de cette femme-là dans son cerveau : « l’horreur de ce souvenir […] restait fiché dans son cerveau comme un hameçon ». Elle va être victime d’un chantage, sous la menace que sa liaison soit révélée à son mari. Elle sait bien qu’il ne faut jamais céder à un maître-chanteur, mais sous le coup de l’émotion elle perd ses moyens. La peur s’empare de tout son être, avec toute une série de symptômes qui l’accompagnent : nervosité, spasmes, émotions exacerbées, sommeil perturbé, mauvais rêves, crises d’hystérie…
Irene ne connait pas son mari
Madame Wagner ne sait quelle attitude adopter face à son mari. Elle aimerait lui avouer la vérité, lui dire qu’elle l’a trompé et qu’aujourd’hui une odieuse femme la fait chanter, mais elle n’ose pas franchir le pas. Son mari lui paraît plein de bonté et de sagesse. Elle se souvient qu’un soir il était rentré à la maison en déclarant « Aujourd’hui, on a condamné un innocent ». Et Zweig de poursuivre, comme si les idées de l’avocat reflétaient les siennes : « Un voleur venait d’être condamné pour un larcin commis trois ans auparavant, et à tort selon lui, car après trois années ce crime n’était plus le sien. On condamnait quelqu’un qui était devenu autre et on le punissait doublement car il avait passé trois ans dans la prison de sa propre peur, dans l’inquiétude permanente d’être découvert. » Le mari de madame Wagner est un homme d’une grande humanité dans sa vie professionnelle, mais montrera-t-il la même compassion face à une affaire d’adultère dans laquelle sa femme est coupable ? C’est alors que madame Wagner prend conscience qu’après huit ans de mariage et d’intimité partagée, elle ne connait pas vraiment son mari et se sent incapable de prévoir sa réaction.
Envahie par la peur, craignant de croiser sa maître-chanteuse dans la rue si elle met le nez dehors, madame Wagner décide de se cloître dans son appartement. Mais, faisant ainsi, privée de toute relation sociale, elle perd sa raison de vivre, car dans son milieu on n’existe que par rapport aux autres : « Irene appartenait à cette élégante bourgeoisie viennoise dont l’emploi du temps semble régi par un accord tacite qui fait que tous les membres de cette alliance invisible se retrouvent toujours aux mêmes heures à s’intéresser aux mêmes choses, au point que s’observer mutuellement et se rencontrer étaient peu à peu devenu le sens de leur existence. » Livrée à elle-même, rongée par la peur et confrontée au vide de son existence, madame Wagner se dirige vers la solution du suicide.
Les lecteurs de Zweig sont habitués à ce que ses histoires terminent mal, tant le pessimisme est présent dans son œuvre ; en sera-t-il de même cette fois ?
La Peur, de Stefan Zweig (1913), collections Rivages Poche / Petite Bibliothèque.
09:15 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la peur, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)
25/11/2013
Le Désert des Tartares, de Dino Buzzati
Le soldat et la mort
Le Désert des Tartares
L'histoire racontée dans ce livre est maintenant bien connue : affecté dans un fort lointain, un soldat attend l’ennemi qui le fera héros. Au-delà, Dino Buzzati nous propose une réflexion sur la vie et sur la mort.
C’est un livre captivant, bien qu’il ne contienne quasiment pas d’action. Il est peu épais et rythmé par des chapitres courts. Le Désert des Tartares nous apporte en premier lieu le dépaysement. L’histoire se déroule dans un pays imaginaire, le royaume du Nord. Le jeune lieutenant Drogo reçoit sa première affectation : le fort Bastiani. Bien que le roi Pietro III ait déclaré le fort Bastiani sentinelle avancée de sa couronne, nous nous apercevons vite de son isolement. Le lieu est aux confins du royaume, dans une zone montagneuse, coincé entre la lointaine ville et le désert des Tartares, d’où l’ennemi peut surgir à tout moment. Mais, comme nulle armée ne s’est montrée depuis des années, plus personne ne croit à la menace.
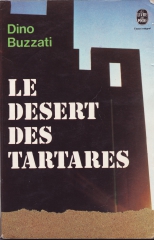 Dans un premier temps, Drogo n’a qu’une idée en tête, quitter le fort où il a été affecté contre son gré. Mais, au bout de quatre mois, quand la possibilité de départ s’offre à lui, il préfère rester, non par héroïsme, mais parce qu’il a pris ses habitudes : il est devenu prisonnier de la routine du fort et reste par facilité. Et pourtant, que la vie y est étriquée, régie par le règlement jusqu’à l’absurdité. Un soir, un soldat de la garnison qui avait manqué à l’appel se présente aux portes du fort. La sentinelle croit reconnaître un camarade, ce qui ne l’empêche pas de tirer sur lui après les sommations d’usage, ainsi que le règlement l’exige. Le soldat s’effondre, touché à mort. Le sous-officier de semaine est catastrophé, non parce qu’un homme est mort, mais parce qu’il risque d’être sanctionné pour cette bavure. Quant au commandant, il se réjouit de ce que la sentinelle ait fait mouche du premier coup malgré l’obscurité.
Dans un premier temps, Drogo n’a qu’une idée en tête, quitter le fort où il a été affecté contre son gré. Mais, au bout de quatre mois, quand la possibilité de départ s’offre à lui, il préfère rester, non par héroïsme, mais parce qu’il a pris ses habitudes : il est devenu prisonnier de la routine du fort et reste par facilité. Et pourtant, que la vie y est étriquée, régie par le règlement jusqu’à l’absurdité. Un soir, un soldat de la garnison qui avait manqué à l’appel se présente aux portes du fort. La sentinelle croit reconnaître un camarade, ce qui ne l’empêche pas de tirer sur lui après les sommations d’usage, ainsi que le règlement l’exige. Le soldat s’effondre, touché à mort. Le sous-officier de semaine est catastrophé, non parce qu’un homme est mort, mais parce qu’il risque d’être sanctionné pour cette bavure. Quant au commandant, il se réjouit de ce que la sentinelle ait fait mouche du premier coup malgré l’obscurité.
En attendant l’arrivée bien improbable de l’ennemi, le lieutenant Drogo mène la vie de caserne sans s’apercevoir qu’il y laisse sa jeunesse et, nous lecteur, nous comprenons alors que Dino Buzzati nous propose une réflexion sur la vie et la mort. Le fort est situé entre la ville et le désert : la ville, avec son animation, représente la vie ; tandis que le désert, dans son immense solitude et avec la menace ennemie, représente la mort, dont nul ne sait ni le jour ni l’heure. Usant d’une image, Buzzati nous montre d’abord Drogo dans l’insouciance de la jeunesse, cheminant placidement sur la route de la vie sous un soleil resplendissant ; du seuil de leurs maisons, les grandes personnes lui font des signes amicaux et lui montrent l’horizon avec des sourires complices. Puis, à mesure que Drogo vieillit, le soleil se déplace et se fait plus pâle, tandis que des portes se ferment derrière lui ; aux fenêtres il n’aperçoit plus que des visages immobiles et indifférents. Quand, après quatre ans passés au fort, Drogo retourne en ville pour sa première permission, il retrouve sa mère et ses proches. Mais il se rend compte amèrement que plus rien n’est comme avant. Certes, sa mère est toujours là et sa chambre d’enfant est restée intacte. Mais, après avoir été éloigné de ses proches pendant quatre ans, il comprend que sa route s’est écartée de la leur. Les personnes qui lui étaient familières sont maintenant comme des étrangers pour lui. Il ne reste plus à Drogo qu’à retourner au fort en espérant une attaque ennemie qui lui permette une action héroïque, car, comme le fait remarquer un officier : « Nous désirons la guerre, nous attendons l’occasion favorable, nous crions à la malchance parce qu’il n’arrive jamais rien ». Au fort Bastiani Drogo attendra que son destin s’accomplisse.
PS : Le Désert des Tartares a inspiré à Jacques Brel la chanson Zangra.
Le Désert des Tartares de Dino Buzzati (1949), collection Le Livre de poche (épuisé) et Press Pocket.
09:20 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : le désert des tartares, buzzati | Lien permanent | Commentaires (1)


