12/06/2017
Les Racines du ciel, de Romain Gary
Le premier roman écologique
Les Racines du ciel
Le héros de ce roman écologique, un Français nommé Morel, fait circuler en Afrique une pétition réclamant l’interdiction de la chasse aux éléphants. Qualifié de farfelu, il entre dans la clandestinité et s’allie à un chef africain qui se bat pour l’indépendance de son peuple. Romain Gary lance un appel à la protection de la nature, il dénonce l’utilitarisme de la société moderne et prend la défense des éléphants, qu’il juge indispensables à la beauté de la vie.
Publiées en 1956, Les Racines du ciel furent couronnées du prix Goncourt. Des années plus tard, il apparut que Romain Gary avait écrit là le premier roman écologique. Le mot écologie est utilisé à plusieurs reprises dans le livre, pour souligner que bien des personnages ne l’avaient jamais entendu auparavant.
Le titre Les Racine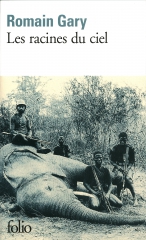 s du ciel reprend une expression empruntée à l’islam : lesdites racines sont celles plantées par le ciel au cœur de l’homme, la première d’entre elles étant la liberté. Or, en AEF (Afrique équatoriale française), au nom de la liberté, un individu du nom de Morel se bat pour la sauvegarde des éléphants, espèce menacée d’extinction. Trente mille d’entre eux seraient tués chaque année par des chasseurs, « pour fournir, écrit Gary, des boules de billard et des coupe-papier » aux Occidentaux. Morel, un idéaliste, fait circuler une pétition réclamant l’interdiction de la chasse à l’éléphant. Certains acceptent de la signer, d’autres s’y refusent ; et d’autres encore se montrent hésitants, tel le père Fargue, un franciscain, qui fait observer à propos de la pétition : « On n’avait pas l’impression de signer pour les éléphants, mais contre les hommes. »
s du ciel reprend une expression empruntée à l’islam : lesdites racines sont celles plantées par le ciel au cœur de l’homme, la première d’entre elles étant la liberté. Or, en AEF (Afrique équatoriale française), au nom de la liberté, un individu du nom de Morel se bat pour la sauvegarde des éléphants, espèce menacée d’extinction. Trente mille d’entre eux seraient tués chaque année par des chasseurs, « pour fournir, écrit Gary, des boules de billard et des coupe-papier » aux Occidentaux. Morel, un idéaliste, fait circuler une pétition réclamant l’interdiction de la chasse à l’éléphant. Certains acceptent de la signer, d’autres s’y refusent ; et d’autres encore se montrent hésitants, tel le père Fargue, un franciscain, qui fait observer à propos de la pétition : « On n’avait pas l’impression de signer pour les éléphants, mais contre les hommes. »
Après tout, si l’on y réfléchit, à quoi un éléphant vivant sert-il ? A rien, il n’est d’aucune utilité. Précisément, le combat de Morel pour les éléphants, c’est un combat contre l’utilitarisme de la société, et ce au nom de la liberté. L’un des soutiens de Morel déclare qu’il s’agit tout simplement de « respecter la nature, la liberté vivante, sans aucun rendement, sans utilité, sans autre objet que de se laisser entrevoir de temps en temps. » Une partie de la presse française relaie le combat de Morel en écrivant : « Les éléphants sont maladroits, encombrants, anachroniques, menacés de toutes parts, et pourtant indispensables à la beauté de la vie. »
Sur le terrain, en Afrique, Morel apparaît bien isolé, la plupart des colons le prenant pour un farfelu. Même les indigènes, dont Romain Gary pressent qu’ils vont tantôt accéder à l’indépendance, ne sont pas sensibles à ses idées. Un colonel britannique déclare à propos des Africains : « La seule chose que les indigènes voient dans un éléphant, c’est la viande. […] Quant à la beauté de l’éléphant, sa noblesse, sa dignité, et cetera, ce sont des idées entièrement européennes comme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. »
Gary, compagnon de la Libération,
n’hésite pas à enrôler de Gaulle
dans le combat pour la défense des éléphants
Malgré tout, Morel réussit à gagner à sa cause le chef Waïtari, ancien député des Oulés. Couvert d’un képi cinq étoiles, Waïtari se bat pour l’indépendance de l’Afrique et se rêve en chef incontesté de la « future fédération africaine de Suez au Cap », tant son ambition est forte. Bien qu’il soit indifférent au sort des animaux, il rallie Morel et entre avec lui dans la clandestinité, parce qu’il voit dans la cause des éléphants l’« instrument de propagande rêvé ». Risquer la prison ne lui fait pas peur, car, dit-il, « aujourd’hui, les prisons coloniales sont les antichambres des ministères. » Morel n’est pas dupe des intentions politiques de Waïtari, il se veut lucide et a fait le calcul suivant : « Si les autorités se persuadent que la protection des éléphants est un prétexte à une action politique, alors elles seront tentées de réagir et d’interdire la chasse d’éléphants, afin d’enlever aux "rebelles" tout motif d’agitation. » Ainsi, en s’alliant à Waïtari qui poursuit un autre but que lui, Morel espère bien atteindre le but que, pour sa part, il s’est fixé.
Dans ce livre les personnages sont très nombreux, tous masculins, sauf Minna, une jeune Allemande, violée par les Russes en 1945, et qui suit Morel par « amour de la nature ». Certains protagonistes semblent directement inspirés de personnalités de l’époque. Ainsi il est fait mention d’« un écrivain américain qui vient régulièrement en Afrique pour abattre sa ration d’éléphants, de lions, de rhinos » : on pense immédiatement à Hemingway. Et surtout le personnage du père Tassin, un jésuite, est la copie presque conforme du père Teilhard de Chardin. Comme ce dernier, Tassin est paléontologue et a la « réputation de s’intéresser beaucoup plus aux origines scientifiques de l’homme qu’à son âme. » Pour le personnage de Morel, Romain Gary indiqua plus tard, dans son livre La Promesse de l’aube, s’être inspiré d’un sergent nommé Dufour, dont il avait la connaissance lors de la débâcle de juin 1940, et qu’il qualifie d’ « homme qui ne savait pas désespérer ».
Comme le sergent Dufour et comme Gary lui-même, Morel a rallié la France Libre dès 1940. Dans son périple africain il porte, épinglée à sa chemise, une petite croix de Lorraine. Le compagnon de la Libération qu’est Gary n’hésite pas à enrôler de Gaulle dans son combat en proclamant que lui aussi est « un homme qui croyait aux éléphants. »
L’un des passages les plus marquants du livre est autobiographique. A un moment, un avion survole en rase-mottes un troupeau d’éléphants contre lequel il finit par s’écraser, tuant plusieurs de ces bêtes. Gary a vécu un tel accident pendant la guerre, qu’il raconte également dans La Promesse de l’aube.
Les Racines du ciel sont un livre dense, touffu, voire boursouflé. Gary n’hésite pas à se répéter au fil des pages et son récit n’est ni linéaire ni chronologique, ce qui peut compliquer la lecture. On peut être a priori indifférent à son appel à la protection de la nature et trouver son message vaguement panthéiste. Néanmoins, les personnages créés par l’auteur sont attachants ; peu à peu il réussit à gagner la sympathie du lecteur et à lui faire épouser la cause des éléphants.
Les Racines du ciel, de Romain Gary, 1956, collection Folio.
10:18 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : les racines du ciel, romain gary | Lien permanent | Commentaires (0)
22/05/2017
La Porte étroite, de Gide
Le piège de la vertu
La Porte étroite
Une jeune fille s’efforce de mettre en pratique les paroles du Christ en plaçant la vertu au centre de sa vie. Elle se réfugie dans l’exaltation, oublie les joies terrestres, fait languir son fiancé et finit par se dessécher. Dans La Porte étroite, Gide met en garde contre l’héroïsme inutile, qui constitue un dévoiement du christianisme.
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite », telles sont les paroles du Christ, rapportées par saint Luc, qui servent de base au récit de Gide. Un jour, au temple, le narrateur, Jérôme Palissier, qui appartient à une famille de la bourgeoisie protestante, entend son oncle pasteur commenter ce verset à l’occasion de son prêche dominical. Selon lui, la multitude des hommes prend un chemin spacieux et une porte large qui mènent à la perdition, alors que, enseigne le Christ, « étroite est la porte et resserrée est le chemin qui conduisent à la Vie, et il en est peu qui la trouvent. » Ces dernières paroles raisonnent dans les oreilles de Jérôme, alors âgé de quatorze ans. Il décide qu’il sera parmi les rares élus qui passent par la porte étroite.
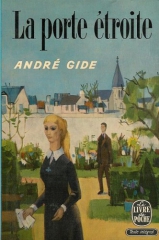 Jérôme aime sa cousine Alissa Bucolin, âgée de seize ans. Or cette fille est un être exigeant, qui elle-même recherche la vertu. Jérôme la compare à cette « perle de grand prix » dont parle l’Evangile. Elle pourrait être celle qui lui montre la route pour aller vers Dieu. C’est ainsi que, quand Jérôme passe la porte de la chambre d’Alissa, il y voit la porte étroite évoquée par saint Luc. Mais le comportement du garçon est-il pur ? Compte-t-il vraiment sur Alissa pour aller vers Dieu, ou ne prétend-il pas chercher Dieu afin de cheminer avec Alissa ?
Jérôme aime sa cousine Alissa Bucolin, âgée de seize ans. Or cette fille est un être exigeant, qui elle-même recherche la vertu. Jérôme la compare à cette « perle de grand prix » dont parle l’Evangile. Elle pourrait être celle qui lui montre la route pour aller vers Dieu. C’est ainsi que, quand Jérôme passe la porte de la chambre d’Alissa, il y voit la porte étroite évoquée par saint Luc. Mais le comportement du garçon est-il pur ? Compte-t-il vraiment sur Alissa pour aller vers Dieu, ou ne prétend-il pas chercher Dieu afin de cheminer avec Alissa ?
Jérôme entrevoit un « immense bonheur » dans la vie commune qu’il pourrait mener avec la jeune fille, mais il n’ose pas lui faire de demande tant que les conditions optimales ne sont pas réunies.
Les années passent, et, à chaque fois que Jérôme fait un pas en direction d’Alissa, celle-ci trouve un prétexte pour se dérober. Dans un premier temps, elle le fait lanterner en lui faisant comprendre que le « contentement plein de délices » qu’il lui propose n’est pas suffisant. Puis, au fil des pages, elle dévoile sa véritable nature.
Gide reprend à son compte
la mise en garde de Bossuet au Grand Dauphin
En vérité, Alissa se complaît dans la recherche de la vertu. Un jour, dans une lettre, elle s’en explique à Jérôme et lui écrit que ce n’est pas le bonheur qu’elle souhaite, mais l’« acheminement vers le bonheur ». Cette fille est tellement éprise de pureté qu’elle ne veut surtout pas pratiquer la vertu dans la perspective d’obtenir la « félicité », car cela voudrait dire, précise-t-elle, qu’elle pratique la vertu pour la récompense qu’elle en espère. Elle écarte toute espèce de troc qui la verrait échanger la sainteté sur terre contre la félicité dans le ciel. Elle le déclare à Jérôme : « C’est par noblesse naturelle, non par espoir de récompense, que l’âme éprise de Dieu va s’enfoncer dans la vertu. »
Alissa s’enferme dans le mysticisme et l’exaltation. Elle finit par repousser Jérôme au motif que la route enseignée par le Seigneur est une route « étroite à n’y pouvoir marcher deux de front. » Dans son esprit de mortification, elle se prive de toute joie et de tout plaisir terrestres, et finit par se dessécher. Son rêve, dit-elle, est « monté si haut que tout contentement humain l’eût fait déchoir. »
Alissa est tombée dans le « piège de la vertu » et entend y faire tomber à son tour Jérôme, qui reste sans défense. Elle pratique la vertu uniquement pour y trouver une forme de noblesse, sans se soucier de savoir si cet héroïsme exalté aidera son prochain. Sa vertu est complètement stérile.
Après la publication de La Porte étroite, Gide qualifia l’héroïsme d’Alissa d’« absolument inutile ». Il rappela que Bossuet, dans ses leçons au Grand Dauphin, le mettait en garde contre ces « penchants de l’âme » et ces « maximes de faux bonheur, qui ont fait périr tant de monde parmi nous… » Gide reprit à son compte cet avertissement et conclut qu’il gardait toute sa valeur, son roman servant d’illustration à la leçon de Bossuet.
Comme dans La Symphonie pastorale, Gide met en garde, non contre la religion elle-même, mais contre une interprétation personnelle et dévoyée de ses préceptes.
La Porte étroite, d’André Gide, 1909, collections Le Livre de Poche (épuisé) et Folio.
08:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XXe, XXIe siècles | Tags : la porte étroite, gide | Lien permanent | Commentaires (0)
24/04/2017
La Malédiction d'Edgar, de Marc Dugain
Hoover : la fin d’un mythe
La Malédiction d’Edgar
Marc Dugain brise une légende. Selon lui, contrairement à ce que l’on a longtemps cru, Edgar Hoover, fondateur du FBI, n’était pas un policier modèle. C’était un être complexe, obsédé par les valeurs morales, ce qui le conduisit à commettre les pires turpitudes. Au lieu de combattre le crime organisé, il préférait surveiller les prétendus ennemis de l’Amérique et constituer des dossiers compromettants pour tenir en ses mains le Tout-Washington.
Edgar Hoover fonda le FBI en 1924, et le dirigea jusqu’à sa mort. De son vivant, il fut présenté comme un policier modèle et un modèle de policier. Aujourd’hui, depuis que certains faits ont été révélés, la réalité apparaît toute autre. Au lieu de combattre le crime organisé, Hoover préféra s’attaquer aux prétendus ennemis de l’Amérique. Il pourchassa les communistes et mit sous écoute des personnalités comme Martin Luther King, qui, à ses yeux, représentaient pour les Etats-Unis un danger plus important que la Mafia. D’une manière générale, Hoover mit à profit ses fonctions pour se constituer des dossiers compromettants sur l’ensemble des hommes politiques de l’époque, ce qui lui permettait de tenir en ses mains le Tout-Washington.
Plutôt qu e d’écrire une biographie, Marc Dugain a imaginé ce qu’eussent pu être les souvenirs personnels de Clyde Tolson, qui fut, pendant quarante ans, l’adjoint de Hoover, et même plus que son adjoint. Dans ses mémoires apocryphes, Tolson fait pénétrer le lecteur dans l’intimité d’Edgar, un homme profondément solitaire, qui considérait son adjoint comme le seul membre de sa famille. Hoover n’était ni svelte ni gracieux, il avait un physique ingrat et ne s’aimait pas. « J’ai toujours une tête de gros et un cou de vieux taureau », confia-t-il à Clyde. Edgar avait fait don de sa personne au Bureau et n’aima qu’une seule femme, Annie Hoover, sa mère.
e d’écrire une biographie, Marc Dugain a imaginé ce qu’eussent pu être les souvenirs personnels de Clyde Tolson, qui fut, pendant quarante ans, l’adjoint de Hoover, et même plus que son adjoint. Dans ses mémoires apocryphes, Tolson fait pénétrer le lecteur dans l’intimité d’Edgar, un homme profondément solitaire, qui considérait son adjoint comme le seul membre de sa famille. Hoover n’était ni svelte ni gracieux, il avait un physique ingrat et ne s’aimait pas. « J’ai toujours une tête de gros et un cou de vieux taureau », confia-t-il à Clyde. Edgar avait fait don de sa personne au Bureau et n’aima qu’une seule femme, Annie Hoover, sa mère.
Il se sentait investi d’une mission première, celle de sauvegarder l’Amérique des êtres subversifs et des personnes dépravées. Son combat était avant tout moral, il se considérait comme étant l’ « immuable gardien des valeurs de ce pays ». Si, malgré son poids et sa puissance, il ne ressentait aucune ambition présidentielle, il confia cependant être prêt à détruire tout candidat qui lui eût paru dangereux : « Il y a un pouvoir que j’accepte qu’on me prête, c’est éventuellement celui de défaire un président ou de nuire à sa réélection, de barrer la route à un candidat qui me paraitrait inadéquat pour le pays. Tous ces hommes politiques à la petite semaine sous-estiment mon pouvoir de nuisance. »
Hoover détestait tout ce que représentaient les Kennedy
Hoover eut dans le collimateur une famille, ou plutôt un clan : les Kennedy ; lesquels représentaient tout ce qu’il détestait. Il abhorrait le patriarche, Joseph, dont la fortune reposait sur une série de malhonnêtetés, et qui pourtant rêvait d’être élu président des Etats-Unis. Avec ironie, Hoover disait que Joseph Kennedy était « prêt à tout, y compris à l’honnêteté, pour accéder à la magistrature suprême. » Pour Hoover, Joseph Kennedy représentait le comble du cynisme et de l’arrivisme, avec ses maximes telles que : « Qu’importe ce qu’on est, ce qui compte c’est l’image qu’on donne. »
Concernant John, Clyde Tolson se montre, pour sa part, plus mesuré. John Kennedy, concède-t-il, « paraissait très différent de son père. A l’inverse de lui, il éprouvait un intérêt sincère pour les autres, pourvu bien sûr qu’ils aient un minimum de charme intellectuel. Il préférait aussi débattre d’un sujet plutôt que de s’ancrer dans des opinions sans y avoir réfléchi. » Mais ses qualités ne trouvaient pas grâce aux yeux de Hoover, selon qui John était « trop riche, trop désinvolte, trop intellectuel, trop coureur de femmes, et au fond, trop immoral. »
Pour Hoover et de Tolson, le pire du clan Kennedy était représenté par Robert Kennedy, nommé ministre de la Justice par son frère après son élection à la présidence des Etats-Unis. Tolson le qualifie de « petit jeune homme nerveux à la voix haut perchée dont le comportement de roquet ne passait inaperçu chez personne. » En tant que ministre de tutelle de Hoover, Bob ne cessa de l’humilier en lui infligeant de petites vexations. Même John se serait montré réservé à l’égard de son frère en le considérant comme un idéaliste.
Dans une déclaration à la presse,
Hoover nia l’existence du crime organisé
C’est sur le terrain de la lutte contre le crime organisé que les choses se jouèrent. Dans une déclaration à la presse, Hoover avait, contre toute évidence, nié l’« existence du crime organisé sur le territoire des Etats-Unis. » Dans une conversation privée avec Tolson, Edgar s’était justifié de cette dénégation en faisant valoir que la moindre affirmation de sa part eût pu être prise par la Mafia comme une déclaration de guerre. La prudence recommandait donc le silence.
Une fois nommé ministre de la Justice, Robert Kennedy se mit en tête de s’attaquer au crime organisé et se lança dans une croisade contre la Mafia, oubliant un peu vite le rôle de celle-ci dans l’élection de son frère. A lire Dugain, la contradiction dans laquelle s’enfoncèrent les Kennedy allait aboutir à l’assassinat de John, suivi, quelques années plus tard, de celui de Bob. Pour leur part, Hoover et Tolson ne versèrent aucune larme sur les cercueils des deux frères ; car, ainsi que l’écrit Clyde, « avec les Kennedy nous avons croisé les pires malfaiteurs déguisés en gendres idéaux. »
Ni John Kennedy, ni Richard Nixon, ni aucun autre président avant eux, n’osèrent se débarrasser de Hoover. Il en savait trop sur eux : « la richesse des informations recueillies, écrit Tolson, devait nous permettre de nous maintenir indéfiniment à la tête du FBI. » Et c’est effectivement ce qui se produisit. Hoover se maintint à son poste pendant quarante-huit années consécutives et mourut directeur du FBI. A son décès, en 1972, le fidèle Clyde Tolson préféra se retirer et prit sa retraite.
Dans son livre, Marc Dugain fait de Hoover un être complexe, prisonnier de ses contradictions. Son obsession des valeurs morales le conduisit à commettre des turpitudes, comme s’il voulait faire oublier les moments d’égarements qu’il avait lui-même connus. Selon Dugain, la Mafia possédait des photos compromettantes qui lui permettait de tenir Hoover, ce qui pourrait expliquer sa tiédeur à combattre le crime organisé.
La Malédiction d’Edgar se lit assez facilement. Le style de Dugain n’est peut-être pas très élégant, mais il est diablement efficace.
La Malédiction d’Edgar, de Marc Dugain, 2006, collection Folio.
08:49 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la malédiction d'edgar, marc dugain, edgar hoover | Lien permanent | Commentaires (0)


