19/01/2015
La Mort est mon métier, de Robert Merle
Mémoires du commandant d’Auschwitz
La Mort est mon métier
Sous forme de fiction, Robert Merle livre ce qu’auraient pu être les souvenirs du commandant du camp d’Auschwitz. Rebaptisé Rudolf Lang, l’officier SS raconte comment il a procédé à l’extermination des juifs. Véritable industriel de la mort, il n’a été confronté à aucun cas de conscience. La Mort est mon métier aide à comprendre l’incompréhensible.
Ce livre est de caractère hybride. C’est à la fois un roman et un document. Robert Merle s’est inspiré de l’entretien qu’eut, en 1945, un psychologue américain avec Rudolf Hœss, commandant du camp d’Auschwitz. A partir d’un compte-rendu, l’auteur a accompli un travail d’imagination pour se mettre dans la peau de l’officier SS et rédiger ce qu’auraient pu être ses mémoires. Mais, parce qu’il s’agit malgré tout d’une œuvre de fiction, Robert Merle a changé certains noms et a rebaptisé Rudolf Hœss en Rudolf Lang. Et c’est donc Rudolf Lang qui est le narrateur de sa propre histoire. Dans ce roman, Robert Merle fait œuvre d’historien en ce sens qu’il nous fait comprendre comment le crime a été rendu possible.
 Dans sa préface, Robert Merle met tout de suite les choses au clair : il serait trop facile de dire qu’à Auschwitz c’est le démon qui fut à la manœuvre et de s’en tenir à cette seule explication. Merle poursuit : « Qu’on ne s’y trompe pas : Rudolf Lang n’était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l’échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. » Et c’est cet équipement psychique que Robert Merle démonte au fil du livre.
Dans sa préface, Robert Merle met tout de suite les choses au clair : il serait trop facile de dire qu’à Auschwitz c’est le démon qui fut à la manœuvre et de s’en tenir à cette seule explication. Merle poursuit : « Qu’on ne s’y trompe pas : Rudolf Lang n’était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l’échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. » Et c’est cet équipement psychique que Robert Merle démonte au fil du livre.
La première moitié du roman est entièrement consacrée aux jeunes années de Rudolf Lang, de 1913 à 1934. Le petit Rudolf est né dans une famille catholique. Son père lui inculque l’esprit d’obéissance et la crainte du péché. A l’âge de treize ans, il perd la foi. En 1916, à seize ans, il rencontre un jeune lieutenant de cavalerie qui l’hypnotise en lui faisant cette révélation : « Il n’y a qu’un péché, Rudolf, écoute-moi bien. C’est de ne pas être un bon Allemand. Voilà le péché ! »
Le garçon s’enfuit de chez lui et s’engage dans l’armée. Sa bravoure et son esprit d’obéissance font merveille. Il sert en Asie mineure. Son allié turc liquide un village arabe. Tout étonné, Rudolf objecte : « Mais ce village était innocent ! » Le Turc rétorque : « Il n’y a pas de place en Turquie pour les Arabes et les Turcs. […] Si tu es piqué par une puce, est-ce que tu ne les tues pas toutes ? »
Sous la République de Weimar, Rudolf Lang travaille dans l’industrie. C’est un ouvrier consciencieux qui obéit aux ordres, qui fait son devoir sans rechigner, et surtout qui tient la cadence. Il se met même, dit-il, « à travailler aveuglément, parfaitement, comme une machine. » Il adhère au parti nazi. Il s’y épanouit pleinement : « J’éprouvais un profond sentiment de paix. J’avais trouvé ma route. Elle s’étendait devant moi, droite et claire. Le devoir, à chaque minute de ma vie, m’attendait. »
Lang ne parle pas de juifs,
mais d’unités à traiter
Rudolf Lang est repéré par le Reichsführer Himmler qui fait de lui un officier de la SS. Lang est tout dévoué à son chef : « On n’avait plus de cas de conscience à se poser. Il suffisait d’être fidèle, c’est-à-dire d’obéir. Notre devoir, notre unique devoir était d’obéir. » Il est devenu un être sans conscience, complètement déshumanisé, qui s’en remet entièrement à Himmler. Quand le Reichsführer le charge, en tant que commandant d’Auschwitz, de procéder à l’extermination des juifs, Lang soulève des objections. Oh, ce n’est pas de liquider des juifs qui le tracasse, d’ailleurs Lang ne parle pas de juifs ni d’êtres humains, mais d’unités à traiter ; ce qui le préoccupe, c’est de ne pas atteindre le rendement fixé. Il estime l’objectif chiffré trop élevé et s’en ouvre à ses supérieurs : « Si je me base sur le chiffre global de 500 000 unités pour les six premiers mois, j’aboutis à une moyenne de 84 000 unités environ par mois, soit environ 2 800 unités à soumettre par vingt-quatre heures au traitement spécial. C’est un chiffre énorme. »
Mais, parce qu’il est un soldat obéissant et dévoué à ses chefs, Rudolf Lang se démène pour atteindre l’objectif fixé. C’est un subordonné froid et zélé, qui s’acquitte de sa tâche sans être confronté au moindre cas de conscience. Il travaille beaucoup. Il part le matin à sept heures et rentre à la maison vers dix, onze heures du soir. Il fait preuve d’une réelle efficacité pour se montrer digne de la confiance qu’Himmler a placée en lui. Rudolf Lang est un industriel de la mort.
La Mort est mon métier peut laisser une impression de malaise. Des esprits bien-pensants déploreront que ce livre ne laisse entrevoir aucune lueur d’espoir. Mais y en avait-t-il à Auschwitz ? La Mort est mon métier aide à comprendre l’incompréhensible. Publié quelques années après la guerre, en 1951, il illustre ce qu’Hannah Arendt allait appeler la banalité du mal.
La Mort est mon métier, de Robert Merle, 1952, avec une préface de l’auteur, 1972, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la mort est mon métier, robert merle | Lien permanent | Commentaires (0)
24/11/2014
Les Puissances des ténèbres, de Burgess
L’histoire dérangeante d’un miracle
Les Puissances des ténèbres
(Earthly Powers)
Le roman d’Anthony Burgess est foisonnant et passionnant. Au soir de sa vie, un grand écrivain se souvient. Il raconte sa jeunesse tumultueuse et scandaleuse, et évoque le défunt pape dont il était un proche. Les échanges entre les deux hommes donnent lieu à une réflexion sur la nature du mal et son origine.
En 1971, l’écrivain britannique Kenneth M. Toomey fête son quatre-vingt-et-unième anniversaire quand il reçoit, à Malte où il réside, la visite d’un émissaire du Vatican. Il lui est demandé d’apporter son témoignage dans le cadre du procès en béatification du défunt pape, Grégoire XVII, dont il était un proche. Le Vatican attend de Toomey qu’il atteste d’un miracle dont il aurait été témoin à l’hôpital de Chicago dans les années trente. Cette visite est l’occasion pour l’écrivain, au soir de sa vie, de replonger dans ses souvenirs et de raconter sa vie au lecteur en commençant par le commencement.
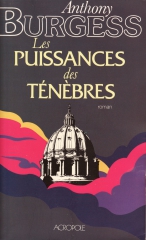 Kenneth M. Toomey, qui est donc le narrateur de cette histoire, est né en 1890 d’une mère française et d’un père britannique. Il est élevé dans la religion catholique. Jeune homme, il se découvre homosexuel. Il s’en ouvre à son confesseur, le père Frobisher SJ. Le jésuite – qui ce jour-là fumait des cigarettes Gold Flake, précise Toomey - l’invite à prier et à se détourner du mauvais chemin qu’il s’apprête à suivre. Le garçon refuse d’obéir au prêtre et met en avant le précédent de Michel-Ange, qui, bien qu’homosexuel, aura été l’une gloire de l’Eglise. De ce jour, Toomey abandonne toute pratique religieuse, mais reste imprégné de catholicisme.
Kenneth M. Toomey, qui est donc le narrateur de cette histoire, est né en 1890 d’une mère française et d’un père britannique. Il est élevé dans la religion catholique. Jeune homme, il se découvre homosexuel. Il s’en ouvre à son confesseur, le père Frobisher SJ. Le jésuite – qui ce jour-là fumait des cigarettes Gold Flake, précise Toomey - l’invite à prier et à se détourner du mauvais chemin qu’il s’apprête à suivre. Le garçon refuse d’obéir au prêtre et met en avant le précédent de Michel-Ange, qui, bien qu’homosexuel, aura été l’une gloire de l’Eglise. De ce jour, Toomey abandonne toute pratique religieuse, mais reste imprégné de catholicisme.
Il séjourne en Italie à la fin de la Grande Guerre quand il fait la connaissance d’un jeune compositeur, Dominico Campanati, et de son frère Carlo. Par la suite, Dominico épouse Constance Toomey, sœur cadette du narrateur. Quant à Carlo, qui est déjà prêtre, il deviendra archevêque de Milan, puis sera élu pape et règnera sous le nom de Grégoire XVII.
Kenneth M. Toomey se veut
un Maupassant épousseté
Les Puissances des ténèbres (Earthly Powers), d’Anthony Burgess, est un pavé qui fait plus de sept-cent pages aux caractères serrés. Il est difficile d’entrer dedans ; au bout d’une centaine de pages, le lecteur se demande même où l’auteur veut en venir tellement le livre part dans tous les sens. Puis, peu à peu, au fil des pages, le lecteur se laisse prendre par le récit, si bien qu’au bout d’un moment il ne sait plus s’il lit un roman d’Anthony Burgess, ou réellement les mémoires de Kenneth M. Toomey. Le livre est foisonnant et passionnant, faisant de Burgess un Balzac du XXème siècle.
La forme est vraiment hybride, oscillant entre fiction et récit. Dès les premières lignes du livre, le narrateur, donc Toomey, sait accrocher l’attention du lecteur et ne peut s’empêcher de souligner son habileté de romancier à entrer tout de suite dans le vif du sujet. Toomey a donc les qualités du romancier, il en a aussi les défauts. Après nous avoir raconté sa confession au père Frobisher SJ, il nous précise, dans un élan de franchise, que son récit ne doit pas être pris au pied de la lettre. Ainsi le prêtre en question ne s’appelait peut-être pas Frobisher et il ne fumait peut-être pas des cigarettes Gold Flake. Toomey ne peut se souvenir de tous les détails tant d’années après, donc il les recrée comme le ferait tout bon romancier.
Dans Les Puissances des ténèbres, l’illusion est parfaite. Toomey ne cesse de faire référence à son œuvre, citant tel ou tel de ses romans, il fait alors un bref résumé du livre et s’en excuse auprès des lecteurs qui le connaitraient déjà. Incidemment, Kenneth M. Toomey nous fait savoir qu’il est un écrivain populaire et donc décrié. Il aura vendu des millions d’exemplaires de ses romans à l’eau de rose et se veut un « Maupassant épousseté ».
A travers le personnage de Toomey, Burgess nous fait traverser le XXème siècle en y mêlant les personnes ayant réellement existé avec les personnages imaginaires. Toomey croise Keynes, rencontre Kipling qui ne se remet pas de la mort de son fils à la guerre, et assiste aux beuveries de Joyce dans le Paris des Années folles. En 1939, il essaye de sauver un écrivain juif nommé Strehler, dans l’Autriche de l’Anschluss. Mais il est arrêté par les Allemands à la déclaration de guerre en 1939. Pour obtenir sa libération, Toomey se voit proposer un chantage face auquel il cède. Il accepte d’accorder une interview de complaisance à la radio allemande. Sa petite compromission avec les Nazis le poursuivra toute sa vie, comme une tache indélébile.
Le pape explique pourquoi Dieu
a permis au mal d’exister
Si Kenneth M. Toomey est le narrateur du roman, il est indissociable de son beau-frère Carlo Campanati, futur Grégoire XVII. Toomey est la plume de l’homme d’Eglise pour un essai sur la question du mal. C’est précisément cette question du mal qui est au cœur des Puissances des ténèbres. Le lecteur doit s’accrocher pour suivre les débats entre théologiens, tels que nous les expose Toomey. Le narrateur, donc en fait Burgess, va jusqu’à publier le texte intégral d’un sermon sur le mal, donné par Mgr Carlo Campanati.
Devenu Grégoire XVII, Carlo effectue une visite aux Etats-Unis. A la télévision, il répond aux questions des spectateurs. L’un d’eux lui pose une question délicate : Dieu étant omniscient, Il devait savoir que le mal existerait, alors pourquoi l’a-t-Il permis ? Voici la réponse donnée par Grégoire XVII :
« C’est là un grand et terrible mystère. Dieu a fait à ses créatures le présent le plus immense, la chose qui se rapproche le plus de Son essence : la liberté du choix. S’Il sait à l’avance ce que vont faire Ses créatures, alors Il leur dénie la liberté. Donc, délibérément, Il efface toute préscience. Dieu pourrait savoir, s’Il le désirait ; mais par respect et par amour pour Sa créature, Il s’y refuse. Pouvez-vous imaginer cadeau plus terrible que celui-ci, Dieu Se niant Lui-même par pur amour ? »
Les théories de Grégoire XVII ne font pas l’unanimité. Certains de ses adversaires déplorent sa tendance à occulter la notion de pêché originel.
A la fin des Puissances des ténèbres, le miracle attribué au défunt pape est authentifié, et là le lecteur est pris par surprise. Le miracle a bien eu lieu, sa nature n’est pas remise en cause, et pourtant la révélation finale faite par le narrateur bouleverse le lecteur et l’amène à un questionnement qui risque de rester sans réponse.
Les Puissances des ténèbres (Earthly Powers), d’Anthony Burgess, 1980, éditions Acropole (épuisé) et collection Pavillons Poche.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XXe, XXIe siècles | Tags : les puissances des ténèbres, earthly powers, burgess, vatican | Lien permanent | Commentaires (0)
18/08/2014
Le Diable au corps, de Radiguet
Le récit d’un adultère peu banal
Le Diable au corps
Le roman parut sulfureux à sa publication en 1923. Le narrateur, un jeune garçon, se vante d’avoir entretenu une liaison avec une femme mariée dont le mari est parti à la guerre. Radiguet mourut peu après la sortie du livre, à l’âge de vingt ans.
Sous un titre accrocheur, Le Diable au corps est le récit d’un adultère. Une femme trompe son mari. A priori il n’y a pas de situation plus banale en littérature. Sauf qu’ici l’amant de madame est un jeune garçon à peine sorti de l’enfance. En 1923, à sa sortie, le livre parut sulfureux : un adolescent racontait sans état d’âme la liaison qu’il avait entretenue avec une femme mariée, et, qui plus est, avec une femme mariée dont le mari était parti à la guerre accomplir son devoir patriotique. La situation décrite paraissait vraiment scandaleuse, d’autant plus que l’auteur, Raymond Radiguet, âgé de vingt ans à la publication du livre, donnait l’impression de raconter sa propre histoire.
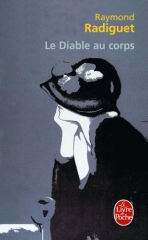 Le narrateur du Diable au corps se prénomme François. En première page du roman, il se rappelle l’année 1914 et se fait faussement provocateur : « Je vais encourir bien des reproches. Mais qu’y puis-je ? Est-ce ma faute si j’eus douze ans quelques mois avant la déclaration de guerre ? […] Que ceux déjà qui m’en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons : quatre ans de grandes vacances. »
Le narrateur du Diable au corps se prénomme François. En première page du roman, il se rappelle l’année 1914 et se fait faussement provocateur : « Je vais encourir bien des reproches. Mais qu’y puis-je ? Est-ce ma faute si j’eus douze ans quelques mois avant la déclaration de guerre ? […] Que ceux déjà qui m’en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons : quatre ans de grandes vacances. »
C’est en avril 1917 que le père de François lui fait rencontrer des amis, les Grangier. M. et Mme Grangier ont une fille, Marthe. Marthe est âgée de dix-huit ans et vient de se marier. Son mari est parti à la guerre. François a alors quinze ans et, comme dans un jeu, il tente de la séduire. Tous deux tombent amoureux l’un de l’autre.
L’intérêt du roman repose notamment sur les contrastes. Même si seulement trois ans d’âge les séparent, Marthe est une femme accomplie tandis que François est encore un enfant. D’un côté, l’époux de Marthe risque chaque jour sa vie au front ; de l’autre, les deux amants passent du bon temps ensemble. François n’arrête pas de répéter qu’il est très timide, ainsi il n’ose pas refuser les avances que lui font les femmes, mais par ailleurs il ne cesse de vouloir tirer les ficelles. Il donne son amour à Marthe, mais se révèle très égoïste, surtout soucieux de sa propre personne. Enfin, et c’est là tout le piment du livre, François insiste bien sur le fait qu’il n’est qu’un enfant, certes plus mûr que les autres garçons de son âge, mais encore ignorant de bien des choses. Dans un premier temps, il se considère quasiment comme un jouet entre les mains de Marthe en particulier, et des femmes en général. Ainsi, quand il cherche à tromper Marthe avec une jeune étrangère, il écrit : « Je n’avais jamais déshabillé de femmes ; j’avais plutôt été déshabillé par elles. »
Cela dit, malgré son caractère sulfureux, le roman ne contient aucune scène torride. Le narrateur procède par sous-entendus et laisse le lecteur libre d’imaginer ce qu’il veut.
Vu la maturité de l’œuvre, on a du mal à imaginer que Radiguet n’avait que dix-huit ans quand il écrivit ce livre inspiré, semble-t-il, de sa propre histoire, bien qu’il s’en fût défendu, rappelant qu’il s’agissait d’un roman et parlant d’une fanfaronnade.
Radiguet mourut à l’âge de vingt ans en 1923, peu de temps après la sortie du livre. Jean Cocteau, qui l’avait pris sous sa protection, se rappela que, quelques jours avant sa mort, il donnait l’impression de s’être rangé. Sans s’en apercevoir, Radiguet, si l’on en croit Cocteau, avait adopté le comportement d’une personne qui s’apprête à mourir, tel qu’il est décrit à la fin du Diable au corps :
« Un homme qui va mourir et ne s’en doute pas met de l’ordre autour de lui. Il classe ses papiers. Il se lève tôt, il se couche de bonne heure. Il renonce à ses vices. Son entourage le félicite. Ainsi sa mort brutale semble-t-elle d’autant plus injuste. Il allait vivre heureux. »
Le Diable au corps, de Raymond Radiguet (1923), collections Le Livre de Poche et Librio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : le diable au corps, radiguet | Lien permanent | Commentaires (0)


