02/11/2015
L'Equipage, de Kessel
Mélodrame à l’escadrille
L’Equipage
Ce roman de Kessel, écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale, a été publié dans sa version définitive en 1969. L'histoire, mélodramatique, est celle d'un jeune combattant du ciel. Le lecteur partage la vie quotidienne d’une escadrille, faite de longs moments d’oisiveté et de courts moments de grand péril.
« Il avait vingt ans. C’était son premier départ pour le front. Malgré les récits qu’il avait entendus au camp d’entraînement, malgré un sens aigu des réalités, sa jeunesse n’acceptait pas la guerre sans l’habiller d’une héroïque parure. » C’est en ces termes que Kessel évoque Jean Herbillon, personnage principal de L’Equipage. Pendant la Grande Guerre, Herbillon, un garçon de vingt ans, est mobilisé dans l’aviation. Avant son départ pour le front, il fait ses adieux à ses parents et à son petit frère. Le jeune aspirant est très fier de son uniforme d’aviateur et de ses bottes. Sur le quai de la gare, Denise, sa maîtresse, l’attend. Il ne sait pas grand-chose d’elle, il sait seulement qu’elle est mariée, mais ignore l’identité de son mari. Jean et Denise s’enlacent une dernière fois avant de se séparer.
 Dans le train qui le mène vers le front, Herbillon est une première fois ébranlé, quand il réfléchit aux raisons qui l’ont poussé à entrer dans l’aviation : « Ce n’était pas soif d’héroïsme, mais vanité. Il s’était laissé tenter par la séduction de l’uniforme, des insignes glorieux, par le prestige ailé sur les femmes. Elles, surtout, l’avaient décidé. »
Dans le train qui le mène vers le front, Herbillon est une première fois ébranlé, quand il réfléchit aux raisons qui l’ont poussé à entrer dans l’aviation : « Ce n’était pas soif d’héroïsme, mais vanité. Il s’était laissé tenter par la séduction de l’uniforme, des insignes glorieux, par le prestige ailé sur les femmes. Elles, surtout, l’avaient décidé. »
Arrivé à son affectation, Herbillon découvre les lieux : un simple terrain d’aviation entouré de hangars et de baraques. Il est ahuri d’être présenté à un lieutenant en tenue débraillée, vêtu d’un simple chandail, et portant, au lieu de bottes, des sabots au pied. Plutôt que de lui parler de gloire et d’héroïsme, le lieutenant incite Herbillon à se faire une petite vie douillette : « Faut être confortable avant tout. Une chambre, un cuisinier savant, une bonne pipe et l’on est paré. Je vous enseignerai tout cela. En s’arrangeant, on s’en tire même avec votre solde. »
Constatant que son chef, le capitaine Thélis, est âgé de seulement une vingtaine d’années, Herbillon se demande comment un garçon à peine plus vieux que lui peut commander une escadrille. L’explication est vite trouvée : l’espérance de vie y est faible. Herbillon s’habitue au fait que certains de ses camarades, partis pour une mission d’observation, n’en reviennent pas. Kessel fait part des commentaires entendus ici et là : « Une escadrille se renouvelle vite » ; « Plus on vole et plus on réduit sa chance. »
Les aviateurs mènent une vie libre, pleine de confort,
qui est la contrepartie du danger qu’ils courent
Un jour, un lieutenant d’âge mûr, du nom de Maury, débarque pour prendre le commandement en second de l’escadrille. Ses camarades le prennent en grippe et refusent de faire équipage avec lui, sauf Herbillon qui se porte volontaire. Maury sera pilote et Herbillon sera son observateur : « Alors ils surent ce que les camarades entendaient par équipage. Ils n’étaient pas simplement des hommes accomplissant les mêmes missions, soumis aux mêmes dangers et recueillant les mêmes récompenses. Ils étaient une entité morale, une cellule à deux cœurs, deux instincts que gouvernait un rythme pareil. »
Les semaines passent et Herbillon obtient une permission. A Paris, il va retrouver ses parents et son petit frère. Il prévoit bien sûr de longs moments à passer, dans sa garçonnière, en compagnie de Denise. Maury lui confie une lettre qu’il le prie de bien vouloir remettre à sa femme Hélène. Herbillon accepte volontiers de rendre ce service. Arrivé à Paris, il sonne au domicile des Maury. Quand il découvre l’identité d’Hélène Maury, Herbillon est stupéfait…
L’Equipage est un roman facile à lire. L’histoire, mélodramatique, accroche l’attention du lecteur. Au-delà, le livre offre une peinture particulièrement réussie du milieu de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale. Le lecteur partage la vie quotidienne de l’escadrille, faite de longs moments d’oisiveté et de courts moments de grand péril. Comme le fait remarquer Kessel, les aviateurs mènent une « vie libre, pleine de confort », avec « mille commodités » qui prennent « figure de privilèges ». Par comparaison avec les hommes qui se battent dans la boue des tranchées, ce sont de véritables seigneurs. Mais le taux de mortalité d’une escadrille est très élevé, comme si le « danger quotidien et mortel » était « la rançon » de leurs privilèges.
En 1935, L’Equipage fut adapté au cinéma par Anatole Litvak, avec Jean-Pierre Aumont, Annabella et Charles Vanel. Kessel collabora au scénario et ajouta au film un développement qui ne figurait pas dans le livre. Le film de Litvak rencontra un grand succès auprès du public. En 1969, à l’occasion de la publication du roman en collection Folio, Kessel révisa son manuscrit et y ajouta des chapitres directement inspirés du film.
L’Equipage, de Joseph Kessel, 1923, nouvelle édition revue et corrigée, 1969, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : l'equipage, kessel | Lien permanent | Commentaires (0)
21/09/2015
Les Grandes Familles, de Druon
Chronique sur les mœurs hypocrites de la France d’en-haut
Les Grandes Familles
Ce roman met en scène les La Monnerie, l’une des plus vieilles familles de France, alliée aux Schoudler, propriétaires de la banque du même nom. Sous forme de chronique, Druon entremêle les destins et les personnages, et dépeint des mœurs hypocrites. Les Grandes Familles est un livre très facile à lire, d’autant plus que Druon a l’art de la formule pour résumer une situation.
Pour certains, Les Grandes Familles, c’est d’abord un film, réalisé par Denys de La Patelière, avec Jean Gabin, Pierre Brasseur, Bernard Blier et Jean Desailly. Pourtant on ne peut oublier que le film est l’adaptation du roman de Maurice Druon, auquel fut décerné le prix Goncourt en 1948.
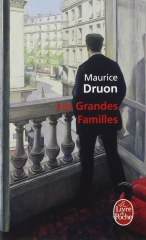 Le livre présente une fresque de la haute société des années 1920. Sous forme de chronique, Druon entremêle les destins, passe d’un personnage à l’autre et associe le lecteur à leur sort. Le livre est foisonnant, mais le récit n’est pas du tout confus. Les personnages sont très typés, le lecteur a le temps de s’intéresser à chacun d’entre eux et de se préoccuper de son sort. Le style de Druon est fluide ; l’auteur n’abuse pas des descriptions et surtout il a l’art de la formule. Il sait tourner ses phrases de façon à résumer une situation et frapper l’esprit du lecteur.
Le livre présente une fresque de la haute société des années 1920. Sous forme de chronique, Druon entremêle les destins, passe d’un personnage à l’autre et associe le lecteur à leur sort. Le livre est foisonnant, mais le récit n’est pas du tout confus. Les personnages sont très typés, le lecteur a le temps de s’intéresser à chacun d’entre eux et de se préoccuper de son sort. Le style de Druon est fluide ; l’auteur n’abuse pas des descriptions et surtout il a l’art de la formule. Il sait tourner ses phrases de façon à résumer une situation et frapper l’esprit du lecteur.
La peinture que fait Druon des élites n’est pas reluisante. Les personnages sont mesquins et centrés sur eux-mêmes : « Chacun […] était un être trop important, ou se croyait tel, pour être occupé d’autre chose que de la pensée de soi. » A lire ce roman, on pourrait croire qu’il est l’œuvre d’un écrivain désabusé qui a beaucoup vécu. Or, en 1948, Druon avait à peine trente ans. Ce livre est donc sorti de la plume d’un jeune homme qui venait de faire son début dans la vie, mais qui, il est vrai, avait déjà traversé un certain nombre d’épreuves.
La première des grandes familles dépeintes par Druon est celle des La Monnerie. Ils sont quatre frères : le marquis, le poète académicien, le ministre plénipotentiaire et le général. Les La Monnerie sont alliés aux Schoudler, propriétaires de la banque Schoudler, la fille du poète ayant épousé le fils du baron Noël Schoudler. Cette alliance contre nature ne fut pas vraiment du goût des La Monnerie, qui constituent l’une des plus vieilles familles de France. Avant son mariage, la fille du poète fut mise en garde au sujet des Schoudler : « ce sont des Juifs, mon enfant ; anoblis, convertis, c’est entendu ; mais enfin, il ne faut pas gratter très loin pour trouver le comptoir du prêteur sur gages. »
Celui qui fait le plus honte aux frères La Monnerie, c’est leur demi-frère Lucien Maublanc, né du remariage de leur mère avec un roturier. Il aggrave son cas en étant buveur, coureur et joueur. Lors d’un conseil de famille orageux au cours duquel se règlent des comptes, Lucien Maublanc dit leurs quatre vérités aux La Monnerie : « Vous m’en voulez de ma naissance. Vous en avez voulu à ma mère d’avoir épousé en secondes noces un homme qui n’était pas marquis ou comte comme vous, et que vous méprisiez à cause de cela. A vos yeux, je suis le fruit d’une mésalliance. »
Jean de La Monnerie a acquis la célébrité
grâce à des vers volés à Sully Prudhomme
Dans ce livre, le mensonge est permanent. Ainsi Jean de La Monnerie, de l’Académie française, a acquis la célébrité grâce à son poème L’Oiseau sur le lac ; or Druon nous apprend qu’il n’en est pas le véritable auteur. Un soir, après dîner, « Sully Prudhomme discourait d’un projet qu’il avait en tête ; La Monnerie avait cueilli l’idée au vol » et se l’était appropriée.
Même les grands principes moraux que défend la famille ne sont que pur affichage. Le grand poète catholique aura multiplié les maîtresses, et son épouse bafouée, devenue veuve, lui en garde rancune. Mais elle aussi se révèle hypocrite. Quand sa nièce, mademoiselle Isabelle d’Huisnes, lui confesse qu’elle attend un enfant, elle lui conseille d’aller consulter le professeur Lartois, ami de la famille, « pour que tout se passe le plus silencieusement possible. » Isabelle est indignée de la recommandation émise par sa tante : « Comment, ma tante, c’est vous si pratiquante, vous qui ne manqueriez pas la messe un dimanche… » Melle d’Huisne n’a pas le temps de finir sa phrase, car Mme de La Monnerie, qui a réponse à tout, lui coupe sèchement la parole : « Oh ! ma petite enfant, tu ne vas me donner des leçons de conduite chrétienne ! […] Quand on commet un premier péché, il en entraîne toute une série d’autres. […] Tu commettras un péché de plus qui est la suite inévitable de tes autres péchés. »
La personnalité la plus forte du roman est le baron Noël Schoudler, président de la banque Schoudler et régent de la Banque de France. Ce géant règne en potentat sur sa famille et ses affaires et ne supporte pas que les autres lui fassent concurrence. Quand il se rend compte que son fils et successeur désigné prend trop d’importance et commence de lui faire de l’ombre, il est décidé à lui donner une leçon, faisant ainsi abstraction de tout amour paternel. Quant à Lucien Maublanc, c’est sa bête noire, il est décidé à l’abattre. Dans l’exécution de ses œuvres, il s’adjoint Simon Lachaume, un jeune agrégé plein d’ambition, qui devient son fils de substitution.
Pourtant, malgré sa puissance et la crainte qu’il inspire aux autres, Noël Schoudler présente une faiblesse, il a peur de la mort. Cette peur de la mort est récurrente dans le roman et habite l’ensemble des personnages, bien qu’aucun d’entre eux n’ose en parler, précise Druon : « Non ! Personne n’avoue jamais sa hantise de la mort ; et cette retenue n’est point, comme on le prétend dignité ; elle est souci surtout de ne pas effaroucher l’aide d’autrui. […] Tout, les civilisations, les cités, les sentiments, les arts, les lois et les armées, tout est enfant de la peur et de sa forme suprême, totale, la peur de la mort. »
Rare personnage positif du livre, un père dominicain essaye d’expliquer le sens de la vie et de la mort à une jeune veuve dont le mari s’est suicidé.
Les Grandes Familles est un livre très facile à lire, édité dans la collection Le Livre de Poche. Il existe une suite, publiée sous le titre Les Corps qui tombent, qui n’est malheureusement plus disponible en poche. Outre le film de Denys de La Patelière, il existe une adaptation en feuilleton qui avait été réalisée pour la télévision, à la fin des années quatre-vingt. Edouard Molinaro y dirigeait Michel Piccoli, Roger Hanin, Pierre Arditi et Marie Trintignant, dans les principaux rôles. Cette version est beaucoup plus fidèle au roman que le film de La Patelière.
Les Grandes Familles, de Maurice Druon, 1948, collection Le Livre de Poche.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : les grandes familles, druon | Lien permanent | Commentaires (0)
08/06/2015
L'Ordinateur du paradis, de Benoît Duteurtre
Conte philosophique sur la société numérique
L’Ordinateur du paradis
Dans un style élégant et fluide, Benoît Duteurtre se moque de la société néolibérale et numérique. A travers l’histoire de Simon Laroche, secrétaire de la commission des Libertés publiques, l’auteur pourfend le tout Internet, la transparence et les vertus prêtées à notre époque.
Benoît Duteurtre n’aime pas notre époque, mais il ne la fuit pas et préfère s’en moquer avec esprit. Au lieu de proposer un essai qui fustige les dérives de la société moderne ou postmoderne, il livre un conte philosophique mettant en scène la société néolibérale dans laquelle les individus sont connectés en permanence.
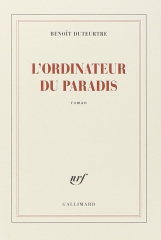 L’histoire se passe dans un pays qui n’est pas précisé, mais qui pourrait être la France, et à une époque qui n’est pas datée, mais qui pourrait être la nôtre. Le personnage principal, Simon Laroche, est ce qu’il est convenu d’appeler un gagnant. Il roule en BMW et vit dans une aisance matérielle certaine, qui lui est assurée par les hautes responsabilités qu’il occupe : il est rapporteur de la commission des Libertés publiques. A ce titre, il est appelé à donner son avis sur le manifeste publié par « Nous, en tant que femmes ! » Ce mouvement réclame la pénalisation de la consultation d’images pornographiques sur Internet. Simon Laroche est invité sur un plateau de télévision pour dire si une telle mesure serait attentatoire aux libertés publiques. Quelques minutes avant la prise d’antenne, il reçoit l’animatrice de l’émission dans sa loge, et, hors-caméra, il se lâche en disant avec franchise l’irritation que lui cause la lutte des femmes. Quelques jours plus tard, les propos de Simon, qui revêtaient pourtant un caractère privé, se trouvent mis en ligne sur Internet. Le scandale est énorme. Simon va devoir se résoudre à des excuses publiques, voire à la démission.
L’histoire se passe dans un pays qui n’est pas précisé, mais qui pourrait être la France, et à une époque qui n’est pas datée, mais qui pourrait être la nôtre. Le personnage principal, Simon Laroche, est ce qu’il est convenu d’appeler un gagnant. Il roule en BMW et vit dans une aisance matérielle certaine, qui lui est assurée par les hautes responsabilités qu’il occupe : il est rapporteur de la commission des Libertés publiques. A ce titre, il est appelé à donner son avis sur le manifeste publié par « Nous, en tant que femmes ! » Ce mouvement réclame la pénalisation de la consultation d’images pornographiques sur Internet. Simon Laroche est invité sur un plateau de télévision pour dire si une telle mesure serait attentatoire aux libertés publiques. Quelques minutes avant la prise d’antenne, il reçoit l’animatrice de l’émission dans sa loge, et, hors-caméra, il se lâche en disant avec franchise l’irritation que lui cause la lutte des femmes. Quelques jours plus tard, les propos de Simon, qui revêtaient pourtant un caractère privé, se trouvent mis en ligne sur Internet. Le scandale est énorme. Simon va devoir se résoudre à des excuses publiques, voire à la démission.
Pour nourrir son intrigue, Benoît Duteurtre a largement puisé dans l’actualité de ces dernières années. Par exemple, la déclaration enregistrée à la dérobée sur un plateau de télévision rappelle une mésaventure analogue survenue à un président de la République.
Dans ce livre, il est beaucoup question de l’omniprésence d’Internet dans la vie quotidienne et de l’absence de conscience devant les risques courus. Ainsi Simon est très étonné quand il s’aperçoit que tout courriel envoyé, ou toute consultation de site, laisse forcément des traces quelque part, que ce soit sur la toile ou sur son ordinateur personnel ; et cela même s’il a pris soin d’effacer toute trace de ses manipulations. Simon est terrifié d’apprendre qu’il n’y a pas de droit à l’oubli numérique : « Contrairement à la confession catholique qui remet à zéro le compteur de nos péchés, la foi dans l’effacement des données n’était qu’une illusion. »
Les élèves planchent sur la liberté d’expression
et en définissent d’abord les limites
Le fils de Simon, Tristan, suit des « ateliers sociaux » au collège. Les élèves ont pour projet de rédiger un manifeste pour la liberté d’expression. En même temps ils doivent en définir les limites. Et, au grand agacement de Simon, ils ont d’abord réfléchi aux bornes à ne pas dépasser. Tristan explique sur un ton très convaincu : « Nous, on s’est mis d’accord sur les limitations. […] D’abord le racisme, le sexisme, le terrorisme, l’injure aux religions… […] Et, bien entendu, les sites nazis et pédophiles ! » Simon, qui a été trotskiste dans les années soixante-dix et qui a ferraillé contre les religions, n’en revient pas et a du mal à avaler les propos de son fils sur « l’injure aux religions ».
Dans son livre, Duteurtre a aussi dans le collimateur la SNCF, même si la société nationale n’est pas nommément citée. On voit Simon obligé de renoncer à prendre le train rapide à réservation obligatoire, parce qu’il a décidé trop tard de son voyage. Il déplore que soit perdue la souplesse qui caractérisait le train et qui permettait d’y monter au dernier moment. Il est obligé de se rabattre sur une compagnie aérienne low-cost, et, dans l’avion, il devra s’acquitter d’un supplément de cinq euros pour utiliser les toilettes.
Dans cette société néolibérale, la langue française est massacrée. Le ministre de tutelle de Simon le convoque en entretien, et, bien que titulaire d’un Mastère [sic]de lettres, il bourre son discours de fautes de grammaire et d’anglicismes. Il déclare notamment : « Avant d’en venir à l’affaire qui nous impacte, j’aimerais connaître votre avis sur cette horrible news ! » Même au paradis, où espère entrer Simon après sa mort, la connaissance de l’anglais s’avère indispensable ! Et en ce qui concerne « cette horrible news » auquel le ministre fait allusion, il s’agit d’un grand dérèglement informatique qui menace la société sur ses bases. Ce dérèglement est une espèce de virus qui, dans sa propagation, peut faire penser à La Peste, de Camus.
Le livre de Duteurtre laissera probablement de marbre les lecteurs hyper-connectés acquis au monde néolibéral, mais, peut-être malgré tout, les fera-t-il réfléchir. L’Ordinateur du paradis permet de prendre quelque distance avec les vertus, supposées ou réelles, prêtées à la société actuelle : la rapidité, la réactivité, la transparence, l’hygiénisme, la mise en réseau, et cette volonté permanente de tout quantifier. Simon en arrive à la conclusion suivante : « le capitalisme a gagné ; mais notre époque a également recyclé le pire du communisme : s’exposer sans tabou, sur Facebook ou à la télé ; se fustiger publiquement à la moindre faute. »
L’Ordinateur du paradis, de Benoît Duteurtre, 2014, éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Société, XXe, XXIe siècles | Tags : l’ordinateur du paradis, benoît duteurtre | Lien permanent | Commentaires (0)


