09/05/2016
Alstom, scandale d'Etat, de Jean-Michel Quatrepoint
Les secrets du dépeçage d’Alstom
Alstom, scandale d’Etat
(dernière liquidation de l’industrie française)
Jean-Michel Quatrepoint a enquêté sur la vente à la sauvette de la branche énergie du groupe Alstom. Il accuse les autorités françaises d’avoir bradé un bijou de famille, privant le pays de la maîtrise d’une activité stratégique. Selon lui, General Electric a été choisi comme repreneur pour des raisons inavouables.
Après Péchiney, Arcelor, Lafarge et Alcatel, la France a perdu Alstom Energie, qui a été vendue aux Américains en 2015. Dans Alstom, scandale d’Etat, Jean-Michel Quatrepoint tire la sonnette d’alarme : année après année, la France se désindustrialise, elle perd ses fleurons les uns après les autres, ses dirigeants vendant les « bijoux de famille » dans l’indifférence générale. Selon lui, la vente à General Electric de la branche énergie d’Alstom constitue un cas d’école d’autant plus grave que la France se prive ainsi de la maîtrise d’une activité stratégique :
Dans la concurrence économique mondiale, ne pas être maître de sa filière énergétique va être un rude handicap. Voilà pourquoi la vente, à la sauvette, d’Alstom est une affaire d’Etat. Et les conditions de cette cession un scandale d’Etat. Car il était possible de faire autrement, voire de négocier des accords plus équilibrés.
 Jean-Michel Quatrepoint remonte aux heures glorieuses de l’industrie française. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Alsthom (avec un « h », à l’époque) était une filiale de la toute puissante CGE, Compagnie générale d’électricité. Ce vaste conglomérat était l’une des plus grosses entreprises au monde, valeur vedette du CAC40, l’une des fiertés de la France. La CGE était leader mondial des télécommunications et numéro un des câbles électriques. Dans cet empire, outre Alsthom, on trouvait Alcatel, Cegelec, les Câbles de Lyon, les Chantiers de l’Atlantique et même une branche médias avec L’Express et les Presses de la Cité. Rebaptisé Alcatel-Alsthom au début des années quatre-vingt-dix, le groupe a alors fière allure. Mais les apparences sont trompeuses. Son patron historique, Ambroise Roux, « grand maître de l’industrie française », n’a pas préparé l’avenir, il n’a pas vu venir la révolution numérique, qui va tout balayer sur son passage. Alcatel-Alsthom vit sur des acquis et n’est pas armé pour affronter le déferlement de la téléphonie mobile et de l’Internet. Pour trouver les milliards nécessaires au développement des activités de télécommunications, le groupe vend Alsthom (qui perd son « h » à cette occasion) et l’introduit en bourse, en 1999.
Jean-Michel Quatrepoint remonte aux heures glorieuses de l’industrie française. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Alsthom (avec un « h », à l’époque) était une filiale de la toute puissante CGE, Compagnie générale d’électricité. Ce vaste conglomérat était l’une des plus grosses entreprises au monde, valeur vedette du CAC40, l’une des fiertés de la France. La CGE était leader mondial des télécommunications et numéro un des câbles électriques. Dans cet empire, outre Alsthom, on trouvait Alcatel, Cegelec, les Câbles de Lyon, les Chantiers de l’Atlantique et même une branche médias avec L’Express et les Presses de la Cité. Rebaptisé Alcatel-Alsthom au début des années quatre-vingt-dix, le groupe a alors fière allure. Mais les apparences sont trompeuses. Son patron historique, Ambroise Roux, « grand maître de l’industrie française », n’a pas préparé l’avenir, il n’a pas vu venir la révolution numérique, qui va tout balayer sur son passage. Alcatel-Alsthom vit sur des acquis et n’est pas armé pour affronter le déferlement de la téléphonie mobile et de l’Internet. Pour trouver les milliards nécessaires au développement des activités de télécommunications, le groupe vend Alsthom (qui perd son « h » à cette occasion) et l’introduit en bourse, en 1999.
Devenu un groupe indépendant, Alstom possède deux activités différentes : les transports, avec notamment la fabrication des rames TGV, et l’énergie. C’est dans l’énergie qu’Alstom décide de se renforcer en entamant une politique d’acquisition, coûteuse et risquée. Pour éviter la catastrophe - en clair, la faillite -, Patrick Kron est appelé à la rescousse. Ce major de Polytechnique est nommé PDG. Son ancien patron, Louis Gallois, le dit « extraordinairement intelligent, travailleur et doté d’un humour caustique. » Dans sa tâche de redressement d’Alstom, Patrick Kron est soutenu par Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie et des finances, qui arrive à « tordre le bras » aux banquiers, de telle sorte qu’ils acceptent une restructuration de la dette du groupe.
En 2004, Alstom est sauvé, du moins en apparence.
L’arrestation aux Etats-Unis d’un cadre d’Alstom
fait l’effet d’une bombe parmi les dirigeants du groupe
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, le DoJ (Department of Justice) enquête sur une affaire de corruption. Alstom est soupçonné d’avoir versé une commission pour obtenir un (petit) marché en Indonésie. Dans un premier temps, les dirigeants du groupe ne s’inquiètent pas, à l’image des dirigeants de BNP-Paribas impliqués dans une autre affaire. Tout change en 2013, quand un cadre supérieur d’Alstom en voyage aux Etats-Unis est arrêté par la police. Son arrestation et les conditions de sa détention font l’effet d’une bombe à Paris. Les dirigeants d’Alstom comprennent que le groupe est menacé d’une lourde amende et qu’eux-mêmes risquent la prison. Dès lors, il faut réagir, avant que l’étau ne se resserre trop.
Dans son livre, Jean-Michel Quatrepoint se fait très clair. Il affirme que Patrick Kron s’est décidé à vendre l’activité énergie, moins pour désendetter le groupe que pour payer la lourde amende à laquelle la justice américaine ne manquerait pas de le condamner. Quatrepoint va plus loin en affirmant que, dès le début, le choix de Patrick Kron s’est porté sur General Electric, dans l’espoir d’obtenir l’indulgence du Department of Justice. L’auteur cependant porte un jugement nuancé sur les faits :
S’imaginer qu’il y a une relation directe, une concertation entre le DoJ et les grandes entreprises américaines serait une absurdité. La séparation des pouvoirs est l’un des principes de la Constitution américaine. Toutefois, rien n’empêche, dans les difficultés et face à l’adversité, de préférer se vendre à un groupe américain ayant pignon sur rue, dont l’entregent pourrait faciliter un arrangement avec la justice du pays.
Dès lors, les choses sont jouées. Jean-Michel Quatrepoint se fait d’autant plus accusateur que, selon lui, Patrick Kron n’a pas profité de l’offre concurrente formulée par l’Allemand Siemens pour « faire monter les enchères » et obtenir de General Electric qu’il améliore son offre. Jean-Michel Quatrepoint montre également comment le sommet de l’Etat, François Hollande en tête, a laissé faire.
Quatrepoint accuse la classe politique et médiatique
de se focaliser sur le sociétal et le compassionnel,
impuissante qu’elle est à traiter des vrais sujets
Par désintérêt et par manque de compétences, le gouvernement français a été complètement dépassé par les événements. Jean-Michel Quatrepoint reproche aux hommes politiques d’être plus à l’aise dans les dossiers dits « sociétaux » que dans les dossiers de politique industrielle. Il parle de « d’une classe politique – et médiatique- focalisée sur le compassionnel et le sociétal, impuissante qu’elle est à traiter des vrais sujets et à influer sur le cours du monde. » Certes, dans ce dossier, le gouvernement a sauvé les apparences en obtenant la constitution de co-entreprises détenues à la fois par General Electric et par Alstom. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, General Electric y sera majoritaire et contrôlera les finances, Alstom apportant ses compétences techniques, tant recherchées par les Américains. Et ce sont eux qui contrôleront Arabelle, l’une des turbines les plus sûres au monde, qui doit équiper les centrales nucléaires de type EPR.
Quatrepoint précise que ce sont en fait les contrats de maintenance détenus par Alstom que General Electric convoitait :
Dans l’énergie, on ne gagne pas d’argent sur la vente d’une centrale ou d’une turbine, ni sur celle de tous les équipements qui leur sont associés, mais sur la maintenance, le service après-vente. […] En achetant Alstom Energie, General Electric acquiert une base de clients captifs.
Alstom se retrouve aujourd’hui réduit à sa branche transports. Or les marges sont faibles dans cette activité, beaucoup moins rentable que l’énergie. Et la concurrence y est de plus en plus forte. Les Chinois, après avoir « volé » la technologie Siemens, sont attendus sur le marché et pèsent quatre fois plus lourd qu’Alstom. Quatrepoint entrevoit déjà un scénario inéluctable se dessiner : la vente de ce qui reste d’Alstom à un concurrent, probablement Siemens.
Alstom, scandale d’Etat, de Jean-Michel Quatrepoint, 2015, éditions Fayard.
07:30 Publié dans Economie, Essai, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre | Tags : jean-michel quatrepoint, alstom scandale d'etat | Lien permanent | Commentaires (0)
25/04/2016
Germinal, de Zola
Célèbre roman sur la condition ouvrière
Germinal
La crise économique frappe de plein fouet les industries du nord de la France. Pour rester compétitive, la Compagnie des mines de Montsou décide de baisser le coût du travail. Les ouvriers se mettent en grève. Le mouvement s’annonce dur. Plus de cent ans après sa publication, Germinal reste le roman synonyme de la condition ouvrière.
Germinal est l’un des romans les plus célèbres de Zola, sinon le plus célèbre, publié dans le cycle des Rougon-Macquart. De nos jours encore, pour qualifier des conditions de travail déplorables, les expressions telles que « On se croirait chez Zola » ou « C’est digne de Germinal » sont éloquentes et clairement connotées. Il faut dire que Zola est l’un des premiers écrivains à s’être intéressé de près à la classe ouvrière, ici aux mineurs de fond du nord de la France. Il montre que, par leurs sacrifices au travail, les ouvriers ont rendu possibles la Révolution industrielle et l’enrichissement de la bourgeoisie sous le Second Empire.
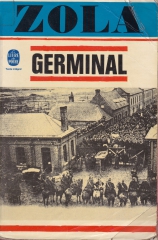 Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
C’est la famille Maheu qui est au cœur du roman. Le couple a sept enfants, âgés de vingt-et-un ans à trois mois. Chez les Maheu, dès qu’un enfant est en âge de travailler, il descend à la mine, qu’il soit fille ou garçon. C’est ainsi que Lydie, « chétive fillette de dix ans » va au puits. L’argent que chacun rapporte est nécessaire à ce foyer qui a du mal à joindre les deux bouts. Le sort de leurs voisins n’est guère plus enviable, au point que le coron du Voreux a été surnommé par ses habitants le « coron Paie-tes-Dettes ». Les mineurs sont payés à la quinzaine ; et le dimanche, jour chômé, n’est bien sûr pas rémunéré.
Ce qui étonne le plus Lantier,
ce sont les brusques changements de température au fond du puits
Les Maheu hébergent un locataire âgé d’une vingtaine d’années, Etienne Lantier, qui vient d’être embauché à la mine. C’est avec lui, qui n’était jamais descendu dans un puits, que le lecteur découvre le quotidien du mineur. Le matin, les Maheu se lèvent à quatre heures pour boire un café préparé avec une mauvaise eau qui donne la colique. En leur compagnie, Etienne pénètre l’univers souterrain de la mine ; il ne cesse de se heurter la tête au plafond, tandis que pas un de ses camarades, à force d’habitude, ne se cogne. Il souffre du sol glissant et traverse de véritables mares. Zola insiste sur les chauds et froids : « Mais ce qui l’étonnait surtout, c’étaient les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage, par où passait l’air de la mine, soufflait un vent glacé, dont la violence tournait à la tempête, entre les muraillements étroits. Ensuite, à mesure qu’on s’enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d’aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante, d’une pesanteur de plomb. » Zola poursuit : « C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés, l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue demeurait mortel. » A trois heures de l’après-midi, quand les Maheu remontent, leur journée finie, ils sont relayés par une autre équipe, car la mine tourne vingt-quatre heures sur vingt-quatre : « Jamais la mine ne chômait, il y avait nuit et jour des insectes humains finissant la roche à six-cents mètres sous les champs de betterave. »
Le puits est exploité par la Compagnie des mines de Montsou. Le directeur général, M. Hennebeau, n’en est pas le propriétaire ; « il est payé comme nous », précise un ouvrier. Son neveu Paul Négrel, âgé de vingt-six ans, est l’ingénieur de la fosse. Il passe ses journées au fond du puits, au milieu des ouvriers. Zola écrit : « Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon ; et, pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou. »
Alors que le salariat n’a pas encore trouvé sa forme,
les ouvriers sont payés à la tâche
Mais la crise est là. La surproduction menace. Pour rester compétitive, la Compagnie doit baisser ses coûts. On dirait aujourd’hui que l’entreprise doit faire un effort de compétitivité qui passe par la baisse du coût du travail. Pour ce faire, à une époque où le salariat n’a pas encore trouvé sa forme, la rémunération se faisant à la tâche, la Compagnie organise la concurrence entre ouvriers en mettant aux enchères les tailles. Il s’agit d’enchères inversées qui favorisent, pour prendre une expression actuelle, le « dumping social ». Quarante marchandages sont offerts aux mineurs, et, face à l’ingénieur qui procède aux adjudications, Maheu a peur de ne rien obtenir s’il ne baisse pas suffisamment la rémunération qu’il réclame ; car : « Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. » A la sortie, Etienne a ce commentaire : « En voilà un égorgement !... Alors, aujourd’hui, c’est l’ouvrier qu’on force à manger l’ouvrier ! » Le propriétaire de la mine voisine de Montsou se montre lucide et honnête quand, en privé, il déclare : « L’ouvrier a raison de dire qu’il paie les pots cassés. »
La colère monte dans le coron du Voreux. Les femmes, qui gèrent le ménage et donc la pénurie, sont en première ligne. La Maheu, très remontée, ne cesse de répéter : « Il faudra que ça pète. »
La colère monte contre les bourgeois qui auraient confisqué à leur profit les révolutions de 1789, 1830 et 1848 : « L’ouvrier ne pouvait tenir le coup, la révolution n’avait fait qu’aggraver ses misères. C’étaient les bourgeois qui s’engraissaient depuis 89. » A Montsou, il existe pourtant des bourgeois généreux. Ainsi, les Grégoire, actionnaires de la Compagnie qui vivent de leur rente, pratiquent la charité, mais à leur manière : « Il fallait être charitable, ils disaient eux-mêmes que leur maison est la maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillés de la continuelle crainte d’être trompés et d’encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d’argent, jamais ! pas dix sous, pas deux sous, car c’était un fait connu, dès qu’un pauvre avait deux sous, il les buvait. » A la place, les Grégoire ne font que des dons en nature, non en nourriture, mais sous forme de vêtements chauds.
Sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail,
l’employeur organise une baisse déguisée des rémunérations
Devant tant d’injustice, Etienne décide d’agir. Il s’enflamme en apprenant la création, à Londres, de l’Association internationale des travailleurs, la fameuse Internationale : « Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s’unissant, pour assurer à l’ouvrier le pain qu’il gagne. » Il entreprend de fonder une section à Montsou et de mettre en place une caisse de prévoyance. Cette caisse servirait des secours en cas de grève. Or un conflit éclate quand, sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail, la Compagnie décide d’un nouveau mode de rémunération : « Devant le peu de soin apporté au boisage, lasse d’infliger des amendes inutiles, elle avait pris la résolution d’appliquer un nouveau mode de paiement, pour l’abattage de la houille. Désormais, elle paierait le boisage à part […]. Le prix de la berline de charbon abattu serait naturellement baissé […]. » Les ouvriers, comprenant qu’il s’agit là d’une baisse déguisée des rémunérations, décident la grève, avec Lantier pour meneur. Le garçon est fort de ses idées socialisantes. Il abreuve ses camarades de paroles, mais il a mal assimilé ses lectures et manque de bases intellectuelles solides, nous dit Zola. Le cabaretier Rasseneur, qui avait jadis été licencié de la mine, se pose en concurrent de Lantier et propose une voie qu’il veut plus raisonnable ; il met en garde les ouvriers qui seraient tentés de faire main basse sur les moyens de production : « Il expliquait que la mine ne pouvait être la propriété du mineur, comme le métier est la propriété du tisserand, et il disait préférer la participation aux bénéfices, l’ouvrier intéressé, devenu l’enfant de la maison. » Mais Rasseneur ne sera pas écouté.
Lantier lui-même finit par être dépossédé de la grève qui tourne à l’émeute. Les femmes sont les plus hargneuses. Lors d’une manifestation, elles veulent déshabiller une bourgeoise qu’elles trouvent sur leur passage, et s’écrient : « Le cul à l’air ! » Puis il y a du sang. Un acte de sabotage est même commis à la mine, provoquant une catastrophe dont des ouvriers sont les premières victimes. Quand les régisseurs de la Compagnie apprennent l’origine criminelle de l’incident, ils préfèrent la taire et parler d’accident, quitte à être accusés de négligence, afin d’éviter tout effet d’imitation ; il s’agit de ne pas donner de mauvaises idées à des apprentis criminels.
La grève n’a pas que du mauvais pour la Compagnie, car elle contribue à nettoyer le marché en faisant succomber les sociétés trop faibles pour résister à un mouvement aussi dur. Une fois la grève finie, la Compagnie peut escompter acheter à prix cassé ceux de ses concurrents qui auront fait faillite entre-temps. C’est ainsi qu’une espèce de darwinisme économique est à l’œuvre.
Avec le recul, il parait évident que Germinal ne pouvait que choquer le lecteur bourgeois de l’époque, à cause du langage employé et des situations décrites. D’une certaine manière, Zola, c’est l’écrivain bourgeois qui bouscule sa classe sociale, quitte à l’effrayer, afin de la mettre en garde contre les conséquences que pourrait avoir son indifférence au sort de la classe ouvrière.
Germinal, de Zola, 1883, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Economie, Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : germinal, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)
11/04/2016
Fatherland, de Robert Harris
Thriller uchronique
Fatherland
Robert Harris imagine une intrigue policière ayant pour cadre le Berlin de 1964, capitale d’une Allemagne qui aurait gagné la guerre. Fatherland est ce qu’on pourrait appeler un thriller uchronique. A l’aide d’une solide documentation et tout en faisant preuve d’imagination, Robert Harris mêle habilement le vrai et le faux.
Par certains aspects, Fatherland a les caractéristiques d’un roman policier classique. Au départ, il s’agit d’une simple histoire de crime. Une nuit, à Berlin, l’inspecteur Xavier March, de la Kripo, la police criminelle, est appelé sur les bords de la Havel, pour constater le décès d’un individu retrouvé noyé. La victime est un ancien ministre, et sa mort n’est pas naturelle. L’inspecteur March enquête, il trouve des témoins, mais ils ont peur de parler. On cherche à l’envoyer sur de fausses pistes. Sa quête de la vérité gêne en haut lieu, lui-même reçoit des menaces…
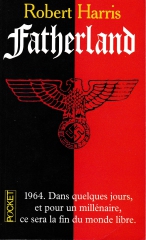 Beaucoup d’ingrédients servis dans Fatherland se retrouvent dans de nombreux autres thrillers : un assassinat, une enquête, des témoins qui se taisent définitivement, des fausses pistes, un secret d’Etat... Ce qui fait l’originalité de ce roman, c’est le contexte imaginé par l’auteur. Robert Harris a construit sa fiction sur la base d’une uchronie : il a placé son intrigue en avril 1964, dans un Berlin qui s’apprête à célébrer le soixante-quinzième anniversaire du Führer. Robert Harris imagine qu’Hitler a gagné la guerre et qu’il domine l’Europe. A condition d’accepter cette hypothèse de départ, les informations données par Robert Harris paraissent vraisemblables et font froid dans le dos. La nouvelle Europe est dominée par l’Allemagne qui a annexé ses proches voisins : « Le Luxembourg était devenu le Moselland, l’Alsace-Lorraine la Westmark ; l’Autriche, l’Ostmark. Même scénario pour la Tchécoslovaquie – le petit bâtard de Versailles n’était plus que le protectorat de Bohême et de Moravie. La Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie : gommées de la carte. […] A l’ouest, douze nations [dont la France et la Grande-Bretagne] avaient lié leur sort à celui de l’Allemagne, par le traité de Rome, et formaient l’espace économique européen. L’allemand était la deuxième langue officielle dans toutes les écoles. » Edouard VIII a été réinstallé sur le trône d’Angleterre et règne avec la reine Wallis à ses côtés. La Guerre froide oppose l’Allemagne aux Etats-Unis, mais la Détente semble se profiler, avec l’annonce du voyage qu’a prévu de faire à Berlin le président Kennedy. Il s’agit bien sûr de Joseph Kennedy, soixante-quinze ans, qui, quand il était ambassadeur en Allemagne avant-guerre, était réputé pour ses sympathies pro-nazies.
Beaucoup d’ingrédients servis dans Fatherland se retrouvent dans de nombreux autres thrillers : un assassinat, une enquête, des témoins qui se taisent définitivement, des fausses pistes, un secret d’Etat... Ce qui fait l’originalité de ce roman, c’est le contexte imaginé par l’auteur. Robert Harris a construit sa fiction sur la base d’une uchronie : il a placé son intrigue en avril 1964, dans un Berlin qui s’apprête à célébrer le soixante-quinzième anniversaire du Führer. Robert Harris imagine qu’Hitler a gagné la guerre et qu’il domine l’Europe. A condition d’accepter cette hypothèse de départ, les informations données par Robert Harris paraissent vraisemblables et font froid dans le dos. La nouvelle Europe est dominée par l’Allemagne qui a annexé ses proches voisins : « Le Luxembourg était devenu le Moselland, l’Alsace-Lorraine la Westmark ; l’Autriche, l’Ostmark. Même scénario pour la Tchécoslovaquie – le petit bâtard de Versailles n’était plus que le protectorat de Bohême et de Moravie. La Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie : gommées de la carte. […] A l’ouest, douze nations [dont la France et la Grande-Bretagne] avaient lié leur sort à celui de l’Allemagne, par le traité de Rome, et formaient l’espace économique européen. L’allemand était la deuxième langue officielle dans toutes les écoles. » Edouard VIII a été réinstallé sur le trône d’Angleterre et règne avec la reine Wallis à ses côtés. La Guerre froide oppose l’Allemagne aux Etats-Unis, mais la Détente semble se profiler, avec l’annonce du voyage qu’a prévu de faire à Berlin le président Kennedy. Il s’agit bien sûr de Joseph Kennedy, soixante-quinze ans, qui, quand il était ambassadeur en Allemagne avant-guerre, était réputé pour ses sympathies pro-nazies.
S’inspirant des projets d’Albert Speer qui était l’architecte d’Hitler, Robert Harris plante le décor et imagine à quoi ressemble la capitale du Reich hitlérien. Xavier March, en compagnie de son jeune fils, a pris place à bord d’un autobus touristique qui fait le tour de Berlin. Le guide leur présente les principaux monuments de la ville en commençant par le plus célèbre, le Grand Dôme. Il précise : « Le Grand Dôme du Reich est le plus grand édifice au monde. Il s’élève à plus d’un quart de kilomètre du sol et certains jours – remarquez aujourd’hui – le sommet est invisible. La coupole fait cent quarante mètres de diamètre ; elle peut contenir seize fois Saint-Pierre de Rome. » La visite se poursuit avec l’Arc de Triomphe ; le guide croit bon d’ajouter que « l’Arc de Triomphe de Paris y pénétrerait quarante-neuf fois. » Quand l’autobus s’engage dans l’imposante avenue de la Victoire, il est précisé qu’elle est « deux fois et demie plus longue que les Champs-Elysées à Paris. » Robert Harris, ou plutôt Xavier March, conclut : « Plus haut, plus long, plus grand, plus large, plus cher… Même dans la victoire, pensait March, l’Allemagne gardait un complexe d’infériorité. Rien n’avait de valeur en soi. Tout se comparait à ce qui existait ailleurs. »
Dans cette nouvelle Allemagne, reste un sujet tabou :
le sort des Juifs
La victoire de l’Allemagne apparaît d’ailleurs toute relative. Sur le papier, elle a gagné de vastes territoires à l’Est. La propagande promet aux volontaires de devenir colons sur des terres qui leur sont distribuées gracieusement. Pourtant ces vastes espaces ne sont pas sûrs. Robert Harris présente l’envers du décor : « La propagande montrait des colons heureux vivant dans l’opulence. Mais d’autres informations filtraient, sur la situation réelle : une existence conditionnée par un sol pauvre, un travail harassant, les mornes cités-dortoirs où les Allemands devaient se réfugier la nuit tombée, par crainte des attaques des partisans locaux. »
Dans cette nouvelle Allemagne, reste un sujet tabou : le sort des Juifs. Les personnages du roman s’abstiennent d’en parler, ou le font à mots couverts. L’un d’entre eux se borne à dire, quand il est question des Juifs au cours d’une conversation : « Comme chacun sait, ils sont à l’Est. » Et le personnage change aussitôt de sujet.
Ce qui rend percutant Fatherland, c’est le mélange habile entre le vrai et le faux. Robert Harris a su trouver le bon équilibre entre les deux. Par exemple, les citations d’Hitler qu’il met en exergue sont authentiques. Certes le Berlin colossal qu’il imagine n’a jamais vu le jour, mais il correspond, monument par monument, à celui qu’Hitler avait prévu de bâtir à partir des plans de Speer, si l’Allemagne avait gagné la guerre. A la lecture du livre, on perçoit que Robert Harris, tout en faisant preuve d’imagination, s’est solidement documenté sur le IIIème Reich.
Publié en 1992, Fatherland est le premier roman écrit par Robert Harris et contribua à sa renommée. Depuis, l’auteur s’est fait le spécialiste du thriller historique, visitant différentes époques, l’une après l’autre. Son dernier livre, D., publié en 2014, porte sur l’affaire Dreyfus. Robert Harris est aussi l’auteur de Ghostwriter, adapté au cinéma par Polanski.
Fatherland, de Robert Harris, 1992, collection Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Policier, thriller, XXe, XXIe siècles | Tags : fatherland, robert harris | Lien permanent | Commentaires (0)


