21/09/2015
Les Grandes Familles, de Druon
Chronique sur les mœurs hypocrites de la France d’en-haut
Les Grandes Familles
Ce roman met en scène les La Monnerie, l’une des plus vieilles familles de France, alliée aux Schoudler, propriétaires de la banque du même nom. Sous forme de chronique, Druon entremêle les destins et les personnages, et dépeint des mœurs hypocrites. Les Grandes Familles est un livre très facile à lire, d’autant plus que Druon a l’art de la formule pour résumer une situation.
Pour certains, Les Grandes Familles, c’est d’abord un film, réalisé par Denys de La Patelière, avec Jean Gabin, Pierre Brasseur, Bernard Blier et Jean Desailly. Pourtant on ne peut oublier que le film est l’adaptation du roman de Maurice Druon, auquel fut décerné le prix Goncourt en 1948.
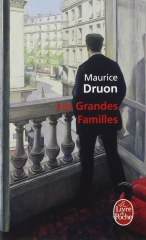 Le livre présente une fresque de la haute société des années 1920. Sous forme de chronique, Druon entremêle les destins, passe d’un personnage à l’autre et associe le lecteur à leur sort. Le livre est foisonnant, mais le récit n’est pas du tout confus. Les personnages sont très typés, le lecteur a le temps de s’intéresser à chacun d’entre eux et de se préoccuper de son sort. Le style de Druon est fluide ; l’auteur n’abuse pas des descriptions et surtout il a l’art de la formule. Il sait tourner ses phrases de façon à résumer une situation et frapper l’esprit du lecteur.
Le livre présente une fresque de la haute société des années 1920. Sous forme de chronique, Druon entremêle les destins, passe d’un personnage à l’autre et associe le lecteur à leur sort. Le livre est foisonnant, mais le récit n’est pas du tout confus. Les personnages sont très typés, le lecteur a le temps de s’intéresser à chacun d’entre eux et de se préoccuper de son sort. Le style de Druon est fluide ; l’auteur n’abuse pas des descriptions et surtout il a l’art de la formule. Il sait tourner ses phrases de façon à résumer une situation et frapper l’esprit du lecteur.
La peinture que fait Druon des élites n’est pas reluisante. Les personnages sont mesquins et centrés sur eux-mêmes : « Chacun […] était un être trop important, ou se croyait tel, pour être occupé d’autre chose que de la pensée de soi. » A lire ce roman, on pourrait croire qu’il est l’œuvre d’un écrivain désabusé qui a beaucoup vécu. Or, en 1948, Druon avait à peine trente ans. Ce livre est donc sorti de la plume d’un jeune homme qui venait de faire son début dans la vie, mais qui, il est vrai, avait déjà traversé un certain nombre d’épreuves.
La première des grandes familles dépeintes par Druon est celle des La Monnerie. Ils sont quatre frères : le marquis, le poète académicien, le ministre plénipotentiaire et le général. Les La Monnerie sont alliés aux Schoudler, propriétaires de la banque Schoudler, la fille du poète ayant épousé le fils du baron Noël Schoudler. Cette alliance contre nature ne fut pas vraiment du goût des La Monnerie, qui constituent l’une des plus vieilles familles de France. Avant son mariage, la fille du poète fut mise en garde au sujet des Schoudler : « ce sont des Juifs, mon enfant ; anoblis, convertis, c’est entendu ; mais enfin, il ne faut pas gratter très loin pour trouver le comptoir du prêteur sur gages. »
Celui qui fait le plus honte aux frères La Monnerie, c’est leur demi-frère Lucien Maublanc, né du remariage de leur mère avec un roturier. Il aggrave son cas en étant buveur, coureur et joueur. Lors d’un conseil de famille orageux au cours duquel se règlent des comptes, Lucien Maublanc dit leurs quatre vérités aux La Monnerie : « Vous m’en voulez de ma naissance. Vous en avez voulu à ma mère d’avoir épousé en secondes noces un homme qui n’était pas marquis ou comte comme vous, et que vous méprisiez à cause de cela. A vos yeux, je suis le fruit d’une mésalliance. »
Jean de La Monnerie a acquis la célébrité
grâce à des vers volés à Sully Prudhomme
Dans ce livre, le mensonge est permanent. Ainsi Jean de La Monnerie, de l’Académie française, a acquis la célébrité grâce à son poème L’Oiseau sur le lac ; or Druon nous apprend qu’il n’en est pas le véritable auteur. Un soir, après dîner, « Sully Prudhomme discourait d’un projet qu’il avait en tête ; La Monnerie avait cueilli l’idée au vol » et se l’était appropriée.
Même les grands principes moraux que défend la famille ne sont que pur affichage. Le grand poète catholique aura multiplié les maîtresses, et son épouse bafouée, devenue veuve, lui en garde rancune. Mais elle aussi se révèle hypocrite. Quand sa nièce, mademoiselle Isabelle d’Huisnes, lui confesse qu’elle attend un enfant, elle lui conseille d’aller consulter le professeur Lartois, ami de la famille, « pour que tout se passe le plus silencieusement possible. » Isabelle est indignée de la recommandation émise par sa tante : « Comment, ma tante, c’est vous si pratiquante, vous qui ne manqueriez pas la messe un dimanche… » Melle d’Huisne n’a pas le temps de finir sa phrase, car Mme de La Monnerie, qui a réponse à tout, lui coupe sèchement la parole : « Oh ! ma petite enfant, tu ne vas me donner des leçons de conduite chrétienne ! […] Quand on commet un premier péché, il en entraîne toute une série d’autres. […] Tu commettras un péché de plus qui est la suite inévitable de tes autres péchés. »
La personnalité la plus forte du roman est le baron Noël Schoudler, président de la banque Schoudler et régent de la Banque de France. Ce géant règne en potentat sur sa famille et ses affaires et ne supporte pas que les autres lui fassent concurrence. Quand il se rend compte que son fils et successeur désigné prend trop d’importance et commence de lui faire de l’ombre, il est décidé à lui donner une leçon, faisant ainsi abstraction de tout amour paternel. Quant à Lucien Maublanc, c’est sa bête noire, il est décidé à l’abattre. Dans l’exécution de ses œuvres, il s’adjoint Simon Lachaume, un jeune agrégé plein d’ambition, qui devient son fils de substitution.
Pourtant, malgré sa puissance et la crainte qu’il inspire aux autres, Noël Schoudler présente une faiblesse, il a peur de la mort. Cette peur de la mort est récurrente dans le roman et habite l’ensemble des personnages, bien qu’aucun d’entre eux n’ose en parler, précise Druon : « Non ! Personne n’avoue jamais sa hantise de la mort ; et cette retenue n’est point, comme on le prétend dignité ; elle est souci surtout de ne pas effaroucher l’aide d’autrui. […] Tout, les civilisations, les cités, les sentiments, les arts, les lois et les armées, tout est enfant de la peur et de sa forme suprême, totale, la peur de la mort. »
Rare personnage positif du livre, un père dominicain essaye d’expliquer le sens de la vie et de la mort à une jeune veuve dont le mari s’est suicidé.
Les Grandes Familles est un livre très facile à lire, édité dans la collection Le Livre de Poche. Il existe une suite, publiée sous le titre Les Corps qui tombent, qui n’est malheureusement plus disponible en poche. Outre le film de Denys de La Patelière, il existe une adaptation en feuilleton qui avait été réalisée pour la télévision, à la fin des années quatre-vingt. Edouard Molinaro y dirigeait Michel Piccoli, Roger Hanin, Pierre Arditi et Marie Trintignant, dans les principaux rôles. Cette version est beaucoup plus fidèle au roman que le film de La Patelière.
Les Grandes Familles, de Maurice Druon, 1948, collection Le Livre de Poche.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : les grandes familles, druon | Lien permanent | Commentaires (0)
07/09/2015
Pétain, de Bénédicte Vergez-Chaignon
Du héros de Verdun à l’homme de Vichy
Pétain
Le livre de Bénédicte Vergez-Chaigon est un pavé d’un millier de pages, aux caractères serrés. L’auteur montre comment Pétain a pu, en moins de trois ans, passer du grade de colonel à la fonction de commandant en chef de l’armée française, et comment le vainqueur de Verdun, héros national, a pu se transformer en l’homme de Vichy, chef de l’Etat français et collaborateur avec l’ennemi.
En ouverture de son livre, la très sérieuse historienne Bénédicte Vergez-Chaignon se livre à un exercice d’uchronie. Elle imagine que Pétain soit mort à la veille de la seconde guerre mondiale, en 1937 ou 1938 :
« Mort à quatre-vingt-deux ou quatre-vingt-trois ans, le maréchal Pétain aurait été comblé d’honneurs. Ses cendres auraient été transférées à l’ossuaire de Douaumont, parmi les morts de Verdun, selon ses dernières volontés. […] Des rues, des établissements scolaires, des hôpitaux porteraient son nom, sans que personne ne trouve à y redire. Mais, en véritable personnage faustien, Philippe Pétain a acheté ses années de vie supplémentaires au prix de sa gloire et de sa postérité historique. »
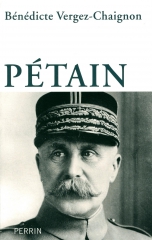 La lecture de cette biographie permet de mieux comprendre la personnalité de Pétain. Au printemps 1914, âgé de cinquante-huit ans, le colonel Pétain est un officier ordinaire, qui attend que l’heure de la retraite sonne. Il appartient à la génération qui se prépare à la revanche depuis plusieurs décennies. Etant âgé de quatorze ans en 1870, il était trop jeune pour combattre. Il s’apprête donc à partir en retraite sans avoir jamais fait la guerre. Mais, à l’été 1914, la guerre éclate et rebat les cartes.
La lecture de cette biographie permet de mieux comprendre la personnalité de Pétain. Au printemps 1914, âgé de cinquante-huit ans, le colonel Pétain est un officier ordinaire, qui attend que l’heure de la retraite sonne. Il appartient à la génération qui se prépare à la revanche depuis plusieurs décennies. Etant âgé de quatorze ans en 1870, il était trop jeune pour combattre. Il s’apprête donc à partir en retraite sans avoir jamais fait la guerre. Mais, à l’été 1914, la guerre éclate et rebat les cartes.
L’effectif de soldats mobilisés est tel, que le nombre d’officiers généraux n’est pas suffisant pour encadrer les divisions qui se mettent en place. Le grand quartier général est obligé de puiser dans le vivier des colonels. Ainsi le colonel Pétain est bombardé général et reçoit le commandement d’une division.
Le 6 septembre 1914, sa division est impliquée dans de violents combats. Le général Pétain pourrait choisir de rester chaudement à l’arrière. Au lieu de cela, il « choisit de montrer l’exemple en se portant en avant de la première ligne, accompagné de quelques officiers », note Bénédicte Vergez-Chagnon, qui poursuit : « Ainsi apparaît l’un des éléments de ce qui constituera sa légende. »
Pétain acquiert une réputation d’organisateur
qui prépare soigneusement ses offensives
L’ascension de Pétain est fulgurante. Simple colonel en 1914, il reçoit le commandement de l’armée de Verdun en 1916, puis, en 1917, il est nommé commandant en chef des armées du Nord et de l’Est, c’est-à-dire généralissime. Pétain a gagné une réputation d’organisateur, qui lui a permis de se distinguer. Avec lui, rien n’est improvisé, tout est réfléchi. Les offensives ne sont pas lancées prématurément, mais soigneusement organisées. Elles doivent être précédées de reconnaissance aérienne des positions ennemies, et de tirs d’artillerie précis et abondants.
Pétain s’est aussi acquis la réputation d’être économe du sang des soldats. Bénédicte Vergez-Chaignon insiste cependant sur le fait que c’est par réalisme que Pétain veut en finir avec les percées inutiles et coûteuses en hommes. Ce n’est pas la compassion qui l’anime, car lui-même sait faire preuve de cruauté. Ainsi en Artois, écrit l’auteur, « le général fait ligoter et jeter par-dessus le parapet de la tranchée des hommes qui se sont mutilés volontairement en se tirant dans un membre, les exposant à une mort atroce différée. »
En 1917, le nouveau commandant en chef Pétain est confronté à une grave crise qui touche l’armée : la guerre s’éternise et les mutineries se multiplient. Pétain fait face et apporte sa réponse : d’un côté il déclenche la répression contre ceux qu’il considère les meneurs et autorise les formes de justice expéditive avec condamnation à mort sans appel ; et d’un autre côté, une fois l’impression de terreur installée dans la troupe, il se préoccupe du quotidien des soldats, en améliorant notamment leur nourriture et leur équipement. Sans nul doute, cette méthode porte ses fruits. Mais, si Pétain redresse effectivement la situation, il n’est pas exagéré de dire que, fort de son succès, sa pensée s’est figée à la suite de Verdun et des mutineries. Dès cette époque, il acquiert la conviction d’avoir eu raison contre tout le monde et d’être le dernier recours pour faire face à une crise morale qui pourrait frapper le pays.
Le président Poincaré est effaré par le pessimisme de Pétain
Alors que Pétain estime que sa méthode a fait ses preuves, assez curieusement il ne fait pas l’unanimité. Raymond Poincaré, président de la République, est effaré par son pessimisme. Il est vrai que dans presque toutes les situations Pétain, tel un Cassandre, multiplie les mises en garde et prévoit le pire. Ainsi, en cas d’échec, note l’auteur, « on ne pourra pas dire qu’il n’avait pas prévenu. » Clemenceau, président du Conseil, continue d’apporter son soutien à Pétain, mais, quand il s’agit de nommer un chef suprême à la tête des armées alliées, il donne la préférence à Foch. Dans son livre Le Tigre, publié en 1930, Jean Martet, qui fut son secrétaire, rapporte cette confidence que lui fit Clemenceau après la Grande Guerre :
« A Doullens, je me suis trouvé entre deux hommes, l’un qui me disait que nous étions fichus, l’autre qui allait et qui venait comme un fou et qui voulait se battre. Je me suis dit : « Essayons Foch. Au moins, nous mourrons le fusil à la main. » J’ai laissé cet homme sensé, plein de raison, qu’était Pétain ; j’ai adopté ce fou qu’était Foch. C’est le fou qui nous a tirés de là. »
Après la victoire de 1918, Pétain est couvert d’honneurs. Elevé à la distinction de maréchal de France, il est maintenu à la tête de l’armée française. En 1922, il a soixante six ans et, déjà, le général Buat, son second, note que le maréchal vieillit et qu’ « il lui arrive d’être embrouillé et peu compréhensible. »
La méthode Pétain en politique internationale
consiste à proposer d’emblée des concessions
pour montrer sa bonne volonté
Dans les années qui suivent, le maréchal Pétain fait preuve de loyauté vis-à-vis de la République. Loin d’être un militaire factieux, il est au contraire un homme respectueux des institutions. Mais, pessimiste par nature, il voit la guerre approcher et se convainc que la France n’est pas prête. Il est très remonté contre le SNI, le syndicat national des instituteurs, et parle de « l’influence néfaste » qu’exercent certains maîtres sur leurs élèves. En 1934, pour la première fois, il parle de procéder au « redressement moral […] nécessaire au bien du pays. » Un an plus tard, le journal La Victoire lance l’appel : « C’est Pétain qu’il nous faut. »
En mars 1939, Pétain est nommé ambassadeur à Madrid, auprès du gouvernement franquiste. Face au risque de guerre avec l’Allemagne, Pétain a pour mission d’obtenir la neutralité de l’Espagne. Cette ambassade sert de laboratoire à sa méthode en matière de relations internationales. A Madrid, Pétain rencontre Franco et cède à toutes ses demandes. Il s’agit, selon Bénédicte Vergez-Chaignon, de « proposer d’emblée des concessions, y compris majeures, pour montrer sa bonne volonté, demander ensuite que le partenaire, rival ou adversaire, agisse de même, être prêt à de nouvelles concessions si la première passe n’a pas abouti. En somme, une politique du toujours plus faible au toujours plus fort […]. » Cette méthode que Pétain utilise face à Franco, il la reproduira face à Hitler et se lancera dans la politique de collaboration avec l’Allemagne.
En mai 1940, l’armée allemande envahit la France. Pétain est rappelé en France et entre au gouvernement. Devenu vice-président du Conseil, il est accablé par la débâcle et parle d’ « affreuse épreuve ». Il porte sa part de responsabilité, lui qui, quelques années auparavant, jugeait le massif des Ardennes infranchissable par l’armée ennemie. Pourtant, en juin 1940, Pétain apparaît comme le recours. Il ne croit plus du tout à un renversement de la situation militaire et se résigne à un armistice. Il veut le signer le plus tôt possible, de façon à ce qu’il soit assez avantageux. Selon l’auteur, « non seulement il pense que l’armistice préserve un avenir […], mais il pense être le mieux – le seul – pour en tirer quelque chose. » L’armistice signé, il fait voter une loi, le 11 juillet 1940, qui lui accorde les pleins pouvoirs, mais dans le cadre de la République. Dès le lendemain, un acte constitutionnel, outrepassant la loi votée la veille, fait de lui le chef de l’Etat et abolit la République.
La seconde partie du livre est essentiellement consacrée aux quatre années passées par Pétain à la tête de l’Etat français. Très détaillée, elle intéressera surtout les spécialistes. En revanche, les 400 premières pages, sur Pétain avant Vichy, peuvent être lues par un public assez large.
Pétain, de Bénédicte Vergez-Chaignon, 2014, éditions Perrin.
07:34 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : pétain, bénédicte vergez-chaignon | Lien permanent | Commentaires (0)
24/08/2015
Bel-Ami, de Maupassant
L’irrésistible ascension d’un être amoral
Bel-Ami
Journaliste dénué de scrupule, Georges Duroy, dit Bel-Ami, est prêt à prendre tous les moyens possibles pour assouvir son ambition. Fort de son pouvoir de séduction, il multiplie les conquêtes et se sert des femmes pour accéder à la richesse et aux honneurs. Maupassant fait de Bel-Ami un être amoral, narcissique et sans conviction, qui évolue dans un milieu, celui des élites politiques, financières et intellectuelles, qui est peu reluisant.
« Le monde est aux forts. Il faut être fort. Il faut être au-dessus de tout. » Telle est la leçon que Georges Duroy tire de l’existence, et qui le guide dans la vie. A force de cynisme et de calculs, il arrive en seulement quelques mois à se faire un nom dans le journalisme et à devenir une personnalité du tout Paris. Pourtant rien ne semblait écrit à l’avance. Au départ, Georges Duroy est un garçon de vingt-huit ans qui est simple employé de bureau. Il végète aux Chemins de fer et enrage de sa modeste position, lui qui se croit promis aux plus hautes destinées. Mais comment s’élever dans la société quand on est sans le sou et sans relation. Un jour, la chance lui sourit quand par hasard il croise Charles Forestier, un ancien camarade de régiment, qu’il a connu en Algérie. Forestier est devenu journaliste et dirige la politique à La Vie française. Autant dire qu’il a réussi dans l’existence. Il se propose d’aider son camarade Duroy et le fait entrer au journal, à un poste modeste pour commencer.
 A la manière de Lucien de Rubempré dans Illusions perdues, Duroy est fasciné par les facilités qu’offre le métier. Comme chez Balzac, le journaliste ne paie pas sa place au spectacle ; en entrant aux Folies-Bergères, alors que Duroy lui fait remarquer qu’il a omis de passer au guichet, Forestier lui répond d’un ton important : « Avec moi on ne paie pas. »
A la manière de Lucien de Rubempré dans Illusions perdues, Duroy est fasciné par les facilités qu’offre le métier. Comme chez Balzac, le journaliste ne paie pas sa place au spectacle ; en entrant aux Folies-Bergères, alors que Duroy lui fait remarquer qu’il a omis de passer au guichet, Forestier lui répond d’un ton important : « Avec moi on ne paie pas. »
Un soir, Duroy est invité à dîner chez Forestier en présence de M. Walter, directeur de La Vie française. Au cours du repas, Duroy brille en racontant son séjour en Afrique, il captive son auditoire au point que M. Walter lui commande une série d’articles sous le titre Souvenirs d’un chasseur d’Afrique. Rentré chez lui, Duroy est poursuivi par l’article à rédiger et sent que son cerveau ne sera soulagé qu’une fois la tâche accomplie. Il se lance aussitôt dans le travail d’écriture, mais sèche devant la page blanche. Il lui est impossible de mettre noir sur blanc les souvenirs d’Afrique qu’il avait spontanément et brillamment racontés au dîner. Les mots ne viennent pas et les idées ne s’enchaînent pas. Le lendemain matin, Duroy reste complètement paralysé et ne voit plus qu’une solution, s’en remettre à Forestier pour qu’il le dépanne. Complètement débordé ce jour-là, Forestier lui conseille d’aller voir sa femme, qui est sa collaboratrice et qui pourra lui donner un coup de main. Recevant Duroy, Mme Forestier lui déclare : « Oui, je vous arrangerai la chose. Je ferai la sauce, mais il me faut le plat. » Comme un prêtre au confessionnal, elle le presse de questions et lui demande un maximum de détails. Grâce à son savoir-faire, elle met en forme les souvenirs de Duroy, elle brode et invente des détails susceptibles d’accrocher l’attention du lecteur, pratiquant ce qu’on appellerait aujourd’hui le « bidonnage ». Auprès de Mme Forestier, Duroy apprend le métier et prend de l’aisance en rédigeant des échos pour La Vie française, si bien qu’au bout de quelques temps il acquiert ce que Maupassant appelle la « souplesse de la plume. »
Dans l’exercice de l’activité de journaliste, Duroy
compense son absence de bagage culturel par son caractère et son culot
Duroy n’a pas fait d’études et n’est pas cultivé. Quand devant lui un rédacteur fait référence à Balzac, il ne comprend pas, n’ayant jamais lu Balzac de sa vie. Mais peu importe que Duroy soit un être inculte, il compense cette lacune par sa force de caractère : il est volontaire, roublard, débrouillard et plein de culot. Bref, il a les qualités requises pour l’exercice du métier de journaliste. Duroy réussit même à ce que son absence de bagage culturel soit un atout. Dépourvu de conviction, il n’a aucun état d’âme à mettre sa plume au service des idées défendues par son employeur. Maupassant donne en exemple un confrère de Duroy qui « passait d’une rédaction dans une autre comme on change de restaurant, s’apercevant à peine que la cuisine n’avait pas tout à fait le même goût. » Or, poursuit Maupassant, « les inspirateurs et véritables rédacteurs de La Vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait à la Chambre “la bande à Walter” et on les enviait parce qu’ils devaient gagner de l’argent avec lui et par lui. » Duroy, par sa souplesse d’esprit, devient l’homme de la situation. Il gravit les échelons à La Vie française et devient indispensable à ses commanditaires. Mais malheur à qui viendrait le limiter au rôle d’idiot utile ! Duroy n’est pas né de la dernière pluie et entend compter parmi les bénéficiaires des combinaisons de la bande à Walter.
Duroy a conscience de sa valeur. C’est un être narcissique qui aime à se contempler dans un miroir. Il est conscient du charme qu’il exerce auprès des dames et se trouve lui-même « pris d’un grand désir d’amour ». Dès lors, il réussit à concilier son plaisir et son intérêt. Il sait que c’est par l’intermédiaire des femmes du monde qu’il peut parvenir au sommet. Son objectif en tête, il multiplie les conquêtes. Dans un premier temps il séduit Mme de Marelle, dont la famille lui trouve le surnom de Bel-Ami. A ses débuts, c’est Mme de Marelle qui l’entretient et lui procure le train de vie nécessaire à ses projets. D’autres conquêtes suivront.
Bel-Ami sait rompre toute liaison
qui ne lui est plus d’aucune utilité
Un soir, Duroy raccompagne le poète Norbert de Varenne, l’une des plus prestigieuses signatures de La Vie française. Alors qu’ils échangent tous les deux, Varenne lui avoue, à son âge avancé, être « hanté par la peur de la mort ». Il poursuit : « Une vie ! quelques jours, et puis plus rien. On naît, on grandit, on est heureux, on attend, puis on meurt. » Duroy médite les paroles de Varenne sur l’absurdité de la vie et se forge sa propre philosophie. Il en arrive à la conclusion qu’il faut se montrer fort : « Chacun pour soi. La victoire est aux audacieux. Tout n’est que de l’égoïsme. L’égoïsme pour l’ambition et la fortune vaut mieux que l’égoïsme pour la femme et pour l’amour. » Fort de sa volonté de réussir, Bel-Ami met son principe en application. Dorénavant les femmes ne seront plus un but, mais exclusivement le moyen d’arriver à ses fins. L’homme à femmes qu’il est se résoudra à rompre toute liaison qui n’est plus d’aucune utilité. Il consacrera ses forces à conquérir les femmes qui peuvent le faire progresser dans sa carrière. L’accumulation d’argent devient primordiale à ses yeux. Pour reprendre une expression de Maupassant à propos des combinaisons politiques, il ne faut pas dire à son sujet « Cherchez la femme », mais « Cherchez l’affaire ».
Par ailleurs, Duroy aime les honneurs et ne résiste pas à ce qui brille. Il obtient la Légion d’honneur et, pour satisfaire sa vanité, il parvient à transformer son patronyme en jouant sur le nom de plume qu’il s’est attribué. Au cours du roman, Georges Duroy devient officiellement Georges Du Roy du Cantel.
Comme l’ensemble de l’œuvre de Maupassant, Bel-Ami est un livre facile à lire. Peut-être encore aujourd’hui se trouvera-t-il des lecteurs épris de bons sentiments, qui éprouveront du dégoût face à l’accumulation de tant de bassesses. En réalité, Du Roy n’est pas un être immoral, mais amoral. Il est convaincu de l’absurdité de la vie et conclut que seule la réussite, sa réussite, lui permettra de donner un sens à son existence. Maupassant ne s’attaque pas aux institutions en tant que telles, il ne sape pas la société sur ses bases, il ne juge pas les hommes, mais montre quel peut être leur comportement.
Bel-Ami, de Maupassant, 1885, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : bel-ami, maupassant | Lien permanent | Commentaires (0)


