06/07/2015
Le Voyage de Monsieur Perrichon, de Labiche
Le triomphe du bourgeois ridicule
Le Voyage de Monsieur Perrichon
Le Voyage de Monsieur Perrichon est la pièce la plus connue d’Eugène Labiche. C’est une farce féroce qui met en scène un bourgeois ridicule, monsieur Perrichon, qui est à Labiche ce que monsieur Jourdain fut à Molière. La pièce est drôle, enlevée et remplie de quiproquos, si bien que sa lecture, ou sa relecture, est un vrai régal.
Monsieur Perrichon est un bourgeois parvenu, devenu rentier après avoir fait fortune comme carrossier. Il part en voyage en compagnie de sa femme et de sa fille. Ils se rendent, par chemin de fer, en Savoie. Au cours de leur séjour, ils ont l’intention de visiter la Mer de Glace. Arrivés là-bas, ils croisent deux jeunes gens de leur connaissance, Armand Desroches et Daniel Savary, qui sont en compétition pour obtenir la main de mademoiselle Perrichon. La jeune fille n’a donné la préférence à aucun des deux ; très soumise, elle a décidé de s’en remettre à ses parents, attendu que leur choix sera le bon. Lors de la visite de la Mer de Glace, Armand Desroches sauve la vie de M. Perrichon, qui, sans sa présence d’esprit, serait tombé dans un précipice. Le jeune homme croit avoir gagné la partie, mais au lieu de lui témoigner de la reconnaissance, Perrichon est agacé d’être son obligé, d’autant plus que sa femme et sa fille lui rappellent sans cesse ce fait. Lui, relativise en disant : « Il m’a sauvé ! Toujours le même refrain ! ». Atteint dans sa vanité, Perrichon prend en grippe Armand Desroches.
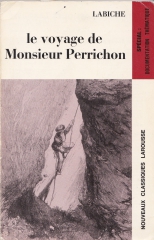 De son côté, Daniel Leroy fait mieux. Plutôt que de sauver la vie de M. Perrichon, c’est M. Perrichon qui lui sauve la vie. Perrichon savoure son acte de bravoure et se répète à l’oreille : « J’ai sauvé un homme ! » Content de lui, il déclare à Daniel Savary : « Vous me devez tout ! Je ne l’oublierai jamais. » Pas dupe, sa femme dit à Perrichon : « Ca flatte ta vanité. »
De son côté, Daniel Leroy fait mieux. Plutôt que de sauver la vie de M. Perrichon, c’est M. Perrichon qui lui sauve la vie. Perrichon savoure son acte de bravoure et se répète à l’oreille : « J’ai sauvé un homme ! » Content de lui, il déclare à Daniel Savary : « Vous me devez tout ! Je ne l’oublierai jamais. » Pas dupe, sa femme dit à Perrichon : « Ca flatte ta vanité. »
Perrichon est un personnage hautement ridicule. Pédant, il est friand d’envolées lyriques. Sa fille lui sert de secrétaire pour noter ses impressions de voyage. A l’auberge, sur le livre des voyageurs il écrit cette sentence, faute d’orthographe comprise : « Que l’homme est petit quand on le contemple du haut de la mère de glace. » Perrichon est vaniteux, fanfaron, mais aussi imprudent et pleutre ; c’est une espèce d’Achille Talon du XIXe siècle.
Par comparaison, les deux jeunes gens paraissent plus fades. Ils sont dans les affaires, mais ni l’un ni l’autre ne sont débordés de travail. Ils s’accordent volontiers un congé, à condition d’être rentrés à Paris pour toucher leur dividende.
Malgré tous ses défauts,
Perrichon est un être attachant
La pièce est une peinture de la bourgeoisie triomphante, qui s’épanouit sous le Second Empire. 1860, année de la création de la pièce, voit le rattachement de la Savoie à la France. Napoléon III est à son apogée, la France est enfin entrée, avec retard, dans la Révolution industrielle, et ses paysages se transforment avec la construction d’un vaste réseau de chemin de fer. La bourgeoisie doit beaucoup à l’empereur qui garantit l’ordre et la prospérité. On pourrait croire qu’elle lui restera fidèle, mais cela n’est qu’une illusion. Il ne faut pas oublier que Perrichon, archétype du bourgeois du Second Empire, est un pleutre capable de retourner sa veste au gré des événements.
Malgré tous ses défauts, M. Perrichon est un personnage attachant. Ce n’est pas un mauvais bougre et il a un bon fond. Ses mésaventures sont l’occasion de tirer un certain nombre de leçons de vie. Alors qu’Armand Desroches ne parvient pas à comprendre pourquoi après avoir sauvé la vie de Perrichon, ce dernier fait preuve d’ingratitude à son égard, son rival Daniel Savary lui explique doctement ceci : il faut savoir se cacher, se masquer pour rendre service à son semblable, de façon à ce qu’il n’ait pas à supporter la charge écrasante de la reconnaissance ; il vaut mieux flatter sa vanité, comme l’a fait Daniel, qui conclut : « Les hommes ne s’attachent point en raison des services que nous leur rendons, mais en raison de ceux qu’ils nous rendent. » Cette conclusion est toute provisoire, car la pièce réserve encore des rebondissements.
Le Voyage de Monsieur Perrichon, de Labiche, 1860, collections Classique Larousse, Folio et Librio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Théâtre | Tags : le voyage de monsieur perrichon, labiche | Lien permanent | Commentaires (0)
22/06/2015
L'Assommoir, de Zola
Docu-fiction sur les ravages de l’alcool dans la France d’en-bas
L’Assommoir
L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste, tel que Zola le concevait. L’auteur plonge le lecteur au milieu du petit peuple des faubourgs de Paris. Le personnage principal, Gervaise, épouse un ouvrier zingueur qui, suite à un accident du travail, tombe sous la dépendance de l’alcool. A l’époque, Zola choqua nombre de lecteurs par les situations décrites et le vocabulaire employé.
Dans L’Assommoir, Zola charge son histoire en détails qui peuvent donner l’impression d’alourdir l’ensemble, si bien que de nombreux lecteurs risquent de s’impatienter. Ils pourraient être tentés de sauter des pages, ce qui n’est guère aisé et risque de les faire passer à côté de l’essentiel. Le mieux, pour ne pas s’ennuyer, est de considérer L’Assommoir comme un documentaire-fiction. L’intérêt du livre est de plonger le lecteur dans une classe sociale précise, celle des milieux populaires des faubourgs de Paris, sous le Second Empire. Zola a accompli tout un travail d’enquête qu’il restitue au lecteur sous forme de fiction. L’abondance de détails qu’il donne devient alors une force, ce sont des détails qui « font vrai » et qui permettent de partager la vie quotidienne des ouvriers et des artisans. En cela, L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste et social.
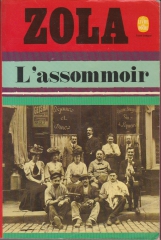 Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »
Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »
Un jour, Lantier la quitte et lui laisse leurs deux petits garçons sur les bras. Abandonnée, Gervaise se marie, par dépit, avec Coupeau, un brave garçon, zingueur de son état.
Quelques temps plus tard, sur un chantier, Coupeau fait une grave chute. Il survit et se remet d’aplomb petit à petit. Mais ce n’est plus le même homme. Il ne veut plus travailler, et alors qu’il était sobre auparavant, il se met à boire et tombe sous la dépendance de l’alcool.
L’alcool est au centre du roman. Selon Zola, le vin est consubstantiel à l’ouvrier : « L’ouvrier n’aurait pu vivre sans le vin », écrit-il. Une consommation raisonnable de rouge lui paraît naturelle, tant qu’elle aide l’ouvrier à tenir le coup. En revanche, les choses se gâtent quand il va au-delà d’une quantité raisonnable de vin et prend goût aux alcools forts : « Le vin nourrit l’ouvrier ; les alcools, au contraire, étaient des saletés, des poisons qui ôtaient à l’ouvrier le goût du pain. » Or Coupeau passe de plus en plus de temps à l’Assommoir, l’établissement du père Colombe, qui est un lieu de perdition. On y trouve la machine à saouler, qui sert un vitriol qui fait des ravages et cause la déchéance de Coupeau.
Gervaise, son mari Coupeau et son amant Lantier
font ménage à trois
On comprend que nombre de situations décrites par Zola aient pu choquer à l’époque. A un moment de l’histoire, les Coupeau font ménage à trois avec Lantier. L’ancien concubin de Gervaise vient s’installer dans leur logement et redevient son amant. D’une manière générale, les personnages ne sont guère charitables entre eux. L’une des scènes les plus fortes se trouve au début du livre, avec deux lavandières qui se battent à coups de baquets et de battoirs. L’une des deux femmes finit dans une posture honteuse et n’est pas près d’oublier l’humiliation subie ce jour-là. Dans ce milieu tel que Zola le décrit, il n’y a guère de place pour l’amour filial. Coupeau héberge sa mère âgée et malade, qui finit par devenir un poids. Certes il n’est pas question de l’euthanasier, mais ses proches, nous dit l’auteur, ne serait pas fâchés de la voir mourir : « Bien sûr, ses enfants ne l’auraient pas achevée ; seulement, elle traînait depuis si longtemps, elle était si encombrante qu’on souhaitait sa mort, au fond, comme une délivrance pour tout le monde. »
Zola ne nous épargne rien. Dans son roman, en été, quand il fait chaud, il fait très chaud et la chaleur est suffocante ; de la même manière, en hiver, quand il fait froid, il fait très froid et l’alcool constitue le seul réconfort possible. Même la noce entre Gervaise et Coupeau est gâchée par la pluie, comme si la fatalité devait s’abattre sur les pauvres.
Gervaise ne sort pas épargnée de l’histoire. Dès les premières pages, Zola prévient qu’à vingt-deux ans elle a les « traits fins, déjà tirés par la vie. » Suite à son mariage avec Coupeau, le lecteur la voit s’épuiser et vieillir prématurément. Elle fait des journées de douze heures au travail, et le soir, une fois rentrée à la maison, elle soit s’occuper de ses deux enfants et préparer à dîner pour son mari. Elle travaille beaucoup, ce qui lui permet d’accomplir son vieux rêve de s’établir à son compte, en ouvrant une blanchisserie. Au début, les affaires marchent, car elle est travailleuse. Et en plus elle est gentille. Et pourtant Zola recommande de ne pas nous faire des illusions sur elle ; selon lui, elle manque de caractère, ce qui l’amène à céder à la facilité et à ne pas savoir dire non : « On avait tort de lui croire une grosse volonté ; elle était très faible, au contraire ; elle se laissait aller où on la poussait, par crainte de causer de la peine à quelqu’un. »
Au Louvre, Gervaise et ses compagnons
sont émerveillés par les dorures des tableaux
Plus encore que les situations décrites, le style de Zola était en mesure de choquer le lecteur bourgeois soucieux des convenances. Son langage est volontairement relâché et sans élégance. Il utilise des mots ou des expressions tels que « bouffer », « boustifailler », « rigolade à mort », « gueuler »… Zola parle comme ses personnages et ses personnages parlent comme les ouvriers qu’ils sont censés être ; et ils n’hésitent pas à se montrer grivois. Pourtant ils ont aussi soif de culture. Le jour de la noce de Coupeau et de Gervaise, pour échapper à la pluie, les mariés et les invités décident de visiter le musée du Louvre, ce qui donne l’un des passages les plus piquants du livre. Zola nous dit que « des siècles d’art passaient devant leur ignorance ahurie. » Ils traversent très vite les collections et sont nettement moins émerveillées par les toiles elles-mêmes que par les dorures des encadrements des tableaux. Zola poursuit : « Gervaise demanda le sujet des Noces de Cana ; c’était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. Coupeau s’arrêta devant la Joconde, à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes. »
L’Assommoir a donc choqué, mais, pourtant, si l’on va au-delà des apparences on découvre un livre dont la substance est, au fond, très morale. Zola ne cesse de mettre en garde contre les méfaits de l’alcool. Ainsi le médecin-chef de l’hôpital Sainte-Anne examine Coupeau dont le corps et l’esprit sont ravagés par l’alcool, puis il livre sa conclusion à Gervaise : « Vous buvez ! Prenez garde, voyez où mène la boisson… Un jour ou l’autre, vous mourrez ainsi. »
L’Assommoir est plus qu’un roman, c’est un document sur les ouvriers et les artisans des faubourgs de Paris, à une époque qui voit la capitale bouleversée par les travaux du baron Haussmann. A la fin du livre, Gervaise ne reconnaît plus son faubourg, percé de larges boulevards bordés d’immeubles qui ont des airs de palais. Tout cela sent le neuf. Le boulevard Magenta et le boulevard d’Ornano sont, dit Zola, « deux vastes avenues encore blanches de plâtre. » Le Paris d’Haussmann ressemble à un décor de théâtre qui contraste avec la crudité des faubourgs : « Sous le luxe montant de Paris, la misère du faubourg crevait et salissait ce chantier d’une ville nouvelle, si hâtivement bâtie. »
Par son réalisme, sa crudité et son absence voulue de souffle épique, L’Assommoir est à l’opposé des Misérables publié quinze ans plus tôt. Zola prend Hugo à contre-pied et enterre le romantisme une fois pour toutes.
L’Assommoir, de Zola, 1876, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : l'assommoir, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)
08/06/2015
L'Ordinateur du paradis, de Benoît Duteurtre
Conte philosophique sur la société numérique
L’Ordinateur du paradis
Dans un style élégant et fluide, Benoît Duteurtre se moque de la société néolibérale et numérique. A travers l’histoire de Simon Laroche, secrétaire de la commission des Libertés publiques, l’auteur pourfend le tout Internet, la transparence et les vertus prêtées à notre époque.
Benoît Duteurtre n’aime pas notre époque, mais il ne la fuit pas et préfère s’en moquer avec esprit. Au lieu de proposer un essai qui fustige les dérives de la société moderne ou postmoderne, il livre un conte philosophique mettant en scène la société néolibérale dans laquelle les individus sont connectés en permanence.
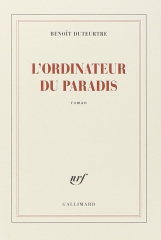 L’histoire se passe dans un pays qui n’est pas précisé, mais qui pourrait être la France, et à une époque qui n’est pas datée, mais qui pourrait être la nôtre. Le personnage principal, Simon Laroche, est ce qu’il est convenu d’appeler un gagnant. Il roule en BMW et vit dans une aisance matérielle certaine, qui lui est assurée par les hautes responsabilités qu’il occupe : il est rapporteur de la commission des Libertés publiques. A ce titre, il est appelé à donner son avis sur le manifeste publié par « Nous, en tant que femmes ! » Ce mouvement réclame la pénalisation de la consultation d’images pornographiques sur Internet. Simon Laroche est invité sur un plateau de télévision pour dire si une telle mesure serait attentatoire aux libertés publiques. Quelques minutes avant la prise d’antenne, il reçoit l’animatrice de l’émission dans sa loge, et, hors-caméra, il se lâche en disant avec franchise l’irritation que lui cause la lutte des femmes. Quelques jours plus tard, les propos de Simon, qui revêtaient pourtant un caractère privé, se trouvent mis en ligne sur Internet. Le scandale est énorme. Simon va devoir se résoudre à des excuses publiques, voire à la démission.
L’histoire se passe dans un pays qui n’est pas précisé, mais qui pourrait être la France, et à une époque qui n’est pas datée, mais qui pourrait être la nôtre. Le personnage principal, Simon Laroche, est ce qu’il est convenu d’appeler un gagnant. Il roule en BMW et vit dans une aisance matérielle certaine, qui lui est assurée par les hautes responsabilités qu’il occupe : il est rapporteur de la commission des Libertés publiques. A ce titre, il est appelé à donner son avis sur le manifeste publié par « Nous, en tant que femmes ! » Ce mouvement réclame la pénalisation de la consultation d’images pornographiques sur Internet. Simon Laroche est invité sur un plateau de télévision pour dire si une telle mesure serait attentatoire aux libertés publiques. Quelques minutes avant la prise d’antenne, il reçoit l’animatrice de l’émission dans sa loge, et, hors-caméra, il se lâche en disant avec franchise l’irritation que lui cause la lutte des femmes. Quelques jours plus tard, les propos de Simon, qui revêtaient pourtant un caractère privé, se trouvent mis en ligne sur Internet. Le scandale est énorme. Simon va devoir se résoudre à des excuses publiques, voire à la démission.
Pour nourrir son intrigue, Benoît Duteurtre a largement puisé dans l’actualité de ces dernières années. Par exemple, la déclaration enregistrée à la dérobée sur un plateau de télévision rappelle une mésaventure analogue survenue à un président de la République.
Dans ce livre, il est beaucoup question de l’omniprésence d’Internet dans la vie quotidienne et de l’absence de conscience devant les risques courus. Ainsi Simon est très étonné quand il s’aperçoit que tout courriel envoyé, ou toute consultation de site, laisse forcément des traces quelque part, que ce soit sur la toile ou sur son ordinateur personnel ; et cela même s’il a pris soin d’effacer toute trace de ses manipulations. Simon est terrifié d’apprendre qu’il n’y a pas de droit à l’oubli numérique : « Contrairement à la confession catholique qui remet à zéro le compteur de nos péchés, la foi dans l’effacement des données n’était qu’une illusion. »
Les élèves planchent sur la liberté d’expression
et en définissent d’abord les limites
Le fils de Simon, Tristan, suit des « ateliers sociaux » au collège. Les élèves ont pour projet de rédiger un manifeste pour la liberté d’expression. En même temps ils doivent en définir les limites. Et, au grand agacement de Simon, ils ont d’abord réfléchi aux bornes à ne pas dépasser. Tristan explique sur un ton très convaincu : « Nous, on s’est mis d’accord sur les limitations. […] D’abord le racisme, le sexisme, le terrorisme, l’injure aux religions… […] Et, bien entendu, les sites nazis et pédophiles ! » Simon, qui a été trotskiste dans les années soixante-dix et qui a ferraillé contre les religions, n’en revient pas et a du mal à avaler les propos de son fils sur « l’injure aux religions ».
Dans son livre, Duteurtre a aussi dans le collimateur la SNCF, même si la société nationale n’est pas nommément citée. On voit Simon obligé de renoncer à prendre le train rapide à réservation obligatoire, parce qu’il a décidé trop tard de son voyage. Il déplore que soit perdue la souplesse qui caractérisait le train et qui permettait d’y monter au dernier moment. Il est obligé de se rabattre sur une compagnie aérienne low-cost, et, dans l’avion, il devra s’acquitter d’un supplément de cinq euros pour utiliser les toilettes.
Dans cette société néolibérale, la langue française est massacrée. Le ministre de tutelle de Simon le convoque en entretien, et, bien que titulaire d’un Mastère [sic]de lettres, il bourre son discours de fautes de grammaire et d’anglicismes. Il déclare notamment : « Avant d’en venir à l’affaire qui nous impacte, j’aimerais connaître votre avis sur cette horrible news ! » Même au paradis, où espère entrer Simon après sa mort, la connaissance de l’anglais s’avère indispensable ! Et en ce qui concerne « cette horrible news » auquel le ministre fait allusion, il s’agit d’un grand dérèglement informatique qui menace la société sur ses bases. Ce dérèglement est une espèce de virus qui, dans sa propagation, peut faire penser à La Peste, de Camus.
Le livre de Duteurtre laissera probablement de marbre les lecteurs hyper-connectés acquis au monde néolibéral, mais, peut-être malgré tout, les fera-t-il réfléchir. L’Ordinateur du paradis permet de prendre quelque distance avec les vertus, supposées ou réelles, prêtées à la société actuelle : la rapidité, la réactivité, la transparence, l’hygiénisme, la mise en réseau, et cette volonté permanente de tout quantifier. Simon en arrive à la conclusion suivante : « le capitalisme a gagné ; mais notre époque a également recyclé le pire du communisme : s’exposer sans tabou, sur Facebook ou à la télé ; se fustiger publiquement à la moindre faute. »
L’Ordinateur du paradis, de Benoît Duteurtre, 2014, éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Société, XXe, XXIe siècles | Tags : l’ordinateur du paradis, benoît duteurtre | Lien permanent | Commentaires (0)


