06/03/2017
La Peau de chagrin, de Balzac
Récit fantastique et scientifique
La Peau de chagrin
Le jeune Raphaël de Valentin acquiert, chez un antiquaire, une peau de chagrin qui accomplit tous ses désirs. Mais dès qu’un souhait est satisfait, la Peau décroît en même temps que les jours de son propriétaire. Esprit rationnel, Raphaël ne comprend pas ce qui lui arrive, à une époque où la science est censée tout expliquer. La force du roman de Balzac est de mêler le fantastique et le scientifique.
Dans son livre Boussole, prix Goncourt 2015, Mathias Enard évoque La Peau de chagrin et publie le fac-similé d’une page de l’édition de 1834 du roman de Balzac. La reproduction contient la sentence inscrite sur la peau de chagrin achetée par le héros chez un antiquaire. Mathias Enard fait observer que le texte est écrit en arabe, ce qui le conduit à insister sur cette singularité : Balzac, réputé pour être le peintre des mœurs de la société française, s’est donc intéressé à l’Orient. Mieux, il fut le premier romancier français à publier un texte en arabe.
 Au début du récit, le héros, Raphaël de Valentin, vingt-six ans, est au bord du suicide. Jeune homme pauvre, il se qualifie lui-même de « véritable zéro social, inutile à l’Etat, qui n’en avait aucun souci ». Désespéré, il erre dans les rues de Paris. Passant devant un antiquaire, il entre dans la boutique. Après avoir exposé sa situation au marchand, un vieillard aux « yeux verts », celui-ci lui tient cet étrange propos sur la vie et la mort :
Au début du récit, le héros, Raphaël de Valentin, vingt-six ans, est au bord du suicide. Jeune homme pauvre, il se qualifie lui-même de « véritable zéro social, inutile à l’Etat, qui n’en avait aucun souci ». Désespéré, il erre dans les rues de Paris. Passant devant un antiquaire, il entre dans la boutique. Après avoir exposé sa situation au marchand, un vieillard aux « yeux verts », celui-ci lui tient cet étrange propos sur la vie et la mort :
L’homme s’épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort : VOULOIR et POUVOIR. Entre ces deux termes de l’action humaine, il est une autre formule dont s’emparent les sages et je lui dois le bonheur de ma longévité. VOULOIR nous brûle et POUVOIR nous détruit, mais SAVOIR laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme.
Il tend alors à Raphaël une peau de chagrin, et déclare :
Ceci est le POUVOIR et le VOULOIR réunis.
Conformément à l’inscription qu’elle contient, la Peau de chagrin promet d’accomplir les moindres désirs de son propriétaire. Mais l’inscription prévoit cette contrepartie : « A chaque vouloir je décroîtrai comme tes jours. » Raphaël se laisse tenter et achète la Peau.
Dès sa sortie de la boutique, il croise des camarades partis à sa recherche pour lui confier les rênes d’un journal qu’ils envisagent de fonder. « Quoiqu’il lui fût impossible de croire à une influence magique, écrit Balzac, il admirait les hasards de la destinée humaine. » Le soir même, un notaire se présente à Raphaël et l’informe que, suite au décès d’un lointain parent, il va toucher un héritage de six millions. Aussitôt, le jeune homme pâlit. La Peau de chagrin a décru. En l’achetant, il a conclu un pacte avec une force occulte.
Cette histoire a priori invraisemblable
a lieu à une époque où tout s’explique,
où la police traduirait un nouveau Messie devant les tribunaux
et soumettrait ses miracles à l’Académie des sciences
Le roman mêle étroitement le fantastique et le scientifique, ce qui lui donne sa force. Balzac insiste sur le fait que cette histoire a priori invraisemblable a « lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au dix-neuvième siècle, temps et lieu où la magie devrait être impossible. » Raphaël ne comprend pas ce qui lui arrive, il est un esprit rationnel représentatif de son temps qui est, précisément, encore celui de Voltaire ; il n’admet pas que sa vie puisse être menacée par une simple peau « à une époque où tout s’explique, où la police traduirait un nouveau Messie devant les tribunaux et soumettrait ses miracles à l’Académie des sciences. »
Le jeune homme reste convaincu que la science peut résoudre le mystère de cette peau qui rétrécit. Il visite des savants : d’abord un zoologiste, puis un physicien, puis un chimiste ; il leur demande de rendre à la Peau sa dimension initiale ; mais rien n’y fait, la science est impuissante à expliquer ce phénomène qui demeure surnaturel.
Au début de l’histoire, Raphaël était sur le point de se suicider, il était prêt à abréger ses jours tant qu’il gardait, jusqu’au dernier moment, la liberté de renoncer à son projet. Mais maintenant que l’échéance ne dépend plus de son libre arbitre, il a radicalement changé de point de vue : il a peur de mourir.
Peu à peu, alors que la fortune ne cesse de lui sourire, Raphaël fuit ses désirs et ne se préoccupe plus que de sa propre conservation. Il a tellement peur de raccourcir sa vie qu’il fuit la vie en société. Ainsi il se promet « de ne plus jamais regarder aucune femme » et s’enferme dans son hôtel particulier. Quand il reconduit un visiteur venu exprimer une sollicitation, il le raccompagne en lui déclarant aimablement : « Je souhaite bien vivement que vous réussirez… » Or cette simple formule de politesse creuse, qui n’engage à rien, suffit à raccourcir la Peau de chagrin ! Désespéré, Raphaël se résout à se procurer de l’opium pour se plonger dans un sommeil factice, car, dit-il, « dormir, c’est encore vivre. » Pour prolonger sa vie, Raphaël fuit la vie.
La Peau de chagrin fut l’un des premiers succès de Balzac
Dans son roman, Balzac rend hommage au naturaliste Cuvier. Même si plus tard il prit, avec raison, le parti de Geoffroy Saint-Hilaire dans le débat l’opposant à Cuvier, Balzac fut un grand admirateur de celui-ci : dans La Peau de chagrin, il le qualifie de génie et de « plus grand poète de notre siècle ». Cuvier avait mis en évidence les couches superposées de civilisations fossilisées. L’observation de ces mondes disparus et réduits à l’état de cendres entassées, conduit Balzac à cette réflexion solennelle sur le sens de l’existence et sur LE TEMPS :
Nous nous demandons, écrasés que nous sommes sous tant d’univers en ruine, à quoi bon nos gloires, nos haines, nos amours : et si, pour devenir un point intangible dans l’avenir, la peine de vivre doit s’accepter ? Déracinés du présent, nous sommes morts jusqu’à ce que notre valet de chambre entre et vienne nous dire : « Madame la comtesse a répondu qu’elle attendait Monsieur ! »
Publiée en 1831, La Peau de chagrin fut l’un des premiers succès de Balzac, son « premier vrai roman », considérait Stefan Zweig. Pourtant on ne conseillera peut-être pas au lecteur désireux d’entrer dans son œuvre, de commencer par ce livre. De nos jours, il est publié dans une édition contenant seulement trois chapitres : Le Talisman, La Femme sans cœur et L’Agonie. Or La femme sans cœur, largement autobiographique, peut s’apparenter à une digression, ou tout au moins à un roman dans le roman, et ce en dépit de toutes les exégèses savantes faites sur le personnage de Fédora qui en est le centre ; et surtout ce chapitre deux contient un paragraphe totalisant plusieurs dizaines de pages à lui seul. Le texte ainsi présenté manque d’aération et paraît indigeste. On peut déplorer que, par excès de purisme, il n’existe plus, comme ce fut le cas jusque dans les années 1980, une édition de La Peau de chagrin reprenant les courts chapitres du feuilleton tel qu’il fut publié dans la presse, ce qui rendrait la lecture plus aisée.
En dépit de ces réserves, il n’en demeure pas moins que La Peau de chagrin est un roman riche en péripéties et en réflexions.
La Peau de chagrin, de Balzac, 1831, collections Folio, Le Livre de Poche et Pocket.
08:41 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : la peau de chagrin, balzac, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)
27/02/2017
L'Incompris, de Comencini
Film d’une infinie tristesse
L’Incompris
A l’annonce de la mort de sa mère, Andrea, un garçon d’une dizaine d’années, ne manifeste aucune émotion, ce qui déconcerte son père, qui le prend pour un être insensible, et qui désormais ne voit plus en lui que ses défauts. Après avoir été sous-estimé, L’Incompris valut à Comencini un succès international. Son film est un drame universel, qui bouleverse le spectateur.
Tourné en 1966, L’Incompris fut présenté au festival de Cannes en 1967 et sortit à Paris au cœur de l’été 1968 ; la critique y vit un simple mélodrame et se montra sévère, si bien que le film ne marqua pas les esprits et fut vite oublié. En 1978, à l’occasion d’une rétrospective Comencini, l’ensemble de son œuvre ressortit en France. L’Incompris bouleversa alors les spectateurs, ce qui valut à Comencini un succès international. Il se produisit même un fait exceptionnel dans l’histoire de la critique : des journalistes se ravisèrent ; ainsi Jacques Siclier, critique à Télérama, fit amende honorable en reconnaissant avoir manqué de « clairvoyance » dix ans plus tôt et qualifia L’Incompris de « très beau film ».
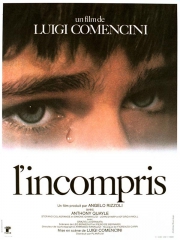 Le film de Comencini est l’adaptation très libre de Misunderstood, roman de Florence Montgomery, publié à Londres en 1869. Le réalisateur et ses scénaristes transférèrent l’histoire en Italie, la modernisèrent et la remanièrent profondément.
Le film de Comencini est l’adaptation très libre de Misunderstood, roman de Florence Montgomery, publié à Londres en 1869. Le réalisateur et ses scénaristes transférèrent l’histoire en Italie, la modernisèrent et la remanièrent profondément.
Après la mort de sa femme, sir Edward Duncombe, consul de Grande-Bretagne à Florence, retrouve ses deux enfants qu’il avait laissés à des amis. A l’aîné, Andrea, âgé d’une dizaine d’années, qu’il juge suffisamment mûr, il annonce la nouvelle, tout en lui demandant de faire croire à son petit frère, Milo, que leur mère est partie en voyage. Quand son père lui parle, Andrea ne le regarde pas et ne manifeste aucune émotion, comme si son esprit était ailleurs. Déconcerté par son absence de réaction, le consul ne voit plus en lui que ses défauts, il se met à le rabrouer et réserve son affection au cadet dont la grâce et la fragilité lui rappellent sa chère disparue.
Une rivalité mimétique oppose
le cadet à l’aîné
Dans ce film, seule la fin est mélodramatique, l’essentiel de l’intrigue étant bâti sur des petits faits de la vie quotidienne : un tournoi de judo perdu ; deux enfants à bicyclette qui s’accrochent à un autocar pour aller plus vite ; une bande de magnétophone qui disparaît ; un enfant trempé après avoir joué avec un tuyau d’arrosage…
Andrea et Milo s’aiment et jouent beaucoup ensemble. Le cadet admire son aîné, mais une rivalité mimétique l’oppose à lui. Milo se montre jaloux, notamment quand il voit que leur père pense à faire entrer Andrea dans le monde des adultes. Or le cadet est un enfant malicieux qui parvient constamment à ses fins. Son frère aîné est le premier à céder à ses exigences.
Le père donne systématiquement raison à Milo et a arrêté un jugement définitif sur la personnalité d’Andrea en le cataloguant en être insensible à la souffrance. Il est vrai que les circonstances se montrent particulièrement défavorables : dès que le consul tente de se rapprocher de son fils aîné, il se produit à chaque fois un incident qui le conforte dans son jugement initial, si bien qu’il finit par se désintéresser complètement de lui. S’il avait été moins centré sur ses propres problèmes, il aurait observé que les petits gestes de nervosité du garçon trahissent une agitation intérieure.
Le spectateur lui-même ne se méprend-il pas sur la personnalité d’Andrea ? Il croit d’abord avoir affaire à un être plein de vitalité et résilient, avant de découvrir que, contrairement aux apparences, c’est un garçon secret et sensible.
Andrea est renvoyé dans sa solitude. Les gouvernantes et les domestiques constituent un entourage artificiel. La villa familiale, maison du malheur, a des allures de prison dorée. Seule une escapade dans un cinéma de quartier permet à Andrea d’entrer en interaction avec le monde extérieur. Mais il souffre de n’avoir personne à qui se confier. Quand il est mortifié que son père ne le croit pas, il en est réduit à soliloquer devant le portrait de sa mère accroché au salon.
Très tôt naît chez Andrea la volonté de mourir
Suite à la mort de leur mère, les deux frères ont des attitudes très différentes. Le petit, Milo, vit dans l’instant présent, il manifeste une forte capacité d’oubli et n’a déjà plus qu’un souvenir ténu de leur mère qu’il n’a guère connue, si bien qu’il s’adapte facilement à la situation nouvelle. Andrea, lui, a presque déjà une réaction d’adulte, il prend conscience de l’irréversibilité de la perte de leur mère et ne s’en accommode pas. Mis à part son portrait, ne reste d’elle qu’une bande audio dans laquelle elle dit un poème. Cette bande sera malencontreusement effacée, faisant disparaître à jamais la voix de la jeune femme. Ce qui était n’est plus.
Très tôt naît chez Andrea la volonté de mourir. La pensée persistante que sa mère est morte, a annihilé en lui la peur de la mort. La seule perspective qu’il entrevoit est d’aller rejoindre sa mère là où elle est. Dès lors, il s’adonne à un jeu dangereux par lequel il cherche la mort.
L’Incompris est remarquablement interprété. Anthony Quayle, acteur shakespearien souvent condamné aux seconds rôles au cinéma, trouva dans ce film un personnage à sa mesure. Il a de la prestance dans le rôle du consul, qu’il interprète avec finesse. Pour jouer l’incompris, Comencini trouva un garçon doté d’une forte personnalité. Dans son livre Enfance, vocation, expériences d’un cinéaste, il évoque leur première rencontre :
Pour le rôle d’Andrea, je voulais un enfant d’une dizaine d’années, beau, sensible, avec un caractère ombrageux qui pouvait faire de lui un être introverti et, selon le titre du film, facilement « incompris ». Nous avions passé toute la ville [de Florence] au peigne fin sans le trouver, quand nous décidâmes de revenir frapper à la porte d’un appartement où personne ne nous avait ouvert. Cette fois encore notre coup de sonnette resta sans réponse, mais un voisin nous dit que l’enfant de la maison était en train de jouer au ballon sur une place du voisinage. Nous l’aperçûmes de loin et nous nous dîmes en nous approchant : « C’est lui ! »
Le dialogue fut sans équivoques : « Tu veux faire du cinéma ?
- Non. »
En fait il joua le rôle, probablement parce que sa mère y tenait.
Assez étrangement, dans la version française, les prénoms sont transformés - Andrea devenant Jonathan -, et les enfants sont doublés par des adultes, ce qui ne sert pas le film. Pour cette raison, il est préférable de le voir en version italienne, même si Anthony Quayle, ayant joué en anglais, est doublé dans les deux versions.
La musique de Mozart, extraite du concerto pour piano n° 23 - K 488, ajoute une note supplémentaire d’infinie tristesse à ce drame universel.
L’Incompris, de Luigi Comencini, 1966, avec Anthony Quayle, Stefano Colagrande, Simone Giannozzi et John Sharp, DVD Carlotta Films.
09:02 Publié dans Drame, Film | Tags : comencini, anthony quayle, stefano colagrande, simone giannozzi, john sharp, l’incompris | Lien permanent | Commentaires (1)
20/02/2017
Les Forêts de Ravel, de Michel Bernard
Dans la peau du soldat Ravel
Les Forêts de Ravel
Se fondant sur des faits biographiques attestés, Michel Bernard se glisse dans la peau de Ravel qui fut soldat pendant la Grande Guerre. Le compositeur avait été réformé et n’avait guère de goût pour la vie militaire, mais il désira tant faire son devoir qu’il fit jouer ses relations pour être incorporé et servir au plus près du front.
Le compositeur Maurice Ravel était de constitution fragile. « La nature, écrit Michel Bernard, l’avait fait petit et costaud. » Il mesurait seulement un mètre soixante-et-un et avait les épaules étroites. En 1895, il avait été réformé par le conseil de révision et n’en avait pas été chagriné, n’étant guère attiré par la vie militaire. En août 1914, à la déclaration de guerre, Ravel était âgé de trente-neuf ans. Alors que ses proches, ses amis, son frère furent mobilisés et partirent pour le front, lui demeura à Paris sans que rien ne changeât dans sa vie. Mais il se sentit mal à l’aise et éprouva comme une honte, un déshonneur : « Cette vie sûre et confortable, qu’il avait tant désirée autrefois, qu’il avait patiemment aménagée, lui pesait. »
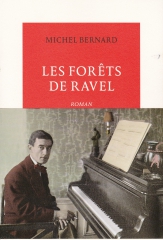 Alors il se présenta aux autorités militaires pour s’engager, mais il fut ajourné. Afin de servir malgré tout, il se porta volontaire pour assurer des veilles de nuit à l’hôpital de Saint-Jean-de-Luz. Ce service ne lui parut pas suffisant. Opiniâtre, il fit jouer ses relations pour obtenir son incorporation. User du piston dans ce sens est plutôt rare. Comme l’écrit Michel Bernard, « désirer à ce point [faire son devoir], cela excédait la morale commune. »
Alors il se présenta aux autorités militaires pour s’engager, mais il fut ajourné. Afin de servir malgré tout, il se porta volontaire pour assurer des veilles de nuit à l’hôpital de Saint-Jean-de-Luz. Ce service ne lui parut pas suffisant. Opiniâtre, il fit jouer ses relations pour obtenir son incorporation. User du piston dans ce sens est plutôt rare. Comme l’écrit Michel Bernard, « désirer à ce point [faire son devoir], cela excédait la morale commune. »
En 1915, Ravel obtint enfin que son aptitude à servir fût reconnue. Il fut certes incorporé, mais seulement dans un service auxiliaire, celui du train. Il accomplit des missions de conducteur de camion et ne fut pas pour autant satisfait de sa situation. Il se considérait comme trop éloigné du front et voulait s’en rapprocher au plus près. En conséquence, il se porta volontaire pour effectuer des transports à Verdun, dans la zone des combats. En tant que conducteur d’ambulance chirurgicale, il ne manquait pas d’activité. Il accumula tellement de fatigue, que la nuit il dormait comme une masse. Lui qui avant-guerre souffrait d’insomnie, il devait maintenant lutter contre le sommeil : « Il goûtait l’ironie de la chose et annonçait dans ses lettres à sa mère et à ses amis que la guerre l’avait guéri de ses nuits blanches. »
A son grand étonnement,
Ravel fit preuve de calme et de détachement
au milieu des cadavres
Ravel se trouvait à l’aise dans son uniforme. Bien que simple soldat et petit de taille, il avait de l’allure et restait attentif à son port de tête quand il revêtait sa tenue bien coupée, qu’un tailleur parisien lui avait confectionnée. Beaucoup de soldats qu’il croisait, croyant reconnaître un officier, le saluaient au passage.
A Verdun, Ravel pataugea dans la boue et la gadoue au milieu des cadavres et du sang, mais il n’en fut pas écœuré : « Cette patience, ce calme et ce détachement, il ne s’en serait pas cru capable et personne n’aurait pu croire cela de lui. » En revanche, il fut très affecté par la mort de sa mère, qui le plongea dans un état de prostration. Cette mort marque une rupture dans sa vie.
Dans son livre, Michel Bernard évoque l’œuvre musicale de Ravel, notamment Le Tombeau de Couperin, commencé en 1914, alors que la paix régnait encore ; le compositeur ne pouvait prévoir que la guerre donnerait à cette pièce « un sens aussi littéral ». Michel Bernard parle également de l’écriture du Concerto pour la main gauche commandé par un pianiste autrichien ancien combattant, que la guerre avait rendu manchot. La création de l’œuvre eut lieu à Vienne en présence de Ravel. L’exécution toute personnelle qu’en fit son commanditaire et interprète déplut fortement à Ravel, qui se leva et quitta sa place en plein récital.
Au lendemain de la guerre, Ravel acheta une villa en région parisienne et gagna le surnom d’« ermite de Montfort-l’Amaury ». Celui qui avait été « soldat avec les plus humbles », était souvent désigné, dans les années vingt, comme le « plus grand compositeur vivant ».
Le livre de Michel Bernard est bien un roman, l’auteur se glissant dans la peau du musicien, mais son roman est fondé sur des éléments biographiques attestés. Il n’y a pas de dialogue, ce qui pourrait décourager certains lecteurs, pourtant ce livre n’est pas ardu à lire. Il est cependant préférable de l’ouvrir à des moments où le cerveau est pleinement disponible pour se fondre dans le personnage de Ravel et être, par l’imagination, à l’écoute de sa musique.
Les Forêts de Ravel, de Michel Bernard, 2015, éditions de La Table Ronde.
09:00 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : les forêts de ravel, michel bernard, ravel | Lien permanent | Commentaires (0)


