26/06/2017
Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand, Livres XIII à XXIV
Les années Napoléon
Mémoires d’outre-tombe
Livres XIII à XXIV
Dans ce volume, Chateaubriand évoque son œuvre littéraire, notamment le Génie du christianisme, qui fit beaucoup pour sa renommée. Il consacre de nombreuses pages à Napoléon dont il se fait quasiment le biographe. Tout en admettant son génie, il lui impute plusieurs crimes, parmi lesquels l’exécution du duc d’Enghien. Le lecteur vit quasiment en direct les Cent-Jours et les deux Restaurations, que Chateaubriand vécut auprès de Louis XVIII.
A son retour en France sous le Consulat, Chateaubriand était encore inconnu du grand public. Après son exil provoqué par la Révolution, le jeune aristocrate avait obtenu de Bonaparte d’être rayé de la liste des émigrés et ainsi avait pu rentrer au pays. En 1802, il fit paraître le Génie du christianisme ; le retentissement de cet ouvrage fut tel, que le nom de Chateaubriand s’imposa chez les catholiques. Selon l’auteur, « on avait alors besoin de foi », si bien que le livre « est venu juste et à son moment ». Sous le Consulat, la France se remet de la Révolution, s’interroge sur les doctrines qui ont conduit à ses excès et remet en cause une partie de l’héritage philosophique issu du XVIIIe siècle. Chateaubriand se flatte d’avoir permis « une résurrection momentanée d’une religion qu’on prétendait au tombeau » et parle d’« une métamorphose » qui s’opéra dans les esprits. Croire en Dieu ne paraissait plus aussi absurde qu’au siècle précédent :
L’athéisme et le matérialisme ne furent plus la base de la croyance ou de l’incroyance des jeunes esprits ; l’idée de Dieu et de l’immortalité de l’âme reprit son empire : dès lors, altération dans la chaîne des idées qui se lient les unes aux autres. On ne fut plus cloué dans sa place par un préjugé antireligieux ; on ne se crut plus obligé de rester momie du néant, entouré de bandelettes philosophiques ; on se permit d’examiner tout système, si absurde qu’on le trouvât, fût-il même chrétien.
 Quand, en 1815, pendant les Cent-Jours, Chateaubriand retourne en exil, il semble flatté, voire amusé, de la réputation que continue de lui procurer le Génie du christianisme, sorti treize ans plus tôt. Il réside alors en Belgique, au lieudit l’enclos du Béguinage, et voici l’accueil qu’il reçoit :
Quand, en 1815, pendant les Cent-Jours, Chateaubriand retourne en exil, il semble flatté, voire amusé, de la réputation que continue de lui procurer le Génie du christianisme, sorti treize ans plus tôt. Il réside alors en Belgique, au lieudit l’enclos du Béguinage, et voici l’accueil qu’il reçoit :
J’étais reçu gracieusement dans l’enclos comme l’auteur du Génie du christianisme ; partout où je vais, parmi les chrétiens, les curés m’arrivent ; ensuite les mères m’amènent leurs enfants ; ceux-ci me récitent mon chapitre sur la première communion. Puis se présentent des personnes malheureuses qui me disent le bien que j’ai eu le bonheur de leur faire. Mon passage dans une ville catholique est annoncé comme celui d’un missionnaire et d’un médecin. Je suis touché de cette double réputation ; c’est le seul souvenir agréable de moi que je conserve ; je me déplais dans tout le reste de ma personne et de ma renommée.
Il arrive cependant que son livre soit une carte de visite sans effet. Ainsi, toujours pendant les Cent-Jours, il se présente chez un chanoine à Senlis pour lui demander l’hospitalité, et :
Sa servante nous reçut comme des chiens ; quant au chanoine, qui n’était pas saint Rieul, patron de la ville, il ne voulut pas nous regarder. Sa bonne avait ordre de nous rendre d’autre service que de nous acheter de quoi manger, pour notre argent : le Génie du christianisme me fut néant.
Chateaubriand se flatte d’avoir mis à la mode
l’architecture gothique
Chateaubriand se flatte également d’avoir mis à la mode l’architecture gothique, car, dans le Génie du christianisme, il faisait part de son admiration pour les cathédrales. Il écrit que « c’est encore à cet ouvrage que se rattache le goût actuel pour les édifices du moyen âge ». Cependant il nuance aussitôt son propos en ajoutant que de nos jours (dans les années 1830-1840) on a tendance à exagérer la beauté de ces constructions. Il se défend d’être à l’origine de cette exagération et précise : « si à force d’entendre rabâcher du gothique on en meurt d’ennui, ce n’est pas ma faute. » Même si Chateaubriand ne cite aucun nom, cette dernière phrase peut être légitimement prise comme une pique visant Victor Hugo et son Notre-Dame de Paris.
Chateaubriand revient aussi sur René, roman qui, à l’origine, faisait partie intégrante du Génie, et qui préfigure les autofictions chères à la littérature française des XXe et XXIe siècles. Œuvre essentielle aux yeux des romantiques, René a contribué à la naissance du spleen, la maladie du siècle. Faussement contrit, Chateaubriand ironise :
Si René n’existait pas, je ne l’écrirais plus ; s’il m’était possible de le détruire, je le détruirais. Une famille de René poètes et de René prosateurs a pullulé […]. Il n’y a pas de grimaud sortant du collège qui n’ait rêvé être le plus malheureux des hommes ; de bambin qui à seize ans n’ait épuisé la vie, qui ne se soit crut tourmenté par son génie ; qui, dans l’abîme de ses pensées, ne se soit livré au vague de ses passions ; qui n'ait frappé son front pâle et échevelé, et n’ait étonné les hommes stupéfaits d’un malheur dont il ne savait pas le nom, ni eux non plus.
***
Les livres seizième à vingt-quatrième sont consacrées à Napoléon, dont Chateaubriand se fait pour ainsi dire le biographe. Pour commencer, il s’interroge sur son année de naissance et, après recoupement d’informations de différentes provenances, il en arrive à penser que Napoléon a triché sur ce point : il ne serait pas né en 1769, comme c’est indiqué sur certains actes officiels, mais en 1768, c’est-à-dire un an avant le rattachement de la Corse à la France. Napoléon aurait menti afin de prétendre être né français.
A ce propos, Chateaubriand rappelle que la langue maternelle de Napoléon était l’italien et qu’il maîtrisait mal le français. Pour étayer ses dires, l’auteur reproduit le texte d’un écrit de Napoléon, fautes d’orthographe comprises ; et il a ce commentaire : « C’est visiblement pour cacher la négligence de son instruction que Napoléon a rendu son écriture indéchiffrable. »
Bonaparte envahissant l’Egypte, c’est comme si des Algériens
s’étaient emparés de Marseille et de la Provence
Si Chateaubriand ne nie pas le génie militaire de Napoléon, il critique très sévèrement la plupart de ses campagnes, notamment l’expédition d’Egypte. Selon lui, la volonté d’exporter les droits de l’homme ne saurait justifier le déclenchement d’une guerre. « Comme Mahomet avec le glaive et le Koran, nous allions, écrit-il, l’épée dans une main, les droits de l’homme dans l’autre. » Chateaubriand n’hésite pas à faire la leçon à ses compatriotes en leur faisant remarquer que ladite expédition violait ce qu’on appellerait aujourd’hui le droit international :
Les Français s’extasient sur l’expédition d’Egypte, et ils ne remarquent pas qu’elle blessait autant la probité que le droit politique : en pleine paix avec la plus vieille alliée de la France [c’est-à-dire la Turquie], nous l’attaquons, nous lui ravissons la féconde province du Nil, sans déclaration de guerre, comme des Algériens qui, dans une de leurs algarades, se seraient emparés de Marseille et de la Provence.
Chateaubriand est d’autant plus sévère pour la France qu’au cours de ses voyages il a découvert d’autres peuples, d’autres cultures et d’autres manières de penser. Ainsi, en 1805-1806, il s’est rendu en pèlerinage à Jérusalem et, dans sa traversée des contrées orientales, il a bénéficié de la protection des autorités ottomanes. Son passeport visé à Constantinople le qualifiait de « personnage noble de la cour de France » parti « pour accomplir le saint pèlerinage des (chrétiens) » et demandait à toutes les juridictions de l’Empire de s’acquitter de tous les égards qui lui étaient dus. Conscient des facilités que lui ont accordées les autorités ottomanes, Chateaubriand se demande quel comportement nous aurions dans une situation analogue : « Protégerions-nous de la sorte un voyageur inconnu près des maires et des gendarmes qui visitent son passeport ? »
« Pratiquons le bien pour être heureux »
Dans un premier temps, Chateaubriand se mit au service du Premier Consul ; il le quitta définitivement quand il démissionna du corps diplomatique pour protester contre la mort du duc d’Enghien. En 1804, le duc d’Enghien, cadet des Bourbons, fut enlevé en territoire étranger, ramené en France, jugé et exécuté. Tel un enquêteur, Chateaubriand restitue la chronologie des faits ayant abouti à ce qu’il appelle « un odieux assassinat ». Il attribue à chaque protagoniste sa part de responsabilité dans la mort du jeune prince, fusillé dans un fossé du château de Vincennes, et conclut sans ambages : « Bonaparte a voulu la mort du duc d’Enghien. »
Plus loin dans ses Mémoires, Chateaubriand fait un parallèle entre la mort du duc d’Enghien et la guerre d’Espagne, menée contre une autre branche des Bourbons. Selon lui, ces deux actions injustifiées ont précipité la chute de Napoléon. Chateaubriand se fait alors moraliste en appelant à la vertu en politique :
Une grave leçon est à tirer de la vie de Bonaparte. Deux actions, toutes deux mauvaises, ont commencé et amené sa chute : la mort du duc d’Enghien, la guerre d’Espagne. Il a beau passé dessus avec sa gloire, elles sont demeurées là pour le perdre. Il a péri par le côté même où il s’est cru fort, profond, invincible, lorsqu’il violait les lois de la morale en négligeant, en dédaignant sa vraie force, c’est-à-dire ses qualités supérieures dans l’ordre et l’équité. […] Tout crime porte en soi une incapacité radicale et un germe de malheur : Pratiquons donc le bien pour être heureux, et soyons justes pour être habiles.
Cette exhortation à faire le bien est digne de Bossuet !
Napoléon eut le tort
de ne pas savoir s’arrêter
Pour Chateaubriand, Napoléon eut un grand tort, celui de ne pas savoir s’arrêter à temps. Pendant ses années de gloire, il « a la puissance d’arrêter le monde et n’a pas celle de s’arrêter », tant sa soif de conquêtes demeure insatiable ; ce qui le conduisit à la désastreuse campagne de Russie.
Chateaubriand fait le récit de la retraite de la Grande Armée dans le froid et la neige et insiste sur le nombre de morts, y compris des femmes et des enfants noyés dans la Bérésina. Il reproduit le bulletin de la Grande Armée du 3 décembre 1812, lequel informait les Français du retour de l’Empereur sain et sauf. Le bulletin se termine par cette phrase : « La santé de Sa Majesté n’a jamais été meilleure. » Et Chateaubriand d’ironiser : « Familles, séchez vos larmes : Napoléon se porte bien. » Selon lui, l’Empereur, à l’époque, ne se souciait plus que de sa propre personne et se désintéressait du sort des Français. Chateaubriand décrit un Napoléon égocentrique et narcissique :
« Sous l’Empire, nous disparûmes ; il ne fut plus question de nous, tout appartenait à Bonaparte : J’ai ordonné, j’ai vaincu, j’ai parlé ; mes aigles, ma couronne, mon sang, ma famille, mes sujets. »
« Vivant il a manqué le monde,
mort il le possède. »
S’il est exhaustif dans l’énumération des crimes qu’il attribue à Napoléon, qualifié par lui de « fléau », Chateaubriand ne cache cependant pas une certaine admiration à son égard ; il le qualifie ainsi de « plus fier génie d’action qui ait jamais existé. » Selon lui, la campagne de 1814, menée par un Napoléon cerné de toutes parts, est l’une de ses « deux plus belles campagnes », au même titre que la campagne d’Italie menée alors qu’il était un jeune général. Le fait que Napoléon tint tête aux armées alliées jusqu’au bout conduit Chateaubriand à faire observer qu’en 1814 ce sont bien les Français qui ont obtenu son abdication : « Il a succombé, non parce qu’il a vaincu, mais parce que la France n’en voulait plus. »
Dans les années 1830-1840, alors que Chateaubriand rédige cette partie de ses Mémoires, Napoléon appartient définitivement au passé. L’Empereur est mort en 1821, ses cendres ont été rapatriées en France en 1840 (ce qui a donné lieu à une grande cérémonie aux Invalides), et son souvenir est très populaire auprès de la jeunesse, laquelle n’était pas née sous l’Empire. Tout se passe comme si les milliers de morts étaient passés par pertes et profit, ce qui amène Chateaubriand à considérer que « la postérité n’est pas aussi équitable dans ses arrêts qu’on le dit ». Il déplore que l’on magnifie les victoires de Bonaparte, du fait que l’on n’entend plus « les cris de douleur et de détresse des victimes » de ses guerres de conquête.
Conscient que ces rappels sont vains et inutiles face à la jeune génération qui s’extasie devant le génie du grand homme, Chateaubriand conclut : « Le monde appartient à Bonaparte ; ce que le ravageur n’avait pu achever de conquérir, sa renommée l’usurpe ; vivant il a manqué le monde, mort il le possède. »
***
Chateaubriand n’a jamais fait mystère de son attachement à la royauté. En avril 1814, à la chute de Napoléon, il publie une brochure intitulée De Buonaparte et des Bourbons, qui est un appel à se rallier à ceux qu’il appelle « nos princes légitimes » ; et pendant les Cent-Jours il suit Louis XVIII dans son exil à Gand. Sa fidélité à la dynastie des Bourbons est sincère, mais ne l’empêche pas d’être lucide et de revendiquer son attachement au principe de liberté.
Chateaubriand appelle le Roi
à rendre la presse entièrement libre
En Belgique, Chateaubriand publie un Rapport sur l’état de la France dans lequel il appelle le Roi à adopter une loi qui rendrait la presse « entièrement libre ». Mais il est sans illusion sur le résultat de sa demande ; car, comme il le rappelle dans ses Mémoires, les pages de son rapport étaient écrites, non en France, mais en terre étrangères, « dans les Etats des souverains alliés, parmi des rois et des émigrés qui détestaient la liberté de la presse, au milieu des armées marchant à la conquête, et dont nous étions, pour ainsi dire, les prisonniers. »
Avec le recul des années, Chateaubriand considère, dans des pages écrites après la Révolution de Juillet (c’est-à-dire après 1830), que « tous les présages de la seconde Restauration furent menaçants », notamment du fait que « Louis XVIII revenaient derrière quatre cent milles étrangers » des armées russes, autrichiennes, prussiennes, britanniques. Bref, comme cela le lui a été reproché, le Roi revenait dans les fourgons de l’étranger.
« Tout à coup une porte s’ouvre :
entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime »
Chateaubriand décrit le rôle trouble joué par Talleyrand et Fouché dans le second retour de Louis XVIII. Il dit tout le mal qu’il pense de Talleyrand, ancien évêque d’Autun, « un homme sans foi », qui, selon lui, « vivait dans une atmosphère de corruption ». Il cite le célèbre mot de l’ambassadeur anglais sur Talleyrand : « C’est de la boue dans un bas de soie. » Chateaubriand note qu’il affaiblit l’expression utilisée, qui, dans sa version originale, était plus crue.
Chateaubriand dépeint une scène qui en dit long sur Talleyrand et son caractère de séducteur. Cela se passe à Gand en 1814. Au nom du Roi, Chateaubriand se rend chez Talleyrand, dont il faut rappeler qu’il avait un pied-bot :
Je l’allai voir ; il me fit toutes ces cajoleries avec lesquelles il séduisait les petits ambitieux et les niais importants. Il me prit par le bras, s’appuya sur moi en me parlant : familiarités de haute faveur, calculées pour me tourner la tête, et qui étaient, avec moi, tout à fait perdues ; je ne comprenais même pas.
Chateaubriand fait état des relations entre l’ancien évêque d’Autun et l’ancien prêtre oratorien qu’était Fouché : « M. de Talleyrand n’aimait pas M. Fouché ; M. Fouché détestait et, ce qu’il y a de plus étrange, méprisait M. de Talleyrand. » A la veille de la Seconde Restauration, en juin 1815, à Saint-Denis, alors que les deux hommes s’apprêtaient à être reçu par le Roi, Chateaubriand eut ce qu’il appelle une vision infernale : « Tout à coup une porte s’ouvre : entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, M. de Talleyrand soutenu par M. Fouché. »
« La Charte avait l’inconvénient
d’être octroyée »
D’une manière générale, Chateaubriand est plus respectueux envers Louis XVIII et Monsieur, futur Charles X. Cependant il n’hésite pas à égratigner le Roi qui, après avoir prétendu « mourir au milieu de la France », ne tint pas parole et quitta précipitamment Paris pour échapper à Napoléon de retour de l’île d’Elbe.
Surtout, Chateaubriand est conscient du fait que la société a énormément évolué depuis 1789 et qu’un retour à l’Ancien Régime ne serait pas accepté par la nation. De fait, il constate que la dynastie des Bourbons, qu’il appelle la race légitime, est en complet décalage avec les aspirations des Français :
La race légitime, étrangère à la nation pendant vingt-trois années, était restée au jour et à la place où la Révolution l’avait prise, tandis que la nation avait marché dans le temps et l’espace. De là impossibilité de s’entendre et de se rejoindre ; religion, idées, intérêts, langage, terre et ciel, tout était différent pour le peuple et pour le Roi, parce qu’ils n’étaient plus au même point de la route, parce qu’ils étaient séparés par un quart de siècle équivalent à des siècles.
Certes, la promulgation de la Charte fait qu’une esquisse de monarchie constitutionnelle a pu être instaurée. Mais cela n’a été possible que parce que le Roi le voulait bien. Comme le fait observer Chateaubriand, « la Charte avait, pour la plus grande partie de la nation, l’inconvénient d’être octroyée. » Autrement dit, elle venait d’en-haut et le Roi pouvait la suspendre à tout moment.
Chateaubriand croit la monarchie finie
Sans illusion sur l’avenir de la royauté, Chateaubriand rapporte ce mot qu’il tint à Louis XVIII : « Sire ; pardonnez à ma fidélité : je crois la monarchie finie. » Et le Roi de répondre : « Eh bien, monsieur de Chateaubriand, je suis de votre avis. »
Chateaubriand fait le deuil de la dynastie des Capets en écrivant : « Notre ancien pouvoir royal était l’ancienne royauté du monde : du bannissement des Capets datera l’ère de l’expulsion des rois. »
L’auteur se targue de ses « lubies » qui, selon lui, l’ont fait mal voir des deux côtés : « pour les royalistes, j’aimais trop la liberté ; pour les révolutionnaires, je méprisais trop les crimes ». Et, se montrant indifférent aux modes, il réaffirme son attachement à la liberté qu’il place au-dessus de tout :
Je ne suis point à la mode, je pense que sans la liberté il n’y a rien dans le monde ; elle seule donne le prix à la vie ; dussé-je rester le dernier à la défendre, je ne cesserai de proclamer ses droits.
Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand, 1848, Livres XIII à XXIV, collection Le Livre de poche.
09:44 Publié dans Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre, Mémoires, autobiographie, témoignage, Religion | Tags : mémoires d'outre-tombe, chateaubriand, napoléon | Lien permanent | Commentaires (0)
19/06/2017
L'Aveu, de Costa-Gavras
La mécanique implacable d’un procès stalinien
L’Aveu
Ce film est adapté du livre de témoignage écrit par Arthur London, apparatchik communiste rescapé des purges staliniennes. L’Aveu marque la rupture de Montand avec le communisme. L’acteur s’imposa un régime de privation pour mieux s’imprégner de son rôle. Il apparut amaigri et fatigué à l’écran. La force du film est de montrer comment un innocent peut finir par s’accuser de crimes qu’il n’a pas commis.
Arthur London était né en 1915 au sein d’une famille juive de l’Empire austro-hongrois. Militant communiste, il combattit dans les rangs des Brigades internationales pendant la Guerre d’Espagne. Installé en France, il s’engagea dans la Résistance dès 1940. Les Allemands l’arrêtèrent et le déportèrent à Mauthausen. Après la Seconde Guerre mondiale, il rentra en Tchécoslovaquie ; et, au lendemain du Coup de Prague (qui vit la prise du pouvoir par les communistes), il entra au gouvernement. En 1951, il était vice-ministre des Affaires étrangères, quand il fut brusquement arrêté. Inculpé de conspiration contre l’Etat, il fut l’un des quatorze accusés des grands procès de Prague et fut condamné à une peine de prison. En 1956, il fut libéré dans le cadre de la déstalinisation, qui entraîna la réhabilitation des victimes des purges. Installé définitivement en France, Arthur London raconta sa propre histoire dans un livre, L’Aveu, publié en 1968.

Le tournage eut lieu à Lille à l’automne 1969. Montand s’investit pleinement dans son rôle d’accusé soumis à l’enfermement et à la torture. Il se priva volontairement de nourriture, ne mangeant que du riz et des légumes, et perdit plusieurs kilos. La nuit il dormait à même le sol ; et, entre les prises, il gardait les mains attachées par des menottes derrière le dos. C’est un Montand amaigri aux traits tirés, que ses geôliers cherchent à faire passer aux aveux.
Comme pour ajouter à la vraisemblance, c’est Simone Signoret qui interprète elle-même la femme de Montand. Rien ne peut ébranler sa foi dans le Parti. Quand son mari est arrêté, elle cherche toutes les raisons possibles pour justifier l’attitude du Parti.
Dans la mécanique qui se met en place,
la torture a son importance
Costa-Gavras et son scénariste, Jorge Semprun, ne cherchent ni à émouvoir ni à attendrir le spectateur, mais ils veulent lui montrer comment un innocent finit par avouer des crimes imaginaires. Dans la mécanique qui se met en place, la torture a son importance. De façon à réduire sa capacité de résistance, le détenu est privé de la lumière du jour et de sommeil ; il est condamné à faire les cent pas dans sa cellule constamment éclairée, sans pouvoir s’allonger ou même s’asseoir. Mais, dans le cas du personnage de Montand, l’humiliation et la torture se révèlent insuffisantes.
L’interrogateur fait preuve de patience et d’habileté pour obtenir de Montand qu’il reconnaisse, un par un, des faits qui, pris isolément, ne présentent aucune signification particulière. La méthode est apparemment rigoureuse, puisqu’elle consiste, pas à pas, à établir des vérités « objectives », qui ne souffrent pas la contestation.
Dans un second temps, l’interrogateur rassemble les faits entre eux en les enchaînant, et les présente de telle manière que la culpabilité de Montand saute aux yeux. C’est, soit dit en passant, la démonstration selon laquelle une addition de faits avérés ne fait pas forcément une vérité.
Au moment de signer sa déclaration, l’accusé hésite. Alors l’interrogateur lui fait valoir un suprême argument : s’il consent à signer, sa femme et ses enfants seront épargnés. Cette forme de chantage s’avère très concluante.
Montand est prié d’apprendre par cœur le texte de sa confession
et de le déclamer avec foi et sincérité
La seconde partie du film est centrée sur le procès. Pour que Montand soit présentable devant ses juges, les geôliers le soumettent, dans les jours qui précèdent, à un régime destiné à retrouver un bon teint ; il subit notamment des piqures de calcium et des séances de lampe-à-bronzer. Cette « remise en forme » est accompagnée de tout un conditionnement. Il est prié d’apprendre par cœur le texte de sa confession et de le déclamer avec foi et sincérité. Le procès est public, et, comme s’il s’agissait d’une dramatique, il est radiodiffusé, afin que nul doute ne continue de planer sur la culpabilité des accusés.
Quatorze anciens apparatchiks, réduits à l’état de loques, comparaissent ce jour-là. Parmi eux se trouve l’ancien secrétaire général du PC. La vie sauve leur a été promise en échange de leur reconnaissance de culpabilité. C’est ainsi que tous les accusés, sans exception, avouent leurs crimes en s’en tenant au texte établi par le Parti. Malgré la promesse qui leur a été faite, la plupart sont condamnés et pendus, le personnage joué par Montand étant l’un des rares accusés à être seulement condamné à de la prison.
Il est évident que la dureté des conditions de tournage de L’Aveu fut l’occasion pour Montand de trouver une forme d’expiation aux errements qu’il pensait avoir commis en apportant trop longtemps son soutien à l’URSS. C’est presque son aveuglement qui figure dans l’affiche du film. Certains spectateurs peuvent se régaler de l’accumulation de perles propres à la lange de bois communiste, telle que : « On peut toujours s’expliquer avec le Parti » ; « Le Parti a toujours raison » ; « Mieux vaut avoir tort avec le Parti que raison en dehors » ; « Qu’importe que nous soyons broyés si la Révolution continue »…
Cependant il serait facile d’ironiser sur la naïveté de ces militants communistes. En voyant le film, il faut garder en tête que beaucoup de contemporains crurent en l’authenticité des procès staliniens. Ce fut notamment le cas, dans les années trente, à l’occasion des Procès de Moscou. Même des farouches anticommunistes crurent en la sincérité des aveux des accusés, parce que, malgré leur anticommunisme, ils ne pouvaient concevoir que des innocents s’accusassent de crimes qu’ils n’avaient pas commis. Cela défiait l’imagination.
L’un des grands mérites de ce film est de démonter la mécanique implacable qui conduit un innocent à avouer un crime qu’il n’a pas commis.
L’Aveu, de Costa-Gavras, 1969, avec Yves Montand, Simone Signoret, Michel Vitold et Gabriele Ferzetti, DVD StudioCanal.
09:50 Publié dans Drame, Film, Histoire | Tags : l’aveu, costa-gavras, montand, simone signoret, michel vitold, gabriele ferzetti | Lien permanent | Commentaires (0)
12/06/2017
Les Racines du ciel, de Romain Gary
Le premier roman écologique
Les Racines du ciel
Le héros de ce roman écologique, un Français nommé Morel, fait circuler en Afrique une pétition réclamant l’interdiction de la chasse aux éléphants. Qualifié de farfelu, il entre dans la clandestinité et s’allie à un chef africain qui se bat pour l’indépendance de son peuple. Romain Gary lance un appel à la protection de la nature, il dénonce l’utilitarisme de la société moderne et prend la défense des éléphants, qu’il juge indispensables à la beauté de la vie.
Publiées en 1956, Les Racines du ciel furent couronnées du prix Goncourt. Des années plus tard, il apparut que Romain Gary avait écrit là le premier roman écologique. Le mot écologie est utilisé à plusieurs reprises dans le livre, pour souligner que bien des personnages ne l’avaient jamais entendu auparavant.
Le titre Les Racine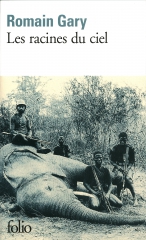 s du ciel reprend une expression empruntée à l’islam : lesdites racines sont celles plantées par le ciel au cœur de l’homme, la première d’entre elles étant la liberté. Or, en AEF (Afrique équatoriale française), au nom de la liberté, un individu du nom de Morel se bat pour la sauvegarde des éléphants, espèce menacée d’extinction. Trente mille d’entre eux seraient tués chaque année par des chasseurs, « pour fournir, écrit Gary, des boules de billard et des coupe-papier » aux Occidentaux. Morel, un idéaliste, fait circuler une pétition réclamant l’interdiction de la chasse à l’éléphant. Certains acceptent de la signer, d’autres s’y refusent ; et d’autres encore se montrent hésitants, tel le père Fargue, un franciscain, qui fait observer à propos de la pétition : « On n’avait pas l’impression de signer pour les éléphants, mais contre les hommes. »
s du ciel reprend une expression empruntée à l’islam : lesdites racines sont celles plantées par le ciel au cœur de l’homme, la première d’entre elles étant la liberté. Or, en AEF (Afrique équatoriale française), au nom de la liberté, un individu du nom de Morel se bat pour la sauvegarde des éléphants, espèce menacée d’extinction. Trente mille d’entre eux seraient tués chaque année par des chasseurs, « pour fournir, écrit Gary, des boules de billard et des coupe-papier » aux Occidentaux. Morel, un idéaliste, fait circuler une pétition réclamant l’interdiction de la chasse à l’éléphant. Certains acceptent de la signer, d’autres s’y refusent ; et d’autres encore se montrent hésitants, tel le père Fargue, un franciscain, qui fait observer à propos de la pétition : « On n’avait pas l’impression de signer pour les éléphants, mais contre les hommes. »
Après tout, si l’on y réfléchit, à quoi un éléphant vivant sert-il ? A rien, il n’est d’aucune utilité. Précisément, le combat de Morel pour les éléphants, c’est un combat contre l’utilitarisme de la société, et ce au nom de la liberté. L’un des soutiens de Morel déclare qu’il s’agit tout simplement de « respecter la nature, la liberté vivante, sans aucun rendement, sans utilité, sans autre objet que de se laisser entrevoir de temps en temps. » Une partie de la presse française relaie le combat de Morel en écrivant : « Les éléphants sont maladroits, encombrants, anachroniques, menacés de toutes parts, et pourtant indispensables à la beauté de la vie. »
Sur le terrain, en Afrique, Morel apparaît bien isolé, la plupart des colons le prenant pour un farfelu. Même les indigènes, dont Romain Gary pressent qu’ils vont tantôt accéder à l’indépendance, ne sont pas sensibles à ses idées. Un colonel britannique déclare à propos des Africains : « La seule chose que les indigènes voient dans un éléphant, c’est la viande. […] Quant à la beauté de l’éléphant, sa noblesse, sa dignité, et cetera, ce sont des idées entièrement européennes comme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. »
Gary, compagnon de la Libération,
n’hésite pas à enrôler de Gaulle
dans le combat pour la défense des éléphants
Malgré tout, Morel réussit à gagner à sa cause le chef Waïtari, ancien député des Oulés. Couvert d’un képi cinq étoiles, Waïtari se bat pour l’indépendance de l’Afrique et se rêve en chef incontesté de la « future fédération africaine de Suez au Cap », tant son ambition est forte. Bien qu’il soit indifférent au sort des animaux, il rallie Morel et entre avec lui dans la clandestinité, parce qu’il voit dans la cause des éléphants l’« instrument de propagande rêvé ». Risquer la prison ne lui fait pas peur, car, dit-il, « aujourd’hui, les prisons coloniales sont les antichambres des ministères. » Morel n’est pas dupe des intentions politiques de Waïtari, il se veut lucide et a fait le calcul suivant : « Si les autorités se persuadent que la protection des éléphants est un prétexte à une action politique, alors elles seront tentées de réagir et d’interdire la chasse d’éléphants, afin d’enlever aux "rebelles" tout motif d’agitation. » Ainsi, en s’alliant à Waïtari qui poursuit un autre but que lui, Morel espère bien atteindre le but que, pour sa part, il s’est fixé.
Dans ce livre les personnages sont très nombreux, tous masculins, sauf Minna, une jeune Allemande, violée par les Russes en 1945, et qui suit Morel par « amour de la nature ». Certains protagonistes semblent directement inspirés de personnalités de l’époque. Ainsi il est fait mention d’« un écrivain américain qui vient régulièrement en Afrique pour abattre sa ration d’éléphants, de lions, de rhinos » : on pense immédiatement à Hemingway. Et surtout le personnage du père Tassin, un jésuite, est la copie presque conforme du père Teilhard de Chardin. Comme ce dernier, Tassin est paléontologue et a la « réputation de s’intéresser beaucoup plus aux origines scientifiques de l’homme qu’à son âme. » Pour le personnage de Morel, Romain Gary indiqua plus tard, dans son livre La Promesse de l’aube, s’être inspiré d’un sergent nommé Dufour, dont il avait la connaissance lors de la débâcle de juin 1940, et qu’il qualifie d’ « homme qui ne savait pas désespérer ».
Comme le sergent Dufour et comme Gary lui-même, Morel a rallié la France Libre dès 1940. Dans son périple africain il porte, épinglée à sa chemise, une petite croix de Lorraine. Le compagnon de la Libération qu’est Gary n’hésite pas à enrôler de Gaulle dans son combat en proclamant que lui aussi est « un homme qui croyait aux éléphants. »
L’un des passages les plus marquants du livre est autobiographique. A un moment, un avion survole en rase-mottes un troupeau d’éléphants contre lequel il finit par s’écraser, tuant plusieurs de ces bêtes. Gary a vécu un tel accident pendant la guerre, qu’il raconte également dans La Promesse de l’aube.
Les Racines du ciel sont un livre dense, touffu, voire boursouflé. Gary n’hésite pas à se répéter au fil des pages et son récit n’est ni linéaire ni chronologique, ce qui peut compliquer la lecture. On peut être a priori indifférent à son appel à la protection de la nature et trouver son message vaguement panthéiste. Néanmoins, les personnages créés par l’auteur sont attachants ; peu à peu il réussit à gagner la sympathie du lecteur et à lui faire épouser la cause des éléphants.
Les Racines du ciel, de Romain Gary, 1956, collection Folio.
10:18 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : les racines du ciel, romain gary | Lien permanent | Commentaires (0)


