21/11/2016
Mémoires d'outre-tombe, de Chateaubriand, Livres I à XII
Monument de la littérature
Mémoires d’outre-tombe
Livres I à XII
En écrivant les Mémoires d’outre-tombe Chateaubriand a érigé une statue à sa propre gloire dans le but de passer à la postérité. Il prend le lecteur par la main et celui-ci n’a qu’à se laisser guider. L’ensemble est vivant, les chapitres sont courts et le style de l’auteur est fluide. Dans les livres I à XII, Chateaubriand évoque son enfance à Combourg, les débuts de la Révolution et son voyage en Amérique.
Selon la volonté de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe furent publiés après sa mort, d’où leur titre. L’auteur narre les principaux épisodes de sa vie, il retrace également les grands événements de l’Histoire auxquels il a été mêlé et évoque les grands personnages qu’il a croisés sur sa route, donnant à son œuvre un aspect de fresque épique.
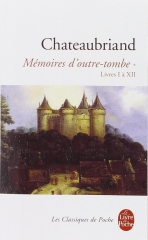 Chateaubriand a vécu la Révolution française, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet ; il a rencontré Washington en Amérique ; il a été en pèlerinage à Jérusalem ; il a assisté à la fin de la féodalité et aux débuts de la Révolution industrielle. Les Mémoires d’outre-tombe constituent un témoignage de première importance pour comprendre une époque qui a été marquée par de grandes transformations. Peu importe que son imagination débordante conduise Chateaubriand à se rappeler des faits qui ne sont peut-être jamais produits ; ce qui compte, c’est que par la force de son écriture et de ses évocations, il amène le lecteur à s’identifier à lui et à se plonger dans les périodes qu’il a traversées.
Chateaubriand a vécu la Révolution française, l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet ; il a rencontré Washington en Amérique ; il a été en pèlerinage à Jérusalem ; il a assisté à la fin de la féodalité et aux débuts de la Révolution industrielle. Les Mémoires d’outre-tombe constituent un témoignage de première importance pour comprendre une époque qui a été marquée par de grandes transformations. Peu importe que son imagination débordante conduise Chateaubriand à se rappeler des faits qui ne sont peut-être jamais produits ; ce qui compte, c’est que par la force de son écriture et de ses évocations, il amène le lecteur à s’identifier à lui et à se plonger dans les périodes qu’il a traversées.
Les Mémoires d’outre-tombe sont une œuvre (constituée de trente-quatre livres) qui, par sa longueur, peut donner le vertige à qui voudrait se lancer dedans. Mais, en réalité, l’ensemble est aéré, car les chapitres sont courts. Et surtout, le style de l’auteur est fluide et vivant, ce qui rend la lecture aisée. On peut presque dire que Chateaubriand prend le lecteur par la main, et que celui-ci n’a qu’à se laisser guider, quitte à s’arrêter sur certaines phrases pour bien s’en imprégner.
Les Mémoires d’outre-tombe sont un monument de la littérature et sont aussi un monument que Chateaubriand a édifié à sa propre gloire dans le but de passer à la postérité, alors qu’il craignait d’être oublié des générations à venir.
***
Les livres I à XII, consacrés par Chateaubriand à ses années de jeunesse, ont été regroupés en un volume de la collection Le Livre de poche, l’ensemble des mémoires faisant quatre tomes.
La solitude de Combourg
François-René de Chateaubriand naquit en 1768 à Saint-Malo. Le petit René avait un frère et quatre sœurs, dont il était le cadet. Il était très proche de sa sœur Lucile ; tous deux vivaient auprès de leurs parents en Bretagne. M. de Chateaubriand, seigneur de l’Ancien Régime, s’était retiré dans son château de Combourg, au nord de Rennes (voyez l’illustration de couverture ci-dessus). Il y menait une vie triste et solitaire, ne recevant quasiment aucun visiteur. Selon René, son père était un homme redouté qui inspirait la crainte :
M. de Chateaubriand était grand et sec; il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits et pers ou glauques, comme ceux des lions ou des anciens barbares. Je n’ai jamais vu un pareil regard : quand la colère y montait, la prunelle étincelante semblait se détacher et venir vous frapper comme une balle.
Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. Son état habituel était une tristesse profonde que l’âge augmenta et un silence dont il ne sortait que par des emportements. Avare dans l’espoir de rendre à sa famille son premier éclat, hautain aux états de Bretagne, dur avec ses vassaux à Combourg, taciturne, despotique et menaçant dans son intérieur, ce qu’on sentait en le voyant était la crainte.
« Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été »
Chateaubriand introduit le lecteur dans le quotidien de Combourg. Son père était le premier levé le matin :
Mon père se levait à quatre heures du matin, hiver comme été : il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre, à l’entrée de l’escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à cinq heures ; il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu’à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre, à huit heures du matin. Je n’avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner ; j’étais censé étudier jusqu’à midi : la plupart du temps, je ne faisais rien.
Les soirées à Combourg se déroulaient dans une atmosphère lourde. Ni Lucille, ni René, ni leur mère, saisis de terreur, n’osaient avoir de conversation en présence de M. de Chateaubriand. Quand dix heures sonnaient à l’horloge du château, M. de Chateaubriand tirait sa montre, la montait, embrassait ses enfants et se retirait pour se coucher. Les portes se refermaient sur lui, et alors :
Le talisman était brisé ; ma sœur, ma mère et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles : si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher.
François-René de Chateaubriand est né dans une famille noble, mais, ainsi qu’il le souligne, cela fut le fruit du hasard. Il n’en tire aucune vanité et juge sans complaisance son milieu social :
Je suis né gentilhomme. Selon moi, j’ai profité du hasard de mon berceau, j’ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l’aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L’aristocratie a trois âges successifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités : sortie du premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier.
Chateaubriand est présenté au Roi à Versailles
« Obscur cadet de Bretagne », le jeune Chateaubriand, âgé de dix-huit ans, fait ses débuts à la cour à Versailles. Un matin de février 1787, dans le salon de l’Œil-de-Bœuf, au milieu des courtisans, il est là à attendre le lever du Roi. Sous le règne de Louis XVI, la cérémonie du lever semble réduite à une fonction symbolique :
La chambre à coucher du Roi s’ouvrit : je vis le Roi, selon l’usage, achever sa toilette, c’est-à-dire prendre son chapeau de la main du premier gentilhomme de service.
Le lendemain, le « débutant » Chateaubriand est invité à chasser avec le Roi dans la forêt de Saint-Germain. Au cours de la chasse, après qu’un chevreuil eut été abattu, Louis XVI dit à Chateaubriand : « Il n’a pas tenu longtemps ! » Et, dans ses mémoires, Chateaubriand a ce commentaire : « C’est le seul mot que j’aie jamais obtenu de Louis XVI. »
Chateaubriand critique les dépenses de la monarchie,
les dettes des princes et les acquisitions de châteaux
Avec le recul des années, malgré son attachement aux Bourbons et à la monarchie, Chateaubriand critique sévèrement les excès de dépenses dans le budget de la maison du Roi et dénonce « les dettes des princes, les acquisitions de châteaux et les déprédations de la cour », le terme de déprédation devant s’entendre ici au sens de « détournement d’argent ». Par ailleurs, Chateaubriand a conscience des contradictions de la société française :
A cette époque, tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d’une révolution prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tournaient en moquerie la gravité de leurs pères. […] Le prêtre, en chair, évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du législateur des chrétiens ; les ministres tombaient les uns sur les autres ; le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d’être Américain à la ville, Anglais à la cour, Prussien à l’armée ; d’être tout, excepté Français. Ce que l’on faisait, ce que l’on disait était une suite d’inconséquences. On prétendait garder des abbés commendataires, et l’on ne voulait point de religion ; nul ne pouvait être officier s’il n’était gentilhomme, et l’on déblatérait contre la noblesse ; on introduisait l’égalité dans les salons et les coups de bâton dans les camps.
Chateaubriand spectateur des débuts de la Révolution
Le 14 juillet 1789, à Paris, Chateaubriand était le « spectateur » de la prise de la Bastille, qu’il qualifie d’« assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur ». Il décrit les « orgies » qui suivirent et ironise sur la multiplication des clefs qui se produisit : « Les clefs de la Bastille se multiplièrent ; on en envoya à tous les niais d’importance dans les quatre parties du monde. » Cependant, avec le recul, Chateaubriand mesure la portée de l’événement :
Tout événement, si misérable ou si odieux qu’il soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et qu’il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté : ce qu’il fallait voir dans la prise de la Bastille (et qu’on ne vit pas alors), c’était, non l’acte violent de l’émancipation d’un peuple, mais l’émancipation même, résultat de cet acte.
« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable,
de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste »
Quelques jours après le 14 juillet 1789, Chateaubriand était aux fenêtres de son hôtel avec ses sœurs, quand :
Nous entendons crier : « Fermez les portes ! Fermez les portes ! » Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue ; du milieu de ce groupe s’élevaient deux étendards que nous ne voyions pas bien de loin. Lorsqu’ils s’avancèrent, nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées, que les devanciers de Marat portaient au bout d’une pique : c’était les têtes de MM. Foulon et Bertier. […] Ces têtes, et d’autres que je rencontrai bientôt après, changèrent mes dispositions politiques ; j’eus horreur des festins de cannibales […].
Chateaubriand eut d’abord de la sympathie pour les idées nouvelles, mais il fut dégoûté par le déchainement de violence de la Révolution :
La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique, et je reculai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste.
Paradoxalement, malgré la violence des événements, la vie culturelle est intense et les Parisiens sortent beaucoup. Chateaubriand s’en explique :
Les effets de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. […] Dans tous les coins de Paris, il y avait des réunions littéraires, des sociétés politiques et des spectacles ; les renommées futures erraient dans la foule sans être connues, comme les âmes au bord du Léthé avant d’avoir joui de la lumière. J’ai vu le maréchal Gouvion Saint-Cyr remplir un rôle, sur le théâtre du Marais, dans la Mère coupable de Beaumarchais. […] Aux théâtres, les acteurs publiaient les nouvelles ; le parterre entonnait des couplets patriotiques. Des pièces de circonstance attiraient la foule : un abbé paraissait sur scène ; le peuple lui criait : « Calotin ! calotin ! » et l’abbé répondait : « Messieurs, vive la nation ! »
Dans le Nouveau-Monde
Chateaubriand rencontre Washington
Dégoûté par la violence révolutionnaire, l’idée de quitter la France pour quelque pays lointain germait dans l’esprit de Chateaubriand. En 1791, il s’embarqua pour l’Amérique. Arrivé là-bas, il remarqua que d’autres Français l’avaient précédé, la jeune République offrant l’asile à des émigrés qui n’avaient pas les mêmes idées que lui. « Une terre de liberté, note Chateaubriand, offrait un asile à ceux qui fuyaient la liberté : rien ne prouve mieux le haut prix des institutions généreuses que cet exil volontaire du pouvoir absolu dans une pure démocratie. »
A Philadelphie, muni d’une lettre de recommandation, Chateaubriand se présente au palais du président des Etats-Unis : « une petite maison, ressemblant aux maisons voisines ». Il est introduit auprès du général Washington, un homme « d’une grande taille, d’un air calme et froid plutôt que noble. » Le président lui parla « par monosyllabes anglais et français », et l’invita à dîner le soir suivant. Or, ce soir-là, à table, les cinq ou six convives présents parlèrent des événements en France, et il se passa ceci :
La conversation roula sur la Révolution française. Le général nous montra une clef de la Bastille [envoyée par La Fayette]. Ces clefs, je l’ai déjà remarqué, étaient des jouets assez niais qu’on distribuait alors. […] Si Washington avait vu dans les ruisseaux de Paris les vainqueurs de la Bastille, il aurait moins respecté sa relique.
Chateaubriand déplore la quasi-absence
de la langue française en Amérique
Dans un passage des Mémoires rédigé en 1822, Chateaubriand est assez critique sur l’Amérique du Nord, notamment quant au sort réservé aux tribus indiennes, « car, note-il, les puissances civilisées, républicaines et monarchiques, se partagent sans façon en Amérique des terres qui ne leur appartiennent pas. »
Aux Etats-Unis, il fut « fort scandalisé de trouver partout le luxe des équipages, la frivolité des conversations, l’inégalité des fortunes, l’immoralité des maisons de banque et de jeu, le bruit des salles de bal et de spectacle. »
Cependant, dans la version des Mémoires revue en 1846, Chateaubriand reste fasciné par le prodigieux essor que connaissent les Etats-Unis et notamment leurs villes. Ainsi il souligne qu'en 1791, « New-York était loin d’être ce qu’elle est aujourd’hui, loin de ce qu’elle sera dans quelques années : car les Etats-Unis croissent plus vite que ce manuscrit. »
Chateaubriand déplore la quasi-absence de la France dans le Nouveau Monde, suite à la perte du Canada sous Louis XV et la vente de la Louisiane par Napoléon Bonaparte ; et il laisse entrevoir le déclin du rayonnement de la langue française :
Nous sommes exclus du nouvel univers, où le genre humain recommence : les langues anglaise, portugaise, espagnole, servent en Afrique, en Asie, dans l’Océanie, dans les îles de la mer du Sud, sur les continents des deux Amériques, à l’interprétation de la pensée de plusieurs millions d’hommes ; et nous, déshérités des conquêtes de notre courage et de notre génie, à peine entendons-nous parler dans quelques bourgades de la Louisiane et du Canada, sous une domination étrangère, la langue de Colbert et de Louis XIV : elle n’y reste que comme un témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique.
Apprenant l’arrestation du Roi à Varennes, Chateaubriand décida de rentrer en France. Il débarqua en Bretagne, embrassa sa mère à Saint-Malo, et se maria ; ou plutôt, comme il le dit lui-même, on le maria. Puis il rejoignit l’armée des princes, se battit aux côtés des émigrés et passa en Angleterre. C’est en exil qu’il apprit l’arrestation de sa mère et de ses sœurs et l’exécution de son frère aîné.
Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand, 1848, Livres I à XII, collection Le Livre de poche.
08:39 Publié dans Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre, Mémoires, autobiographie, témoignage | Tags : mémoires d'outre-tombe, chateaubriand | Lien permanent | Commentaires (2)
14/11/2016
Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, de Fritz Lang
Chef-d’œuvre aux allures de bande dessinée
Le Tigre du Bengale
et
Le Tombeau hindou
Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou sont deux films d’aventures captivants de bout en bout. L’intrigue, racontée en deux épisodes, a un côté feuilletonesque qui accumule les péripéties. Comme dans une bande dessinée, Fritz Lang privilégie le récit aux dépens de la psychologie des personnages. Les critiques de la Nouvelle Vague ont vu un chef-d’œuvre dans ces deux films.
A la fin des années 50, cela faisait plus de vingt ans que Fritz Lang vivait en Amérique. Il avait fui l’Allemagne nazie dans les années trente et s’était installé en Californie au milieu d’autres exilés. Ses films, tels que Docteur Mabuse, Métropolis et M le Maudit, l’avaient déjà rendu célèbre, et la MGM, le plus grand studio d’Hollywood, lui avait ouvert grand ses portes. En Amérique, Fritz Lang réalisa des films noir, des films de guerre, des films d’aventure et des westerns, mais sans retrouver le prestige qui avait été le sien en Allemagne.
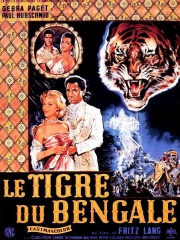 Pour se convaincre du semi-échec de sa carrière américaine, il suffit de confronter son parcours à celui de son cadet Hitchcock. Hitchcock, venu d’Angleterre, était arrivé à Hollywood trois ans après Fritz Lang. Il s’était spécialisé dans le suspense, et ses films rencontraient le succès. Dans les années cinquante, ses performances au box-office, combinées à ses passages à la télévision dans la série Hitchcock présente, faisaient du Britannique le cinéaste le plus populaire d’Amérique.
Pour se convaincre du semi-échec de sa carrière américaine, il suffit de confronter son parcours à celui de son cadet Hitchcock. Hitchcock, venu d’Angleterre, était arrivé à Hollywood trois ans après Fritz Lang. Il s’était spécialisé dans le suspense, et ses films rencontraient le succès. Dans les années cinquante, ses performances au box-office, combinées à ses passages à la télévision dans la série Hitchcock présente, faisaient du Britannique le cinéaste le plus populaire d’Amérique.
Rien de tel ne s’était produit pour Fritz Lang. Le succès l’avait déserté. En 1955, pour faire oublier ses films noirs considérés – à tort – comme mineurs par la critique américaine, il s’était résolu à entreprendre un grand film d’aventures produit par la MGM. Ce fut Les Contrebandiers de Moonfleet, tournés en couleurs et en cinémascope. Malgré tous les efforts de Fritz Lang, le film ne rencontra pas son public.
Dès lors, le cinéaste se décida à rentrer en Allemagne, libérée du nazisme. Sur place, il fut contacté par un producteur qui se proposa de lui offrir un budget considérable pour sa prochaine réalisation. Fritz Lang décida de tourner Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, un récit en deux épisodes. Il reprit ici un scénario qu’avait écrit dans les années vingt Thea von Harbou, son épouse de l’époque ; un film en avait été tiré, mais Fritz Lang avait regretté de n’avoir pu le réaliser. Le diptyque qu’il comptait tourner serait aussi une manière de rendre hommage à son ex-épouse qui venait de mourir.
L’ampleur de son budget donna à Fritz Lang la possibilité de tourner les extérieurs en Inde et de réaliser les deux films en couleurs. Mais, parce qu’il n’aimait pas le format cinémascope, bon selon lui à filmer les serpents et les enterrements, il resta fidèle au format quasi-carré du 1.33.
Au pays du maharadjah, on jette les traîtres aux tigres
et on sacrifie aisément les serviteurs
L’histoire est celle d’un jeune architecte européen appelé auprès du maharadjah d’Eschnapour pour lui bâtir un palais. L’architecte sauve la vie de Seetha, une jeune danseuse du temple, menacée par un tigre, et tombe amoureux d’elle. Mais le maharadjah convoite la jeune femme. Quand il apprend que les deux jeunes gens se sont enfuis ensemble, il lance son armée à leur poursuite et bouleverse ses plans. Ce n’est plus un palais qu’il entend bâtir, mais un mausolée qui soit une « sépulture digne d’un amour infini, d’un amour perdu, d’un amour à jamais défunt ».
Aveuglé par la perte de la jeune femme, le maharadjah ne voit pas le complot tramé dans l’ombre par son frère aîné, qui estime que le trône lui revient de droit.
Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou sont deux films d’aventures captivants de bout en bout. L’œuvre a un côté feuilletonesque qui accumule les péripéties. Le spectateur tremble pour les deux jeunes héros : menacés par le très inquiétant maharadjah, ils courent un danger permanent. Certaines scènes sont terribles et ont un côté clairement sadique. Au pays du maharadjah, la vie humaine ne compte guère, surtout celle des serviteurs. On les sacrifie aisément, tandis que l’on jette les traîtres aux tigres. A la violence s’ajoute la puissance érotique de certaines scènes, notamment quand Seeta se met à danser avec une sensualité certaine.
Chacun des personnages est mû par un désir unique : celui de posséder Seeta, en ce qui concerne le jeune architecte et le maharadjah ; et la volonté de conquérir le trône, pour ce qui est du frère du maharadjah, qui s’estime dépossédé de son droit d’aînesse. Fritz Lang met au second plan les caractères et privilégie l’enchainement des faits qui conduisent au drame. Son sens du récit, allié à la psychologie sommaire des personnages, donne à l’ensemble des allures de bande dessinée.
Les dialogues ont un côté littéraire et le dépaysement est garanti. L’histoire paraît hors du temps. Le spectateur ne sait pas s’il est dans l’Inde des années vingt ou dans celle des années cinquante. Et surtout, Fritz Lang fait preuve d’une grande maîtrise technique. Même le spectateur à l’œil exercé est bien en peine de distinguer les plans tournés en studio (à Berlin) des extérieurs filmés en Inde.
Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou sortirent en 1959. En Allemagne, la critique fut mauvaise, mais les spectateurs furent au rendez-vous. En France, les Jeunes Turcs de la Nouvelle Vague, notamment Jean-Luc Godard et Claude Chabrol, s’enflammèrent pour le film et crièrent au chef-d’œuvre. Le mythe Fritz Lang était en train de naître.
Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, de Fritz Lang, 1959, avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Walter Reyer et Claus Holm, deux DVD Wild Side Video.
08:41 Publié dans Aventures, Film | Tags : le tigre du bengale, le tombeau hindou, fritz lang, debra paget, paul hubschmid, walter reyer, claus holm | Lien permanent | Commentaires (0)
07/11/2016
Là-bas, de Huysmans
Enquête sur les milieux sataniques
Là-bas
Là-bas est le premier roman mettant en scène Durtal, le double littéraire de Huysmans. Pour écrire son livre consacré au Démon, l’auteur avait au préalable enquêté sur les milieux sataniques et assisté à une messe noire. Le lecteur, qu’il soit croyant ou incroyant, s’identifie sans mal à Durtal, qui, au départ, se montre très sceptique qaund on lui parle du Diable.
Lorsqu’il écrivit ce livre, Huysmans était « en recherche », il s’intéressait alors aux sciences occultes et au satanisme. Tout en commençant de fréquenter les églises, il rencontra un abbé déchu et assista à une messe noire. Il s’intéressa aussi de près à la figure de Gilles de Rais, dit Barbe-Bleue, et visita son château de Tiffauges.
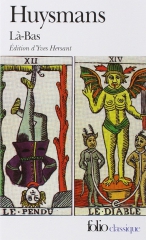 C’est toute cette matière qui a inspiré Huysmans dans l’écriture de Là-bas. Le personnage principal du roman s’appelle Durtal. C’est un écrivain qui est en réalité le double littéraire de Huysmans. Durtal, « resté célibataire et sans fortune » est un peu un marginal dans sa profession ; il a cessé de fréquenter le monde des lettres qui se prend pour le « diocèse de l’intelligence ». L’un de ses rares amis est un médecin du nom de des Hermies, avec qui il aime à discuter de choses et d’autres, notamment de littérature. Tous deux dînent régulièrement chez Carhaix, le sonneur de cloches de Saint-Sulpice. Durtal n’aime pas cette église et la qualifie d’« abominable construction ». Il concède cependant que son architecte a été visionnaire, puisque, à une époque où le chemin de fer n’existait pas encore, il a symbolisé « le future embarcadère des railways » ; pour Durtal, « Saint-Sulpice, ce n’est pas, en effet, une église, c’est une gare. »
C’est toute cette matière qui a inspiré Huysmans dans l’écriture de Là-bas. Le personnage principal du roman s’appelle Durtal. C’est un écrivain qui est en réalité le double littéraire de Huysmans. Durtal, « resté célibataire et sans fortune » est un peu un marginal dans sa profession ; il a cessé de fréquenter le monde des lettres qui se prend pour le « diocèse de l’intelligence ». L’un de ses rares amis est un médecin du nom de des Hermies, avec qui il aime à discuter de choses et d’autres, notamment de littérature. Tous deux dînent régulièrement chez Carhaix, le sonneur de cloches de Saint-Sulpice. Durtal n’aime pas cette église et la qualifie d’« abominable construction ». Il concède cependant que son architecte a été visionnaire, puisque, à une époque où le chemin de fer n’existait pas encore, il a symbolisé « le future embarcadère des railways » ; pour Durtal, « Saint-Sulpice, ce n’est pas, en effet, une église, c’est une gare. »
Le seul endroit que Durtal aime dans Saint-Sulpice, c’est l’appartement de Carhaix situé dans l’une des tours. Le sonneur et sa femme sont entièrement dévoués à l’Eglise et ne se permettent jamais de critiquer l’institution, alors que pourtant, à ce que Durtal peut remarquer, le clergé n’a guère d’égard pour eux : « Ils ploient sous le despotisme des prêtres, - et il y a des moments où ça ne doit pas être drôle,- et ils les révèrent et les adorent ! » Des Hermies ne pense guère différemment. Ainsi il déclare à son ami que « le dix-neuvième siècle regorge d’abbés immondes ».
Durtal n’a plus qu’une idée en tête,
assister à une messe noire célébrée par le chanoine Docre
Quand ils sont à la table de Carhaix, Durtal et des Hermies font attention à mesurer leur propos afin de ne pas choquer leur hôte. Mais, un soir, Des Hermies parle de l’abbé Boudes, un ecclésiastique à la réputation sulfureuse, accusé de crimes. Il évoque aussi ceux qu’on nomme « les prêtres habitués ». Ce sont, explique des Hermies, « tous les ecclésiastiques qui ont failli en province » ; ils sont envoyés à Paris « où ils sont moins en vue, presque perdus dans la foule ». Dans les paroisses de la capitale, les curés et les vicaires se déchargent des besognes ingrates sur ces « prêtres habitués ». Ces propos irritent Carahaix, qui rétorque : « Voyons, des Hermies, vous allez trop loin ; car enfin, j’ai la prétention, moi aussi, de connaître les prêtres, et ce sont à Paris même de braves gens qui font leur devoir, en somme. […] Mais, il faudrait pourtant le dire à la fin, les abbés Boudes, les chanoines Docre sont, Dieu merci, des exceptions ; et, hors de Paris, à la campagne, par exemple, il y a dans le clergé de véritables saints ! »
C’est la première fois que Durtal entend parler du chanoine Docre, qui, dit-on, célèbre des messes noires quelque part dans Paris. Sa curiosité étant piquée au vif, Durtal veut en savoir plus sur les pratiques observées au cours de telles célébrations. Des Hermies lui fait des descriptions précises sur ce qui ressemble à un culte de l’ordure humaine. Durtal, qui fait partie des sceptiques, ne peut s’empêcher de rire : « Décidément les êtres qui, pieusement, ignoblement, suivent ces offices sont un peu fous ? » Mais des Hermies ne voit pas là de la folie, il prend au sérieux le culte du Démon : « Le culte du Démon n’est pas plus insane que celui de Dieu ; l’un purule et l’autre resplendit, voilà tout ; à ce compte-là, tous les gens qui implorent une divinité quelconque seraient des déments ! » Il qualifie les « affiliés du Satanisme » de « mystique d’un ordre immonde ». Mais le médecin qu’il est, peine à trouver une explication médicale : « La médecine classe tant bien que mal cette faim de l’ordure dans les districts inconnus de la Névrose ; et elle le peut, car personne ne sait au juste ce qu’est cette maladie dont tout le monde souffre ; il est bien certain, en effet, que les nerfs vacillent dans ce siècle, plus aisément qu’autrefois, au moindre choc. » Durtal et des Hermies évoquent aussi largement l’« incube », démon masculin censé abuser la femme dans son sommeil, et le « succube », son équivalent féminin pour l’homme.
Après ces conversations, Durtal le sceptique veut absolument voir de près à quoi ressemble une célébration satanique et n’a qu’une idée en tête : assister à une messe noire célébrée par le chanoine Docre.
Gilles de Rais se livrait à un manège diabolique
pour tromper ses petites victimes
Entre toutes ces rencontres et toutes ces conversations, Durtal travaille à son prochain livre, qui doit porter sur Gilles de Rais. Et c’est au cours de ce travail qu’il s’interroge le plus profondément sur le Démon. Gilles de Rais, maréchal de France, fut le compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, avec qui il libéra la France des Anglais. Après la mort de Jeanne, il se retira dans son château de Tiffauges et fut pris d’une exaltation mystique. Cette exaltation le conduisit, non vers Dieu, mais à rebours des enseignements du Christ. Il fit enlever des petits garçons, que leurs mères ne reverraient jamais, et se livra sur eux à des débauches. Après avoir mené ses œuvres criminelles dans une parfaite impunité pendant une dizaine d’années, il fut enfin arrêté. Au cours de son procès, il se convertit et fut condamné au bûcher.
Gilles de Rais fut donc ce qu’on qu’appellerait de nos jours un monstre, pour lequel on ne trouverait aucune circonstance atténuante. Pourtant, contre toute attente, Durtal, donc Huysmans, en fait un portrait nuancé : « A contempler le panorama de sa vie, l’on découvre en face de chacun de ses vices une vertu qui le contredit ; mais aucune route visible ne les rejoint. » Gilles de Rais fut orgueilleux et superbe, mais humble dans la contrition ; il fut féroce, mais se montra charitable au cours de son existence ; il fut impétueux et néanmoins patient. Gilles de Rais ne fut donc pas un monstre à cent pour cent, sa personnalité était double. En lui se jouait un combat entre le mal et le bien. Gilles de Rais, c’est en quelque sorte Dr Jekill Mister Hyde.
Cependant, ce qui fut particulièrement diabolique chez lui, c’est le manège qu’il mit au point pour tromper ses petites victimes. « Alors, écrit Huysmans, il dépassa, d’un coup, l’infamie de l’homme et entra de plain-pied dans la dernière ténèbre du Mal. » Dans sa chambre, ses sbires pendaient un enfant à un croc ; il faisait son entrée, apercevait le petit garçon ; et, selon Huysmans : « Gilles ordonnait de le descendre et de dénouer la corde. Il prenait alors avec précaution le petit sur les genoux, il le ranimait, le caressait, le dorlotait, essuyait ses larmes, lui disait en lui montrant ses complices : ces hommes-là sont méchants, mais tu vois, ils m’obéissent ; n’aies plus peur, je te sauve la vie et je vais te rendre à ta mère ; - et tandis que l’enfant éperdu de joie, l’embrassait, l’aimait, à ce moment, il lui incisait doucement le cou par derrière […]. » Et Huysmans de citer de nombreux détails sur les atrocités commises par Gilles de Rais.
« La plus grande force du Diable, c’est d’être nié. »
Le lecteur, qu’il soit croyant ou incroyant, s’identifie sans mal à Durtal, qui se veut un observateur neutre. C’est un incrédule. Il ne croit ni en Dieu ni au Diable, ne porte pas le clergé dans son cœur et n’est pas tenté par la foi du charbonnier. Mais, l’écriture de son livre sur Gilles de Rais et son intérêt croisant pour le satanisme, le conduisent à un certain nombre d’interrogations et de réflexions. Et il peut toujours compter sur des Hermies pour lui donner le point de vue d’un médecin, tandis que Carhaix est toujours prompt à défendre l’Eglise.
Le chapitre le plus attendu par bien des lecteurs est celui consacré à la messe noire célébrée par le chanoine Docre. En voyant le comportement de l’assistance, qui perd tout contrôle d’elle-même et qui se déchaîne dans tous les sens, Durtal ne sait s’il doit rire ou pleurer. Et quand des Hermies parle d’« un véritable sérail d’hystéro-épileptiques et éthéromanes », Carhaix croit bon de rappeler que « la plus grande force du Diable, c’est d’être nié. »
Là-bas fut publié en 1891. L’année suivante, Huysmans se convertissait au catholicisme. Il réutilisa le personnage de Durtal et le fit revenir dans son roman suivant, En route, qui est le récit de son cheminement vers la foi.
Là-bas, de Huysmans, 1891, collections Folio et Garnier Flammarion.
PS : Là-bas a inspiré à Jacques Martin et Jean Pleyers la série de bandes dessinées Jhen, aux éditions Casterman, certains passages du roman étant repris dans l’album Barbe-bleue.
08:35 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XIXe siècle | Tags : là-bas, huysmans | Lien permanent | Commentaires (0)


