30/05/2016
Mémoires d'Hadrien, de Marguerite Yourcenar
Souvenirs apocryphes d’un empereur
Mémoires d’Hadrien
Marguerite Yourcenar se glisse dans la peau de l’empereur Hadrien et imagine ce qu’eussent pu être ses mémoires, s’il en avait laissés. Elle fait preuve d’un tel mimétisme, qu’au bout d’un moment le lecteur finit par se convaincre qu’il est vraiment en train de lire les souvenirs laissés par Hadrien lui-même.
L’empereur Hadrien n’a jamais laissé de mémoires. Mais, en puisant dans les sources de l’époque, notamment dans sa correspondance, Marguerite Yourcenar a imaginé ce qu’eussent pu être les souvenirs de l’empereur. Le résultat est étonnant. Marguerite Yourcenar s’efface complètement derrière son personnage ; elle fait preuve d’un tel mimétisme, d’une telle empathie, qu’au bout d’un moment le lecteur finit par se convaincre qu’il est vraiment en train de lire un texte rédigé par Hadrien lui-même. Soyons franc. Ce livre ne se dévore pas comme un roman policier. L’absence totale de dialogues peut décourager nombre de lecteurs et le langage soutenu employé par l’auteur peut paraître difficile et ardu. Pour bien profiter de ce livre, il est préférable de le lire quand on a du temps, notamment du « temps de cerveau disponible ».
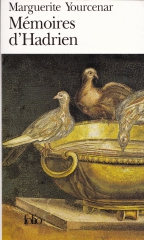 Marguerite Yourcenar a donné à ces mémoires apocryphes la forme d’une longue lettre qu’Hadrien écrit à Marc-Aurèle, un garçon de dix-sept ans, déjà désigné par lui pour régner un jour sur l’empire. Hadrien est alors âgé de soixante ans, c’est un homme diminué par la maladie ; il sent que son corps, « ce fidèle compagnon », ne lui répond plus. Même s’il ignore quand il va mourir, il sait que ses jours sont comptés, et, avant de partir, il fait à Marc-Aurèle le récit de sa vie.
Marguerite Yourcenar a donné à ces mémoires apocryphes la forme d’une longue lettre qu’Hadrien écrit à Marc-Aurèle, un garçon de dix-sept ans, déjà désigné par lui pour régner un jour sur l’empire. Hadrien est alors âgé de soixante ans, c’est un homme diminué par la maladie ; il sent que son corps, « ce fidèle compagnon », ne lui répond plus. Même s’il ignore quand il va mourir, il sait que ses jours sont comptés, et, avant de partir, il fait à Marc-Aurèle le récit de sa vie.
Hadrien est né en Espagne, où « l’hellénisme et l’orient étaient inconnus ». Dans ce pays rustique de garnisons, il reçoit une instruction militaire qui le prépare à un mode de vie rude. Mais cette éducation à la dure est équilibrée par l’apprentissage du grec, la langue de la philosophie. Le garçon a la chance d’être envoyé à Athènes, ville qui immédiatement conquiert son cœur. Jeune homme, Hadrien est surnommé « l’étudiant grec ». Quand un jour il a une cicatrice au menton, il y voit là « un prétexte pour porter la courte barbe des philosophes grecs ». Il avoue lui-même : « C’est en latin que j’ai administré l’empire ; […] mais c’est en grec que j’aurai pensé et vécu. »
Hadrien veut le pouvoir pour lui-même,
afin de se réaliser avant de mourir
Hadrien devient un proche du nouvel empereur, Trajan, un Romain d’Espagne comme lui. Mais, alors qu’Hadrien concilie les qualités de soldat et de philosophe, Trajan est avant tout un militaire. C’est même, selon Hadrien, un « empereur-soldat », qui vit modestement au milieu de ses hommes. Il est constamment en campagne et veut toujours étendre les limites géographiques de l’empire. Cette soif insatiable de conquêtes, notamment ce rêve d’Orient qui habite Trajan, finit par inquiéter Hadrien. Hadrien a conscience des « raisons pratiques » d’ordre politique, économique et commerciale qui dictent ces guerres, il constate également que Trajan est un empereur heureux que la victoire n’a jamais déserté. Mais il sait aussi que toutes ces conquêtes sont bien fragiles et qu’il suffirait de presque rien pour faire basculer une situation qui confine à l’absurde. Selon Hadrien, l’empereur prend des risques inconsidérés et se condamne à la victoire perpétuelle : « Le moindre revers aurait eu pour résultat un ébranlement de prestige que toutes les catastrophes pourraient suivre ; il ne s’agissait pas seulement de vaincre, mais de vaincre toujours, et nos forces s’épuiseraient. » Tombé malade, Trajan meurt au cours d’une campagne contre les Parthes, au bout de vingt ans de règne. Hadrien lui-succède.
Cette succession n’est pas allée de soi. C’est Plotine, veuve de Trajan et devenue entre-temps grande amie d’Hadrien, qui a imposé son protégé. Pour faciliter les choses, elle déclara que, sur son lit de mort, l’empereur agonisant avait, par lettre, désigné Hadrien. Très vite la rumeur se propagea selon laquelle la succession reposait sur une fraude. Au soir de sa vie, Hadrien en garde mémoire : « Mes ennemis ont accusé Plotine d’avoir profité de l’agonie de l’empereur pour faire tracer à ce moribond les quelques mots qui me léguaient le pouvoir. […] Mais il faut bien avouer que la fin, ici, m’importaient plus que les moyens : l’essentiel est que l’homme arrivé au pouvoir ait prouvé par la suite qu’il méritait de l’exercer. » Devenu empereur à quarante ans passés, Hadrien est impatient de rencontrer enfin son destin, car il avait peur de mourir avant de se réaliser : « Tous les problèmes de l’empire m’accablaient à la fois, mais le mien propre pesait davantage. Je voulais le pouvoir. Je le voulais pour imposer mes plans, essayer mes remèdes, restaurer la paix. Je le voulais surtout pour moi-même avant de mourir. »
Antinoüs occupe une place centrale dans les Mémoires d’Hadrien
Pour apparaître comme le successeur naturel de Trajan, Hadrien, quand il était jeune homme, avait épousé Sabine, petite nièce de l’empereur-soldat. Ce mariage avait été, reconnaît Hadrien, « un triomphe pour un ambitieux de vingt-huit ans ». Mais, par la suite, il fut « source d’irritation et d’ennuis ». Hadrien écrit à Marc-Aurèle qu’au cours de son règne il avait envisagé de se séparer d’elle : « J’aurais pu me débarrasser par le divorce de cette femme point aimée […]. Mais elle me gênait fort peu […]. Elle assistait aujourd’hui sans paraître s'en apercevoir aux manifestations d’une passion qui s’annonçait longue. » Ici Hadrien fait allusion à sa passion pour Antinoüs.
Antinoüs occupe une place centrale dans les Mémoires d’Hadrien. C’est en Asie mineure, à l’occasion de l’un de ses multiples voyages, que l’empereur fit la connaissance de ce jeune Grec, natif de Bithynie, dont la beauté tout de suite le fascina. Ce fut comme un coup de foudre : « Une intimité s’ébaucha. Il m’accompagna par la suite dans tous mes voyages, et quelques années fabuleuses commencèrent. […] Ce beau lévrier avide de caresses et d’ordre se coucha sur ma vie. » Hadrien évoque longuement Antinoüs vivant… et mort. Quand il est retrouvé noyé dans le Nil, c’est en philosophe qu’Hadrien accepte la mort du garçon qui a quitté la vie quelques semaines avant d’avoir vingt ans, « épouvanté de déchoir, c’est-à-dire de vieillir ». L’empereur veut immortaliser les traits de son favori qui fut pour lui l’image de la beauté, et fait graver de multiples médailles et pièces à son effigie. Il fonde une ville qui lui est dédiée, Antinoé, en Egypte, et établit le culte d’Antinoüs. C’est ainsi que les mères dont le fils est malade l’invoquent pour obtenir la guérison.
Diminué, Hadrien décide de rentrer en Italie pour régler ses affaires : « Je me disais que seules deux choses m’attendaient à Rome ; l’une était le choix de mon successeur, qui intéressait tout l’empire ; l’autre était ma mort, et ne concernait que moi. »
Tout au long du livre, Hadrien apparaît comme un être conforme à la réputation que la postérité lui a accordée, c’est-à-dire celle d’un empereur philosophe qui a beaucoup réfléchi au pouvoir, à la vie et à la mort. Marguerite Yourcenar va au-delà du factuel pour essayer de comprendre en profondeur la signification des événements qui ont jalonné la vie d’Hadrien, ce qui donne au livre sa force.
Post-scriptum : Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar, inspirèrent à Hervé Cristiani la chanson Antinoüs.
Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar, 1951, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : marguerite yourcenar, mémoires d'hadrien | Lien permanent | Commentaires (0)
23/05/2016
Une étrange affaire, de Pierre Granier-Deferre
L’un des meilleurs rôles de Piccoli
Une étrange affaire
Un jeune cadre salarié d’un grand magasin est fasciné par son nouveau patron. Il se donne à lui corps et âme sans comprendre qu’il a affaire à un prédateur aux intentions troubles. Michel Piccoli, dans le rôle du directeur, est ambigu à souhait.
Louis Coline est le numéro deux du service marketing d’un grand magasin parisien. Il n’est pas débordé de travail, arrive tard au bureau et passe beaucoup de temps au bistrot. Pourtant c’est un jeune homme plein d’ambition qui aimerait tant donner le meilleur de lui-même. Un nouveau directeur arrive à la tête du magasin. C’est un bel homme, grand et large d’épaules, très élégant, âgé d’une cinquantaine d’années. Il s’appelle Bertrand Malair et débarque en compagnie de sa garde rapprochée, deux jeunes gens qui ne le quittent guère et qui l’assistent au quotidien dans sa fonction de directeur.
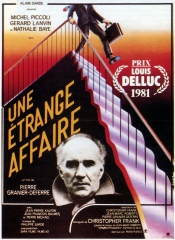 Craignant de faire partie de la prochaine charrette, Louis est décidé à faire preuve de dynamisme afin d’échapper au couperet. Il s’adresse directement à Bertrand Malair et lui fait part de ses suggestions pour développer le marketing. Malair l’écoute avec intérêt. Il retient ses idées, l’associe à sa garde rapprochée et lui accorde une promotion en le nommant chef du service marketing. Louis est comblé, il a enfin le sentiment de donner du sens à son travail et d’avoir trouvé sa voie. Peu à peu il est fasciné par la personnalité de Malair et tombe sous son charme, sans s’apercevoir qu’il a affaire à un prédateur qui va s’immiscer dans sa vie privée pour le dévorer.
Craignant de faire partie de la prochaine charrette, Louis est décidé à faire preuve de dynamisme afin d’échapper au couperet. Il s’adresse directement à Bertrand Malair et lui fait part de ses suggestions pour développer le marketing. Malair l’écoute avec intérêt. Il retient ses idées, l’associe à sa garde rapprochée et lui accorde une promotion en le nommant chef du service marketing. Louis est comblé, il a enfin le sentiment de donner du sens à son travail et d’avoir trouvé sa voie. Peu à peu il est fasciné par la personnalité de Malair et tombe sous son charme, sans s’apercevoir qu’il a affaire à un prédateur qui va s’immiscer dans sa vie privée pour le dévorer.
Il ne faut pas confondre Une étrange affaire avec Une ténébreuse affaire, le roman de Balzac ; les deux œuvres n’ont aucun rapport, sauf cette ressemblance de nom. Le film de Granier-Deferre, tourné en 1981, montre le monde du travail tel que l’on pouvait se le représenter à l’époque. Dans le secteur de la distribution, malgré le développement récent des grandes surfaces, les grands magasins parisiens semblent assis sur des bases solides. Les bureaux ont un aspect XIXème siècle et sont séparés par des cloisons, les open spaces n’ayant pas encore fait leur apparition. Il n’y a pour ainsi dire pas d’ordinateur ; la musique que l’on entend le plus est celle de la frappe des machines à écrire manipulées par des armées de secrétaires. Le vouvoiement est d’usage dans ce grand magasin et une certaine distance est gardée entre un subordonné et son supérieur hiérarchique.
La France est alors dans les premières années de la crise économique qui a éclaté suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1979 ; il y a déjà des craintes pour l’emploi, et le mot « charrette » est entré dans le langage courant. Il faut dire que le directeur ne fait pas dans le sentiment quand il décide de licencier un salarié qu’il estime surnuméraire.
En contrepartie de sa promotion
le directeur attend de Louis une disponibilité totale
Bertrand Malair favorise Louis et le promeut. Mais, en contrepartie de son avancement, il attend de lui une disponibilité totale. Il lui fait comprendre qu’il doit de lui-même renoncer à la semaine de sports d’hiver qu’il avait prévu de passer avec sa femme, Nina. Il lui demande de l’accompagner au magasin le dimanche et dans des dîners en ville tard le soir.
Louis se laisse faire. Malair est devenu son gourou, il finit par lui obéir sans réfléchir et le fait passer avant sa femme. Nina trouve malsains les nouveaux amis de son mari. Invitée à se rendre dans le bureau de Malair, elle trouve le cadre sinistre : Malair s’est fait aménager un bureau design aux murs tout blancs et froids et au mobilier contemporain, qui contraste avec l’aspect dix-neuvième siècle du magasin. Nina voit son ménage se fissurer, elle sent que son mari lui échappe et ne sait plus que faire pour lui ouvrir les yeux.
Michel Piccoli est remarquable dans la peau de Bertrand Malair. Pour l’historien Jean Tulard, il s’agit là de son meilleur rôle. Il est troublant et ambigu à souhait. Par contraste, Gérard Lanvin apparaît assez candide et manipulable dans son interprétation de Louis Coline. Nathalie Baye, dans le rôle de Nina, se montre plus lucide que lui. Jean-Pierre Kalfon se montre trouble lui aussi, dans le rôle du second de Mahler.
L’atmosphère de ce film est effectivement étrange, voire malsaine. Qui aime l’ambiguïté au cinéma sera comblé en voyant ce film.
Une étrange affaire, de Pierre Granier-Deferre, 1981, avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin, Nathalie Baye, Jean-Pierre Kalfon et Jean-François Balmer, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Etude de moeurs, Film, Société | Tags : une étrange affaire, pierre granier-deferre, piccoli, gérard lanvin, nathalie baye, jean-pierre kalfon, jean-françois balmer | Lien permanent | Commentaires (0)
09/05/2016
Alstom, scandale d'Etat, de Jean-Michel Quatrepoint
Les secrets du dépeçage d’Alstom
Alstom, scandale d’Etat
(dernière liquidation de l’industrie française)
Jean-Michel Quatrepoint a enquêté sur la vente à la sauvette de la branche énergie du groupe Alstom. Il accuse les autorités françaises d’avoir bradé un bijou de famille, privant le pays de la maîtrise d’une activité stratégique. Selon lui, General Electric a été choisi comme repreneur pour des raisons inavouables.
Après Péchiney, Arcelor, Lafarge et Alcatel, la France a perdu Alstom Energie, qui a été vendue aux Américains en 2015. Dans Alstom, scandale d’Etat, Jean-Michel Quatrepoint tire la sonnette d’alarme : année après année, la France se désindustrialise, elle perd ses fleurons les uns après les autres, ses dirigeants vendant les « bijoux de famille » dans l’indifférence générale. Selon lui, la vente à General Electric de la branche énergie d’Alstom constitue un cas d’école d’autant plus grave que la France se prive ainsi de la maîtrise d’une activité stratégique :
Dans la concurrence économique mondiale, ne pas être maître de sa filière énergétique va être un rude handicap. Voilà pourquoi la vente, à la sauvette, d’Alstom est une affaire d’Etat. Et les conditions de cette cession un scandale d’Etat. Car il était possible de faire autrement, voire de négocier des accords plus équilibrés.
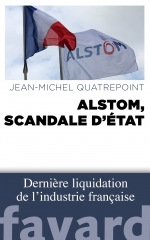 Jean-Michel Quatrepoint remonte aux heures glorieuses de l’industrie française. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Alsthom (avec un « h », à l’époque) était une filiale de la toute puissante CGE, Compagnie générale d’électricité. Ce vaste conglomérat était l’une des plus grosses entreprises au monde, valeur vedette du CAC40, l’une des fiertés de la France. La CGE était leader mondial des télécommunications et numéro un des câbles électriques. Dans cet empire, outre Alsthom, on trouvait Alcatel, Cegelec, les Câbles de Lyon, les Chantiers de l’Atlantique et même une branche médias avec L’Express et les Presses de la Cité. Rebaptisé Alcatel-Alsthom au début des années quatre-vingt-dix, le groupe a alors fière allure. Mais les apparences sont trompeuses. Son patron historique, Ambroise Roux, « grand maître de l’industrie française », n’a pas préparé l’avenir, il n’a pas vu venir la révolution numérique, qui va tout balayer sur son passage. Alcatel-Alsthom vit sur des acquis et n’est pas armé pour affronter le déferlement de la téléphonie mobile et de l’Internet. Pour trouver les milliards nécessaires au développement des activités de télécommunications, le groupe vend Alsthom (qui perd son « h » à cette occasion) et l’introduit en bourse, en 1999.
Jean-Michel Quatrepoint remonte aux heures glorieuses de l’industrie française. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Alsthom (avec un « h », à l’époque) était une filiale de la toute puissante CGE, Compagnie générale d’électricité. Ce vaste conglomérat était l’une des plus grosses entreprises au monde, valeur vedette du CAC40, l’une des fiertés de la France. La CGE était leader mondial des télécommunications et numéro un des câbles électriques. Dans cet empire, outre Alsthom, on trouvait Alcatel, Cegelec, les Câbles de Lyon, les Chantiers de l’Atlantique et même une branche médias avec L’Express et les Presses de la Cité. Rebaptisé Alcatel-Alsthom au début des années quatre-vingt-dix, le groupe a alors fière allure. Mais les apparences sont trompeuses. Son patron historique, Ambroise Roux, « grand maître de l’industrie française », n’a pas préparé l’avenir, il n’a pas vu venir la révolution numérique, qui va tout balayer sur son passage. Alcatel-Alsthom vit sur des acquis et n’est pas armé pour affronter le déferlement de la téléphonie mobile et de l’Internet. Pour trouver les milliards nécessaires au développement des activités de télécommunications, le groupe vend Alsthom (qui perd son « h » à cette occasion) et l’introduit en bourse, en 1999.
Devenu un groupe indépendant, Alstom possède deux activités différentes : les transports, avec notamment la fabrication des rames TGV, et l’énergie. C’est dans l’énergie qu’Alstom décide de se renforcer en entamant une politique d’acquisition, coûteuse et risquée. Pour éviter la catastrophe - en clair, la faillite -, Patrick Kron est appelé à la rescousse. Ce major de Polytechnique est nommé PDG. Son ancien patron, Louis Gallois, le dit « extraordinairement intelligent, travailleur et doté d’un humour caustique. » Dans sa tâche de redressement d’Alstom, Patrick Kron est soutenu par Nicolas Sarkozy, ministre de l’économie et des finances, qui arrive à « tordre le bras » aux banquiers, de telle sorte qu’ils acceptent une restructuration de la dette du groupe.
En 2004, Alstom est sauvé, du moins en apparence.
L’arrestation aux Etats-Unis d’un cadre d’Alstom
fait l’effet d’une bombe parmi les dirigeants du groupe
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, le DoJ (Department of Justice) enquête sur une affaire de corruption. Alstom est soupçonné d’avoir versé une commission pour obtenir un (petit) marché en Indonésie. Dans un premier temps, les dirigeants du groupe ne s’inquiètent pas, à l’image des dirigeants de BNP-Paribas impliqués dans une autre affaire. Tout change en 2013, quand un cadre supérieur d’Alstom en voyage aux Etats-Unis est arrêté par la police. Son arrestation et les conditions de sa détention font l’effet d’une bombe à Paris. Les dirigeants d’Alstom comprennent que le groupe est menacé d’une lourde amende et qu’eux-mêmes risquent la prison. Dès lors, il faut réagir, avant que l’étau ne se resserre trop.
Dans son livre, Jean-Michel Quatrepoint se fait très clair. Il affirme que Patrick Kron s’est décidé à vendre l’activité énergie, moins pour désendetter le groupe que pour payer la lourde amende à laquelle la justice américaine ne manquerait pas de le condamner. Quatrepoint va plus loin en affirmant que, dès le début, le choix de Patrick Kron s’est porté sur General Electric, dans l’espoir d’obtenir l’indulgence du Department of Justice. L’auteur cependant porte un jugement nuancé sur les faits :
S’imaginer qu’il y a une relation directe, une concertation entre le DoJ et les grandes entreprises américaines serait une absurdité. La séparation des pouvoirs est l’un des principes de la Constitution américaine. Toutefois, rien n’empêche, dans les difficultés et face à l’adversité, de préférer se vendre à un groupe américain ayant pignon sur rue, dont l’entregent pourrait faciliter un arrangement avec la justice du pays.
Dès lors, les choses sont jouées. Jean-Michel Quatrepoint se fait d’autant plus accusateur que, selon lui, Patrick Kron n’a pas profité de l’offre concurrente formulée par l’Allemand Siemens pour « faire monter les enchères » et obtenir de General Electric qu’il améliore son offre. Jean-Michel Quatrepoint montre également comment le sommet de l’Etat, François Hollande en tête, a laissé faire.
Quatrepoint accuse la classe politique et médiatique
de se focaliser sur le sociétal et le compassionnel,
impuissante qu’elle est à traiter des vrais sujets
Par désintérêt et par manque de compétences, le gouvernement français a été complètement dépassé par les événements. Jean-Michel Quatrepoint reproche aux hommes politiques d’être plus à l’aise dans les dossiers dits « sociétaux » que dans les dossiers de politique industrielle. Il parle de « d’une classe politique – et médiatique- focalisée sur le compassionnel et le sociétal, impuissante qu’elle est à traiter des vrais sujets et à influer sur le cours du monde. » Certes, dans ce dossier, le gouvernement a sauvé les apparences en obtenant la constitution de co-entreprises détenues à la fois par General Electric et par Alstom. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, General Electric y sera majoritaire et contrôlera les finances, Alstom apportant ses compétences techniques, tant recherchées par les Américains. Et ce sont eux qui contrôleront Arabelle, l’une des turbines les plus sûres au monde, qui doit équiper les centrales nucléaires de type EPR.
Quatrepoint précise que ce sont en fait les contrats de maintenance détenus par Alstom que General Electric convoitait :
Dans l’énergie, on ne gagne pas d’argent sur la vente d’une centrale ou d’une turbine, ni sur celle de tous les équipements qui leur sont associés, mais sur la maintenance, le service après-vente. […] En achetant Alstom Energie, General Electric acquiert une base de clients captifs.
Alstom se retrouve aujourd’hui réduit à sa branche transports. Or les marges sont faibles dans cette activité, beaucoup moins rentable que l’énergie. Et la concurrence y est de plus en plus forte. Les Chinois, après avoir « volé » la technologie Siemens, sont attendus sur le marché et pèsent quatre fois plus lourd qu’Alstom. Quatrepoint entrevoit déjà un scénario inéluctable se dessiner : la vente de ce qui reste d’Alstom à un concurrent, probablement Siemens.
Alstom, scandale d’Etat, de Jean-Michel Quatrepoint, 2015, éditions Fayard.
07:30 Publié dans Economie, Essai, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre | Tags : jean-michel quatrepoint, alstom scandale d'etat | Lien permanent | Commentaires (0)


