11/04/2016
Fatherland, de Robert Harris
Thriller uchronique
Fatherland
Robert Harris imagine une intrigue policière ayant pour cadre le Berlin de 1964, capitale d’une Allemagne qui aurait gagné la guerre. Fatherland est ce qu’on pourrait appeler un thriller uchronique. A l’aide d’une solide documentation et tout en faisant preuve d’imagination, Robert Harris mêle habilement le vrai et le faux.
Par certains aspects, Fatherland a les caractéristiques d’un roman policier classique. Au départ, il s’agit d’une simple histoire de crime. Une nuit, à Berlin, l’inspecteur Xavier March, de la Kripo, la police criminelle, est appelé sur les bords de la Havel, pour constater le décès d’un individu retrouvé noyé. La victime est un ancien ministre, et sa mort n’est pas naturelle. L’inspecteur March enquête, il trouve des témoins, mais ils ont peur de parler. On cherche à l’envoyer sur de fausses pistes. Sa quête de la vérité gêne en haut lieu, lui-même reçoit des menaces…
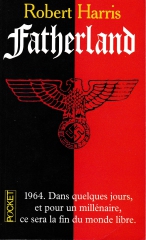 Beaucoup d’ingrédients servis dans Fatherland se retrouvent dans de nombreux autres thrillers : un assassinat, une enquête, des témoins qui se taisent définitivement, des fausses pistes, un secret d’Etat... Ce qui fait l’originalité de ce roman, c’est le contexte imaginé par l’auteur. Robert Harris a construit sa fiction sur la base d’une uchronie : il a placé son intrigue en avril 1964, dans un Berlin qui s’apprête à célébrer le soixante-quinzième anniversaire du Führer. Robert Harris imagine qu’Hitler a gagné la guerre et qu’il domine l’Europe. A condition d’accepter cette hypothèse de départ, les informations données par Robert Harris paraissent vraisemblables et font froid dans le dos. La nouvelle Europe est dominée par l’Allemagne qui a annexé ses proches voisins : « Le Luxembourg était devenu le Moselland, l’Alsace-Lorraine la Westmark ; l’Autriche, l’Ostmark. Même scénario pour la Tchécoslovaquie – le petit bâtard de Versailles n’était plus que le protectorat de Bohême et de Moravie. La Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie : gommées de la carte. […] A l’ouest, douze nations [dont la France et la Grande-Bretagne] avaient lié leur sort à celui de l’Allemagne, par le traité de Rome, et formaient l’espace économique européen. L’allemand était la deuxième langue officielle dans toutes les écoles. » Edouard VIII a été réinstallé sur le trône d’Angleterre et règne avec la reine Wallis à ses côtés. La Guerre froide oppose l’Allemagne aux Etats-Unis, mais la Détente semble se profiler, avec l’annonce du voyage qu’a prévu de faire à Berlin le président Kennedy. Il s’agit bien sûr de Joseph Kennedy, soixante-quinze ans, qui, quand il était ambassadeur en Allemagne avant-guerre, était réputé pour ses sympathies pro-nazies.
Beaucoup d’ingrédients servis dans Fatherland se retrouvent dans de nombreux autres thrillers : un assassinat, une enquête, des témoins qui se taisent définitivement, des fausses pistes, un secret d’Etat... Ce qui fait l’originalité de ce roman, c’est le contexte imaginé par l’auteur. Robert Harris a construit sa fiction sur la base d’une uchronie : il a placé son intrigue en avril 1964, dans un Berlin qui s’apprête à célébrer le soixante-quinzième anniversaire du Führer. Robert Harris imagine qu’Hitler a gagné la guerre et qu’il domine l’Europe. A condition d’accepter cette hypothèse de départ, les informations données par Robert Harris paraissent vraisemblables et font froid dans le dos. La nouvelle Europe est dominée par l’Allemagne qui a annexé ses proches voisins : « Le Luxembourg était devenu le Moselland, l’Alsace-Lorraine la Westmark ; l’Autriche, l’Ostmark. Même scénario pour la Tchécoslovaquie – le petit bâtard de Versailles n’était plus que le protectorat de Bohême et de Moravie. La Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie : gommées de la carte. […] A l’ouest, douze nations [dont la France et la Grande-Bretagne] avaient lié leur sort à celui de l’Allemagne, par le traité de Rome, et formaient l’espace économique européen. L’allemand était la deuxième langue officielle dans toutes les écoles. » Edouard VIII a été réinstallé sur le trône d’Angleterre et règne avec la reine Wallis à ses côtés. La Guerre froide oppose l’Allemagne aux Etats-Unis, mais la Détente semble se profiler, avec l’annonce du voyage qu’a prévu de faire à Berlin le président Kennedy. Il s’agit bien sûr de Joseph Kennedy, soixante-quinze ans, qui, quand il était ambassadeur en Allemagne avant-guerre, était réputé pour ses sympathies pro-nazies.
S’inspirant des projets d’Albert Speer qui était l’architecte d’Hitler, Robert Harris plante le décor et imagine à quoi ressemble la capitale du Reich hitlérien. Xavier March, en compagnie de son jeune fils, a pris place à bord d’un autobus touristique qui fait le tour de Berlin. Le guide leur présente les principaux monuments de la ville en commençant par le plus célèbre, le Grand Dôme. Il précise : « Le Grand Dôme du Reich est le plus grand édifice au monde. Il s’élève à plus d’un quart de kilomètre du sol et certains jours – remarquez aujourd’hui – le sommet est invisible. La coupole fait cent quarante mètres de diamètre ; elle peut contenir seize fois Saint-Pierre de Rome. » La visite se poursuit avec l’Arc de Triomphe ; le guide croit bon d’ajouter que « l’Arc de Triomphe de Paris y pénétrerait quarante-neuf fois. » Quand l’autobus s’engage dans l’imposante avenue de la Victoire, il est précisé qu’elle est « deux fois et demie plus longue que les Champs-Elysées à Paris. » Robert Harris, ou plutôt Xavier March, conclut : « Plus haut, plus long, plus grand, plus large, plus cher… Même dans la victoire, pensait March, l’Allemagne gardait un complexe d’infériorité. Rien n’avait de valeur en soi. Tout se comparait à ce qui existait ailleurs. »
Dans cette nouvelle Allemagne, reste un sujet tabou :
le sort des Juifs
La victoire de l’Allemagne apparaît d’ailleurs toute relative. Sur le papier, elle a gagné de vastes territoires à l’Est. La propagande promet aux volontaires de devenir colons sur des terres qui leur sont distribuées gracieusement. Pourtant ces vastes espaces ne sont pas sûrs. Robert Harris présente l’envers du décor : « La propagande montrait des colons heureux vivant dans l’opulence. Mais d’autres informations filtraient, sur la situation réelle : une existence conditionnée par un sol pauvre, un travail harassant, les mornes cités-dortoirs où les Allemands devaient se réfugier la nuit tombée, par crainte des attaques des partisans locaux. »
Dans cette nouvelle Allemagne, reste un sujet tabou : le sort des Juifs. Les personnages du roman s’abstiennent d’en parler, ou le font à mots couverts. L’un d’entre eux se borne à dire, quand il est question des Juifs au cours d’une conversation : « Comme chacun sait, ils sont à l’Est. » Et le personnage change aussitôt de sujet.
Ce qui rend percutant Fatherland, c’est le mélange habile entre le vrai et le faux. Robert Harris a su trouver le bon équilibre entre les deux. Par exemple, les citations d’Hitler qu’il met en exergue sont authentiques. Certes le Berlin colossal qu’il imagine n’a jamais vu le jour, mais il correspond, monument par monument, à celui qu’Hitler avait prévu de bâtir à partir des plans de Speer, si l’Allemagne avait gagné la guerre. A la lecture du livre, on perçoit que Robert Harris, tout en faisant preuve d’imagination, s’est solidement documenté sur le IIIème Reich.
Publié en 1992, Fatherland est le premier roman écrit par Robert Harris et contribua à sa renommée. Depuis, l’auteur s’est fait le spécialiste du thriller historique, visitant différentes époques, l’une après l’autre. Son dernier livre, D., publié en 2014, porte sur l’affaire Dreyfus. Robert Harris est aussi l’auteur de Ghostwriter, adapté au cinéma par Polanski.
Fatherland, de Robert Harris, 1992, collection Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Policier, thriller, XXe, XXIe siècles | Tags : fatherland, robert harris | Lien permanent | Commentaires (0)
04/04/2016
Médecin de campagne, de Thomas Lilti
Eloge du médecin à l’ancienne
Médecin de campagne
Dans Médecin de campagne, François Cluzet interprète un généraliste à l’ancienne, qui ne cherche pas à faire du chiffre et qui prend le temps d’écouter ses patients. Marianne Denicourt joue le médecin appelé à le seconder en vue d’un remplacement. Le film de Thomas Lilti défend une certaine idée de la médecine.
Dans son précédent film, Hippocrate, Thomas Lilti décrivait le monde de l’hôpital ; deux ans après, il revient avec un nouveau film médical, dans lequel, comme son titre l’indique, il fait le portrait d’un médecin de campagne. Le spectateur suit le docteur Jean-Pierre Werner dans son quotidien fait de consultations à son cabinet et de visites aux malades. Dès le début du film, Jean-Pierre Werner apprend qu’il est atteint d’une tumeur. Il prend auprès de lui le docteur Nathalie Delezia, afin que, dans un premier temps, elle le seconde, en vue, à terme, de le remplacer.
 Le film prend la forme d’une chronique. A la manière de Huysmans qui, dans ses romans, voulait se débarrasser de l’intrigue traditionnelle, Thomas Lilti prend prétexte de son scénario, qui est squelettique, pour montrer différentes situations auxquelles un médecin peut être confronté.
Le film prend la forme d’une chronique. A la manière de Huysmans qui, dans ses romans, voulait se débarrasser de l’intrigue traditionnelle, Thomas Lilti prend prétexte de son scénario, qui est squelettique, pour montrer différentes situations auxquelles un médecin peut être confronté.
Le Dr Werner est un médecin à l’ancienne, il ne cherche pas à faire du chiffre et prend le temps d’écouter ses patients. Comme autrefois, il reçoit chez lui, dans sa maison, sans rendez-vous ; et il fait sa tournée à travers les villages et les fermes du pays.
Médecin de campagne délivre un certain nombre de messages dont ceux-ci :
- Le patient a intérêt à être concis et précis quand il décrit au médecin les symptômes qu’il ressent, car il est établi qu’en moyenne un médecin coupe la parole à son patient toutes les vingt-deux secondes, alors que, dans 90% des cas, le diagnostic est contenu dans les propos du patient ;
- Il faut faire preuve de discernement avant de décider d’hospitaliser une personne âgée, car le remède peut être pire que le mal ; le vieillard risque d’être désorienté et d’être plus affaibli à sa sortie de l’hôpital qu’il ne l’était avant ;
- Le médecin est là pour réparer les erreurs de la nature, qui produit de belles choses, mais aussi des choses laides, car il y a une forme de barbarie dans la nature, si bien que la médecine est par essence contre-nature ;
- L’informatique ne fait pas gagner au médecin autant de temps qu’on le croit, et souvent le gain est illusoire ;
- Il faut se méfier des projets de maisons de santé et autres pôles médicaux, qui visent à regrouper des professionnels de santé sous un même toit, car ces projets obéissent bien souvent à des motifs financiers et sont avant tout des opérations immobilières ne répondant pas strictement à un besoin d’ordre médical ;
- Etre médecin de campagne est un sacerdoce, à un point tel que, si le médecin prend trop à cœur son métier, il risque l’épuisement professionnel ;
- Le médecin est un patient comme les autres, il se croit immortel et irremplaçable, mais ne l’est pas ; quand il tombe malade, il est traversé par les mêmes doutes et les mêmes angoisses que le commun des mortels.
Dans ce film, c’est donc une certaine idée de la médecine que défend Thomas Lilti, lui-même ancien médecin.
Médecin de campagne est remarquablement interprété par François Cluzet et Marianne Denicourt, lui dans le rôle du médecin titulaire et elle dans le rôle du médecin remplaçant. Il la rabroue et ils se chamaillent de temps en temps, comme dans les comédies américaines d’antan.
Médecin de campagne, de Thomas Lilti, 2016, avec Fraçois Cluzet et Marianne Denicourt, actuellement en salles.
07:31 Publié dans Etude de moeurs, Film, Société | Tags : médecin de campagne, thomas lilti, françois cluzet, marianne denicourt | Lien permanent | Commentaires (0)
21/03/2016
Bouvard et Pécuchet, de Flaubert
Roman encyclopédiste resté très moderne
Bouvard et Pécuchet
Bouvard et Pécuchet sont deux êtres ridicules qui passent en revue tous les champs de la connaissance. Joignant la pratique à la théorie, ils sont tour à tour cultivateurs, médecins, écrivains, philosophes… Mais toutes leurs expériences ratent invariablement, car ils manquent de méthode, sont dépourvus de sens critique et n’arrivent pas à fixer leur attention. Ce roman incite à la modestie et reste très moderne dans une société qui ne cesse de sauter d'un sujet à l'autre.
Bouvard et Pécuchet est un roman foisonnant à prétention encyclopédiste. Les deux personnages créés par Flaubert embrassent tour à tour quasiment toutes les activités humaines, depuis l’agriculture jusqu’à la philosophie, en passant par l’archéologie, la médecine, la politique et l’éducation. Pour ce faire, avant de se lancer dans quoi que ce soit, ils se renseignent et lisent beaucoup. Flaubert fait œuvre d’érudit en énumérant et commentant un par un les livres qu’ils consultent, en général des livres savants qui font autorité. Pourtant, en dépit du soin qu’ils mettent à se documenter, ils échouent dans les expériences qu’ils entreprennent. Avec eux, tout rate. Et c’est cela qui rend le livre passionnant ; certes le lecteur s’aperçoit bien qu’il a affaire à deux prétentieux, et en même temps il cherche à s’expliquer leurs échecs à répétition, alors que pourtant ils choisissent de lire les grands auteurs et essaient de faire preuve de bon sens.
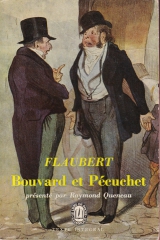 En 1839, quand ils se rencontrent pour la première fois, Bouvard et Pécuchet ont tous deux quarante-sept ans. L’un est veuf tandis que l’autre est célibataire. Ils sont tous deux copistes, l’un dans une maison de commerce, l’autre au ministère de la Marine. C’est le coup de foudre, nous dit Flaubert ; ils deviennent inséparables. Quand Bouvard touche un héritage et que Pécuchet part en retraite, ils décident de se retirer en Normandie. Ils achètent un domaine à Chavignolles, composé d’une demeure et d’une ferme de trente-huit hectares. Tout d’abord ils s’essaient au jardinage. Les premiers résultats étant prometteurs, ils voient plus loin. Flaubert poursuit : « Puisqu’ils s’entendaient au jardinage, ils devaient réussir dans l’agriculture ; et l’ambition les prit de cultiver leur ferme. Avec du bon sens et de l’étude ils s’en tireraient sans doute. » Ils se renseignent auprès de leurs voisins, et surtout ils lisent beaucoup de livres : « Ils se consultaient mutuellement, ouvraient un livre, passaient à un autre, puis ne savaient que résoudre devant la divergence d’opinion. » Les livres se contredisant dans leur précepte, les deux hommes ont tendance à donner raison au dernier auteur qu’ils ont lu.
En 1839, quand ils se rencontrent pour la première fois, Bouvard et Pécuchet ont tous deux quarante-sept ans. L’un est veuf tandis que l’autre est célibataire. Ils sont tous deux copistes, l’un dans une maison de commerce, l’autre au ministère de la Marine. C’est le coup de foudre, nous dit Flaubert ; ils deviennent inséparables. Quand Bouvard touche un héritage et que Pécuchet part en retraite, ils décident de se retirer en Normandie. Ils achètent un domaine à Chavignolles, composé d’une demeure et d’une ferme de trente-huit hectares. Tout d’abord ils s’essaient au jardinage. Les premiers résultats étant prometteurs, ils voient plus loin. Flaubert poursuit : « Puisqu’ils s’entendaient au jardinage, ils devaient réussir dans l’agriculture ; et l’ambition les prit de cultiver leur ferme. Avec du bon sens et de l’étude ils s’en tireraient sans doute. » Ils se renseignent auprès de leurs voisins, et surtout ils lisent beaucoup de livres : « Ils se consultaient mutuellement, ouvraient un livre, passaient à un autre, puis ne savaient que résoudre devant la divergence d’opinion. » Les livres se contredisant dans leur précepte, les deux hommes ont tendance à donner raison au dernier auteur qu’ils ont lu.
Il arrive que certaines idées leur montent à la tête, ainsi sur les engrais : « Excité par Pécuchet, [Bouvard] eut le délire de l’engrais. […] Il employa la liqueur belge, le lizier suisse, la lessive, des harengs saurs, du varech, des chiffons, fit venir du guano, tâcha d’en fabriquer, et, poursuivant jusqu’au bout ses principes, ne tolérait pas qu’on perdît l’urine ; il supprima la fosse d’aisance. […] Le colza fut chétif, l’avoine médiocre, et le blé se vendit mal, à cause de son odeur. »
Bouvard et Pécuchet prétendent guérir les malades
et reprochent au médecin le caractère empirique de son savoir
Après leur échec dans l’agriculture, Bouvard et Pécuchet ne se découragent pas et se lancent dans la chimie et la médecine. Là encore, ils lisent beaucoup, notamment le Dictionnaire des sciences médicales, et se lancent aussitôt dans des expériences. L’une d’elles porte sur la soif : « On les vit courir le long de la grande route, revêtus d’habits mouillés et à l’ardeur du soleil. C’était pour vérifier si la soif s’apaise par l’application de l’eau sur l’épiderme. Ils rentrèrent haletants et tous les deux avec un rhume. »
Forts de leur savoir, les deux maladroits prétendent guérir les gens de Chavignolles. Au cours d’une visite chez un malade, le médecin du village est apostrophé par Bouvard, qui lui reproche le caractère empirique de son savoir fondé sur l’observation. Piqué au vif, le médecin se défend et déclare : « D’abord, il faut avoir fait de la pratique. » Ce à quoi Bouvard répond : « - Ceux qui ont révolutionné la science n’en faisaient pas ! Van Helmont, Bœrhave, Broussais lui-même. » Sûrs de leur savoir, Bouvard et Pécuchet passent à l’acte et entreprennent de soigner des malades.
Après avoir provoqué des dégâts dans la population, les deux hommes se lassent de la médecine et se lancent dans l’archéologie. Ils fondent un muséum, aménagé dans une pièce de leur demeure.
Bouvard et Pécuchet se lancent en littérature
et entament l’écriture d’une biographie
Puis, ils étudient la littérature et entament la lecture de l’œuvre de Balzac. Flaubert écrit : « L’œuvre de Balzac les émerveilla ». Ainsi Bouvard s’écrie : « Quel observateur ! », émettant ainsi un poncif. Mais Pécuchet le refroidit en disant : « Moi je le trouve chimérique. Il croit aux sciences occultes, à la monarchie, à la noblesse, est ébloui par les coquins, vous remue des millions comme des centimes, et ses bourgeois ne sont pas des bourgeois, mais des colosses. Pourquoi gonfler ce qui est plat, et décrier tant de sottises ! Il a fait un roman sur la chimie, un autre sur la Banque, un autre sur les machines à imprimer, comme un certain Ricard avait fait " le cocher de fiacre ", " le porteur d’eau ", " le marchand de coco ". » Ils dévorent aussi Alexandre Dumas, qui les enthousiasme. Puis Pécuchet décide de le réviser « au point de vue de la science. » A l’aide d’un dictionnaire, il se rend compte que Dumas n’est pas à une approximation près : « L’auteur, dans les Deux Diane, se trompe de dates. Le mariage du Dauphin François eut lieu le 15 octobre 1548, et non le 20 mars 1549. » Après avoir constaté toutes les libertés prises avec l’histoire, « Pécuchet n’eut plus confiance en Dumas. »
N’ayant peur de rien, Bouvard et Pécuchet prétendent se lancer dans l’écriture. Ils décident de s’attaquer à la rédaction d’une biographie du duc d’Angoulême. Pour bien faire, ils vont en bibliothèque pour se documenter, mais s’embrouillent dans leurs recherches. Alors ils décident d’écrire une pièce de théâtre, mais peinent à trouver un sujet ; ils étudient La Pratique du théâtre, d’Aubignac, espérant que ce livre les dépannera. Ils sèchent lamentablement et abandonnent leur projet.
Ils se lancent alors dans la philosophie. Ils lisent Descartes, Kant, Leibniz, Bossuet… Au bout du compte, ils voient moins clair qu’avant : « Et tous deux s’avouèrent qu’ils étaient las des philosophes. Tant de systèmes vous embrouillent. La métaphysique ne sert à rien. On peut vivre sans elle. »
Délaissant la philosophie, ils recueillent deux petits orphelins, Victor (comme « l’enfant sauvage ») et Victorine, et entament leur éducation. Mais comment les faire progresser ? Bouvard hésite : « Rien n’est stupide comme de faire apprendre par cœur ; cependant si on n’exerce pas la mémoire, elle s’atrophiera et ils serinèrent leurs premières fables de La Fontaine ». Puis il s’aperçoit qu’une forte motivation à caractère matériel les fait vite progresser : « Comme Victor était enclin à la gourmandise, on lui présentait le nom d’un plat ; bientôt il lut couramment dans Le Cuisinier français. » La méthode porte ses fruits, mais en pratiquant ainsi, Bouvard et Pécuchet courtisent les défauts des enfants, ce qui est pernicieux.
Bouvard et Pécuchet sont des touche-à-tout autodidactes
et brouillons
En fait, Bouvard et Pécuchet sont des touche-à-tout autodidactes. Ils s’intéressent à tous les sujets. Rien de ce qui est humain ne leur est étranger. Ils lisent beaucoup en s’imaginant que les livres donnent réponse à tout. Mais les deux hommes ont un problème de méthode, dès le départ. Ils ne sont pas travaillés par le doute quand ils s’attaquent à un sujet d’étude, et ils n’arrivent pas à fixer leur attention sur un sujet. Ils « zappent » sans arrêt. Face au flot d’informations auquel ils sont confrontés, ils sont vite débordés. Ils sont brouillons et n’ont pas la distance critique qui leur permettrait de faire la part des choses chez un auteur, d’où leurs enthousiasmes, par exemple pour Dumas, suivis de déceptions à la hauteur de l’enthousiasme qui a précédé. Ils n’arrivent pas à se forger une opinion solide et argumentée et sont versatiles. Ils se contentent de connaissances livresques sans arriver à les confronter à leur expérience. Bouvard et Pécuchet sont étonnamment modernes et nous invitent à l’humilité et au doute perpétuel. D’une certaine manière, pour paraphraser Flaubert, on pourrait dire : « Bouvard et Pécuchet, c’est nous ! »
Flaubert est mort avant d’avoir achevé son roman. Le récit s’interrompt brutalement. Le lecteur note cependant une évolution dans le comportement de Bouvard et Pécuchet, qui semblent peu à peu prendre du recul et trouver ce qu’on pourrait appeler la voie de la sagesse. Plus l’histoire avance, moins les deux hommes semblent ridicules. S’il manque bien des développements à ce roman inachevé, heureusement les notes laissées par Flaubert nous indiquent le dénouement qu’il avait prévu.
Bouvard et Pécuchet, de Flaubert, 1880, collections Le Livre de Poche et Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : bouvard et pécuchet, flaubert | Lien permanent | Commentaires (0)


