09/11/2015
L'Homme irrationnel (Irrational Man), de Woody Allen
Le crime comme thérapie
L’Homme irrationnel
(Irrational Man)
L’Homme irrationnel est à la fois un film intellectuel et un film grand public. Une étudiante est fascinée par son professeur de philosophie. Celui-ci, pourtant, est une épave qui a un problème avec l’alcool. Il ne trouve pas de sens à son existence, jusqu’au jour où il projette un crime.
En 2005, Woody Allen montrait dans Match Point comment le hasard d’une rencontre pouvait transformer un homme en meurtrier. Dix ans plus tard, il reprend cette même thématique en l’enrichissant philosophiquement. Le titre anglais du film, Irrational Man, reprend celui d’un livre que Woody Allen avait lu lorsqu’il était jeune homme. Ce livre, publié en 1958, expliquait aux Américains ce qu’est l’existentialisme.
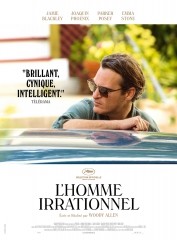 Le personnage principal du film, Abe Lucas, est professeur de philosophie. Précédé d’une solide réputation, il prend son nouveau poste, dans un collège universitaire de Newport, ville huppée de la côte nord-est des Etats-Unis. Au cours de son enseignement, il repère une étudiante à qui il fait un compliment bien troussé, pour la qualité de sa réflexion. La jeune femme, Jill, tombe aussitôt sous le charme du professeur. Pourtant il n’a rien d’un séducteur. Il est ventripotent, il vit seul et, visiblement, il a un problème avec l’alcool ; ainsi il ne se sépare jamais de sa bouteille de gin. En clair, il a l’air d’une épave. Jill cherche à le sortir de la solitude et aimerait qu’il s’intéresse encore un peu plus à elle. Mais Abe Lucas ne cherche pas à la conquérir. En fait, il a perdu le goût de vivre. Il trouve la vie absurde et désespère de donner un sens à son existence.
Le personnage principal du film, Abe Lucas, est professeur de philosophie. Précédé d’une solide réputation, il prend son nouveau poste, dans un collège universitaire de Newport, ville huppée de la côte nord-est des Etats-Unis. Au cours de son enseignement, il repère une étudiante à qui il fait un compliment bien troussé, pour la qualité de sa réflexion. La jeune femme, Jill, tombe aussitôt sous le charme du professeur. Pourtant il n’a rien d’un séducteur. Il est ventripotent, il vit seul et, visiblement, il a un problème avec l’alcool ; ainsi il ne se sépare jamais de sa bouteille de gin. En clair, il a l’air d’une épave. Jill cherche à le sortir de la solitude et aimerait qu’il s’intéresse encore un peu plus à elle. Mais Abe Lucas ne cherche pas à la conquérir. En fait, il a perdu le goût de vivre. Il trouve la vie absurde et désespère de donner un sens à son existence.
Comme tous les films de Woody Allen, L’Homme irrationnel a un côté intellectuel. Ainsi Abe Lucas brille auprès de Jill à coups de citations d’auteurs, de Kant à Sartre et Simone de Beauvoir en passant par Heidegger. Cependant, même un spectateur qui n’entend rien à la philosophie trouvera de l’intérêt à ce film, car c’est avant tout un thriller, un suspense avec un meurtre au cœur de l’intrigue.
Abe Lucas va trouver un sens à son existence en usant d’une forme de thérapie bien particulière ; il va commettre un crime, non un crime dont le motif lui profiterait, mais un crime altruiste, au profit d’un autre. On pourrait même dire que son crime va rendre service à la société prise dans son ensemble. Une fois le meurtre accompli, il retrouve, littéralement, le goût et l’appétit de vivre ; d’autant plus qu’il a commis le crime parfait. Rien ne le relie à sa victime, et il est suffisamment intelligent et réfléchi pour avoir soigneusement prémédité son crime. Il n’a donc rien à craindre de l’enquête.
Emma Stone, dans le rôle de Jill,
est pleine de fraîcheur
Joaquin Phénix donne de l’épaisseur au personnage d’Abe Lucas. Mais c’est surtout Emma Stone, dans le rôle de Jill, qui retient l’attention. Elle est pleine de fraîcheur et a trouvé en Abe son gourou. Elle aussi, elle est altruiste en cherchant à le sortir de sa solitude. Elle va jusqu’à délaisser son petit ami, un étudiant lisse et fade, moralement vieilli avant l’âge, et qui fait pâle figure en comparaison d’Abe. Quand Jill a l’intuition de la vérité, elle refuse de la voir en face, tellement elle est aveugle dès qu’il s’agit d’Abe, à qui un sentiment fort l’attache. La confrontation finale qui les met en scène rappelle par certains aspects le dénouement de L’Ombre d’un doute (Shadow of a doubt), d’Hitchcock.
Le campus qui sert de décor au film lui donne son unité. C’est un monde clos, une espèce de cocon replié sur lui-même. Les professeurs vivent au milieu des élèves et la rumeur va bon train.
Ce film peut être vu en version originale, tant, comme souvent chez Woody Allen, la bande-son est claire. Ainsi, lors d’une scène dans un café, aucun bruit de vaisselle, aucun bruit d’ambiance intempestif ne vient polluer le dialogue.
Le spectateur trouvera du plaisir à ce film grand public qu’est L’Homme irrationnel, mais il peut lui préférer Match Point, dont la construction et la narration paraissent plus efficaces.
L’Homme irrationnel (Irrational Man), de Woody Allen, 2015, avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey et Jamie Blackley, actuellement en salles.
07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense | Tags : l’homme irrationnel, irrational man, woody allen, joaquin phoenix, emma stone, parker posey, jamie blackley | Lien permanent | Commentaires (0)
02/11/2015
L'Equipage, de Kessel
Mélodrame à l’escadrille
L’Equipage
Ce roman de Kessel, écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale, a été publié dans sa version définitive en 1969. L'histoire, mélodramatique, est celle d'un jeune combattant du ciel. Le lecteur partage la vie quotidienne d’une escadrille, faite de longs moments d’oisiveté et de courts moments de grand péril.
« Il avait vingt ans. C’était son premier départ pour le front. Malgré les récits qu’il avait entendus au camp d’entraînement, malgré un sens aigu des réalités, sa jeunesse n’acceptait pas la guerre sans l’habiller d’une héroïque parure. » C’est en ces termes que Kessel évoque Jean Herbillon, personnage principal de L’Equipage. Pendant la Grande Guerre, Herbillon, un garçon de vingt ans, est mobilisé dans l’aviation. Avant son départ pour le front, il fait ses adieux à ses parents et à son petit frère. Le jeune aspirant est très fier de son uniforme d’aviateur et de ses bottes. Sur le quai de la gare, Denise, sa maîtresse, l’attend. Il ne sait pas grand-chose d’elle, il sait seulement qu’elle est mariée, mais ignore l’identité de son mari. Jean et Denise s’enlacent une dernière fois avant de se séparer.
 Dans le train qui le mène vers le front, Herbillon est une première fois ébranlé, quand il réfléchit aux raisons qui l’ont poussé à entrer dans l’aviation : « Ce n’était pas soif d’héroïsme, mais vanité. Il s’était laissé tenter par la séduction de l’uniforme, des insignes glorieux, par le prestige ailé sur les femmes. Elles, surtout, l’avaient décidé. »
Dans le train qui le mène vers le front, Herbillon est une première fois ébranlé, quand il réfléchit aux raisons qui l’ont poussé à entrer dans l’aviation : « Ce n’était pas soif d’héroïsme, mais vanité. Il s’était laissé tenter par la séduction de l’uniforme, des insignes glorieux, par le prestige ailé sur les femmes. Elles, surtout, l’avaient décidé. »
Arrivé à son affectation, Herbillon découvre les lieux : un simple terrain d’aviation entouré de hangars et de baraques. Il est ahuri d’être présenté à un lieutenant en tenue débraillée, vêtu d’un simple chandail, et portant, au lieu de bottes, des sabots au pied. Plutôt que de lui parler de gloire et d’héroïsme, le lieutenant incite Herbillon à se faire une petite vie douillette : « Faut être confortable avant tout. Une chambre, un cuisinier savant, une bonne pipe et l’on est paré. Je vous enseignerai tout cela. En s’arrangeant, on s’en tire même avec votre solde. »
Constatant que son chef, le capitaine Thélis, est âgé de seulement une vingtaine d’années, Herbillon se demande comment un garçon à peine plus vieux que lui peut commander une escadrille. L’explication est vite trouvée : l’espérance de vie y est faible. Herbillon s’habitue au fait que certains de ses camarades, partis pour une mission d’observation, n’en reviennent pas. Kessel fait part des commentaires entendus ici et là : « Une escadrille se renouvelle vite » ; « Plus on vole et plus on réduit sa chance. »
Les aviateurs mènent une vie libre, pleine de confort,
qui est la contrepartie du danger qu’ils courent
Un jour, un lieutenant d’âge mûr, du nom de Maury, débarque pour prendre le commandement en second de l’escadrille. Ses camarades le prennent en grippe et refusent de faire équipage avec lui, sauf Herbillon qui se porte volontaire. Maury sera pilote et Herbillon sera son observateur : « Alors ils surent ce que les camarades entendaient par équipage. Ils n’étaient pas simplement des hommes accomplissant les mêmes missions, soumis aux mêmes dangers et recueillant les mêmes récompenses. Ils étaient une entité morale, une cellule à deux cœurs, deux instincts que gouvernait un rythme pareil. »
Les semaines passent et Herbillon obtient une permission. A Paris, il va retrouver ses parents et son petit frère. Il prévoit bien sûr de longs moments à passer, dans sa garçonnière, en compagnie de Denise. Maury lui confie une lettre qu’il le prie de bien vouloir remettre à sa femme Hélène. Herbillon accepte volontiers de rendre ce service. Arrivé à Paris, il sonne au domicile des Maury. Quand il découvre l’identité d’Hélène Maury, Herbillon est stupéfait…
L’Equipage est un roman facile à lire. L’histoire, mélodramatique, accroche l’attention du lecteur. Au-delà, le livre offre une peinture particulièrement réussie du milieu de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale. Le lecteur partage la vie quotidienne de l’escadrille, faite de longs moments d’oisiveté et de courts moments de grand péril. Comme le fait remarquer Kessel, les aviateurs mènent une « vie libre, pleine de confort », avec « mille commodités » qui prennent « figure de privilèges ». Par comparaison avec les hommes qui se battent dans la boue des tranchées, ce sont de véritables seigneurs. Mais le taux de mortalité d’une escadrille est très élevé, comme si le « danger quotidien et mortel » était « la rançon » de leurs privilèges.
En 1935, L’Equipage fut adapté au cinéma par Anatole Litvak, avec Jean-Pierre Aumont, Annabella et Charles Vanel. Kessel collabora au scénario et ajouta au film un développement qui ne figurait pas dans le livre. Le film de Litvak rencontra un grand succès auprès du public. En 1969, à l’occasion de la publication du roman en collection Folio, Kessel révisa son manuscrit et y ajouta des chapitres directement inspirés du film.
L’Equipage, de Joseph Kessel, 1923, nouvelle édition revue et corrigée, 1969, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : l'equipage, kessel | Lien permanent | Commentaires (0)
19/10/2015
Amadeus, de Milos Forman
Un Mozart grivois aux compositions sublimes
Amadeus
Mozart n’était pas celui que l’on aurait pu imaginer. C’était un être grivois aimant les plaisanteries scatologiques et ayant un rire strident. Mais cela ne l’empêcha pas de composer une musique sublime qui élève l’âme. Le film de Milos Forman ne respecte pas entièrement la vérité historique, mais peu importe, car il propose une réflexion passionnante sur le mystère de la création artistique.
Amadeus n’est pas un film académique qui raconterait la vie de Mozart en l’entrecoupant de longs morceaux de musique qui déclencheraient un sentiment d’ennui chez le spectateur. Adapté de la pièce de Peter Shaffer, ce film est avant tout une fiction qui, sous la forme d’un essai cinématographique, essaye de cerner la personnalité du compositeur et de comprendre son génie.
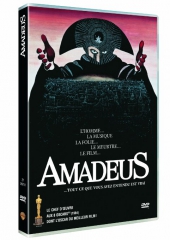 L’histoire commence en 1823 ; dans un hospice de Vienne, un vieil homme sent qu’il va mourir. Un prêtre accourt pour le confesser. Le vieil homme, qui s’appelle Salieri, avoue un crime ; il a, dit-il, tué Mozart. Et, sous forme de retour en arrière, il raconte sa vie et sa carrière. En 1781, alors qu’il était le compositeur officiel de la Cour impériale, une rivalité l’opposa au jeune Mozart.
L’histoire commence en 1823 ; dans un hospice de Vienne, un vieil homme sent qu’il va mourir. Un prêtre accourt pour le confesser. Le vieil homme, qui s’appelle Salieri, avoue un crime ; il a, dit-il, tué Mozart. Et, sous forme de retour en arrière, il raconte sa vie et sa carrière. En 1781, alors qu’il était le compositeur officiel de la Cour impériale, une rivalité l’opposa au jeune Mozart.
Salieri dans la force de l’âge est un homme distingué et bien élevé. C’est un musicien dont le talent est reconnu, notamment par l’empereur Joseph II qui le tient en grande estime. Salieri entend parler d’un jeune prodige nommé Mozart, qui est au service de l’archevêque de Salzbourg. Sa curiosité est piquée au vif, il aimerait savoir à quoi il ressemble. Un jour, à Salzbourg, dans le palais de l’archevêque, il le voit pour la première fois. Il le surprend en galante compagnie en train de se livrer à des jeux interdits. Mozart n’est pas du tout le genre d’homme auquel il s’attendait. Il est petit et surtout horriblement vulgaire. Alors que sa musique est élégante et empreinte d’une grande beauté, il est un être grivois, qui fait des plaisanteries scatologiques et dont le rire strident provoque le dégoût. Salieri n’en revient pas : comment un tel être est-il en mesure d’écrire une musique aussi sublime, qui élève l’âme vers Dieu ? Cela est d’autant plus étonnant que Mozart semble avoir un sens inné de la composition.
Apprenant qu’il doit être présenté à l’empereur, Salieri écrit une marche en l’honneur de Mozart. Le jour venu, Joseph II en personne se met au piano et interprète avec peine le morceau au moment où le jeune prodige fait son entrée. Après l’avoir entendu une seule fois, sans même regarder la partition, Mozart est capable de jouer à son tour la marche, au piano. Mieux, il se permet d’apporter quelques améliorations à la composition de Salieri afin de la rendre plus entraînante. Ce jour-là, devant l’empereur et la Cour, Salieri subit en silence l’humiliation que lui inflige Mozart.
Plus que jamais Salieri devient jaloux de Mozart. Il est conscient du génie de son rival et vit son succès comme une injustice. Comment est-il possible que Dieu ait choisi un être aussi repoussant que Mozart pour s’exprimer ? Car Salieri en est convaincu, c’est bien le Créateur qui s’exprime dans la musique de Mozart. Dès lors, Salieri déclare la guerre à Dieu… et à Mozart. Il va agir par derrière, en faisant preuve de ruse, pour faire trébucher son rival, tout en restant, ô paradoxe, un secret admirateur de ses compositions.
Le film montre que la postérité peut réviser le jugement
porté par les contemporains d’une époque
Le film suscite l’intérêt à plus d’un titre. Tout d’abord, il montre que la postérité peut démentir le jugement porté par les contemporains d’une époque. Alors qu’aujourd’hui Salieri est tombé dans l’oubli, le spectateur est tout étonné de découvrir que de son vivant ses œuvres pouvaient être préférées à celles de Mozart. Ainsi, à l’issue d’une représentation, l’empereur félicite Salieri d’avoir donné le meilleur opéra jamais composé ; en revanche, Sa Majesté baille à la première du Mariage de Figaro. D’une manière générale, il trouve qu’il y a trop de notes dans la musique de Mozart et que l’oreille humaine n’a pas la capacité de toutes les entendre. Et puis, les opéras de Mozart sont trop longs, près de trois heures pour Le Mariage de Figaro, d’où le bâillement de l’empereur.
Au-delà, Amadeus est l’illustration du principe selon lequel un créateur est bien souvent un être décevant qui, dans la vie de tous les jours, ne se montre pas à la hauteur de sa création. Mozart n’est pas un surhomme, c’est un être humain avec ses qualités et ses défauts. Cependant, le portrait que fait de lui le film est plus nuancé qu’il n’y paraît au premier abord. C’est un être doué pour la musique et jouissant de grandes facilités, mais c’est aussi un bourreau de travail. A la fin, quand il compose à la fois La Flûte enchantée et Le Requiem, il est au bord du surmenage, ou du « burn-out » comme on dirait aujourd’hui.
En ce qui concerne la vérité historique, il semble bien que Mozart, par moment, pouvait se lâcher et se montrer grivois, comme bien de ses contemporains. Il semble bien aussi que, tombé malade, il se soit convaincu que Salieri l’avait assassiné en l’empoisonnant, même si aucun élément ne le prouvait. Le film, lui, tranche, quitte à ne pas respecter les faits. Mais, après tout, la vérité historique importe peu au cinéma.
Au final, Amadeus apparaît comme un drame sur le mystère de la création artistique. Ce n’est pas un film de musicologue, et, de fait, il peut servir de porte d’entrée à la musique de Mozart.
Amadeus, de Milos Forman, 1984, avec F. Murray Abraham, Tom Hulce et Elizabeth Berridge, DVD Warner.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : amadeus, milos forman, f. murray abraham, tom hulce, elizabeth berridge | Lien permanent | Commentaires (0)


