15/06/2015
La Loi du marché, de Stéphane Brizé
Vincent Lindon chômeur prêt à bien des accommodements
La Loi du marché
Vincent Lindon est remarquable dans le rôle d’un chômeur qui retrouve du travail au prix de bien des concessions. Les dialogues sonnent juste et les personnages cherchent leurs mots comme dans la « vraie vie ». Dans ce film c’est la dureté du monde du travail qui apparaît.
On peut qualifier La Loi du marché de film social. Il raconte le parcours de Thierry, un quinquagénaire qui passe par une période de chômage avant de retrouver du travail. Le film se compose de deux parties informelles : la première est consacrée à la galère que connaît un chômeur, et la seconde le montre dans son nouvel emploi en insistant sur la dureté du monde du travail d’aujourd’hui. Les situations s’enchaînent sans transition : entretien à Pôle emploi, rendez-vous avec la banquière, appel reçu d’un recruteur, simulation d’un entretien d’embauche…
 C’est par la scène se déroulant à Pôle emploi que s’ouvre le film. Thierry est reçu par un agent pour son entretien de suivi personnalisé. La caméra filme le face-à-face avec en arrière-plan des affiches rappelant les devoirs du chômeur. Le rendez-vous tourne au dialogue de sourds.
C’est par la scène se déroulant à Pôle emploi que s’ouvre le film. Thierry est reçu par un agent pour son entretien de suivi personnalisé. La caméra filme le face-à-face avec en arrière-plan des affiches rappelant les devoirs du chômeur. Le rendez-vous tourne au dialogue de sourds.
La banquière de Thierry tire la sonnette d’alarme. Il puise dans son épargne de précaution pour boucler ses fins de mois. Elle lui conseille de vendre sa maison, ce qui lui procurerait de la trésorerie. Ce qui est piquant, c’est de constater que la banquière essaye de lui fourguer un produit financier supplémentaire, probablement pour toucher sa commission. Elle lui conseille de souscrire à une assurance-décès afin d’ « envisager sereinement l’avenir. »
Il est décidé à garder sa maison, mais il accepte de se séparer de son mobile-home. La négociation qu’il entame avec un acquéreur potentiel tourne à l’aigre. La relation est inégale entre les deux : Thierry est pressé de vendre pour disposer de liquidités, et l’acheteur, qui a compris sa situation de détresse, en profite pour tirer le prix à la baisse.
Thierry, victime d’un licenciement économique, aimerait tourner la page et « passer à autre chose » en retrouvant du travail. Lors d’un vidéo-entretien d’embauche, sur Skype, il se retrouve à nouveau en situation d’infériorité. Pressé par le recruteur, il accepte de réviser ses prétentions salariales à la baisse et de se montrer très flexible en matière d’horaires. Le recruteur est satisfait de ses réponses, car pour lui ces deux points sont très importants. Mais il ajoute aussitôt que, bien que rien ne soit décidé, il est peu probable que sa candidature soit retenue.
Autre grand moment, la simulation d’un entretien d’embauche. Au cours d’une session de formation organisée par Pôle emploi, les stagiaires sont invités à commenter la vidéo d’un essai fait par Thierry. Ils lui reprochent d’être avachi le col ouvert et de ne pas manifester, vis-à-vis d’un éventuel recruteur, le désir de s’investir dans son travail. Cet exercice dit de « coaching » est digne des grandes heures du Parti communiste chinois et de ses séances d’autocritique avec humiliation publique.
Homme affable, le directeur de l’hypermarché
n’a aucun état d’âme à réduire la masse salariale
Thierry est embauché comme vigile dans un hypermarché. Certes il a retrouvé du travail, mais au prix de bien des concessions. Dans la coulisse c’est un monde à la Orwell qui apparaît. Quatre-vingt caméras sont réparties dans le magasin. L’ensemble des clients sont surveillés, car, comme le dit un surveillant, « tout le monde est susceptible de voler. » Sont particulièrement suivis de près les clients qui gardent en main un produit qu’ils viennent de prendre en rayon, au lieu de le poser directement dans leur caddie.
Au premier abord, le directeur de l’hypermarché est un homme doux et affable. Mais il a besoin de réduire la masse salariale et n’a aucun un état d’âme à passer à l’acte. Quand il convoque une caissière prise en faute, il ne veut pas agir en être cynique et sans scrupule. Sur un ton très calme, il lui annonce qu’il ne peut la garder, car elle n’est plus digne de confiance. Non seulement il la licencie, mais en plus il lui fait une leçon de morale.
Le spectateur peut être mal à l’aise devant certaines scènes. La tension est palpable dans bien des échanges, et pourtant presque personne n’élève la voix. Dans cet univers oppressant, les seules respirations sont constituées de cours de danse et de moments passés en famille, dans lesquels Thierry trouve son équilibre.
Les dialogues sonnent juste. Comme dans la « vraie vie », les personnages ont des hésitations et cherchent leurs mots, ce qui leur confère du naturel sans que cela nuise au plaisir du spectateur. La qualité d’élocution et de maniement de la langue française dépend du milieu social auquel appartient chaque personnage. Dans le rôle de Thierry, Vincent Lindon est remarquable. Le prix d’interprétation que lui a décerné le festival de Cannes est amplement mérité.
La Loi du marché, de Stéphane Brizé, 2015, avec Vincent Lindon, actuellement en salles.
07:30 Publié dans Economie, Etude de moeurs, Film, Société | Tags : la loi du marché, stéphane brizé, vincent lindon | Lien permanent | Commentaires (0)
08/06/2015
L'Ordinateur du paradis, de Benoît Duteurtre
Conte philosophique sur la société numérique
L’Ordinateur du paradis
Dans un style élégant et fluide, Benoît Duteurtre se moque de la société néolibérale et numérique. A travers l’histoire de Simon Laroche, secrétaire de la commission des Libertés publiques, l’auteur pourfend le tout Internet, la transparence et les vertus prêtées à notre époque.
Benoît Duteurtre n’aime pas notre époque, mais il ne la fuit pas et préfère s’en moquer avec esprit. Au lieu de proposer un essai qui fustige les dérives de la société moderne ou postmoderne, il livre un conte philosophique mettant en scène la société néolibérale dans laquelle les individus sont connectés en permanence.
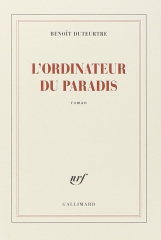 L’histoire se passe dans un pays qui n’est pas précisé, mais qui pourrait être la France, et à une époque qui n’est pas datée, mais qui pourrait être la nôtre. Le personnage principal, Simon Laroche, est ce qu’il est convenu d’appeler un gagnant. Il roule en BMW et vit dans une aisance matérielle certaine, qui lui est assurée par les hautes responsabilités qu’il occupe : il est rapporteur de la commission des Libertés publiques. A ce titre, il est appelé à donner son avis sur le manifeste publié par « Nous, en tant que femmes ! » Ce mouvement réclame la pénalisation de la consultation d’images pornographiques sur Internet. Simon Laroche est invité sur un plateau de télévision pour dire si une telle mesure serait attentatoire aux libertés publiques. Quelques minutes avant la prise d’antenne, il reçoit l’animatrice de l’émission dans sa loge, et, hors-caméra, il se lâche en disant avec franchise l’irritation que lui cause la lutte des femmes. Quelques jours plus tard, les propos de Simon, qui revêtaient pourtant un caractère privé, se trouvent mis en ligne sur Internet. Le scandale est énorme. Simon va devoir se résoudre à des excuses publiques, voire à la démission.
L’histoire se passe dans un pays qui n’est pas précisé, mais qui pourrait être la France, et à une époque qui n’est pas datée, mais qui pourrait être la nôtre. Le personnage principal, Simon Laroche, est ce qu’il est convenu d’appeler un gagnant. Il roule en BMW et vit dans une aisance matérielle certaine, qui lui est assurée par les hautes responsabilités qu’il occupe : il est rapporteur de la commission des Libertés publiques. A ce titre, il est appelé à donner son avis sur le manifeste publié par « Nous, en tant que femmes ! » Ce mouvement réclame la pénalisation de la consultation d’images pornographiques sur Internet. Simon Laroche est invité sur un plateau de télévision pour dire si une telle mesure serait attentatoire aux libertés publiques. Quelques minutes avant la prise d’antenne, il reçoit l’animatrice de l’émission dans sa loge, et, hors-caméra, il se lâche en disant avec franchise l’irritation que lui cause la lutte des femmes. Quelques jours plus tard, les propos de Simon, qui revêtaient pourtant un caractère privé, se trouvent mis en ligne sur Internet. Le scandale est énorme. Simon va devoir se résoudre à des excuses publiques, voire à la démission.
Pour nourrir son intrigue, Benoît Duteurtre a largement puisé dans l’actualité de ces dernières années. Par exemple, la déclaration enregistrée à la dérobée sur un plateau de télévision rappelle une mésaventure analogue survenue à un président de la République.
Dans ce livre, il est beaucoup question de l’omniprésence d’Internet dans la vie quotidienne et de l’absence de conscience devant les risques courus. Ainsi Simon est très étonné quand il s’aperçoit que tout courriel envoyé, ou toute consultation de site, laisse forcément des traces quelque part, que ce soit sur la toile ou sur son ordinateur personnel ; et cela même s’il a pris soin d’effacer toute trace de ses manipulations. Simon est terrifié d’apprendre qu’il n’y a pas de droit à l’oubli numérique : « Contrairement à la confession catholique qui remet à zéro le compteur de nos péchés, la foi dans l’effacement des données n’était qu’une illusion. »
Les élèves planchent sur la liberté d’expression
et en définissent d’abord les limites
Le fils de Simon, Tristan, suit des « ateliers sociaux » au collège. Les élèves ont pour projet de rédiger un manifeste pour la liberté d’expression. En même temps ils doivent en définir les limites. Et, au grand agacement de Simon, ils ont d’abord réfléchi aux bornes à ne pas dépasser. Tristan explique sur un ton très convaincu : « Nous, on s’est mis d’accord sur les limitations. […] D’abord le racisme, le sexisme, le terrorisme, l’injure aux religions… […] Et, bien entendu, les sites nazis et pédophiles ! » Simon, qui a été trotskiste dans les années soixante-dix et qui a ferraillé contre les religions, n’en revient pas et a du mal à avaler les propos de son fils sur « l’injure aux religions ».
Dans son livre, Duteurtre a aussi dans le collimateur la SNCF, même si la société nationale n’est pas nommément citée. On voit Simon obligé de renoncer à prendre le train rapide à réservation obligatoire, parce qu’il a décidé trop tard de son voyage. Il déplore que soit perdue la souplesse qui caractérisait le train et qui permettait d’y monter au dernier moment. Il est obligé de se rabattre sur une compagnie aérienne low-cost, et, dans l’avion, il devra s’acquitter d’un supplément de cinq euros pour utiliser les toilettes.
Dans cette société néolibérale, la langue française est massacrée. Le ministre de tutelle de Simon le convoque en entretien, et, bien que titulaire d’un Mastère [sic]de lettres, il bourre son discours de fautes de grammaire et d’anglicismes. Il déclare notamment : « Avant d’en venir à l’affaire qui nous impacte, j’aimerais connaître votre avis sur cette horrible news ! » Même au paradis, où espère entrer Simon après sa mort, la connaissance de l’anglais s’avère indispensable ! Et en ce qui concerne « cette horrible news » auquel le ministre fait allusion, il s’agit d’un grand dérèglement informatique qui menace la société sur ses bases. Ce dérèglement est une espèce de virus qui, dans sa propagation, peut faire penser à La Peste, de Camus.
Le livre de Duteurtre laissera probablement de marbre les lecteurs hyper-connectés acquis au monde néolibéral, mais, peut-être malgré tout, les fera-t-il réfléchir. L’Ordinateur du paradis permet de prendre quelque distance avec les vertus, supposées ou réelles, prêtées à la société actuelle : la rapidité, la réactivité, la transparence, l’hygiénisme, la mise en réseau, et cette volonté permanente de tout quantifier. Simon en arrive à la conclusion suivante : « le capitalisme a gagné ; mais notre époque a également recyclé le pire du communisme : s’exposer sans tabou, sur Facebook ou à la télé ; se fustiger publiquement à la moindre faute. »
L’Ordinateur du paradis, de Benoît Duteurtre, 2014, éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Société, XXe, XXIe siècles | Tags : l’ordinateur du paradis, benoît duteurtre | Lien permanent | Commentaires (0)
01/06/2015
Fenêtre sur cour (Rear Window), d'Hitchcock
Le voyeur selon Hitchcock
Fenêtre sur cour
(Rear Window)
James Stewart incarne un personnage immobilisé dans un fauteuil suite à un accident. Pour s’occuper, de sa fenêtre il observe ses voisins de l’immeuble en face. Bientôt il soupçonne l’un d’entre eux d’avoir assassiné sa femme. Le film vaut notamment pour la bande-son qui permet d’entendre les bruits d’ambiance du voisinage qui remontent dans la chambre de James Stewart. Pour vraiment en profiter, il est impératif de voir Fenêtre sur cour en version originale.
Fenêtre sur cour (Rear Window) présente une spécificité : pendant toute l’histoire le personnage principal ne quitte pas son pyjama et sa chambre. Suite à un accident, il a une jambe dans le plâtre et se trouve immobilisé dans un fauteuil. Pour occuper ses journées, sa seule distraction consiste à observer ses voisins de l’immeuble en face : un couple marié aux incessantes disputes, un couple sans enfant mais avec un chien, une femme seule, un musicien qui reçoit de nombreux visiteurs… Au bout de quelques jours, le personnage principal, joué par James Stewart, prend conscience d’un élément nouveau, qui le chiffonne. Quand il observe l’appartement du couple qui bat de l’aile, il ne voit plus la femme apparaître. Il cherche une explication à ce qui s’apparente à une disparition, et, à force de réflexion, il acquiert la conviction que la femme a été assassinée par son mari. Il fait venir un ami détective et lui livre ses conclusions, mais son ami ne se montre pas convaincu. Il juge saugrenue l’hypothèse de l’assassinat.
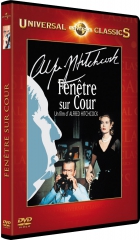 Dans cette histoire, le spectateur a d’autant moins de mal à s’identifier à James Stewart que tout le film est présenté de son point de vue. Comme lui, le spectateur est condamné à garder la chambre. Mais, de sa fenêtre, il a une vision panoramique sur l’immeuble en face et la cour en bas. L’action se passe pendant un été caniculaire, les habitants de New-York sont accablés de chaleur, si bien qu’ils vivent la fenêtre ouverte en permanence. De jour et de nuit, une multitude de sons arrivent plus ou moins brouillés jusqu’à la chambre de James Stewart. Il entend des éclats de voix, des rires et des pleurs ; il entend des discussions sans très bien savoir le contenu des échanges. Mais, à force d’observer les mouvements de ses voisins, il finit par connaître leurs habitudes, leur style de vie et leur caractère. Les sons d’ambiance sont très importants dans ce film, c’est pourquoi il faut le voir en version originale. Elle seule permet de profiter de la bande-son qui est une vraie réussite et qui fait pleinement entrer dans l’histoire. Dans la version française, le son est étouffé, ce qui réduit grandement l’intérêt du film.
Dans cette histoire, le spectateur a d’autant moins de mal à s’identifier à James Stewart que tout le film est présenté de son point de vue. Comme lui, le spectateur est condamné à garder la chambre. Mais, de sa fenêtre, il a une vision panoramique sur l’immeuble en face et la cour en bas. L’action se passe pendant un été caniculaire, les habitants de New-York sont accablés de chaleur, si bien qu’ils vivent la fenêtre ouverte en permanence. De jour et de nuit, une multitude de sons arrivent plus ou moins brouillés jusqu’à la chambre de James Stewart. Il entend des éclats de voix, des rires et des pleurs ; il entend des discussions sans très bien savoir le contenu des échanges. Mais, à force d’observer les mouvements de ses voisins, il finit par connaître leurs habitudes, leur style de vie et leur caractère. Les sons d’ambiance sont très importants dans ce film, c’est pourquoi il faut le voir en version originale. Elle seule permet de profiter de la bande-son qui est une vraie réussite et qui fait pleinement entrer dans l’histoire. Dans la version française, le son est étouffé, ce qui réduit grandement l’intérêt du film.
Fenêtre sur cour pose un problème moral. Le spectateur s’identifie à James Stewart qui passe le plus clair de son temps à épier les autres. Stewart se mêle de ce qui ne le regarde pas et se montre très indiscret. Il n’est pas exagéré de dire qu’il est un voyeur et qu’il viole l’intimité de ses voisins. Ses deux visiteuses régulières, sa fiancée, jouée par Grace Kelly, et son infirmière, ne font rien pour le décourager de sa curiosité et s’associent même à ce qui peut être assimilé à une perversion. Interrogé par Truffaut sur ce sujet, Hitchcock fut clair. Appelant un chat un chat, il affirma que le personnage de James Stewart était effectivement un voyeur, mais il ajouta que neuf personnes sur dix placées dans la même situation auraient eu un comportement parfaitement similaire au sien. Selon Hitchcock, une personne normalement constituée ne peut s’empêcher de regarder un spectacle qui s’offre à elle, et n’arrive pas à détourner le regard d’une scène qui suscite sa curiosité.
Si bien sûr les visites de Grace Kelly à James Stewart prennent une place importante dans le film, les échanges qu’il a avec son ami détective retiennent également l’attention. Quand James Stewart explique être convaincu que l’un de ses voisins a assassiné sa femme, a découpé son cadavre et a dispersé les morceaux dans des valises, il ne fait que confier son intuition. Il s’est construit dans sa tête son propre scénario avec toutes les invraisemblances qu’il comporte. Le détective l’écoute patiemment, mais, comme c’est un homme qui a les pieds sur terre, il trouve à chaque fois une explication logique aux anomalies relevées par James Stewart, qu’il finit par croire un peu dérangé. Le détective, homme d’expérience et de terrain, est ancré dans la réalité et se veut rationnel, et pourtant c’est lui qui a tort. James Stewart, personnage à l’imagination débordante, a vu juste, il est celui qui est dans le vrai. Fenêtre sur cour marque ainsi la victoire de l’imagination sur le vraisemblable.
Fenêtre sur cour (Rear Window), d’Alfred Hitchcock, 1954, avec James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter et Raymond Burr, DVD Universal.
07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense | Tags : fenêtre sur cour, rear window, alfred hitchcock, james stewart, grace kelly, wendell corey, thelma ritter, raymond burr | Lien permanent | Commentaires (0)


