18/05/2015
Choses vues, d'Hugo
Hugo reporter du siècle
Choses vues
Choses vues dans la version proposée par Gallimard est un recueil de plus de 1400 pages de notes prises, au cours de sa vie, par Victor Hugo. Le lecteur entre dans son intimité et est mêlé aux principaux événements du siècle ; il suit la lente évolution politique d’Hugo qui fut royaliste dans sa jeunesse et mourut républicain ; et il côtoie ses contemporains : Louis-Philippe, Chateaubriand, Lamartine, Balzac… Le génie d’Hugo fait de Choses vues un document exceptionnel.
Choses vues est un ensemble de notes prises, au jour le jour, par Victor Hugo pendant sa vie. Le titre Choses vues a été donné par ses exécuteurs testamentaires, l’ouvrage ayant été publié après sa mort. Le nombre d’écrits varie d’une édition à l’autre et c’est le recueil publié dans la collection Quarto de Gallimard qui paraît le plus complet. Il reprend, sur plus de 1400 pages, des notes s’étalant de 1830 à 1885, année de la mort de l’écrivain. Dans ses carnets, Hugo parle de sa vie au quotidien, aussi bien de sa vie publique que de sa vie de famille, les deux formant un tout à ses yeux. Il évoque également ses fréquentations féminines, le plus souvent dans un langage codé cependant. Et puis, il évoque l’état de ses finances et fait une comptabilité précise de ses recettes et de ses dépenses. Il note les montants qu’il touche au titre de ses droits d’auteur, les sommes qu’il tire à la banque, les pourboires qu’il verse, ainsi que les aumônes qu’il pratique ; car Hugo, ancien élève de mathématiques spéciales à Louis-le-Grand, est un homme qui sait compter et qui est à l’aise avec les chiffres.
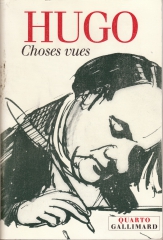 Le lecteur de Choses vues traverse une bonne partie du siècle. L’ensemble est très vivant, Hugo étant un reporter de génie. En sa compagnie, le lecteur a l’impression de vivre en direct de grands moments de l’histoire de France. Hugo assure le suivi au jour le jour de la Révolution de 1848, il est au milieu de l’émeute et des barricades, et fait partager ce qu’il voit et entend. Il rend également très compréhensible la guerre de 1870 et la naissance de la Commune.
Le lecteur de Choses vues traverse une bonne partie du siècle. L’ensemble est très vivant, Hugo étant un reporter de génie. En sa compagnie, le lecteur a l’impression de vivre en direct de grands moments de l’histoire de France. Hugo assure le suivi au jour le jour de la Révolution de 1848, il est au milieu de l’émeute et des barricades, et fait partager ce qu’il voit et entend. Il rend également très compréhensible la guerre de 1870 et la naissance de la Commune.
Au-delà, le lecteur assiste à la longue évolution des convictions d’Hugo. Jeune homme, il est royaliste. Mais déjà son positionnement apparaît ambigu. Ainsi, en août 1830, au lendemain de la chute de Charles X, il écrit : « Il nous faut la chose république et le mot monarchie. » En tout état de cause, il apporte son soutien au nouveau monarque, Louis-Philippe, qui saura le récompenser en le nommant pair de France, c’est-à-dire sénateur.
Sous la monarchie de Juillet, Hugo mène une vie mondaine qui le conduit au palais des Tuileries, au palais du Luxembourg, et au palais de l’Institut. La vie lui sourit et la question sociale n’est pas sa priorité. Cependant, en janvier 1841, quelques jours après son élection à l’Académie française, il fait le récit d’un épisode au cours duquel il se porte au secours d’une jeune femme arrêtée par la police pour avoir agressé un bourgeois. Hugo intervient auprès du commissaire et fait valoir que la malheureuse n’est pas la coupable mais la victime. Il atteste que le bourgeois lui a planté, sans raison, de la neige dans le dos et qu’elle n’a fait que se défendre. Sans nul doute, cet épisode aura été la source d’inspiration de l’écrivain dans la création de Fantine, personnage clé des Misérables.
En septembre 1843, le malheur s’abat sur Hugo. Il perd sa fille aînée Léopoldine, qui meurt en mer, en compagnie de son mari. Léopoldine avait vingt ans et venait de se marier. La blessure est profonde chez Hugo. Même si cela n’apparaît pas encore clairement, il semble que sa lente évolution politique et sociale voit le jour à ce moment-là.
En 1848, Hugo, pair de France, reste fidèle à la monarchie
Quand la Révolution de février 1848 éclate et renverse Louis-Philippe, Hugo, pair de France, reste fidèle à la monarchie et apporte son soutien à la Régence de la duchesse d’Orléans. En réalité, sa position est emberlificotée. Le 25 février, il rend visite à Lamartine, président du gouvernement provisoire de la République. Le recevant dans son bureau de l’hôtel de ville, Lamartine propose à Hugo, non une quelconque mairie d’arrondissement, mais un portefeuille ministériel. Voici le dialogue qui s’engage entre les deux hommes. Lamartine :
« - Ce n’est pas une mairie que je voudrais pour vous, c’est un ministère. Victor Hugo ministre de l’instruction publique de la République !... Voyons, puisque vous dites que vous êtes républicain !
- Républicain… en principe. Mais, en fait, j’étais hier pair de France, j’étais hier pour la Régence, et, croyant la République prématurée, je serais encore pour la Régence aujourd’hui. »
La toute nouvelle république, dominée par la bourgeoisie, est confrontée à la question brûlante des Ateliers nationaux. Ils ont été créés pour occuper les chômeurs. Mais leurs détracteurs y voient des écoles d’oisiveté. Parmi eux se trouve Hugo. Dans une note de mai 1848, il prend position contre ce qu’on appellerait aujourd’hui l’assistanat :
Ceci caractérise assez bien [les ateliers nationaux] ; des hommes en blouse jouaient au bouchon sous les arcades de la place Royale, qui s’appelle aujourd’hui place des Vosges. Jouer au bouchon, c’est un des travaux des ateliers nationaux. Un autre, en blouse aussi, dormait étendu le long du mur. Un des joueurs vient à lui, le pousse du pied et dit : « Qu’est-ce que tu fais là, toi ? » Le dormeur se réveille, se frotte les yeux, lève la tête, et répond : « Eh bien, je gagne mes 20 sous ! » Et il se recouche sur le pavé.
Voilà ce que c’est les Ateliers nationaux.
La majorité de l’Assemblée vote la fermeture des Ateliers nationaux. Furieux, les ouvriers se révoltent. Les journées de juin sont marquées par de nouvelles barricades. La répression est terrible. Dorénavant la bourgeoisie n’est plus du côté de la révolution, mais du côté de l’ordre.
Hugo revient bouleversé de sa visite des caves de Lille
Le véritable tournant, chez Hugo, se produit en 1849. Bien qu’élu représentant sur une liste de candidats conservateurs, il s’en détache en réclamant, en vain, une amnistie et la liberté de la presse. Accusé par ses amis d’hier d’être une girouette, Hugo se justifie dans une note rédigée le 18 décembre 1850 et destinée à la postérité. Il y cible ses adversaires conservateurs :
Ils me disent :
« Vous avez varié. Vous avez changé. En 1848, vous étiez contre les rouges ; en 1850, vous êtes pour les rouges. Donc, etc. »
Expliquons-nous.
En 1848, « les rouges » étaient les oppresseurs, je les combattais. En 1850, « les rouges » sont les opprimés, je les défends.
C’est là que vous appelez varier ?
Comme vous voulez ! »
Le 20 février 1851, à l’invitation d’Adolphe Blanqui, membre de l’Institut, Hugo se rend dans les caves de Lille, ghetto souterrain où sont parqués des pauvres. Il découvre la misère sociale dans sa crudité. Voici ce qu’il écrit :
Dialogue à Lille, dans une cave :
« Ah ! pauvre petite ! Déjà au travail. Mais elle a à peine quatre ans !
- Monsieur, j’ai huit ans.
- C’est égal. Elle n’est pas en état de travailler. Il faut le dire à ses parents, Madame, vous êtes sans doute sa grand-mère ?
- Monsieur, je suis sa mère. J’ai trente-cinq ans. »
Hugo revient bouleversé de sa visite des caves de Lille. Pour la première fois de sa vie, il a été confronté à l’extrême pauvreté. Sa vision de la misère qui était purement livresque jusqu’ici devient ancrée dans la réalité qu’il a vue de ses yeux. De ce jour, il est convaincu de la primauté de la question sociale.
Le 2 décembre 1851, il s’oppose au coup d’état du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte et tente de soulever le peuple de Paris. C’est l’échec. Il s’exile, d’abord en Belgique, d’où il est expulsé, puis à Jersey, d’où il est également expulsé. Il trouve refuge à Guernesey, où le suivent sa famille et sa chère Juliette Drouet.
En 1859, Napoléon III décrète l’amnistie. L’ensemble des opposants au régime profitent de cette largesse pour rentrer en France. Hugo refuse. Le 19 août 1859, il ironise sur l’amnistie :
Le coupable pardonne aux innocents, le bandit réhabilite les justes, le violateur des lois fait grâce aux défenseurs des lois ; c’est bien.
Je laisse l’Europe applaudir l’amnistie sur la joue de la justice et de la vérité.
A une certaine profondeur de dédain il semble qu’il n’y ait plus de possible que le silence.
Le proscrit de Décembre doit à l’Empire l’implacable guerre de la justice. Quand cette guerre finira-t-elle ? à la fin de l’Empire ou à la mort du proscrit.
J’entends rester libre.
Et je veux rester combattant.
Les années passent. Malgré l’éloignement et la réclusion, la proscription est féconde à Hugo, puisqu’elle lui permet de finir la rédaction des Misérables, qui sera un immense succès populaire.
En 1870, Hugo, député républicain,
lance un appel à la guerre à outrance
En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Le 9 août, Hugo, apprenant que trois batailles ont été perdues coup sur coup, décide de rentrer en France pour, écrit-il, « être à la disposition de mon devoir et des événements. »
Le 3 septembre, Hugo est à Bruxelles quand il apprend que Napoléon III est prisonnier et que plus rien ne s’oppose à son retour en France. Le 4 septembre, la République est proclamée. Le 5 septembre, Hugo s’apprête à prendre le train pour Paris quand, place de la Monnaie, un jeune homme l’aborde :
« - Monsieur, on me dit que vous êtes Victor Hugo ?
- Oui.
- Soyez assez bon pour m’éclairer. Je voudrais savoir s’il est prudent d’aller à Paris en ce moment.
- Monsieur, c’est très imprudent, mais il faut y aller. »
Ce même jour, le 5 septembre, après plus de dix-huit années d’exil, Hugo rentre à Paris. Le peuple lui a réservé un accueil triomphal. La foule chante La Marseillaise et Le Chant du départ, et crie « Vive Victor Hugo ! » Hugo lance à la foule : « Vous me payez en une heure vingt ans d’exil. » et il ajoute : « Citoyens ! Je ne suis pas venu ébranler le gouvernement provisoire de la République, mais l’appuyer. »
Hugo est élu député de la Seine. L’ancien pair de France siège maintenant à l’extrême-gauche. Mais l’homme qui présidait, l’année passée, le Congrès de la Paix n’admet pas la défaite. Le 16 septembre 1870, il publie l’Appel aux Français pour la guerre à outrance et note dans ses carnets :
Il y a aujourd’hui un an, j’ouvrais le Congrès de la paix à Lausanne. Ce matin, j’écris L’Appel aux Français pour la guerre à outrance contre l’invasion.
Mais son appel reste sans effet, l’assemblée de Versailles préférant signer la paix avec l’Allemagne. Après la Commune à laquelle il n’a pourtant pas apporté son soutien, Hugo réclame une amnistie générale, ce qui lui vaut l’hostilité de la droite.
On l’a vu, Victor Hugo aura effectué un virage à 180 degrés, en ce qui concerne ses idées politiques. Cependant, de 1830 à sa mort en 1885, il n’aura pas varié sur deux sujets : son opposition absolue à la peine de mort et son patriotisme. Le 27 décembre 1877, il écrit : « Malheur à qui fait mal à la France ! Je ne m’apaiserai pas. Je déclare que je mourrai fanatique de la patrie. »
*****
Dans Choses vues, Victor Hugo fait des portraits de ses illustres contemporains. Voici quelques personnalités qu’il évoque :
Louis-Philippe
Hugo, pair de France, était devenu un familier de Louis-Philippe, auquel il consacre de nombreuses notes. Il évoque notamment la mort accidentelle de son fils aîné. Le 13 juillet 1842, sur la route de Neuilly, le duc d’Orléans, héritier du trône, fait une mauvaise chute de cheval. Informé de l’accident, le roi se rend immédiatement sur place. Selon Hugo, Louis-Philippe voit son fils blessé et déclare : « C’est une chute cruelle ; il est encore évanoui, mais il n’a aucune fracture, tous les membres sont souples et en bon état. » Hugo poursuit : « Le roi avait raison ; tout le corps du prince était sain et intact, excepté la tête, laquelle, sans déchirure ni lésion extérieure, était brisée sous la peau comme une assiette. » Le duc d’Orléans meurt le jour même.
Sous son règne, Louis-Philippe aura été la cible de nombreux attentats. Hugo parle abondamment de la tentative commise, le 16 avril 1846, par le dénommé Pierre Leconte. Ce dernier tire sur le roi et le manque. Il est jugé par la chambre des pairs, qui le condamne à mort. Son avocat, maître Duvergier, se rend au Château pour demander la grâce de son client. Selon Hugo, qui soutient la démarche de l’avocat, Louis-Philippe, très remonté, déclare ceci :
« - J’examinerai, je verrai. Le cas est grave. Mon danger est le danger de tous. Ma vie importe à la France, c’est pour cela que je dois la défendre. Savez-vous comment il se fait qu’on tire sur moi ? C’est qu’on ne me connaît pas, c’est qu’on me calomnie ; on dit partout : - Louis-Philippe est un gueux, Louis-Philippe est un coquin, Louis-Philippe est un avare, Louis-Philippe fait le mal. Il veut des dotations pour ses fils, de l’argent pour lui. Il corrompt le pays. Il l’avilit au-dedans et l’abaisse au-dehors. C’est un vieux Anglais. A bas Louis-Philippe ! Que diable ! il faut bien que je protège un peu ce pauvre Louis-Philippe, maître Duvergier. C’est égal, je réfléchirai. »
Ce jour-là, il apparaît clairement que le roi n’est pas décidé à faire grâce ; et, effectivement, quelques jours plus tard, maître Duvergier reçoit un message du Château lui annonçant que « le roi avait cru devoir décider que la loi aurait son cours. »
La répétition d’affaires politico-financières mettant en cause de hautes personnalités mine la monarchie de Juillet. En 1847, la Chambre des pairs est chargée de juger Jean-Baptiste Teste, président de chambre à la Cour de cassation, accusé de s’être laissé corrompre quand il était ministre des Travaux publics. Le scandale est énorme. Teste est condamné, le régime est affaibli. A cela s’ajoute l’autoritarisme de Louis-Philippe, qui n’arrange pas les choses.
Louis-Philippe ne voit pas venir la Révolution de Février 1848, qui le renverse. Hugo nous fait le récit de la fuite du roi, et il n’est pas exagéré de dire qu’il a fui comme un voleur.
Chateaubriand
Hugo parle assez peu de Chateaubriand, dont il avait été le grand admirateur, presque le disciple. Mais, après la chute de Charles X, leurs relations se sont distendues. Hugo s’est rallié à Louis-Philippe, tandis que Chateaubriand refuse de reconnaître le nouveau roi. De plus, Chateaubriand ose critiquer le mouvement romantique, si bien qu’en 1836, dans ses notes, Hugo lâche :
M. de Chateaubriand vieillit par le caractère plus encore que par le talent. Le voilà qui devient bougon et hargneux.
Chateaubriand sera resté fidèle aux Bourbons tout en luttant pour la liberté de la presse. A sa mort le 4 juillet 1848, alors que la République a été proclamée, Hugo se rappelle ceci :
M. de Chateaubriand ne disait rien de la République, sinon : « Cela vous fera-t-il plus heureux ? »
On sait qu’à la fin de sa vie, Chateaubriand se préoccupa fort de l’édification de sa statue morale et intellectuelle et de l’image qu’il laisserait aux générations à venir.Lorsqu’il s’agit, à l’Académie, de pourvoir son siège devenu vacant, Hugo, quelque peu perfide, note, le 29 décembre 1848 :
[M. de Chateaubriand] haïssait tout ce qui pouvait le remplaçer et souriait à tout ce qui pouvait le faire regretter.
Pour succéder à Chateaubriand, Hugo soutient la candidature de Balzac. L’auteur de La Comédie humaine n’obtient que deux voix, celle d’Hugo et celle de Vigny. C’est un nouvel échec pour Balzac, qui n’aura jamais réussi à entrer à l’Académie française.
La mort de Balzac
Le 18 août 1850, Mme Hugo rend visite à Mme de Balzac. A son retour, elle annonce à son mari que Balzac se meurt. Le soir même, Hugo se rend au domicile de Balzac, où il est accueilli par sa sœur qui est en pleurs. Il est introduit dans la chambre du mourant :
Une odeur insupportable s’exhalait du lit. Je soulevai la couverture et pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression.
C’était cette même chambre où je l’étais venu voir un mois auparavant. Il était gai, plein d’espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure en riant.
Nous avions beaucoup causé et disputé politique. Il me reprochait « ma démagogie ». Lui était légitimiste. Il me disait : « Comment avez-vous pu renoncer avec tant de sérénité à ce titre de pair de France, le plus beau après celui de roi de France ! »
Il me disait aussi : « J’ai la maison de M. de Beaujon, moins le jardin, mais avec la tribune sur la petite église du coin de la rue. J’ai là dans mon escalier une porte qui ouvre sur l’église. Un tour de clef et je suis à la messe. Je tiens plus à cette tribune qu’au jardin. »
Quand je l’avais quitté, il m’avait reconduit jusqu’à cet escalier, marchant péniblement, et m’avait montré cette porte, et il avait crié à sa femme : « Surtout, fais bien voir à Hugo tous mes tableaux. »
La garde me dit :
« Il mourra au point du jour. »
Je redescendis, emportant dans ma pensée cette figure livide ; en traversant le salon, je retrouvai le buste [colossal en marbre de Balzac par David] immobile, impassible, altier et rayonnant vaguement, et je comparai la mort à l’immortalité.
Rentré chez moi, c’était un dimanche, je trouvai plusieurs personnes qui m’attendaient […]. Je leur dis : « Messieurs, l’Europe va perdre un grand esprit. »
Il mourut dans la nuit. Il avait cinquante et un ans.
Choses vues, de Victor Hugo, 1830-1885, édition d’Hubert Juin, 1972, collection Quarto Gallimard.
07:33 Publié dans Carnets, correspondance, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : hugo, choses vues | Lien permanent | Commentaires (0)
11/05/2015
Violence et passion, de Visconti
Histoire du vieil homme qui s’éveilla à la vie
Violence et passion
Sous la direction de Visconti, Burt Lancaster est plein de dignité et de grandeur dans le rôle d’un professeur issu d’une vieille famille de l’aristocratie italienne. Il vit seul dans son palais, entouré de ses livres et de ses tableaux. Alors qu’il aime la tranquillité, il accepte des locataires bruyants et grossiers, qui bouleversent ses habitudes.
Violence et passion est l’avant-dernier film de Visconti. Le réalisateur était déjà malade quand il entreprit le tournage de cette œuvre aux allures de testament. Dix ans après Le Guépard, il retrouvait Burt Lancaster qui incarne à nouveau un aristocrate italien. Le nom de son personnage n’est jamais mentionné, il est uniquement désigné sous le titre de professeur. Il est le dernier rejeton d’une des plus vieilles familles d’Italie et vit seul dans son palais, ou plus précisément dans l’appartement qu’il s’est réservé à l’intérieur de son palais. Il a pour compagnons ses livres, ses tableaux et sa bonne. Cette vie en solitaire lui donne pleine satisfaction, tant il aime le silence. Même les pas de sa bonne le déconcentrent dans son travail.
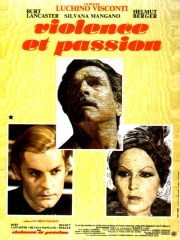 Un jour, il reçoit la visite de la marquise Brumonti, qui demande à louer l’appartement au-dessus du sien. Ne voulant pas perdre sa tranquillité, le professeur refuse. Mais la marquise insiste, et, à force de persuasion et d’habileté, elle finit par lui arracher son consentement. Elle prend possession des lieux en compagnie de sa fille unique et de l’ami de cette dernière. En réalité, elle destine l’appartement à son jeune amant. La marquise entretient un gigolo, Conrad, qui a quinze ans de moins qu’elle.
Un jour, il reçoit la visite de la marquise Brumonti, qui demande à louer l’appartement au-dessus du sien. Ne voulant pas perdre sa tranquillité, le professeur refuse. Mais la marquise insiste, et, à force de persuasion et d’habileté, elle finit par lui arracher son consentement. Elle prend possession des lieux en compagnie de sa fille unique et de l’ami de cette dernière. En réalité, elle destine l’appartement à son jeune amant. La marquise entretient un gigolo, Conrad, qui a quinze ans de moins qu’elle.
La cohabitation s’avère difficile entre le professeur et ses voisins du dessus. Ils sont bruyants et grossiers, alors que le professeur est posé et discret. Il doit supporter leurs disputes, d’autant plus que la marquise et Conrad entretiennent des relations orageuses. Le professeur, qui voit son quotidien bouleversé, veut mettre à la porte ses locataires. Mais Conrad finit par attirer son attention. Malgré son manque évident de savoir-vivre, le jeune homme montre un réel intérêt pour la musique et la peinture. Les commentaires qu’il fait en découvrant la collection du professeur sont pleins de pertinence.
Le professeur se prend d’affection pour Conrad, avec qui il développe une relation quasi-filiale. Parallèlement, il s’adapte aux habitudes de ses voisins. Alors que le professeur n’avait jusqu’ici aucune interaction avec le monde extérieur, ses locataires, eux, sont en perpétuelle interaction. Ils vivent leur vie intensément, quitte à avoir entre eux des relations passionnelles. En dépit de leur style de vie très différent, ils deviennent peu à peu sa famille d’adoption.
Sur le tard, le professeur s’éveille à la vie, comme s’il était sorti d’un long sommeil. A force de se concentrer sur ses livres et ses études, il s’était isolé dans un monde abstrait et était passé à côté de l’essentiel, c’est-à-dire le monde qui l’entoure. Il apprend à vivre en interaction avec les autres et ainsi il découvre la vie, mais déjà la mort est au pas de sa porte.
Tout le film se déroule dans le décor somptueux du palais du professeur. Comme au théâtre, Visconti respecte l’unité de lieu chère aux classiques. Burt Lancaster est plein de dignité et de grandeur dans le rôle du vieil homme. Sa rencontre avec Visconti lui aura permis de montrer qu’il était un acteur complet. Burt Lancaster l’enfant des rues de New-York, le joueur de base-ball, l’acrobate de cirque, donne vraiment l’impression d’être né dans une vieille famille de l’aristocratie italienne. Quant à Conrad, il est interprété par Helmut Berger, qui, deux ans plus tôt, avait incarné Louis II de Bavière dans Ludwig ou le crépuscule des dieux, du même Visconti.
Violence et passion, de Luchino Visconti, 1974, avec Burt Lancaster, Silvana Mangano et Helmut Berger, DVD Gaumont.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : violence et passion, visconti, burt lancaster, silvana mangano, helmut berger | Lien permanent | Commentaires (0)
04/05/2015
Les Clés de saint Pierre, de Roger Peyrefitte
Un écrivain à la réputation sulfureuse s’attaque au Vatican
Les Clés de saint Pierre
En 1954, Les Clés de saint Pierre choqua de nombreux catholiques. Dans ce livre au ton très caustique, Roger Peyrefitte s’attaque au Vatican et à la papauté. Il ironise sur la simplicité de Pie XII et sur ce qu’il appelle son agoraphilie. Plus profondément, l’auteur dénonce l’inflation du nombre de canonisations et s’interroge sur certaines pratiques de l’Eglise.
Roger Peyrefitte fut un écrivain à la réputation sulfureuse. Se rappelant ses années d’étude passées dans des collèges religieux, il en tira un roman, Les Amitiés particulières, publié en 1945. Le livre obtint le prix Renaudot, mais de nombreux lecteurs furent choqués en découvrant les mœurs exposées par l’auteur. En 1954, sous le pontificat de Pie XII, Roger Peyrefitte publia Les Clés de saint Pierre et déclencha à nouveau le scandale, en s’attaquant directement au Vatican. Dans ce livre au ton caustique, l’auteur ne respecte rien de la papauté. Ce n’est pas tant le dogme que l’institution en tant que telle qui est sa cible. Peyrefitte est un érudit, il connait son sujet, et seuls des spécialistes pourraient le prendre en faute. Il a aussi fait appel à son expérience de diplomate pour construire ce livre d’autant plus féroce et dévastateur qu’il est écrit dans une langue élégante. Le style de Peyrefitte, un peu ampoulé, paraît en harmonie avec la pompe vaticane.
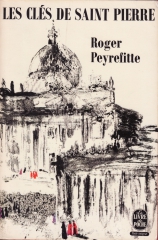 L’intrigue n’a pas grande importance, elle est squelettique et tient en quelques lignes. L’abbé Victor Mas, jeune séminariste du diocèse de Versailles, arrive à Rome pour devenir secrétaire adjoint du cardinal Belloro, préfet de la congrégation des Rites. Au fil du livre, le cardinal Belloro, personnalité anticonformiste, fait découvrir au jeune abbé les arcanes du Vatican. L’essentiel du livre est construit autour des conversations qu’ont les deux hommes. Le lecteur s’identifie à l’abbé Mas et finit par comprendre que, par la bouche du cardinal Belloro, c’est en fait Peyrefitte qui s’exprime.
L’intrigue n’a pas grande importance, elle est squelettique et tient en quelques lignes. L’abbé Victor Mas, jeune séminariste du diocèse de Versailles, arrive à Rome pour devenir secrétaire adjoint du cardinal Belloro, préfet de la congrégation des Rites. Au fil du livre, le cardinal Belloro, personnalité anticonformiste, fait découvrir au jeune abbé les arcanes du Vatican. L’essentiel du livre est construit autour des conversations qu’ont les deux hommes. Le lecteur s’identifie à l’abbé Mas et finit par comprendre que, par la bouche du cardinal Belloro, c’est en fait Peyrefitte qui s’exprime.
Tel un Luther du XXe siècle, Peyrefitte s’attaque aux indulgences sur lesquelles il ironise abondamment. Il consacre aussi de longs passages aux canonisations. Le cardinal Belloro dénonce la récente inflation du nombre de saints et va jusqu’à parler de tromperie. Pour se faire comprendre, il remonte au XIVe siècle : « Boniface VIII n’effectua qu’une seule canonisation et il a régné neuf ans. On trouvait fabuleux au XVIIIe siècle que Benoît XIII eut fait neuf saints. Pie XI a battu tous les records avec vingt-sept saints et quarante et un bienheureux. Pie XII nous a donné à ce jour trente-cinq des uns et dix-huit des autres. » Le cardinal Belloro poursuit en ironisant sur les congrégations, notamment de religieuses, qui se battent pour obtenir la canonisation de leur fondateur. Il poursuit sa démonstration en prenant l’exemple du vénérable Jean-Marie Lamenais, fondateur des frères de Ploërmel. Il ne discute pas ses qualités, mais déplore qu’à côté l’Eglise n’ait pas su garder dans son sein Félicité de Lamenais, frère du précédent, qui a été l’un des plus grands esprits du XIXe siècle et qui est mort hors de l’Eglise. Belloro regrette ce qu’il appelle « les belles canonisations perdues » et raille les papes du XXe siècle qui ont la volonté de canoniser leurs prédécesseurs. A la publication du livre, Pie X vient d’être canonisé et, selon le cardinal, « canoniser Pie X, c’est faire rentrer les papes dans la course aux canonisations, d’où l’on avait jugé décent de les retirer depuis le XVIe siècle. »
Le cardinal Belloro n’aime pas les messes en plein air
La simplicité de style que Pie XII s’impose et impose à l’Eglise, aux cardinaux et aux évêques, ne trouve pas non plus grâce aux yeux de Belloro : « [Le pape] a interdit aux évêques de porter les titres de noblesse liés à leurs évêchés, mais il n’interdit pas à ses neveux de porter le titre de prince qu’il leur a fait donner par la monarchie. »
Belloro n’aime pas non plus la célébration des messes en plein air développé par Pie XII. Plutôt que de célébrer les canonisations entre les murs de Saint-Pierre, le pape préfère officier hors-les-murs, dans le cadre profane de la place publique, devant les portes de la basilique. Peyrefitte écrit : « L’abbé comprenait que le cardinal eût été loin d’approuver l’agoraphilie de Pie XII. […] Le souverain pontife semblait croire à la vertu du plein air. Peut-être avait-il voulu copier les communistes […]. Peut-être avait-il voulu copier les apothéoses de la Rome antique. »
L’un des passages les plus caustiques du livre correspond à la visite que fait l’abbé Mas à un chanoine français du révérendissime chapitre de la basilique Saint-Jean-de-Latran. Le chanoine, chevalier de la Légion d’honneur, est très fier de sa décoration ; son mérite est d’avoir renoué avec l’usage, remontant à Henri IV, qui fait des rois de France les protecteurs du Latran. Aussi le chanoine a-t-il obtenu que ses collègues nomment « à l’unanimité M. le président Auriol chanoine honoraire du Latran comme successeur des rois de France », le titre étant, au moment de la publication du livre, porté par le président Coty. Cette disposition en faveur des présidents de la République française fait ricaner Mgr Pimprenelle, correspondant du journal La Croix. Selon lui, avoir renoué avec cette tradition tient de la mascarade, les présidents de la République n’ayant rien de commun avec les rois : « Les rois de France étaient considérés comme chanoine honoraire du Latran et d’autres lieux, parce que l’onction du sacre était censée les faire sous-diacres. Aussi chantaient-ils l’épître en tunique, quand ils venaient à Rome, mais je n’imagine pas MM. Auriol et Coty chantant l’épître en tunique à Saint-Jean-de-Latran. »
Un chapitre entier du livre est constitué du compte-rendu d’une réunion tenue au Vatican, relative au saint prépuce, qui aurait été conservé après la circoncision du Christ. Selon l’auteur, la séance particulière de la suprême sacrée congrégation du saint office eut lieu le samedi 15 mai 1954. Dans sa conclusion, elle prévoit la peine d’excommunication contre quiconque écrirait et parlerait du saint prépuce. Mais cela n’empêche pas Peyrefitte de publier l’intégralité du procès-verbal de cette réunion. L’illusion est telle, que le lecteur est bien en peine de déterminer si le document est authentique.
Aujourd’hui Les Clés de saint Pierre est tombé dans l’oubli et son auteur demeure dans une espèce de purgatoire littéraire. Etant antérieur au concile Vatican II, le livre peut donner l’impression d’avoir vieilli ; pourtant il est encore en mesure de choquer bien des catholiques, comme s’il n’avait pas tout perdu de son caractère corrosif, et comme s’il gardait une certaine actualité.
Les Clés de saint Pierre, de Roger Peyrefitte, 1954, Le Livre de Poche (épuisé).
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XXe, XXIe siècles | Tags : les clés de saint pierre, roger peyrefitte, vatican | Lien permanent | Commentaires (0)


