01/12/2014
Casque d'or
Echec à sa sortie, film mythique aujourd’hui
Casque d’Or
Au fil des rediffusions à la télévision, le film de Jacques Becker a acquis le statut de film mythique. Simone Signoret est resplendissante dans le rôle de Marie. Elle séduit Serge Reggiani qui joue le rôle d’un charpentier nommé Georges Manda. On les voit tous deux danser la valse dans la scène d’ouverture du film, restée mémorable.
Le film fut un échec commercial. A sa sortie en 1952, un certain nombre de spectateurs furent décontenancés. Ils s’attendaient à un film policier et, au lieu de cela, ils découvraient à l’écran une histoire se déroulant dans le Paris des années 1900. Qui plus est, l’histoire mettait en scène des Apaches, c'est-à-dire les voyous de la Belle Epoque. Les spectateurs ressortirent déçus. Ce n’est que par la suite et avec les années, au fil des ressorties en salles et des diffusions à la télévision, que Casque d’Or acquit sa réputation de film mythique.
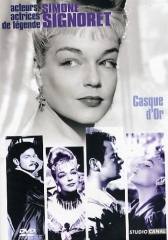 La séquence d’ouverture est la plus mémorable. Un beau dimanche d’été, dans une guinguette des bords de Marne, un menuisier nommé Georges Manda finit d’installer une estrade, quand une bande de jeunes gens turbulents vient s’installer à une table. L’une des filles, Marie, dite Casque d’Or du fait de sa coiffure, se montre très aguicheuse. Par provocation, elle fait de l’œil à Manda et lui demande si les charpentiers savent danser. Pour le lui montrer, il l’invite à valser avec lui. Ils dansent ensemble et, au moment de se séparer, ils promettent de se revoir. Mais Manda va se heurter à Félix, protecteur de Marie et chef de la bande d’Apaches.
La séquence d’ouverture est la plus mémorable. Un beau dimanche d’été, dans une guinguette des bords de Marne, un menuisier nommé Georges Manda finit d’installer une estrade, quand une bande de jeunes gens turbulents vient s’installer à une table. L’une des filles, Marie, dite Casque d’Or du fait de sa coiffure, se montre très aguicheuse. Par provocation, elle fait de l’œil à Manda et lui demande si les charpentiers savent danser. Pour le lui montrer, il l’invite à valser avec lui. Ils dansent ensemble et, au moment de se séparer, ils promettent de se revoir. Mais Manda va se heurter à Félix, protecteur de Marie et chef de la bande d’Apaches.
Casque d’Or vaut d’abord pour les acteurs. Simone Signoret, dans le rôle de Marie, est moqueuse et étincelante. Elle est âgée de trente ans quand elle tourne le film, et sa beauté est resplendissante sous ses cheveux blonds. De nos jours, le spectateur est d’autant plus ému de la voir ainsi qu’il sait que bientôt les années compteront double pour elle, sa beauté ne tardera pas à se faner et ne sera plus qu’un lointain souvenir.
Serge Reggiani, dans le rôle de Manda, est presque méconnaissable, tant ses bacchantes à la mode 1900 lui donne un air sombre. Reggiani raconta des années plus tard que Simone ne savait pas danser la valse et qu’il avait dû la lui apprendre à cette occasion. En 1973, il enregistra une chanson intitulée Un menuisier dansait, dédiée à Simone Signoret.
Claude Dauphin joue le rôle de Félix. Il exige de ses hommes qu’ils portent un chapeau et non une casquette, afin de ne pas se faire remarquer. Il cherche une forme de respectabilité. Ce qui ne l’empêche pas d’être cynique à l’occasion. Ainsi il fait liquider un garçon de café qui avait mouchardé ; pour éloigner les soupçons, il se désole en public de sa mort, et pousse le vice jusqu’à organiser une quête pour aider sa grand-mère.
Les hommes règlent leurs comptes
à coups de couteau
Becker a reconstitué avec soin l’atmosphère du Paris 1900. On y voit des bourgeois en habit et à haut-de-forme venir s’encanailler dans un caf-conc au milieu des ouvriers à casquette. Ils ne seront pas déçus du déplacement.
Le film est sombre. Les hommes règlent leurs comptes à coups de couteau, et la vie, pour eux, n’a pas grand prix. Seule l’amitié, comme souvent chez Becker, finit par montrer sa force, ainsi que l’amour. Une séquence insolite détonne dans cette histoire. On y voit Marie et Manda pousser la porte d’une église et s’y attarder quelques minutes pour apercevoir une cérémonie de mariage.
Jacques Becker fut affecté par l’échec de son film, lui qui rêvait tant du succès. Si bien que, pour son film suivant, il prit le contre-pied de Casque d’Or. Il se décida à réaliser un grand film policier qui aurait les faveurs du public. Après bien des hésitations, il recruta Jean Gabin et cela donna Touchez pas au grisbi, d’après un roman d’Albert Simonin. Et enfin, Becker obtint un succès à la fois public et critique. Touchez pas au grisbi relança la carrière de Gabin qui retrouva la popularité qui avait été la sienne avant la guerre.
Casque d’Or, de Jacques Becker, 1952, avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin et Raymond Buissière, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : casque d'or, jacques becker, simone signoret, reggiani | Lien permanent | Commentaires (0)
24/11/2014
Les Puissances des ténèbres, de Burgess
L’histoire dérangeante d’un miracle
Les Puissances des ténèbres
(Earthly Powers)
Le roman d’Anthony Burgess est foisonnant et passionnant. Au soir de sa vie, un grand écrivain se souvient. Il raconte sa jeunesse tumultueuse et scandaleuse, et évoque le défunt pape dont il était un proche. Les échanges entre les deux hommes donnent lieu à une réflexion sur la nature du mal et son origine.
En 1971, l’écrivain britannique Kenneth M. Toomey fête son quatre-vingt-et-unième anniversaire quand il reçoit, à Malte où il réside, la visite d’un émissaire du Vatican. Il lui est demandé d’apporter son témoignage dans le cadre du procès en béatification du défunt pape, Grégoire XVII, dont il était un proche. Le Vatican attend de Toomey qu’il atteste d’un miracle dont il aurait été témoin à l’hôpital de Chicago dans les années trente. Cette visite est l’occasion pour l’écrivain, au soir de sa vie, de replonger dans ses souvenirs et de raconter sa vie au lecteur en commençant par le commencement.
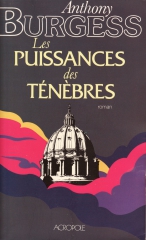 Kenneth M. Toomey, qui est donc le narrateur de cette histoire, est né en 1890 d’une mère française et d’un père britannique. Il est élevé dans la religion catholique. Jeune homme, il se découvre homosexuel. Il s’en ouvre à son confesseur, le père Frobisher SJ. Le jésuite – qui ce jour-là fumait des cigarettes Gold Flake, précise Toomey - l’invite à prier et à se détourner du mauvais chemin qu’il s’apprête à suivre. Le garçon refuse d’obéir au prêtre et met en avant le précédent de Michel-Ange, qui, bien qu’homosexuel, aura été l’une gloire de l’Eglise. De ce jour, Toomey abandonne toute pratique religieuse, mais reste imprégné de catholicisme.
Kenneth M. Toomey, qui est donc le narrateur de cette histoire, est né en 1890 d’une mère française et d’un père britannique. Il est élevé dans la religion catholique. Jeune homme, il se découvre homosexuel. Il s’en ouvre à son confesseur, le père Frobisher SJ. Le jésuite – qui ce jour-là fumait des cigarettes Gold Flake, précise Toomey - l’invite à prier et à se détourner du mauvais chemin qu’il s’apprête à suivre. Le garçon refuse d’obéir au prêtre et met en avant le précédent de Michel-Ange, qui, bien qu’homosexuel, aura été l’une gloire de l’Eglise. De ce jour, Toomey abandonne toute pratique religieuse, mais reste imprégné de catholicisme.
Il séjourne en Italie à la fin de la Grande Guerre quand il fait la connaissance d’un jeune compositeur, Dominico Campanati, et de son frère Carlo. Par la suite, Dominico épouse Constance Toomey, sœur cadette du narrateur. Quant à Carlo, qui est déjà prêtre, il deviendra archevêque de Milan, puis sera élu pape et règnera sous le nom de Grégoire XVII.
Kenneth M. Toomey se veut
un Maupassant épousseté
Les Puissances des ténèbres (Earthly Powers), d’Anthony Burgess, est un pavé qui fait plus de sept-cent pages aux caractères serrés. Il est difficile d’entrer dedans ; au bout d’une centaine de pages, le lecteur se demande même où l’auteur veut en venir tellement le livre part dans tous les sens. Puis, peu à peu, au fil des pages, le lecteur se laisse prendre par le récit, si bien qu’au bout d’un moment il ne sait plus s’il lit un roman d’Anthony Burgess, ou réellement les mémoires de Kenneth M. Toomey. Le livre est foisonnant et passionnant, faisant de Burgess un Balzac du XXème siècle.
La forme est vraiment hybride, oscillant entre fiction et récit. Dès les premières lignes du livre, le narrateur, donc Toomey, sait accrocher l’attention du lecteur et ne peut s’empêcher de souligner son habileté de romancier à entrer tout de suite dans le vif du sujet. Toomey a donc les qualités du romancier, il en a aussi les défauts. Après nous avoir raconté sa confession au père Frobisher SJ, il nous précise, dans un élan de franchise, que son récit ne doit pas être pris au pied de la lettre. Ainsi le prêtre en question ne s’appelait peut-être pas Frobisher et il ne fumait peut-être pas des cigarettes Gold Flake. Toomey ne peut se souvenir de tous les détails tant d’années après, donc il les recrée comme le ferait tout bon romancier.
Dans Les Puissances des ténèbres, l’illusion est parfaite. Toomey ne cesse de faire référence à son œuvre, citant tel ou tel de ses romans, il fait alors un bref résumé du livre et s’en excuse auprès des lecteurs qui le connaitraient déjà. Incidemment, Kenneth M. Toomey nous fait savoir qu’il est un écrivain populaire et donc décrié. Il aura vendu des millions d’exemplaires de ses romans à l’eau de rose et se veut un « Maupassant épousseté ».
A travers le personnage de Toomey, Burgess nous fait traverser le XXème siècle en y mêlant les personnes ayant réellement existé avec les personnages imaginaires. Toomey croise Keynes, rencontre Kipling qui ne se remet pas de la mort de son fils à la guerre, et assiste aux beuveries de Joyce dans le Paris des Années folles. En 1939, il essaye de sauver un écrivain juif nommé Strehler, dans l’Autriche de l’Anschluss. Mais il est arrêté par les Allemands à la déclaration de guerre en 1939. Pour obtenir sa libération, Toomey se voit proposer un chantage face auquel il cède. Il accepte d’accorder une interview de complaisance à la radio allemande. Sa petite compromission avec les Nazis le poursuivra toute sa vie, comme une tache indélébile.
Le pape explique pourquoi Dieu
a permis au mal d’exister
Si Kenneth M. Toomey est le narrateur du roman, il est indissociable de son beau-frère Carlo Campanati, futur Grégoire XVII. Toomey est la plume de l’homme d’Eglise pour un essai sur la question du mal. C’est précisément cette question du mal qui est au cœur des Puissances des ténèbres. Le lecteur doit s’accrocher pour suivre les débats entre théologiens, tels que nous les expose Toomey. Le narrateur, donc en fait Burgess, va jusqu’à publier le texte intégral d’un sermon sur le mal, donné par Mgr Carlo Campanati.
Devenu Grégoire XVII, Carlo effectue une visite aux Etats-Unis. A la télévision, il répond aux questions des spectateurs. L’un d’eux lui pose une question délicate : Dieu étant omniscient, Il devait savoir que le mal existerait, alors pourquoi l’a-t-Il permis ? Voici la réponse donnée par Grégoire XVII :
« C’est là un grand et terrible mystère. Dieu a fait à ses créatures le présent le plus immense, la chose qui se rapproche le plus de Son essence : la liberté du choix. S’Il sait à l’avance ce que vont faire Ses créatures, alors Il leur dénie la liberté. Donc, délibérément, Il efface toute préscience. Dieu pourrait savoir, s’Il le désirait ; mais par respect et par amour pour Sa créature, Il s’y refuse. Pouvez-vous imaginer cadeau plus terrible que celui-ci, Dieu Se niant Lui-même par pur amour ? »
Les théories de Grégoire XVII ne font pas l’unanimité. Certains de ses adversaires déplorent sa tendance à occulter la notion de pêché originel.
A la fin des Puissances des ténèbres, le miracle attribué au défunt pape est authentifié, et là le lecteur est pris par surprise. Le miracle a bien eu lieu, sa nature n’est pas remise en cause, et pourtant la révélation finale faite par le narrateur bouleverse le lecteur et l’amène à un questionnement qui risque de rester sans réponse.
Les Puissances des ténèbres (Earthly Powers), d’Anthony Burgess, 1980, éditions Acropole (épuisé) et collection Pavillons Poche.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XXe, XXIe siècles | Tags : les puissances des ténèbres, earthly powers, burgess, vatican | Lien permanent | Commentaires (0)
17/11/2014
Le Feu follet, de Louis Malle
Maurice Ronet séduisant, mais fragile
Le Feu follet
Maurice Ronet trouve ici le rôle de sa vie, dans ce film adapté du roman de Drieu La Rochelle. Il joue le personnage d’un ancien alcoolique qui traîne son air maladif dans les rues de Paris. Il a décidé de partir et fait une tournée d’adieu auprès de ses connaissances.
En 1957, Maurice Ronet tournait dans Ascenseur pour l’échafaud sous la direction de Louis Malle. Six ans plus tard, les deux hommes se retrouvent pour Le Feu follet, adapté du roman de Drieu La Rochelle. En apparence, les deux films sont très différents. Ascenseur pour l’échafaud est un film grand public, très rythmé, qui rappelle les films noirs américains, tandis que Le Feu follet est une œuvre lente et sèche, qui, par sa dureté, ne pouvait devenir un grand succès populaire. Et pourtant, par certains aspects, Le Feu follet donne l’impression d’être le prolongement d’Ascenseur pour l’échafaud. Le décor est le même, le Paris des années soixante ; et surtout, Maurice Ronet campe à nouveau un personnage d’homme séduisant, ancien baroudeur, et malgré tout fragile, terriblement fragile.
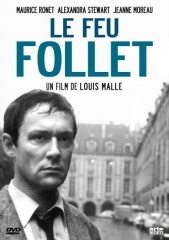 Alain Leroy, personnage interprété par Maurice Ronet, suit une cure de désintoxication dans une clinique privée, sise dans un hôtel particulier de Versailles. Au bout de trois mois, le médecin qui le soigne le juge guéri de l’alcool et lui annonce son intention de le libérer. Mais Maurice Ronet veut au contraire rester. Il déclare que s’il sort il rechutera immédiatement. Il le sait, il le sent. Quand le médecin objecte qu’il ne peut le garder indéfiniment, Maurice Ronet lui répond : « Vous serez débarrassé de moi avant la fin de la semaine. » En fait, iI garde en cachette un pistolet dans le tiroir de sa table de nuit.
Alain Leroy, personnage interprété par Maurice Ronet, suit une cure de désintoxication dans une clinique privée, sise dans un hôtel particulier de Versailles. Au bout de trois mois, le médecin qui le soigne le juge guéri de l’alcool et lui annonce son intention de le libérer. Mais Maurice Ronet veut au contraire rester. Il déclare que s’il sort il rechutera immédiatement. Il le sait, il le sent. Quand le médecin objecte qu’il ne peut le garder indéfiniment, Maurice Ronet lui répond : « Vous serez débarrassé de moi avant la fin de la semaine. » En fait, iI garde en cachette un pistolet dans le tiroir de sa table de nuit.
Maurice Ronet a décidé de partir. Il se rend à Paris faire sa tournée d’adieu. Il visite une dernière fois ses amis, ou du moins ses connaissances. Il s’aperçoit qu’un mur le sépare des autres. Dans la rue il se heurte même aux passants, comme s’il ne les voyait pas. Il semble déjà ailleurs, plongé qu’il est dans ses pensées.
C’est un blessé de la vie qui promène son air maladif dans les rues de Paris. Il a raté sa vie, du moins le croit-il. Il avait trois buts dans l’existence : les femmes, l’argent et l’action. Sur aucun de ces points il n’a trouvé satisfaction. Lui l’ancien baroudeur, héros de guerres perdues, s’ennuie dans le désœuvrement. L’alcool aura servi à combler la vacuité de son existence. Une fois désintoxiqué, il se rend compte du vide qu’il a en face de lui. Derrière le masque de fêtard se cachait une angoisse existentielle. Il voit avec dégoût l’un de ses anciens camarades engourdi dans le confort de la vie bourgeoise.
Il n’aura pas réussi non plus à faire fortune. Il l’a l’air riche, mais ne l’est pas. Il est très élégant dans son costume trois boutons avec pochette, mais il n’est pas celui qu’on croit. Il vit aux crochets d’une riche américaine pendant que son épouse se désintéresse de lui.
Sa tournée d’adieu lui aura permis de vérifier que, dans la vie, il aura toujours dépendu des autres, sans que cela n’empêche ses relations de rester superficielles. Finalement, il n’aura pas réussi à prendre sa vie en main.
La situation est sans issue.
L’acteur Maurice Ronet aura trouvé ici le rôle de sa vie. Comme le font remarquer ses biographes, contrairement à ce que l’on croit parfois, Maurice Ronet n’a pas fini ses jours en imitant le personnage du Feu follet. Il est mort d’un cancer en 1983, à l’âge de cinquante-six ans.
Le Feu follet, de Louis Malle, 1963, avec Maurice Ronet, Alexandra Stewart, Jeanne Moreau et Jacques Sereys, DVD Arte Editions.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : le feu follet, louis malle, maurice ronet, alexandra stewart, jeanne moreau, jacques sereys, ascenseur pour l’échafaud | Lien permanent | Commentaires (0)


