26/01/2015
Eve (All about Eve), de Mankiewicz
Le portrait d’une arriviste
Eve
(All about Eve)
Ce film couronné d’Oscars raconte l’ascension fulgurante d’Eve Harrington, comédienne de théâtre. En l’espace de quelques mois, la jeune femme sort de l’ombre et devient une actrice adulée du public et reconnue de la critique. Au fur et à mesure que l’intrigue progresse, Eve apparait sous son véritable visage. Dans ce film, comme à son habitude, Mankiewicz manipule le spectateur et se joue de lui.
New-York, un soir de 1949. La grande famille du théâtre est rassemblée dans les salons d’un hôtel de la ville pour assister à une cérémonie rituelle : la remise du prix Sarah-Siddons. Cette année-là, la plus haute distinction du théâtre est attribuée à Eve Harrington. Cette jeune actrice était encore inconnue il y a peu, mais en quelques mois elle a réussi à percer dans le métier. Ses prestations ont été acclamées par le public et saluées par la critique dans un élan d’unanimité. Son talent va de pair avec la modestie et la gentillesse qui la caractérisent. Entourée de ses nombreux amis, Eve Harrington reçoit son prix.
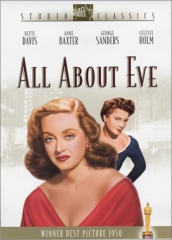 Sous forme de retour en arrière, Addison de Witt, critique de théâtre craint et respecté, et Karen Richards, scénariste et dialoguiste à succès, vont tout nous dire sur Eve. Ils se rappellent ses débuts quelques mois auparavant. La jeune femme, humble et effacée, avait débarqué à New-York et avait obtenu un entretien avec la grande actrice Margo Channing, à qui elle avait raconté sa jeunesse malheureuse. Fille d’un fermier du Wisconsin, Eve avait d’abord travaillé comme secrétaire dans une brasserie. Elle s’était mariée très jeune, mais, quelques semaines après la noce, son mari était tué à la guerre. Elle fit tout pour remonter la pente. Passionnée de théâtre, elle admire profondément Margo Channing, qu’elle rêvait de rencontrer, d’où sa venue à New-York. Margo est touchée au cœur et verse une larme en entendant le récit d’Eve. Très émue, elle décide de garder la jeune femme auprès d’elle et d’en faire son assistante.
Sous forme de retour en arrière, Addison de Witt, critique de théâtre craint et respecté, et Karen Richards, scénariste et dialoguiste à succès, vont tout nous dire sur Eve. Ils se rappellent ses débuts quelques mois auparavant. La jeune femme, humble et effacée, avait débarqué à New-York et avait obtenu un entretien avec la grande actrice Margo Channing, à qui elle avait raconté sa jeunesse malheureuse. Fille d’un fermier du Wisconsin, Eve avait d’abord travaillé comme secrétaire dans une brasserie. Elle s’était mariée très jeune, mais, quelques semaines après la noce, son mari était tué à la guerre. Elle fit tout pour remonter la pente. Passionnée de théâtre, elle admire profondément Margo Channing, qu’elle rêvait de rencontrer, d’où sa venue à New-York. Margo est touchée au cœur et verse une larme en entendant le récit d’Eve. Très émue, elle décide de garder la jeune femme auprès d’elle et d’en faire son assistante.
Auprès de Margo, Eve se montre serviable, pleine d’attention et toujours de bonne humeur. Peu à peu elle se rend indispensable. Elle s’incruste au sein de l’entourage de la comédienne, et, à force de persuasion, elle finit par obtenir un rôle de doublure.
En réalité, aucun acte n’est gratuit chez Eve. Tout obéit à un calcul. Ses offres de service sont intéressées. Tout est dirigé vers un unique but : monter sur les planches pour y briller et, ensuite, supplanter Margo. Eve est une dissimulatrice qui cache bien son jeu et trompe son monde. Ces grands intellectuels qui écrivent pour Margo et qui forment son entourage, ne voient pas clair dans le jeu d’Eve. Ils croient voir une jeune fille humble là où il n’y a qu’une arriviste. Ces êtres réputés supérieurement intelligents se font berner par la jeune femme.
Dans ce film, les apparences
sont trompeuses
Le spectateur, lui aussi, se laisse berner. Mankiewicz le manipule et se joue de lui. A la fin du film, le cinéaste boucle la boucle en revenant à la scène d’ouverture, à savoir la remise du prix Sarah-Siddons à Eve Harrington, et là, la scène d’ouverture prend une tout autre signification.
Dans ce film, les apparences sont trompeuses. Il faut enlever son masque à Eve pour connaitre son vrai visage. Quand les lumières sont braquées sur elle, elle se montre mielleuse ; mais, par derrière, tous les moyens lui sont bons pour arriver à ses fins. A l’opposé, Margot paraît remplie de défauts, elle est colérique et centrée sur elle-même. En réalité, elle est trop sensible et trop franche pour se montrer capable du moindre calcul. Margo est passionnée de théâtre, elle ne s’épanouit que sur les planches, tandis qu’Eve n’utilise la scène que pour briller. C’est une arriviste qui court après la célébrité.
Ann Baxter est pleine de fraicheur dans le rôle d’Eve. Bette Davis joue Margo Channing, grande comédienne qui a dépassé la quarantaine, mais qui prétend encore jouer les jeunes femmes de vingt-six ans. George Sanders, dans le rôle du critique Addison de Witt, publie un article cinglant à ce sujet. Opposant Eve à Margo, il reproche à cette dernière de persister à incarner les jeunes filles. Mais la critique est injuste. A-t-on jamais reproché à Sarah Bernhardt de créer le rôle de l’Aiglon, tout juste âgé de dix-huit ans, alors qu’elle-même avait cinquante ans passés.
Le film a un côté théâtre – c’est le cas de le dire – qui est propre à l’œuvre de Mankiewicz. L’ensemble est volontairement statique et les dialogues sont littéraires, les acteurs ne changeant pas un mot au texte écrit par Mankiewicz. Le son est très clair, si bien qu’il est préférable de voir le film en version originale pour bien profiter du jeu des acteurs et du timbre de voix, si particulier, de George Sanders.
Eve fut couvert d’Oscars, il fut couronné meilleur film de l’année 1949, et Mankiewicz gagna l’Oscar du meilleur réalisateur, récompense qu’il avait déjà obtenue l’année précédente pour son film Chaînes conjugales (A letter to three wives). Et la réalité finit par rejoindre la fiction quand, quelques années plus tard, le prix Sarah-Siddons fut effectivement créé. Bette Davis compta parmi ses lauréats.
Eve (All about Eve), de Joseph L. Mankiewicz, 1949, avec Ann Baxter, Bette Davis, Georges Sanders et Marylin Monroe, DVD 20th Century Fox.
07:30 Publié dans Etude de moeurs, Film | Tags : eve, all about eve, mankiewicz, ann baxter, bette davis, georges sanders, marylin monroe | Lien permanent | Commentaires (0)
19/01/2015
La Mort est mon métier, de Robert Merle
Mémoires du commandant d’Auschwitz
La Mort est mon métier
Sous forme de fiction, Robert Merle livre ce qu’auraient pu être les souvenirs du commandant du camp d’Auschwitz. Rebaptisé Rudolf Lang, l’officier SS raconte comment il a procédé à l’extermination des juifs. Véritable industriel de la mort, il n’a été confronté à aucun cas de conscience. La Mort est mon métier aide à comprendre l’incompréhensible.
Ce livre est de caractère hybride. C’est à la fois un roman et un document. Robert Merle s’est inspiré de l’entretien qu’eut, en 1945, un psychologue américain avec Rudolf Hœss, commandant du camp d’Auschwitz. A partir d’un compte-rendu, l’auteur a accompli un travail d’imagination pour se mettre dans la peau de l’officier SS et rédiger ce qu’auraient pu être ses mémoires. Mais, parce qu’il s’agit malgré tout d’une œuvre de fiction, Robert Merle a changé certains noms et a rebaptisé Rudolf Hœss en Rudolf Lang. Et c’est donc Rudolf Lang qui est le narrateur de sa propre histoire. Dans ce roman, Robert Merle fait œuvre d’historien en ce sens qu’il nous fait comprendre comment le crime a été rendu possible.
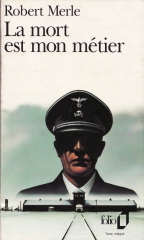 Dans sa préface, Robert Merle met tout de suite les choses au clair : il serait trop facile de dire qu’à Auschwitz c’est le démon qui fut à la manœuvre et de s’en tenir à cette seule explication. Merle poursuit : « Qu’on ne s’y trompe pas : Rudolf Lang n’était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l’échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. » Et c’est cet équipement psychique que Robert Merle démonte au fil du livre.
Dans sa préface, Robert Merle met tout de suite les choses au clair : il serait trop facile de dire qu’à Auschwitz c’est le démon qui fut à la manœuvre et de s’en tenir à cette seule explication. Merle poursuit : « Qu’on ne s’y trompe pas : Rudolf Lang n’était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l’échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. » Et c’est cet équipement psychique que Robert Merle démonte au fil du livre.
La première moitié du roman est entièrement consacrée aux jeunes années de Rudolf Lang, de 1913 à 1934. Le petit Rudolf est né dans une famille catholique. Son père lui inculque l’esprit d’obéissance et la crainte du péché. A l’âge de treize ans, il perd la foi. En 1916, à seize ans, il rencontre un jeune lieutenant de cavalerie qui l’hypnotise en lui faisant cette révélation : « Il n’y a qu’un péché, Rudolf, écoute-moi bien. C’est de ne pas être un bon Allemand. Voilà le péché ! »
Le garçon s’enfuit de chez lui et s’engage dans l’armée. Sa bravoure et son esprit d’obéissance font merveille. Il sert en Asie mineure. Son allié turc liquide un village arabe. Tout étonné, Rudolf objecte : « Mais ce village était innocent ! » Le Turc rétorque : « Il n’y a pas de place en Turquie pour les Arabes et les Turcs. […] Si tu es piqué par une puce, est-ce que tu ne les tues pas toutes ? »
Sous la République de Weimar, Rudolf Lang travaille dans l’industrie. C’est un ouvrier consciencieux qui obéit aux ordres, qui fait son devoir sans rechigner, et surtout qui tient la cadence. Il se met même, dit-il, « à travailler aveuglément, parfaitement, comme une machine. » Il adhère au parti nazi. Il s’y épanouit pleinement : « J’éprouvais un profond sentiment de paix. J’avais trouvé ma route. Elle s’étendait devant moi, droite et claire. Le devoir, à chaque minute de ma vie, m’attendait. »
Lang ne parle pas de juifs,
mais d’unités à traiter
Rudolf Lang est repéré par le Reichsführer Himmler qui fait de lui un officier de la SS. Lang est tout dévoué à son chef : « On n’avait plus de cas de conscience à se poser. Il suffisait d’être fidèle, c’est-à-dire d’obéir. Notre devoir, notre unique devoir était d’obéir. » Il est devenu un être sans conscience, complètement déshumanisé, qui s’en remet entièrement à Himmler. Quand le Reichsführer le charge, en tant que commandant d’Auschwitz, de procéder à l’extermination des juifs, Lang soulève des objections. Oh, ce n’est pas de liquider des juifs qui le tracasse, d’ailleurs Lang ne parle pas de juifs ni d’êtres humains, mais d’unités à traiter ; ce qui le préoccupe, c’est de ne pas atteindre le rendement fixé. Il estime l’objectif chiffré trop élevé et s’en ouvre à ses supérieurs : « Si je me base sur le chiffre global de 500 000 unités pour les six premiers mois, j’aboutis à une moyenne de 84 000 unités environ par mois, soit environ 2 800 unités à soumettre par vingt-quatre heures au traitement spécial. C’est un chiffre énorme. »
Mais, parce qu’il est un soldat obéissant et dévoué à ses chefs, Rudolf Lang se démène pour atteindre l’objectif fixé. C’est un subordonné froid et zélé, qui s’acquitte de sa tâche sans être confronté au moindre cas de conscience. Il travaille beaucoup. Il part le matin à sept heures et rentre à la maison vers dix, onze heures du soir. Il fait preuve d’une réelle efficacité pour se montrer digne de la confiance qu’Himmler a placée en lui. Rudolf Lang est un industriel de la mort.
La Mort est mon métier peut laisser une impression de malaise. Des esprits bien-pensants déploreront que ce livre ne laisse entrevoir aucune lueur d’espoir. Mais y en avait-t-il à Auschwitz ? La Mort est mon métier aide à comprendre l’incompréhensible. Publié quelques années après la guerre, en 1951, il illustre ce qu’Hannah Arendt allait appeler la banalité du mal.
La Mort est mon métier, de Robert Merle, 1952, avec une préface de l’auteur, 1972, collection Folio.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la mort est mon métier, robert merle | Lien permanent | Commentaires (0)
12/01/2015
Le Deuxième Souffle, de Jean-Pierre Melville
Archétype du film de gangsters signé Melville
Le Deuxième Souffle
Lino Ventura joue le personnage de Gu, un gangster sur le retour. Il s’associe à des truands qui préparent l’attaque d’un fourgon de la Banque de France, et prévoit d’abattre de sang-froid les deux motards d’escorte. Le Deuxième Souffle représente l’archétype du film de gangsters tel que le conçoit Melville. Le temps s’écoule lentement, l’image est froide, mais le spectateur finit par s’attacher aux personnages.
De film en film, Jean-Pierre Melville a su créer un style qui lui soit propre. Certes il a emprunté des éléments aux films noirs américains, mais s’est bien gardé de réaliser de simples pastiches. Il a réussi à construire une œuvre originale, qui, depuis, a inspiré d’autres cinéastes, notamment américains, dans une espèce de mouvement d’aller et retour de part et d’autre de l’Atlantique.
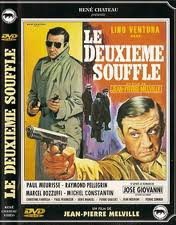 Le Deuxième Souffle est bâti autour du personnage de Gu, truand sur le retour qui s’évade de prison. Dans sa cavale, il entre en contact avec les membres d’un gang qui cherchent un homme sûr et loyal pour les aider à monter un coup. Ils ont pour objectif d’intercepter et de dévaliser un fourgon de la Banque de France. Ils cooptent Gu, qui, fort de son expérience, doit tenir un rôle essentiel à la réussite du coup. Gu sera donc de la partie, mais, comme il est fatigué et a déjà beaucoup donné, il décide que cette participation sera la dernière avant son retrait définitif.
Le Deuxième Souffle est bâti autour du personnage de Gu, truand sur le retour qui s’évade de prison. Dans sa cavale, il entre en contact avec les membres d’un gang qui cherchent un homme sûr et loyal pour les aider à monter un coup. Ils ont pour objectif d’intercepter et de dévaliser un fourgon de la Banque de France. Ils cooptent Gu, qui, fort de son expérience, doit tenir un rôle essentiel à la réussite du coup. Gu sera donc de la partie, mais, comme il est fatigué et a déjà beaucoup donné, il décide que cette participation sera la dernière avant son retrait définitif.
Le Deuxième Souffle représente l’archétype du film de gangsters signé Melville. Dès les premières images, une atmosphère lugubre s’installe : c’est l’hiver, il fait froid, la nuit est tombée, il n’y a pas un bruit, de hauts murs apparaissent, Gu est en train de s’évader. Dans le film, les gangsters sont habillés en gangsters, avec gabardines et chapeaux mous, et ils roulent dans de grosses américaines. On pourrait se croire en Amérique ; ainsi l’attaque du fourgon sur une petite route déserte à flanc de colline, rappelle les attaques de diligence dans le Far-West. Mais l’action se situe bien en France, en Provence pour l’essentiel. Ici, ce n’est pas la Provence de Pagnol et de Raimu qui est montrée, il fait froid dans les rues de Marseille et aucun personnage ne parle avec l’accent du Midi.
Les truands ont une morale très particulière. Lorsqu’ils attaquent le fourgon bancaire, ils abattent de sang-froid les deux motards d’escorte. Cela n’amuse nullement Gu d’agir ainsi, mais il dit ne pas pouvoir faire autrement. En revanche, il ne transige pas avec le code d’honneur du milieu et refuse, après son arrestation, de livrer le nom de ses complices. On en arrive même à une bizarrerie quand Gu décide de liquider le haut-fonctionnaire qui a donné le « tuyau » sur le fourgon, car, précise Gu, quelqu’un qui vend ses hommes et les envoie à la mort, n’est pas digne de confiance.
Le spectateur est en proie
à un sentiment ambivalent
Au moment crucial du film, Melville fait monter la tension ; il dilate le temps à son maximum dans la scène qui précède l’attaque du fourgon. Les minutes s’écoulent lentement et, pendant ce temps, le spectateur est en proie à un sentiment ambivalent. D’un côté il est mal à l’aise en pensant aux deux motards d’escorte qui vont mourir, et de l’autre il souhaite la réussite du coup, car il a fini par s’attacher et s’identifier au personnage du Gu.
Lino Ventura incarne Gu. Avec son pardessus, son chapeau, sa moustache et ses lunettes, il annonce le personnage qu’il jouera trois ans plus tard dans L’Armée des ombres du même Melville. Dans Le Deuxième Souffle, il est une silhouette, presqu’un spectre. On retrouve ici un thème récurrent dans l’œuvre de Melville : l’homme condamné d’avance, qui ne peut échapper à son implacable destin.
Le film oppose deux policiers aux styles et aux méthodes opposés. Paul Meurisse joue un commissaire qui se comporte en gentleman avec les gangsters et leurs maîtresses ; il est digne de respect, tandis que Paul Frankeur incarne un policier aux méthodes plus directes et plus brutales. Là aussi, une forme de morale très particulière finira par triompher.
Le film est long, il dure plus de deux heures, il est lent, et l’image en noir et blanc est froide. Certains spectateurs préfèreront « un bon vieux Jean Gabin » dialogué par Audiard, dans lequel les répliques fusent, si bien qu’on ne risque pas de s’ennuyer. Ici, il n’y a pas de bons mots, pas de dialogues inutiles, les personnages ne parlent que quand ils ont quelque chose à dire. Il n’y a pas de lourdeur non plus. Le Deuxième Souffle peut déstabiliser le jeune spectateur qui serait dopé au rythme trépidant des réalisations contemporaines. Mais, s’il se montre patient, il finira par s’attacher aux personnages et découvrira peu à peu des qualités insoupçonnées à l’œuvre de Melville.
Le Deuxième Souffle, de Jean-Pierre Melville, 1966, avec Lino Ventura, Paul Meurisse, Raymond Pellegrin, Christine Fabrega, Paul Frankeur, Michel Constantin et Marcel Bozzuffi, DVD René Château Vidéo.
07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense | Tags : le deuxième souffle, jean-pierre melville, lino ventura, paul meurisse, raymond pellegrin, christine fabrega, paul frankeur, michel constantin, marcel bozzuffi | Lien permanent | Commentaires (0)


