10/11/2014
Jules Ferry, la liberté et la tradition, de Mona Ozouf
L’un des pères de l’identité française
Jules Ferry,
la liberté et la tradition
En 2012, François Hollande a placé son quinquennat sous la bannière de Jules Ferry père de l’école publique, tout en renvoyant dans les ténèbres Ferry le colonisateur. Piquée au vif, l’historienne Mona Ozouf veut rétablir Jules Ferry dans son unité en montrant la cohérence de sa pensée. De nombreuses réformes qu’il a mises en place ont traversé le temps et nous paraissent aujourd’hui naturelles.
Ce livre n’est pas une biographie de Jules Ferry, mais un court essai cherchant à cerner l’homme et ses idées. Mona Ozouf considère que l’exemple de Ferry peut, de nos jours, éclairer le débat qui a lieu, au sein de la société française, sur l’identité nationale. L’auteur estime que Ferry fut un artisan de cette identité. Il est l’auteur de nombreuses réformes qui ont traversé le temps et qui aujourd’hui nous paraissent naturelles. Il est bien sûr le père de l’école publique, mais, en tant que président du Conseil, il fut aussi à l’origine de la loi sur la liberté de la presse et de la loi sur la liberté de réunion. C’est encore lui qui a fait voter la loi municipale prévoyant, non plus la nomination, mais l’élection des maires, et dotant chaque commune d’un hôtel de ville et d’une mairie. Et puis, il est aussi à l’origine de l’institution du mariage civil.
Malgré l’importance de son legs, il fut haï de son vivant. Mona Ozouf nous rappelle que Ferry eut notamment contre lui :
- la droite catholique, opposée à son école sans Dieu ;
- la gauche radicale, avec à sa tête Clemenceau ;
- le peuple de Paris, qui se souvenait qu’il avait été maire de la ville sous la Commune ;
- et de nombreux patriotes qui l’accusaient de sacrifier les provinces perdues au profit de sa politique coloniale.
Pour couronner le tout, Ferry ne pouvait se glorifier d’actions héroïques, à la manière de Gambetta qui avait organisé la défense héroïque de 1870 contre l’envahisseur prussien.
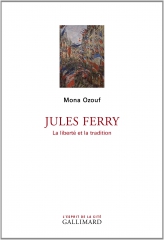 De nos jours, Jules Ferry a trouvé une certaine popularité, mais il existe une fâcheuse tendance à vouloir le couper en deux. Ainsi, n’hésite-t-on pas à opposer le bon Ferry, père de l’école publique, au mauvais Ferry, dont l’action extérieure a eu pour résultat de soumettre des peuples lointains qui n’avaient rien demandé à personne. Même François Hollande, quand il a placé son quinquennat sous sa bannière après son élection en 2012, a cru nécessaire de renvoyer aux ténèbres son action coloniale, comme si la politique de Ferry ne formait pas un tout cohérent. Et pourtant, ainsi que le montre Mona Ozouf, Ferry avait beaucoup réfléchi et avait mûri ses projets politiques.
De nos jours, Jules Ferry a trouvé une certaine popularité, mais il existe une fâcheuse tendance à vouloir le couper en deux. Ainsi, n’hésite-t-on pas à opposer le bon Ferry, père de l’école publique, au mauvais Ferry, dont l’action extérieure a eu pour résultat de soumettre des peuples lointains qui n’avaient rien demandé à personne. Même François Hollande, quand il a placé son quinquennat sous sa bannière après son élection en 2012, a cru nécessaire de renvoyer aux ténèbres son action coloniale, comme si la politique de Ferry ne formait pas un tout cohérent. Et pourtant, ainsi que le montre Mona Ozouf, Ferry avait beaucoup réfléchi et avait mûri ses projets politiques.
Un héritier respectueux de la tradition,
qui ne croit pas en la politique de la table rase
Jules Ferry, bien qu’épris de liberté, est un héritier respectueux de la tradition. Il ne croit ni en la politique de la table rase, ni en l’avènement d’un homme nouveau. Jules Ferry est un homme enraciné dans sa Lorraine natale. Il a souvent parcouru sa province à pied, muni d’un carnet de croquis, à la recherche d’un cloître ou d’une ruine. Il est respectueux des saisons et sait qu’il faut faire preuve de patience avant de récolter le fruit de sa semence. Il est admiratif des paysans… et des prêtres, qui, dans leur majorité, sont « des fils de la charrue et des sillons ». Enfant, Jules Ferry « avait même fait une si bonne première communion », soupirait l’abbé Voizelat, qui s’était occupé de lui ; mais, devenu jeune homme, il s’était détaché de la religion. Cependant il continuait de considérer la France comme un pays dont le catholicisme fait partie des racines. Devenu président du Conseil, il se montre hostile à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et reste favorable au concordat… qui permet au gouvernement de nommer les évêques.
D’une manière générale, Ferry se montre hostile aux changements radicaux. Il fait partie du groupe dit des Opportunistes, qui pratique une politique de petits pas pour installer progressivement la République et y rallier la majorité de la population, notamment la bourgeoisie et les catholiques, qu’il ne veut pas effrayer.
Mona Ozouf ne manque pas de passer au crible la très contestée politique coloniale de Jules Ferry. Son grand adversaire Clemenceau railla son discours dans lequel il faisait valoir le droit des races supérieures de civiliser les races inférieures. Mona Ozouf remet les choses dans leur contexte et rappelle que le mot « race » était d’usage courant à l’époque. Dans l’esprit de Ferry, la colonisation n’a pas pour but d’asservir les faibles, mais de leur apporter la justice et les lumières. Sur ce dossier, le défenseur de la tradition et de l’enracinement est même logique avec lui-même. Quand, en 1881, il doit fixer le statut de la Tunisie, il ne la transforme pas en départements français, ainsi que l’avaient fait ses prédécesseurs pour l’Algérie ; il choisit le protectorat. Grâce à Ferry, la Tunisie gardera une large autonomie administrative, ainsi que ses traditions.
Ferry, natif de Saint-Dié, n’oublie pas
les provinces perdues
De nombreux patriotes, dont Clemenceau, déploraient que la politique coloniale de la France fût encouragée par Bismarck, afin de détourner son attention des provinces perdues. Pourtant, Ferry, natif de Saint-Dié, n’oublie pas l’Alsace-Lorraine. Mais il veut d’abord refaire la France et lui redonner toute sa puissance en la dotant d’un empire colonial.
Pour refaire la France, l’instruction doit occuper une place primordiale. Par l’enseignement qu’ils reçoivent, les enfants doivent apprendre à connaitre la France ; d’où les cartes de géographie qui font leur apparition sur les murs des salles de classe. Ferry n’oublie pas les jeunes filles, à qui il ouvre les portes des écoles. Il les envoie au chef-lieu de canton passer le même certificat d’études que les garçons.
Il encourage la lecture chez l’enfant. Ses adversaires s’inquiètent alors des ravages moraux que pourrait provoquer un accès généralisé aux livres. Ferry leur répond que le contenu du livre importe peu, puisque l’acte de lire est en lui-même émancipateur. Pour cette raison, il ne rechigne pas à ce que des filles apprennent à lire dans L’Imitation de Jésus-Christ.
Mona Ozouf parvient à rendre toute sa cohérence à la pensée et à la politique de Ferry. Il fut ce pendant la proie de quelques contradictions. Ainsi, d’un côté, il voulut débarrasser l’enseignement du discours latin afin de faire plus de place à l’enseignement des sciences, de façon à ce que la France soit une grande puissance industrielle. Mais, d’un autre côté, l’homme enraciné qu’il était, restait attaché au latin et craignait qu’il n’y ait quelques dangers à se couper de la tradition des humanités.
Jules Ferry, la liberté et la tradition, de Mona Ozouf, 2014, éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : jules ferry, la liberté et la tradition, mona ozouf | Lien permanent | Commentaires (0)
03/11/2014
Le Juge et l'assassin, de Tavernier
Noiret fait passer Galabru aux aveux
Le Juge et l’assassin
Le film de Tavernier se passe en pleine affaire Dreyfus. Dans une petite ville de province, le juge Rousseau, brillamment interprété par Philippe Noiret, enquête sur une série de crimes horribles. Il croit tenir l’assassin en la personne de Bouvier, un chemineau joué par Michel Galabru. Le juge va utiliser des méthodes très personnelles pour atteindre la vérité.
Sorti en 1976, Le Juge et l’assassin est le troisième film réalisé par Bertrand Tavernier. Tavernier a coutume de dire que dans ses films il montre des gens dans leur travail au quotidien, qu’ils soient policiers, professeurs ou ministres. Dans Le Juge et l’assassin, le spectateur suit un juge dans l’instruction d’une affaire criminelle.
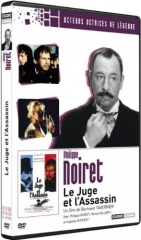 L’action démarre en 1895, dans le contexte de l’affaire Dreyfus et des tensions croissantes entre cléricaux et anticléricaux. Le juge Rousseau est en poste dans une petite ville de province du sud de la France. Confronté à une série de meurtres dont des jeunes filles et des enfants sont les victimes, il progresse très vite dans son travail d’enquête. Il suspecte un dénommé Bouvier, un chemineau qui s’est toujours trouvé à proximité du lieu du crime au moment où il était commis.
L’action démarre en 1895, dans le contexte de l’affaire Dreyfus et des tensions croissantes entre cléricaux et anticléricaux. Le juge Rousseau est en poste dans une petite ville de province du sud de la France. Confronté à une série de meurtres dont des jeunes filles et des enfants sont les victimes, il progresse très vite dans son travail d’enquête. Il suspecte un dénommé Bouvier, un chemineau qui s’est toujours trouvé à proximité du lieu du crime au moment où il était commis.
Même si les apparences sont contre Bouvier et même si de lourdes présomptions pèsent sur lui, cela ne suffit pas au juge Rousseau. Il veut des éléments matériels et des aveux circonstanciés, afin que son travail soit complet et ne souffre nulle contestation. A priori le juge est une âme pure qui se met au service de la vérité, sauf qu’il va utiliser des méthodes très personnelles. Il se met à l’écoute de Bouvier, passe beaucoup de temps avec lui et se montre très compréhensif à son égard. Il lui promet que, s’il collabore, il sera déclaré fou et échappera à l’échafaud. En réalité, il ne s’agit là que d’une manœuvre destinée à obtenir des aveux. Car, au même moment, Rousseau déclare à d’autres qu’il est persuadé que Bouvier est sain d’esprit. Très moderne dans ses méthodes, il n’hésite pas à médiatiser l’affaire et à utiliser la presse. Le juge n’est pas regardant sur la nature des moyens quand il s’agit d’atteindre la vérité.
Le juge Rousseau est brillamment interprété par Philippe Noiret, l’assassin par Michel Galabru. Quant à Jean-Claude Brialy, il incarne un ancien magistrat, M. de Villedieu, qui donne au juge sa vision de l’affaire : qu’importe que Bouvier soit coupable ou innocent, puisqu’il appartient au vagabondage, c'est-à-dire au désordre et à l’anarchie. Villedieu fait sien le propos d’Octave Mirbeau qui a dit : « Nous sommes tous des meurtriers en puissance et ce besoin de meurtre, nous le concilions par des moyens légaux : l’industrie, le commerce colonial, la guerre, l’antisémitisme. »
A la fin du film, le spectateur découvrira qu’il arrive au juge d’avoir un comportement guère éloigné de celui de l’assassin.
La reconstitution de la France de 1895 est réussie. Le décor nous fait plonger en pleine affaire Dreyfus ; ainsi, au début et à la fin du film, la caméra nous montre, accolé à un mur, un placard publicitaire qui proclame : « Lisez La Croix, le journal le plus antisémite de France. » Des chants patriotiques sont entonnés dans des salons bourgeois, tandis que la rue fait entendre des chansons ouvrières. Jean-Roger Caussimon interprète une ballade spécialement écrite sur l’affaire Bouvier.
Malgré le côté scabreux des crimes, le Juge et l’assassin est un film agréable à regarder. Le film est long : un peu plus de deux heures, comme souvent chez Tavernier.
Le Juge et l’assassin, de Bertrand Tavernier, 1976, avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy et Isabelle Hupert, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : le juge et l'assassin, tavernier, galabru, jean-claude brialy, caussimon, noiret | Lien permanent | Commentaires (0)
20/10/2014
Le Père Goriot, de Balzac
Derrière toute grande fortune se cache un crime
Le Père Goriot
Le jeune Eugène de Rastignac monte à Paris et prend une chambre dans une pension de famille. Il y rencontre le père Goriot, un homme très riche qui vit pourtant misérablement. Après enquête, Rastignac découvrira le secret du vieillard. Dans ce roman, Balzac nous démontre, preuve à l’appui, que le travail ne paie pas, la plupart des gens fortunés étant des héritiers. Le livre prend une dimension supplémentaire de nos jours, alors que la société actuelle s’interroge sur la fin de vie. A travers l’exemple de l’agonie de Goriot, Balzac nous renseigne sur la frontière entre la vie et la mort.
Le Père Goriot suscite actuellement un regain d’intérêt depuis que l’économiste Thomas Piketty y fait référence dans son livre Le Capital au XXIème siècle, best-seller en France et aux Etats-Unis.
Ce n’est pas le roman de Balzac le plus difficile d’accès, mais ce n’est pas pour autant le plus facile. Le livre est d’une longueur raisonnable, mais le texte n’est pas aéré, il ne bénéficie pas de divisions en chapitres et certains paragraphes font plus d’une page. Le lecteur se doit d’être attentif aux trente premières pages environ, qui sont des pages d’exposition au cours desquelles Balzac présente les personnages un à un. Si le lecteur sait être patient, alors il sera largement récompensé en entrant peu à peu dans une histoire dont il voudra savoir le dénouement.
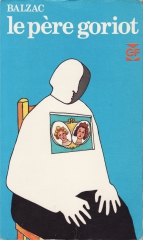 « All is true » nous dit, en anglais dans le texte, Balzac dans son ouverture du Père Goriot. Il précise que son livre n’est ni un roman ni une fiction. Le héros en est Eugène de Rastignac. C’est un garçon de vingt-et-un ans qui a quitté son Angoulême natale pour monter à Paris y suivre des études de droit. C’est encore un cœur pur plein d’illusions sur la vie. Il trouve pension à la Maison-Vauquer, tenue par madame Vauquer (prononcez Vauquère). Les pensionnaires sont des gens de condition modeste qui ne font pas de folie et se révèlent, dans l’ensemble, assez médiocres. Par exemple, ils pratiquent un humour à deux sous. Ainsi, en 1819, date à laquelle se déroule l’histoire, le diorama est une invention toute récente qui fait parler d’elle, si bien, que, pour plaisanter, les pensionnaires de la maison ont pris l’habitude de décliner les mots qu’ils utilisent dans la conversation, en leur ajoutant la terminaison rama. Ainsi, au cours du dînerama l’un des convives évoque sa santérama. Cet usage donne lieu à une discussion très savante pour savoir s’il faut dire froidorama, le mot froid se terminant par la lettre d, ou plutôt froitorama, suivant la règle qui veut que l’on dise : « J’ai froit aux pieds. »
« All is true » nous dit, en anglais dans le texte, Balzac dans son ouverture du Père Goriot. Il précise que son livre n’est ni un roman ni une fiction. Le héros en est Eugène de Rastignac. C’est un garçon de vingt-et-un ans qui a quitté son Angoulême natale pour monter à Paris y suivre des études de droit. C’est encore un cœur pur plein d’illusions sur la vie. Il trouve pension à la Maison-Vauquer, tenue par madame Vauquer (prononcez Vauquère). Les pensionnaires sont des gens de condition modeste qui ne font pas de folie et se révèlent, dans l’ensemble, assez médiocres. Par exemple, ils pratiquent un humour à deux sous. Ainsi, en 1819, date à laquelle se déroule l’histoire, le diorama est une invention toute récente qui fait parler d’elle, si bien, que, pour plaisanter, les pensionnaires de la maison ont pris l’habitude de décliner les mots qu’ils utilisent dans la conversation, en leur ajoutant la terminaison rama. Ainsi, au cours du dînerama l’un des convives évoque sa santérama. Cet usage donne lieu à une discussion très savante pour savoir s’il faut dire froidorama, le mot froid se terminant par la lettre d, ou plutôt froitorama, suivant la règle qui veut que l’on dise : « J’ai froit aux pieds. »
Pendant les repas pris en commun, les pensionnaires font de l’un des leurs leur souffre-douleur : monsieur Goriot, le doyen de la maison, est l’objet de leurs moqueries. Goriot, que l’on appelle sans égard le père Goriot, est un être bien mystérieux. Rastignac apprend que c’est un ancien négociant qui a fait fortune dans la farine. Dans ce cas, comment expliquer qu’un homme qui a gagné beaucoup d’argent mène une vie aussi modeste dans un tel endroit ? La vérité est simple à comprendre, Goriot n’a qu’une seule passion dans la vie, ses deux filles. Il a réussi à conclure pour elles des mariages « heureux » : l’aînée est devenue comtesse de Restaud et la cadette, baronne de Nucingen. Mais, peu de temps après leurs mariages, ses filles et ses gendres eurent honte de lui. Comprenant la situation nouvelle et refusant de constituer une gêne pour ses enfants, le vieux Goriot accepta de se sacrifier et de se retirer en toute discrétion dans la modeste pension qu’est la Maison-Vauquer.
Goriot aime ses filles
comme un amant aime
passionnément sa maîtresse
Rastignac se prend de curiosité pour la personne de Goriot. Il se lie avec lui. Goriot le pousse à devenir l’amant de la baronne de Nucingen, espérant ainsi, par son intermédiaire, se rapprocher de sa fille cadette. Peu à peu, Rastignac découvre la personnalité de Goriot : le vieil homme aime ses filles au point de s’oublier lui-même, il les aime comme un amant peut passionnément aimer sa maîtresse, au-delà de toute raison. Goriot a gâté ses filles et a abîmé leur caractère. Aux yeux des deux sœurs, leur père n’a d’existence que par rapport à elles. Toutes deux se montrent bien ingrates avec lui.
Rastignac, qui cherche encore sa voie, comprend que le comportement de Goriot, qui s’est donné à ses filles, conduit à une impasse. Un autre pensionnaire lui montre un tout autre exemple. Cet autre pensionnaire, c’est monsieur Vautrin. Vautrin est le négatif de Goriot. Autant Goriot est un être effacé, morose, qui dégage une impression de tristesse, autant Vautrin est une forte personnalité, c’est un être truculent, jouisseur, qui respire la joie de vivre. Il est souvent de bonne humeur, trouve le mot pour rire, et sait parler aux dames (en dépit de ses inclinations.) Il connaît la réalité de la vie et, en face de Rastignac, il met les points sur les i. Pour avoir un train de vie conforme à son goût, Rastignac a besoin d’une fortune d’un million par an, or jamais l’étudiant en droit n’arrivera à accumuler une telle somme par le produit de son travail, même après une brillante carrière dans la magistrature. Vautrin, qui entend se transformer en grand marionnettiste, dit crûment à Rastignac à quoi pourrait ressembler son parcours professionnel : « Il faudra […] commencer […] par devenir le substitut de quelque drôle, dans un trou de ville où le gouvernement vous jettera quelques milles francs d’appointements, comme on jette une soupe à un dogue de boucher. […] Si vous n’avez pas de protection, vous pourrirez dans votre tribunal de province. Vers trente ans, vous serez juge à douze cents francs par an, si vous n’avez pas encore jeté la robe aux orties. Quand vous aurez atteint la quarantaine, vous épouserez quelque fille de meunier, riche d’environ six mille livres de rente. Ayez des protections, vous serez procureur du roi à trente ans, avec mille écus d’appointements, et vous épouserez la fille du maire. Si vous faites quelques-unes de ces petites bassesses politiques, […] vous serez à quarante ans procureur général, et vous pourrez devenir député. […] J’ai l’honneur de vous faire observer de plus qu’il n’y a que vingt procureurs généraux en France, et que vous êtes mille aspirants à ce grade, parmi lesquels il se trouve des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d’un cran. […] Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce moment cinquante mille jeunes gens qui se trouvent dans votre position. » Bref, explique Vautrin, le travail ne paie pas. Après tout, si les filles Goriot sont si riches, elles, c’est parce qu’elles sont des héritières.
Vautrin, dont le lecteur ne tardera pas à connaître la véritable identité, connaît le moyen de faire rapidement fortune et veut l’enseigner à Rastignac. Il se transforme en mauvais génie en lui proposant un chemin bien singulier. Vautrin conclue son propos ainsi : « Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu’il a été proprement fait. »
Par la bouche de Vautrin, c’est bien sûr Balzac qui parle. Et pour achever de convaincre le lecteur, Balzac raconte comment Goriot, un homme apparemment honnête et désintéressé, a pu gagner autant d’argent au cours de sa vie. Même la fortune de ce brave Goriot a été bâtie sur la base d’une malhonnêteté.
Le rôle primordial
du cerveau
Comme l’ensemble de l’œuvre de Balzac, Le Père Goriot est un livre très riche qui aborde de nombreux sujets. De nos jours, il prend encore une dimension nouvelle à l’heure où notre société s’interroge sur la fin de vie et les limites entre la vie et la mort. Un être humain est-il encore vivant en l’absence de toute activité cérébrale ? Balzac fournit des éléments de réponse à travers l’exemple de l’agonie de Goriot. Lorsque le vieillard est à l’article de la mort, allongé sur son lit de douleur, Rastignac le veille et obtient d'un ami étudiant en médecine, Bianchon, qu'il lui donne un coup de main. Bianchon, très curieux d’approfondir ses connaissances médicales, demande à Rastignac de surveiller l’agonie du malade et de bien noter ses déclarations : « s’il s’occupe de matérialités ou de sentiment ; s’il calcule, s’il revient sur le passé », car, poursuit Bianchon, il arrive que « le cerveau recouvre quelques unes de ses facultés, et la mort est plus lente à se déclarer ».
Tout au long de l’agonie de Goriot, Balzac se montre très attentif au rôle primordial tenu par le cerveau et parle du « combat qui se livrait entre la mort et la vie dans une machine qui n’avait plus cette espèce de conscience cérébrale d’où résulte le sentiment du plaisir et de la douleur pour l’être humain. » Un peu plus loin, quand Goriot rouvre les yeux, l’une de ses filles, présente à ses côtés, reprend espoir, mais il s’agit d’un simple geste convulsif. Le cerveau a cessé de fonctionner.
Le Père Goriot nécessiterait, à différents moments de la vie, une relecture régulière, qui seule permettrait d’en saisir toute la portée. A chaque fois, le lecteur y trouverait des éléments d’observation et de réflexion qui lui avaient échappé précédemment.
Le Père Goriot, de Balzac, 1835, collections Folio, Garnier et Le Livre de Poche.
07:30 Publié dans Economie, Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : le père goriot, rastignac, vautrin, balzac, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)


