12/10/2015
A Rebours, de Huysmans
L’homme qui avait trop tendu son cerveau
A Rebours
A Rebours est l’amorce de l’œuvre catholique de Huysmans. Dans ce roman qui ne comporte pas d’intrigue traditionnelle, l’auteur fait le portrait d’un homme, Jean des Esseintes, prisonnier d’un cerveau qui a été soumis à trop de tensions. La description clinique des névroses dont souffre le personnage principal fait de ce classique de la littérature un livre contemporain.
A Rebours peut déconcerter plus d’un lecteur. Le livre qui fit la renommée de son auteur ne comporte pas vraiment d’intrigue. Bien que contemporain de Zola, Huysman déclarait éprouver le besoin de « briser les limites du roman », il voulait « supprimer l’intrigue traditionnelle […], concentrer le pinceau de lumière sur un seul personnage, faire à tout prix du neuf. »
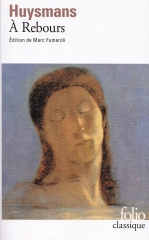 Le seul personnage d’importance du roman, c’est Jean des Esseintes. Des Esseintes est le descendant d’une famille de ducs, dont il est l’ultime rejeton. Agé de trente ans, il est prématurément vieilli par les excès de sa vie de garçon. C’est un grand nerveux qui, pendant ses jeunes années, a soumis son cerveau à des tensions exagérées. Aujourd’hui il en paie les conséquences. Selon Huysmans, « il était arrivé à une telle sensibilité de nerfs que la vue d’un objet ou d’un être déplaisant se gravait profondément dans sa cervelle, et qu’il fallait plusieurs jours pour en effacer même légèrement l’empreinte. » Pour retrouver la santé et une forme d’équilibre, il lui faut absolument se couper du monde, du moins en est-il convaincu. L’isolement lui évitera toutes ces rencontres qui produisent des images qui agressent son cerveau et s’y impriment, pour ne plus en repartir qu’avec difficulté.
Le seul personnage d’importance du roman, c’est Jean des Esseintes. Des Esseintes est le descendant d’une famille de ducs, dont il est l’ultime rejeton. Agé de trente ans, il est prématurément vieilli par les excès de sa vie de garçon. C’est un grand nerveux qui, pendant ses jeunes années, a soumis son cerveau à des tensions exagérées. Aujourd’hui il en paie les conséquences. Selon Huysmans, « il était arrivé à une telle sensibilité de nerfs que la vue d’un objet ou d’un être déplaisant se gravait profondément dans sa cervelle, et qu’il fallait plusieurs jours pour en effacer même légèrement l’empreinte. » Pour retrouver la santé et une forme d’équilibre, il lui faut absolument se couper du monde, du moins en est-il convaincu. L’isolement lui évitera toutes ces rencontres qui produisent des images qui agressent son cerveau et s’y impriment, pour ne plus en repartir qu’avec difficulté.
A la mort de sa mère, des Esseintes reprend ses deux vieux domestiques et achète une maison à Fontenay-les-Roses. Il les installe au premier étage, au-dessus de lui ; mais il prend ses précautions : il « les obligea à porter d’épais chaussons de feutre, fit placer des tambours le long des portes bien huilées et matelasser leur plancher de profonds tapis de manière à ne jamais entendre le bruit de leurs pas, au-dessus de sa tête. » Il se garde le rez-de-chaussée de la maison, et, puisqu’il cherche l’isolement, il a l’idée de façonner sa chambre en cellule monastique. Il en fait « une loge de chartreuse qui eût l’air d’être vrai et qui ne le fût, bien entendu, pas. » Des Esseintes, qui est un collectionneur d’objets religieux, pousse très loin l’illusion. Il place dans sa chambre des objets autrefois consacrés, tel un ancien baptistère qui lui sert de cuvette. Il possède de nombreux livres religieux dans sa bibliothèque, car, élevé chez les Jésuites, il est devenu féru de théologie. Cependant, c’est un grand sceptique qui persiste à « regarder la religion ainsi qu’une superbe légende, qu’une magnifique imposture. »
Des Esseintes a suivi à rebours les préceptes catholiques
Des chapitres entiers du livre sont consacrés à la description des goûts esthétiques de des Esseintes, qui sont bien sûr ceux de Huysmans. Ainsi, en matière de littérature française, Flaubert, Goncourt, Zola et surtout Baudelaire, sont ses auteurs préférés. En peinture, il aime beaucoup Gustave Moreau et Jean Luysken, artiste inconnu en France. Il apprécie chez ce dernier sa série des Persécutions religieuses ; « ces œuvres pleines d’abominables imaginations puant le brûlé, suant le sang » lui donnent la chair de poule. I
Des Esseintes a développé des goûts bien particuliers et surtout très affinés. Ainsi, en matière d’alcool, il a établi un système de classification. Selon lui, chaque liqueur correspond au son d’un instrument ; par exemple le kirsch fait penser au son de la trompette, et la menthe et l’anisette à la flûte. En fait, des Esseintes a tellement affiné ses goûts et aiguisé son cerveau qu’il s’est élevé au-dessus de ses contemporains et s’est définitivement coupé d’eux. Tout ce qui est commun lui paraît fade et les plaisirs les plus simples ne lui sont plus permis.
La lecture d’un roman de Dickens lui donne l’impression d’être noyé dans le brouillard londonien, plus fortement encore que s’il était vraiment à Londres. Son cerveau est tellement stimulé qu’un rien peut faire remonter des tas de souvenirs à la surface. Ainsi le simple fait de humer du whisky d’Irlande versé dans un gobelet lui rappelle un événement désagréable, gravé dans sa mémoire ; quand, il y a trois ans, il avait été pris d’une rage de dents et s’était dépêché chez le dentiste. Installé confortablement chez lui, son gobelet à la main, il a l’impression de revivre ces moments d’intense douleur. Ce petit fait est significatif d’une chose : des Esseintes a perdu la maîtrise de son cerveau, devenu trop puissant. A force de le soumettre à trop de tensions, il en est maintenant prisonnier et voudrait se libérer de cette possession.
En fait, c’est toute sa vie passée qui reste accrochée à son esprit. Lui revient notamment en mémoire le visage d’un garçon de seize ans qu’il avait incité à la débauche dans l’espoir de le pousser au crime. Des Esseintes a mené une vie pleine de dérèglements. Il a suivi « à rebours » les préceptes catholiques « en commettant, afin de bafouer plus gravement le Christ, les péchés qu’il a le plus expressément maudits : la pollution du culte et l’orgie charnelle. »
Des Esseintes pratique l’hydrothérapie pour soigner ses névroses
Non seulement son cerveau est gravement atteint, mais son estomac, qui en est le reflet, est complètement détraqué. Il pratique l’hydrothérapie et se décide à faire de l’exercice en passant du temps à de longues promenades, dans l’espoir de retrouver la santé. Mais, au bout d’un moment, ces moyens thérapeutiques sont devenus insuffisants. Il se rend bien compte que la médecine est impuissante et dépassée par ses dérèglements nerveux : « Si savants, si intuitifs qu’ils pussent l’être, les médecins ne connaissaient rien aux névroses, dont ils ignoraient jusqu’à l’origine. »
Pendant que son état s’aggrave, des Esseintes est gagné par un trouble que l’on pourrait qualifier de mystique. Bien qu’imprégné de christianisme, son caractère rebelle l’avait empêché, dans son enfance, d’être modelé par la discipline des Jésuites. Pourtant, parallèlement à la dégradation de son état, il se trouve, depuis quelques jours, « dans un état d’âme indescriptible. » Face à son trouble, il réagit d’abord en sceptique. Il cherche de bonnes raisons à cela, et cependant, poursuit Huysmans, en dépit de toutes ses explications, son scepticisme commençait à s’entamer. » Que se passe-t-il donc dans l’esprit de des Esseintes ?
On l’aura compris, A Rebours est un roman très curieux et original. Huysmans fait œuvre d’érudit, à en juger par l’étendue du vocabulaire qu’il utilise, ce qui peut rebuter certains lecteurs ; beaucoup de mots qu’il emploie ne sont même pas dans la plupart des dictionnaires. Au-delà, c’est surtout le dérèglement du cerveau de des Esseintes qui est saisissant. La description clinique de ses névroses et de son cerveau victime de trop de tensions contribue à faire de ce classique de la littérature un livre très contemporain.
En 1904, à l’occasion du vingtième anniversaire de la publication d’A Rebours, Huysmans écrivit une nouvelle préface dans laquelle il concluait que ce livre avait été l’amorce de son « œuvre catholique ». Huysmans s’était converti au catholicisme en 1892, soit quelques années après la publication d’A Rebours, roman qui donne l’impression de refléter sa conversion. Huysmans suscite l’étonnement en écrivant dans ladite préface : « Et ce qui complique encore la difficulté et déroute toute analyse, c’est que, lorsque j’écrivis A Rebours, je ne mettais pas les pieds dans une église, je ne connaissais aucun catholique pratiquant, aucun prêtre ; je n’éprouvais aucune touche divine ne m’incitant à me diriger vers l’Eglise. »
A Rebours, de Huysmans, 1884, collections Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XIXe siècle | Tags : a rebour, huysmans | Lien permanent | Commentaires (0)
05/10/2015
L'Ivresse du pouvoir, de Chabrol
Madame le juge raide comme la justice
L’Ivresse du pouvoir
Isabelle Hupert incarne un juge d’instruction sûr de lui-même, qui enquête sur une vaste affaire de corruption. Elle fait trembler les puissants et les envoie en prison. Chabrol s’est vaguement inspiré de l’affaire Elf sans vouloir bâtir un film à thèse. Il s’est intéressé avant tout aux personnages et à l’étude de caractères.
L’ivresse du pouvoir dont parle le film, c’est celle que ressent le juge d’instruction, « l’homme le plus puissant de France », selon le mot attribué à Napoléon. Au moment des faits qui sont évoqués ici, le juge d’instruction disposait du pouvoir exclusif d’envoyer les individus en prison.
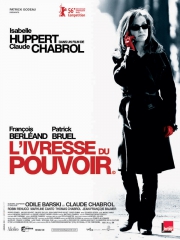 Dans L’Ivresse du pouvoir, le juge d’instruction est une femme : Jeanne Charmant-Killman (appréciez le double patronyme). Elle enquête sur un grand groupe industriel français détenteur de nombreux contrats en Afrique noire. Elle fait arrêter son président, Jean Humeau, qui est brusquement interpellé par la police à la sortie du bureau. Elle le met en examen pour abus de biens sociaux ; il aurait notamment utilisé la carte bleue de l’entreprise pour entretenir sa maîtresse. Au-delà, l’enquête fait apparaître un vaste réseau de corruption, avec versement de rétro-commissions, financement occulte de partis politiques et enrichissement personnel.
Dans L’Ivresse du pouvoir, le juge d’instruction est une femme : Jeanne Charmant-Killman (appréciez le double patronyme). Elle enquête sur un grand groupe industriel français détenteur de nombreux contrats en Afrique noire. Elle fait arrêter son président, Jean Humeau, qui est brusquement interpellé par la police à la sortie du bureau. Elle le met en examen pour abus de biens sociaux ; il aurait notamment utilisé la carte bleue de l’entreprise pour entretenir sa maîtresse. Au-delà, l’enquête fait apparaître un vaste réseau de corruption, avec versement de rétro-commissions, financement occulte de partis politiques et enrichissement personnel.
Lorsqu’en 2006 le film sortit, il fut largement dit que Chabrol s’était inspiré de l’affaire Elf Aquitaine. Effectivement, les similitudes sont troublantes. Le personnage de Jeanne Charmant-Killman rappelle Mme Eva Joly, le juge qui s’était fait connaître en instruisant l’affaire avant de se lancer en politique. Le président du groupe, Jean Humeau, a beaucoup de points communs avec M. Loïc Le Floch-Prigent, ancien président d’Elf. Tous deux sont barbus, souffrent d’eczéma, sont arrêtés en pleine rue et vivent très mal leur détention. La liste des similitudes pourrait être prolongée, et pourtant il ne faut pas se fier aux apparences.
Ce film n’est pas un film à dossier, Chabrol n’est ni Francesco Rosi ni Boisset. Il ne prétend pas éclairer les ténèbres entourant l’affaire Elf et ne défend aucune thèse. Il s’est juste inspiré de cette célèbre affaire et a brodé dessus pour bâtir une intrigue. Ce qui intéresse Chabrol, ce sont les personnages, les caractères, et le jeu de pouvoir qui s’établit entre le juge et les différents protagonistes.
Madame le juge mélange justice et morale
Les moments les plus forts du film sont constitués des scènes de confrontations – si on peut les appeler ainsi – entre le juge et les justiciables qu’elle convoque à son bureau. Face à ses interlocuteurs qui sont tous des hommes, Jeanne Charmant-Killman montre qu’elle est une femme d’autorité, habile et pleine d’esprit. Elle semble dissimuler sa hargne derrière l’ironie. Rien n’est en mesure de l’impressionner et elle n’hésite pas à déstabiliser les puissants qui sont assis de l’autre côté de son bureau. Alors que justice et morale sont en théorie deux choses complètement séparées, elle-même est visiblement lancée dans une opération « mains propres » aux allures de croisade morale ou moralisatrice. Au président Jean Humeau qui lui demande pourquoi elle l’envoie en prison, elle rétorque : « Pour faire un exemple. Ce n’est pas si terrible et ça fait du bien à la France. » Et elle ajoute, pince-sans-rire : « Vous verrez. La prison, c’est une expérience. »
D’un côté Jeanne Charmant-Killman fait trembler les puissants, mais de l’autre son jeune greffier a intérêt à garder le sens de la hiérarchie et à maintenir une certaine distance avec elle, sous peine d’être rappelé à l’ordre. Elle défend un prévenu de fumer dans son bureau, mais elle-même s’autorise à fumer en présence d’un autre prévenu.
Imbue d’elle-même et de l’autorité qu’elle représente, elle est dure avec les prévenus et les simples témoins qu’elle convoque. Elle montre quasiment la même dureté avec son mari ; lors d’une dispute, elle va jusqu’à le gifler. L’une des forces du film est de montrer Jeanne Charmant-Killman aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, ce qui permet de mieux comprendre sa personnalité. En général, au cinéma, les scènes exposant les déboires conjugaux du personnage principal ralentissent l’action et alourdissent le film. Ici, ce n’est pas le cas. Les scènes de la vie privée ne sont pas du tout plaquées et s’articulent bien avec le reste du film.
Isabelle Hupert est parfaite dans le rôle de Jeanne Charmant-Killman. On pourrait être légitimement anxieux à la perspective d’être convoqué dans le bureau de ce juge incorruptible qui n’est pas du style à s’apitoyer sur les autres. A la fin du film, Jeanne Charmant-Killman, qui pourtant ne doute jamais, se demande, malgré tout, ce qui lui manque. On serait tenté de lui répondre qu’il lui manque une bonne dose d’empathie qui lui permettrait de comprendre les autres, leurs paroles, leurs actes, leurs sentiments et leur ressentiment. En résumé, peut-être lui manque-t-il tout simplement un cœur.
L’Ivresse du pouvoir, de Claude Chabrol, 2006, avec Isabelle Hupert, François Berléand, Patrick Bruel, Robin Renucci, Marilyne Canto et Thomas Chabrol, DVD TF1 Vidéo
07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense, Société | Tags : l’ivresse du pouvoir, chabrol, isabelle hupert, françois berléand, patrick bruel, robin renucci, marilyne canto, thomas chabrol | Lien permanent | Commentaires (0)
28/09/2015
Hitchcock-Truffaut, d'Hitchcock et Truffaut
Hitchcock théoricien du cinéma
Hitchcock-Truffaut
Ce livre est constitué d’une série d’entretiens que Truffaut eut avec Hitchcock, principalement en 1966. Ce n’est pas une hagiographie, mais l’examen critique d’une œuvre. Hitchcock développe sa théorie du cinéma, explique pourquoi il a opté pour le suspense et ce qu’est le fameux Mac-Guffin.
Dans ce livre, Hitchcock, répondant aux questions de Truffaut, passe en revue les films qu’il a tournés. Il remonte à ses débuts en Angleterre, dans les années vingt, au temps du cinéma muet. En 1966, au moment où se déroulent les entretiens, il éprouve une véritable nostalgie pour le muet, qui faisait du cinéma un art cent pour cent visuel. On peut supposer que dans ses premiers films il fut influencé par Fritz Lang. Cependant, quand Truffaut lui demande quels films du cinéaste allemand il avait vus, Hitchcock ne répond pas vraiment à la question. Il reste évasif et préfère changer de sujet, comme s’il avait une gêne à parler de Fritz Lang, son aîné de quelques années, qui certainement l’a inspiré. En fait, Hitchcock préfère parler de lui, de son œuvre et de ses théories sur le cinéma.
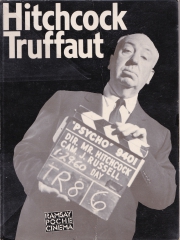 Hitchcock passe un long moment à s’expliquer sur le suspense, qui est au centre de son œuvre. Il oppose le suspense à la surprise et dit pourquoi il a préféré l’un à l’autre :
Hitchcock passe un long moment à s’expliquer sur le suspense, qui est au centre de son œuvre. Il oppose le suspense à la surprise et dit pourquoi il a préféré l’un à l’autre :
« La différence entre le suspense et la surprise est très simple et j’en parle très souvent. Pourtant, il y a fréquemment une confusion dans les films, entre ces deux notions. Nous sommes en train de parler, il y a peut-être une bombe sous cette table et notre conversation est très ordinaire, il ne se passe rien de spécial, et tout d’un coup : boum, explosion. Le public est surpris, mais, avant qu’il ne l’ait été, on lui a montré une scène absolument ordinaire, dénuée d’intérêt. Maintenant, examinons le suspense. La bombe est sous la table et le public le sait, probablement parce qu’il a vu l’anarchiste la déposer. Le public sait que la bombe explosera à une heure et il sait qu’il est une heure moins le quart – il y a une horloge dans le décor ; la même conversation devient tout à coup intéressante parce que le public participe à la scène. Il a envie de dire aux personnages qui sont sur l’écran : « Vous ne devriez pas raconter des choses si banales, il y a une bombe sous la table, et elle va bientôt exploser. » Dans le premier cas, on a offert au public quinze secondes de surprise au moment de l’explosion. Dans le deuxième cas, nous lui offrons quinze minutes de suspense. »
La conclusion d’Hitchcock est qu’il faut préférer informer le public quand on le peut. Dans le même ordre d’idée, il explique ce qu’est le Mac-Guffin, qui est récurrent dans son œuvre. Le Mac-Guffin, c’est le prétexte qui permet de construire une intrigue. Il s’agit par exemple de papiers, de documents, de secrets, dont le contenu est important aux yeux des personnages du film ; mais, pour le réalisateur, ils ne sont qu’un prétexte pour mettre en danger son héros. Le principe du Mac-Guffin a été largement utilisé au cinéma, il a aussi été repris en bande dessinée, notamment dans les albums de Tintin ; ce sera le fétiche ou le sceptre royal que veulent arracher les bandits.
Selon Hitchcock, plus réussi est le méchant,
plus réussi sera le film
Hitchcock rappelle que son ambition première est de distraire les gens et qu’en conséquence filmer la vie quotidienne ne l’intéresse pas :
« Je ne filme jamais une tranche de vie car, cela, les gens peuvent très bien le trouver chez eux ou dans la rue, ou même devant la porte du cinéma. Ils n’ont pas besoin de payer pour voir une tranche de vie. […] Tourner des films, pour moi, cela veut dire d’abord, et avant tout, raconter une histoire. Cette histoire peut être invraisemblable mais elle ne doit jamais être banale. »
Hitchcock concède cependant que le spectateur accepte de s’ennuyer dans la première demi-heure d’un film, à condition qu’ensuite l’intensité dramatique suive une ligne ascendante. C’est ce qu’il appelle la courbe montante d’une histoire. Et toujours selon lui, il ne faut jamais négliger le personnage du méchant, car, dit-il, « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. »
Qu’on ne s’y méprenne pas, ce livre, n’est pas une hagiographie ; on n’y trouve aucune trace de vénération béate pour Hitchcock. Tout en étant un admirateur sincère de son œuvre, Truffaut n’hésite pas à la critiquer. Et Hitchcock lui-même, sous certaines conditions, accepte bien volontiers de se livrer à son autocritique. Truffaut en fait la remarque dans sa conclusion : « On l’a vu tout au long de ce livre, Hitchcock était plutôt sévère pour son travail, toujours lucide et volontiers autocritique… à condition toutefois que le film discuté soit ancien de quelques années et que son échec ait été compensé par une plus fraîche réussite. » Ainsi Hitchcock se félicite du succès universel de Psychose (Psycho), qui n’aura coûté que huit cent mille dollars et qui aura rapporté treize millions de bénéfices, et il émet un vœu à l’adresse de Truffaut : « J’aimerais que vous fassiez un film qui vous rapporterait autant d’argent à travers le monde ! » En revanche, il critique lourdement certains de ses films précédents ; il dit avoir honte d’avoir pris un gros salaire pour Les Amants du Capricorne (Under Capricorn), qui fut un échec ; et il dit du Faux Coupable (The Wrong Man) : « Classons ce film dans les mauvais Hitchcock », provoquant, sur ce point, le désaccord de Truffaut qui trouve des qualités à ce film.
Pour qui connaît un peu les films d’Hitchcock, ce livre est une porte d’entrée sur le monde du cinéma et le métier de réalisateur.
Hitchcock-Truffaut, d’Alfred Hitchcock et François Truffaut, 1983, collection Ramsay Poche Cinéma (épuisé) et éditions Gallimard.
07:30 Publié dans Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre, Mémoires, autobiographie, témoignage | Tags : hitchcock, truffaut | Lien permanent | Commentaires (0)


