02/05/2016
M le Maudit, de Fritz Lang
Les assassins sont parmi nous
M le Maudit
M le Maudit est le premier film parlant tourné par Fritz Lang. C’est un chef-d’œuvre du suspense. Le cinéaste fait monter la tension en mettant en scène des meurtres de petites filles. Devant l’impuissance de la police, la pègre décide de traquer elle-même le coupable. Ce film, sorti en 1931, est indissociable de son contexte, la montée du nazisme en Allemagne.
A l’origine, le film devait s’appeler Les Assassins sont parmi nous. Fritz Lang avait prévu de tourner une séquence dans un hangar à Zeppelin, près de Berlin. Dans le courant de l’année 1931, il sollicita une autorisation de tournage auprès du directeur, un nazi convaincu. Celui-ci la lui refusa dans un premier temps. Mais une fois que Lang lui eut signifié que Les Assassins sont parmi nous racontaient l’histoire d’un tueur d’enfants, le nazi se ravisa et lui accorda son autorisation.
 Le cinéaste avait puisé son inspiration dans l’affaire du Vampire de Düsseldorf, un fait divers qui venait de faire la une de l’actualité, en Allemagne. L’année précédente, un homme avait été arrêté pour le meurtre de plusieurs personnes, dont une petite fille. Fritz Lang eût pu se contenter de mettre en scène l’enquête de la police et sa traque du meurtrier, ce qui eût suffi à rendre le film captivant ; mais il fit preuve d’une plus grande ambition en se concentrant sur le meurtrier, dont il fit le personnage principal de l’histoire.
Le cinéaste avait puisé son inspiration dans l’affaire du Vampire de Düsseldorf, un fait divers qui venait de faire la une de l’actualité, en Allemagne. L’année précédente, un homme avait été arrêté pour le meurtre de plusieurs personnes, dont une petite fille. Fritz Lang eût pu se contenter de mettre en scène l’enquête de la police et sa traque du meurtrier, ce qui eût suffi à rendre le film captivant ; mais il fit preuve d’une plus grande ambition en se concentrant sur le meurtrier, dont il fit le personnage principal de l’histoire.
M le Maudit est un chef-d’œuvre du suspense. Dès les premières minutes, Fritz Lang fait monter la tension. Par un habile montage, il met en scène en parallèle deux actions simultanées : une fillette sort de l’école ; le plan suivant montre une jeune femme dans sa cuisine, à la maison. Elle dresse le couvert en attendant sa fille. L’enfant marche dans la rue et croise des passants sur son chemin. La mère surveille la pendule et guette le moindre bruit en provenance de l’escalier. Mais sa fille tarde à rentrer à la maison, elle est sur le point de faire une mauvaise rencontre. A ce moment-là, le spectateur, impuissant, éprouve le besoin intérieur de dire à la mère : « Votre fille est dehors, dans la rue, à quelques pas d’ici, et elle court un grave danger! » Cette séquence, entièrement muette dans ce film parlant, est l’illustration même du suspense tel qu’il sera plus tard théorisé par Hitchcock.
Il apparaît vite à la police que le tueur de petites filles est un homme d’apparence ordinaire. Il aborde ses futures victimes en leur offrant un bonbon, puis un ballon. C’est un prédateur qui les attire dans un piège mortel. La psychose s’installe. Un simple papier de bonbon devient une pièce à conviction. La police est impuissante et son enquête piétine. Tout le monde soupçonne tout le monde. Le moindre geste prévenant à l’égard d’un enfant devient suspect. Comme le dit un responsable de la police, les assassins sont parmi nous.
Le coup de génie de Fritz Lang est d’avoir fait du meurtrier
un homme ordinaire que le spectateur finit par prendre en pitié
La police multiplie les rafles au sein de la pègre, mais sans résultat. Les truands sont agacés du fait que l’enquête se révèle infructueuse et continue de perturber leur trafic. Pour retrouver leur tranquillité, ils se décident à traquer eux-mêmes l’assassin pour le mettre hors d’état de nuire. Chez Fritz Lang, la pègre est un véritable syndicat du crime, avec ses adhérents qui portent un numéro d’identification. Dans une ville livrée au chaos, c’est le syndicat du crime qui représente la seule autorité capable de faire régner l’ordre. Ce monde de hors-la-loi prend l’apparence de la légalité en organisant sa propre justice. Une fois capturé, le meurtrier est traduit devant un tribunal clandestin. Son président est un homme inquiétant, vêtu d’un imperméable en cuir. En ouvrant l’audience, il déclare en parlant du meurtrier présumé : « Ce monstre ne mérite pas de vivre ! Il doit être supprimé ! éradiqué ! » Le syndicat du crime décrète ainsi qui a le droit de vivre et qui n’en a pas le droit. En voyant cette scène, il est difficile de s’empêcher de penser au parti nazi alors en pleine ascension sous la République de Weimar.
Le coup de génie de Fritz Lang est d’avoir fait du meurtrier, non un monstre froid, mais un homme comme un autre. Certes il tue, mais il n’y peut rien, tant il est prisonnier de ses pulsions. Le spectateur le voit plein de tendresse avec une fillette, alors qu’il lui offre un bonbon, puis un ballon. Fritz Lang réussit à instaurer de l’empathie entre le spectateur et le meurtrier. Quand M est, si l’on peut dire, « arrêté » par la pègre, ses yeux sont révulsés sous l’effet de la peur. Et quand il passe en jugement devant le tribunal clandestin, il n’est plus qu’un être effrayé qui a peur de mourir à son tour. Le spectateur oublie d’un coup ses crimes horribles et ses petites victimes innocentes, et finit par le prendre en pitié, voire par s’identifier à lui.
C’était le but recherché par Fritz Lang, qui déclara quelques années plus tard : « Alors que l’étau se resserre autour du meurtrier, nous ressentons à son égard un sentiment de pitié, voire de sympathie. […] Il existe en nous assez de sauvagerie pour nous identifier avec le hors-la-loi qui défie le monde et s’exalte dans la cruauté. » Fritz Lang, fait appel, non à la raison, mais à toutes les émotions enfouies au plus profond de chacun.
M le Maudit, de Fritz Lang, 1931, avec Peter Lorre, DVD Wild Side Video.
07:30 Publié dans Film, Histoire, Policier, thriller, suspense | Tags : m le maudit, fritz lang, peter lorre | Lien permanent | Commentaires (0)
25/04/2016
Germinal, de Zola
Célèbre roman sur la condition ouvrière
Germinal
La crise économique frappe de plein fouet les industries du nord de la France. Pour rester compétitive, la Compagnie des mines de Montsou décide de baisser le coût du travail. Les ouvriers se mettent en grève. Le mouvement s’annonce dur. Plus de cent ans après sa publication, Germinal reste le roman synonyme de la condition ouvrière.
Germinal est l’un des romans les plus célèbres de Zola, sinon le plus célèbre, publié dans le cycle des Rougon-Macquart. De nos jours encore, pour qualifier des conditions de travail déplorables, les expressions telles que « On se croirait chez Zola » ou « C’est digne de Germinal » sont éloquentes et clairement connotées. Il faut dire que Zola est l’un des premiers écrivains à s’être intéressé de près à la classe ouvrière, ici aux mineurs de fond du nord de la France. Il montre que, par leurs sacrifices au travail, les ouvriers ont rendu possibles la Révolution industrielle et l’enrichissement de la bourgeoisie sous le Second Empire.
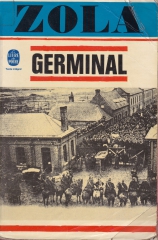 Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
Autant le dire tout de suite, le style de Zola ne brille ni par sa fluidité ni par son élégance. Le lecteur se doit donc de faire un effort pour accrocher à des phrases qui ne coulent pas comme l’eau de source. On sent que Zola a mené tout un travail d’enquête sur le terrain, qu’il restitue en décrivant précisément les conditions de travail des mineurs, si bien que le premier quart du roman est essentiellement composé de descriptions. L’histoire ne commence vraiment qu’avec le déclenchement de la grève. Et là, tel un metteur en scène de cinéma, Zola sait diriger sa foule de papier et met en scène des grévistes criants de vérité. Le lecteur est alors plongé au cœur de la manifestation, pris en étau entre les mineurs déchainés, prêts à tout casser, et les bourgeois, garants d’un certain ordre social.
C’est la famille Maheu qui est au cœur du roman. Le couple a sept enfants, âgés de vingt-et-un ans à trois mois. Chez les Maheu, dès qu’un enfant est en âge de travailler, il descend à la mine, qu’il soit fille ou garçon. C’est ainsi que Lydie, « chétive fillette de dix ans » va au puits. L’argent que chacun rapporte est nécessaire à ce foyer qui a du mal à joindre les deux bouts. Le sort de leurs voisins n’est guère plus enviable, au point que le coron du Voreux a été surnommé par ses habitants le « coron Paie-tes-Dettes ». Les mineurs sont payés à la quinzaine ; et le dimanche, jour chômé, n’est bien sûr pas rémunéré.
Ce qui étonne le plus Lantier,
ce sont les brusques changements de température au fond du puits
Les Maheu hébergent un locataire âgé d’une vingtaine d’années, Etienne Lantier, qui vient d’être embauché à la mine. C’est avec lui, qui n’était jamais descendu dans un puits, que le lecteur découvre le quotidien du mineur. Le matin, les Maheu se lèvent à quatre heures pour boire un café préparé avec une mauvaise eau qui donne la colique. En leur compagnie, Etienne pénètre l’univers souterrain de la mine ; il ne cesse de se heurter la tête au plafond, tandis que pas un de ses camarades, à force d’habitude, ne se cogne. Il souffre du sol glissant et traverse de véritables mares. Zola insiste sur les chauds et froids : « Mais ce qui l’étonnait surtout, c’étaient les brusques changements de température. En bas du puits, il faisait très frais, et dans la galerie de roulage, par où passait l’air de la mine, soufflait un vent glacé, dont la violence tournait à la tempête, entre les muraillements étroits. Ensuite, à mesure qu’on s’enfonçait dans les autres voies, qui recevaient seulement leur part disputée d’aérage, le vent tombait, la chaleur croissait, une chaleur suffocante, d’une pesanteur de plomb. » Zola poursuit : « C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés, l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue demeurait mortel. » A trois heures de l’après-midi, quand les Maheu remontent, leur journée finie, ils sont relayés par une autre équipe, car la mine tourne vingt-quatre heures sur vingt-quatre : « Jamais la mine ne chômait, il y avait nuit et jour des insectes humains finissant la roche à six-cents mètres sous les champs de betterave. »
Le puits est exploité par la Compagnie des mines de Montsou. Le directeur général, M. Hennebeau, n’en est pas le propriétaire ; « il est payé comme nous », précise un ouvrier. Son neveu Paul Négrel, âgé de vingt-six ans, est l’ingénieur de la fosse. Il passe ses journées au fond du puits, au milieu des ouvriers. Zola écrit : « Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon ; et, pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou. »
Alors que le salariat n’a pas encore trouvé sa forme,
les ouvriers sont payés à la tâche
Mais la crise est là. La surproduction menace. Pour rester compétitive, la Compagnie doit baisser ses coûts. On dirait aujourd’hui que l’entreprise doit faire un effort de compétitivité qui passe par la baisse du coût du travail. Pour ce faire, à une époque où le salariat n’a pas encore trouvé sa forme, la rémunération se faisant à la tâche, la Compagnie organise la concurrence entre ouvriers en mettant aux enchères les tailles. Il s’agit d’enchères inversées qui favorisent, pour prendre une expression actuelle, le « dumping social ». Quarante marchandages sont offerts aux mineurs, et, face à l’ingénieur qui procède aux adjudications, Maheu a peur de ne rien obtenir s’il ne baisse pas suffisamment la rémunération qu’il réclame ; car : « Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. » A la sortie, Etienne a ce commentaire : « En voilà un égorgement !... Alors, aujourd’hui, c’est l’ouvrier qu’on force à manger l’ouvrier ! » Le propriétaire de la mine voisine de Montsou se montre lucide et honnête quand, en privé, il déclare : « L’ouvrier a raison de dire qu’il paie les pots cassés. »
La colère monte dans le coron du Voreux. Les femmes, qui gèrent le ménage et donc la pénurie, sont en première ligne. La Maheu, très remontée, ne cesse de répéter : « Il faudra que ça pète. »
La colère monte contre les bourgeois qui auraient confisqué à leur profit les révolutions de 1789, 1830 et 1848 : « L’ouvrier ne pouvait tenir le coup, la révolution n’avait fait qu’aggraver ses misères. C’étaient les bourgeois qui s’engraissaient depuis 89. » A Montsou, il existe pourtant des bourgeois généreux. Ainsi, les Grégoire, actionnaires de la Compagnie qui vivent de leur rente, pratiquent la charité, mais à leur manière : « Il fallait être charitable, ils disaient eux-mêmes que leur maison est la maison du bon Dieu. Du reste, ils se flattaient de faire la charité avec intelligence, travaillés de la continuelle crainte d’être trompés et d’encourager le vice. Ainsi, ils ne donnaient jamais d’argent, jamais ! pas dix sous, pas deux sous, car c’était un fait connu, dès qu’un pauvre avait deux sous, il les buvait. » A la place, les Grégoire ne font que des dons en nature, non en nourriture, mais sous forme de vêtements chauds.
Sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail,
l’employeur organise une baisse déguisée des rémunérations
Devant tant d’injustice, Etienne décide d’agir. Il s’enflamme en apprenant la création, à Londres, de l’Association internationale des travailleurs, la fameuse Internationale : « Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s’unissant, pour assurer à l’ouvrier le pain qu’il gagne. » Il entreprend de fonder une section à Montsou et de mettre en place une caisse de prévoyance. Cette caisse servirait des secours en cas de grève. Or un conflit éclate quand, sous prétexte d’améliorer la sécurité au travail, la Compagnie décide d’un nouveau mode de rémunération : « Devant le peu de soin apporté au boisage, lasse d’infliger des amendes inutiles, elle avait pris la résolution d’appliquer un nouveau mode de paiement, pour l’abattage de la houille. Désormais, elle paierait le boisage à part […]. Le prix de la berline de charbon abattu serait naturellement baissé […]. » Les ouvriers, comprenant qu’il s’agit là d’une baisse déguisée des rémunérations, décident la grève, avec Lantier pour meneur. Le garçon est fort de ses idées socialisantes. Il abreuve ses camarades de paroles, mais il a mal assimilé ses lectures et manque de bases intellectuelles solides, nous dit Zola. Le cabaretier Rasseneur, qui avait jadis été licencié de la mine, se pose en concurrent de Lantier et propose une voie qu’il veut plus raisonnable ; il met en garde les ouvriers qui seraient tentés de faire main basse sur les moyens de production : « Il expliquait que la mine ne pouvait être la propriété du mineur, comme le métier est la propriété du tisserand, et il disait préférer la participation aux bénéfices, l’ouvrier intéressé, devenu l’enfant de la maison. » Mais Rasseneur ne sera pas écouté.
Lantier lui-même finit par être dépossédé de la grève qui tourne à l’émeute. Les femmes sont les plus hargneuses. Lors d’une manifestation, elles veulent déshabiller une bourgeoise qu’elles trouvent sur leur passage, et s’écrient : « Le cul à l’air ! » Puis il y a du sang. Un acte de sabotage est même commis à la mine, provoquant une catastrophe dont des ouvriers sont les premières victimes. Quand les régisseurs de la Compagnie apprennent l’origine criminelle de l’incident, ils préfèrent la taire et parler d’accident, quitte à être accusés de négligence, afin d’éviter tout effet d’imitation ; il s’agit de ne pas donner de mauvaises idées à des apprentis criminels.
La grève n’a pas que du mauvais pour la Compagnie, car elle contribue à nettoyer le marché en faisant succomber les sociétés trop faibles pour résister à un mouvement aussi dur. Une fois la grève finie, la Compagnie peut escompter acheter à prix cassé ceux de ses concurrents qui auront fait faillite entre-temps. C’est ainsi qu’une espèce de darwinisme économique est à l’œuvre.
Avec le recul, il parait évident que Germinal ne pouvait que choquer le lecteur bourgeois de l’époque, à cause du langage employé et des situations décrites. D’une certaine manière, Zola, c’est l’écrivain bourgeois qui bouscule sa classe sociale, quitte à l’effrayer, afin de la mettre en garde contre les conséquences que pourrait avoir son indifférence au sort de la classe ouvrière.
Germinal, de Zola, 1883, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.
07:30 Publié dans Economie, Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : germinal, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)
18/04/2016
Le Bon Plaisir, de Francis Girod
Le Président a un enfant caché
Le Bon Plaisir
Le président de la République use des services de l’Etat pour garder secrète l’existence d’un enfant né hors-mariage. Jean-Louis Trintignant est cassant et autoritaire dans le rôle du chef de l’Etat. Le spectateur de ce film sorti en 1984 ne pouvait se douter que, dix ans plus tard, la fiction serait rejointe par la réalité.
Le président de la République garde cachée l’existence d’un enfant adultérin. Ni son épouse légitime ni le pays ne sont au courant. Cependant, un intellectuel bien renseigné envisage de divulguer l’information auprès du grand public. Une telle révélation pourrait déstabiliser la présidence. Le sommet de l’Etat met alors en branle les services de renseignement, qui reçoivent mission, dans le plus grand secret, de neutraliser celui qui menace de ternir la réputation du chef de l’Etat.
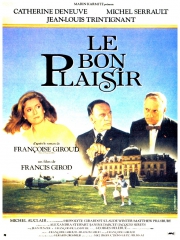 Racontés ainsi, les faits semblent relatifs à la vie privée du président Mitterrand, l’enfant pouvant être Mazarine Pingeot, et l’intellectuel Jean Edern-Hallier. En réalité, les lignes qui précèdent résument un film de fiction intitulé Le Bon Plaisir. Francis Girod en est le réalisateur, et Françoise Giroud en a écrit le scénario, ne faisant qu’adapter au cinéma son propre roman, publié – cela ne s’invente pas – aux éditons Mazarine ! En voyant ce film de nos jours, il faut garder en mémoire qu’au moment de sa sortie, en 1984, les spectateurs ignoraient tout de l’existence de la fille de Mitterrand.
Racontés ainsi, les faits semblent relatifs à la vie privée du président Mitterrand, l’enfant pouvant être Mazarine Pingeot, et l’intellectuel Jean Edern-Hallier. En réalité, les lignes qui précèdent résument un film de fiction intitulé Le Bon Plaisir. Francis Girod en est le réalisateur, et Françoise Giroud en a écrit le scénario, ne faisant qu’adapter au cinéma son propre roman, publié – cela ne s’invente pas – aux éditons Mazarine ! En voyant ce film de nos jours, il faut garder en mémoire qu’au moment de sa sortie, en 1984, les spectateurs ignoraient tout de l’existence de la fille de Mitterrand.
Dans la distribution, Catherine Deneuve interprète la mère de l’enfant et Michel Serrault le ministre de l’Intérieur, ami de trente ans du chef de l’Etat. C’est Jean-Louis Trintignant qui incarne le président de la République. Son travail de composition marque le spectateur. Il est autoritaire, cassant et fascinant. A l’époque, il avait déclaré s’être inspiré – on comprend mieux pourquoi aujourd’hui – de MM. Mitterrand et Chirac. On note au passage que le président fait des voyages privés au Japon et que son état de santé nécessite des injections régulières de cortisone.
Le Président confond son intérêt particulier
avec l’intérêt national
Dans ce film, ce qui reste plus que jamais d’actualité, c’est la fâcheuse tendance du président à confondre son intérêt particulier avec l’intérêt national. Il privatise la police en la mettant au service de sa propre personne, comme si la révélation de l’existence de son enfant mettait en péril la sûreté de l’Etat. Dans ce cadre-là, il envisage des écoutes téléphoniques et délègue tout pouvoir à son ami ministre de l’Intérieur, car il ne veut pas être mêlé à cette affaire, sa main droite ignorant ce que fait sa main gauche.
Le président ment effrontément et a toujours un calcul politique en tête. Ses réels talents d’acteur l’autorisent à nier les réalités les plus évidentes qui pourraient le gêner. Sa première qualité n’est pas la sincérité, mais l’indifférence.
Le président déteste son dauphin et n’a qu’une idée en tête, le faire trébucher. Il est une espèce d’autiste qui a perdu toute capacité d’écoute. Ses proches n’osent plus lui dire la vérité et ne sont pas francs avec lui, de peur d’attirer sur eux le présidentiel courroux. L’une des scènes les plus révélatrices du film montre le président, dans un mouvement de colère, s’autoriser à casser un vase appartenant au mobilier national. Mais comme il le fait lui-même observer, il fait ce qu’il veut puisqu’il est le président, d’où le titre du film.
Le spectateur de 1984 ne pouvait se douter que, dix ans plus tard, la réalité allait rejoindre la fiction. En 1994, pour couper l’herbe sous le pied au journaliste Philippe Alexandre qui s’apprêtait à en faire la révélation dans un livre à paraître, le président Mitterrand autorisa le magazine Paris-Match à publier des photos de Mazarine Pingeot, dévoilant ainsi au grand public l’existence de sa fille.
Aujourd’hui, ce n’est pas sans ironie que l’on peut lire, dans le générique de fin du Bon Plaisir, la mention reprise ici textuellement : « Tout est imaginaire dans cette histoire. Donc : toute ressemblance, etc, etc… »
Le Bon Plaisir, de Francis Girod, 1984, avec Catherine Deneuve, Michel Serrault, Jean-Louis Trintignant, Michel Auclair et Hippolyte Girardot, DVD Gaumont.
07:30 Publié dans Etude de moeurs, Film | Tags : le bon plaisir, francis girod, deneuve, serrault, trintignant, michel auclair, hippolyte girardot | Lien permanent | Commentaires (0)


