18/01/2016
Le Jour se lève, de Marcel Carné
Film regardé aujourd’hui comme un chef-d’œuvre
Le Jour se lève
Ce film, qui fut l’un des premiers à utiliser le procédé du retour en arrière comme mode de narration, déconcerta les spectateurs à sa sortie, malgré la présence de Gabin dans le rôle principal. De nos jours, beaucoup de critiques considèrent Le Jour se lève comme le chef-d’œuvre du réalisme poétique et le jugent supérieur au Quai des brumes.
Dans son livre Je me souviens, Georges Pérec écrit : « Je me souviens que Jean Gabin, avant la guerre, devait par contrat mourir à la fin de chaque film. » Il ne faut bien sûr pas prendre cette assertion au pied de la lettre, mais il est vrai qu’en ce temps-là Gabin avait pour habitude de jouer des personnages marqués par le destin, qui, à la fin, mouraient de mort non naturelle.
 C’est le cas dans Le Jour se lève. Les premières images du film montrent Gabin barricadé au dernier étage d’un immeuble cerné par la police. Il est recherché pour meurtre et, pistolet à la main, il est prêt à vendre chèrement sa peau. Sous forme de retour en arrière, le spectateur va prendre connaissance des faits qui l’on conduit au meurtre.
C’est le cas dans Le Jour se lève. Les premières images du film montrent Gabin barricadé au dernier étage d’un immeuble cerné par la police. Il est recherché pour meurtre et, pistolet à la main, il est prêt à vendre chèrement sa peau. Sous forme de retour en arrière, le spectateur va prendre connaissance des faits qui l’on conduit au meurtre.
Le Jour se lève est l’un des premiers films français à utiliser le retour en arrière dit flashback. A l’époque, en 1939, ce mode de narration déconcerta les spectateurs, peu habitués à ce procédé. A leur attention, un carton placé en ouverture du film expliquait qu’un homme allait raconter les circonstances qui avaient fait de lui un meurtrier. Mais cela ne fut pas suffisant et, de fait, le film reçut un accueil mitigé à sa sortie.
Avec les années, Le Jour se lève devint un classique. Si, dans les années cinquante et soixante, Truffaut voyait dans Le Quai des brumes le chef-d’œuvre du réalisme poétique, de nos jours les critiques ont tendance à considérer que Le Jour se lève lui est supérieur. C’est quasiment la même équipe qui a œuvré dans les deux films : Carné à la réalisation, Prévert aux dialogues, Trauner aux décors, Jaubert à la musique, et bien sûr Gabin dans le rôle principal.
Jules Berry, en dresseur de chiens,
est visqueux à souhait
Dans Le Jour se lève, le premier rôle féminin est tenu par Arletty. On la voit dénudée dans une scène plutôt osée pour l’époque. Jean Gabin est confronté à Jules Berry dans le rôle de victime, si l’on peut employer le mot de victime à son égard, car d’une certaine manière il n’a pas volé son compte. Jules Berry incarne un dresseur de chiens qui est en représentation perpétuelle, sur la scène et à la ville. C’est un affabulateur qui aime à raconter des histoires. Dans un premier temps, Gabin croit tout ce qu’il dit. L’autre le fait marcher et, lui, il court. Mais quand il se rend compte qu’il a été abusé, Gabin s’énerve et cède à la tentation de faire taire Jules Berry définitivement. D’où son geste fatal. Jules Berry est visqueux à souhait dans son personnage, pour le plus grand plaisir du spectateur.
Enfin on ne saurait occulter la dimension sociale du film. Encore une fois, Gabin joue un rôle d’ouvrier à l’écran. On ne cessera de répéter que ce sont ses personnages de prolétaire qui firent de lui l’acteur numéro un du cinéma français et lui assurèrent sa popularité entre les deux guerres. Ici il incarne un ouvrier sableur dans une usine de fonderie. Il respire du sable à longueur de journée et s’empoisonne ainsi les poumons. Face à la foule qui entoure l’immeuble assiégé par la police, de sa fenêtre il s’écrie : « Je suis un assassin ! Mais les assassins, ça court les rue !. Y en a partout ! Tout le monde tue ! Seulement en douceur, alors ça ne se voit pas ! C’est comme le sable en-dedans ! »
Quelques semaines après la sortie du film, la guerre était déclarée. Gabin fut mobilisé et quitta le plateau de Remorques, le film qu’il était en train de tourner après Le Jour se lève. La guerre stoppa net sa carrière. Il ne revint dans les studios français que quatre ans plus tard, à la Libération, prématurément vieilli. Le Jour se lève correspond donc au dernier grand rôle du Gabin d’entre les deux guerres.
Le Jour se lève, de Marcel Carné, 1939, avec Jean Gabin, Jules Berry et Arletty, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : le jour se lève, marcel carné, prévert, jaubert, trauner, gabin, arletty, jules berry | Lien permanent | Commentaires (0)
04/01/2016
L627, de Tavernier
Immersion dans une brigade des Stups
L627
A sa sortie, en 1992, L627 dépoussiérait l’image de la police en montrant le travail au quotidien d’une brigade des Stupéfiants. Le film faisait apparaître la misère matérielle des policiers et l’obsession de la hiérarchie pour les résultats chiffrés. Plus de vingt ans après, le réalisateur Bertrand Tavernier se dit fier de son film.
L627 n’est pas un film policier comme les autres. L’intrigue traditionnelle fait défaut, il n’y pas de fil d’Ariane. Au lieu d’emmener le spectateur d’un point A à un point B, Tavernier lui fait partager la vie quotidienne d’une brigade de policiers. Il a coécrit son scénario avec Michel Alexandre, un ancien enquêteur, et le résultat fait penser aux reportages d’immersion que la télévision affectionne tant depuis quelques années. Mais, attention, L627 est bien une fiction, avec des personnages inventés pour la circonstance.
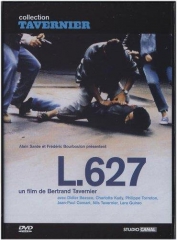 Lucien Marguet est le personnage principal du film. Après avoir été un temps dans un commissariat d’arrondissement, il est affecté aux Stups en tant qu’enquêteur de deuxième classe. Le spectateur découvre la brigade avec les yeux de Marguet ; et ce qui frappe d’abord, c’est le manque de moyens. Les policiers sont parqués dans un étroit module préfabriqué. Ils sont sous-équipés en matériels ; ainsi leurs véhicules tombent souvent en panne. Les frais d’enquête sont remboursés le plus souvent avec retard, et en liquide. L’obsession de la hiérarchie, c’est de faire du chiffre. Pour être bien vu de ses supérieurs, un policier doit savoir bien mettre les bâtons dans les cases et faire les additions de façon à ce que les stats tombent juste. Les membres de la brigade se plaignent des lenteurs de la justice et de la lourdeur de la procédure qui rend leur action inefficace. Ainsi, dans une affaire, le Parquet réussit à égarer les pièces du dossier.
Lucien Marguet est le personnage principal du film. Après avoir été un temps dans un commissariat d’arrondissement, il est affecté aux Stups en tant qu’enquêteur de deuxième classe. Le spectateur découvre la brigade avec les yeux de Marguet ; et ce qui frappe d’abord, c’est le manque de moyens. Les policiers sont parqués dans un étroit module préfabriqué. Ils sont sous-équipés en matériels ; ainsi leurs véhicules tombent souvent en panne. Les frais d’enquête sont remboursés le plus souvent avec retard, et en liquide. L’obsession de la hiérarchie, c’est de faire du chiffre. Pour être bien vu de ses supérieurs, un policier doit savoir bien mettre les bâtons dans les cases et faire les additions de façon à ce que les stats tombent juste. Les membres de la brigade se plaignent des lenteurs de la justice et de la lourdeur de la procédure qui rend leur action inefficace. Ainsi, dans une affaire, le Parquet réussit à égarer les pièces du dossier.
Ce film, sorti au début des années quatre-vingt-dix, aura fait date en mettant en lumière la grande misère matérielle de la police et l’obsession du résultat (quantitatif), qui n’ont fait que s’amplifier depuis. Au-delà, l’intérêt de L627 est de montrer de l’intérieur le travail des policiers au quotidien. Leur tache n’est pas toujours spectaculaire, ils traitent plusieurs dizaines d’affaires en parallèle, ils s’égarent quelques fois sur des fausses pistes et ne savent pas à l’avance sur quel résultat, ou absence de résultat, ils déboucheront.
Dans L627, les policiers doivent se confondre
avec les truands qu’ils poursuivent
Par certains aspects, L627 peut faire penser à Serpico, de Sidney Lumet. En 1971, ce film montrait que le policier moderne ne devait plus être repérable à cent mètres à la ronde, avec son chapeau et son pardessus. Il devait, au contraire, se confondre avec les délinquants qu’il était chargé de poursuivre. Dans L627, les policiers sont à des années-lumière du commissaire Maigret. Ils s’habillent comme les truands, parlent le même langage et ont la même absence de manière. Les policiers ne sont pas du tout policés et ont du mal à résister à la tentation de se conduire en cow-boys. On les voit, lors d’une traque, faire irruption dans un lycée. Quand Mme le censeur, mise au courant de leur intrusion, se trouve en face d’eux, elle n’arrive pas à croire qu’elle a affaire à des policiers, tant elle est choquée de leur comportement et de leur accoutrement. Elle se permet une réflexion sur leur tenue, ce à quoi Marguet lui rétorque : « Ce n’est pas en costume trois-pièces qu’on arrête les dealers. » Bref, Marguet ne ressemble pas du tout à Maigret.
Le chef de la brigade, Dodo, n’est pas du tout distingué. Quand il est énervé, il frappe. Pour se détendre, il use d’un pistolet à eau et se montre capable de comportement encore plus puéril. Il est vrai que les policiers sont soumis à des moments de grande tension, si bien qu’ils ont besoin de se relâcher de temps en temps. Les heures de planque dans un sous-marin paraissent interminables et, quelques fois, ne débouchent sur rien. Une fin d’après-midi, enfermé dans la fourgonnette qui sert à la surveillance, Dodo est tellement pressé de finir sa journée qu’il ne résiste pas à la tentation de conclure, même prématurément, l’affaire qu’ils sont en train de suivre.
L’une des scènes les plus fortes du film se déroule dans une station de métro. Les policiers, équipés de talkies-walkies, ont monté un dispositif dans le but d’arrêter des dealers en flagrant délit. Il leur faut faire preuve de doigté, garder leur sang-froid et avoir des qualités de sportif.
En voyant ce film, on comprend aussi comment des policiers puissent franchir la ligne jaune, tant les limites sont floues. On voit Marguet laisser un peu de drogue à un indicateur qui le met sur la piste d’une grosse saisie, et lui-même s’est pris d’affection pour une toxicomane, Cécile, qu’il essaye de remettre sur le droit chemin.
Par sa longueur – plus de deux heures, comme souvent chez Tavernier – L627 peut rebuter plus d’un spectateur. Pourtant, ce film permet, mieux que n’importe quel reportage télévisé, de saisir le métier de policier et les difficultés de son exercice. Aujourd’hui Tavernier se dit fier de cette œuvre tournée en 1992. Il est vrai que, par bien des aspects, L627 n’a pas pris une ride.
L627, de Bertrand Tavernier, 1992, avec Didier Bezace, Jean-Pierre Comart, Charlotte Kady, Philippe Torreton, Jean-Roger Milo, Nils Tavernier, Lara Guirao et Claude Brosset, DVD StudioCanal.
07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense, Société | Tags : l627, tavernier, didier bezace, jean-pierre comart, charlotte kady, philippe torreton, jean-roger milo, nils tavernier, lara guirao, claude brosset | Lien permanent | Commentaires (0)
07/12/2015
L'Hermine, de Christian Vincent
Film désacralisant la justice
L’Hermine
Fabrice Luchini interprète, avec sobriété, le rôle d’un président de cour d’assises. Très loin des stéréotypes, le magistrat n’écrase pas de son autorité l’accusé et les témoins, mais leur parle avec douceur. C’est un homme comme les autres ; il a lui aussi ses problèmes personnels et, tel un acteur sur scène, il les oublie dès qu’il entre dans la salle d’audience. L’Hermine est un film agréable à suivre, mais il lui manque un peu d’intensité dramatique.
Dans l’histoire du cinéma français, il y eut de nombreux films dits de procès, dans lesquels le principal décor était la salle d’audience d’une cour d’assises. On peut penser à des films comme Les Inconnus dans la maison, La Vérité ou L’Affaire Dominici. L’Hermine, de Christian Vincent, se rattache à cette tradition. Mais, alors que les œuvres précitées mettaient en scène une justice solennelle avec des magistrats grandiloquents écrasant de leur autorité les simples citoyens, ici il en est tout autrement. Certes, dans L’Hermine, le président Racine a la réputation d’être sévère avec les accusés ; ainsi est-il surnommé « le président à deux chiffres » parce qu’il ne condamne jamais à moins de dix ans de prison. Il sait aussi se montrer cassant avec son entourage et tient à garder ses distances avec ses assesseurs, au sens propre comme au sens figuré. Mais, à l’audience, malgré sa réputation de verrouiller les débats, il se montre sobre et n’élève pas la voix. Il est plutôt doux avec l’accusé et les témoins, comme s’il pensait que les mettre en confiance rend les débats plus efficaces.
 Ce film contribue à désacraliser la justice, en montrant que le président de la cour d’assises, sous sa lourde hermine, n’est pas un pur esprit. C’est un homme comme les autres, y compris d’un point de vue physiologique, et il a lui aussi ses problèmes personnels. Ainsi, au premier jour d’audience de la session, Racine est grippé et fiévreux. Pourtant, tel un acteur s’apprêtant à monter sur scène, il se doit d’être en forme et de laisser ses problèmes de côté, afin de donner le meilleur de lui-même dans le prétoire. Le film montre avec insistance que la salle d’audience a les caractéristiques d’un théâtre. D’ailleurs un personnage précise que « Racine aime les coups de théâtre ».
Ce film contribue à désacraliser la justice, en montrant que le président de la cour d’assises, sous sa lourde hermine, n’est pas un pur esprit. C’est un homme comme les autres, y compris d’un point de vue physiologique, et il a lui aussi ses problèmes personnels. Ainsi, au premier jour d’audience de la session, Racine est grippé et fiévreux. Pourtant, tel un acteur s’apprêtant à monter sur scène, il se doit d’être en forme et de laisser ses problèmes de côté, afin de donner le meilleur de lui-même dans le prétoire. Le film montre avec insistance que la salle d’audience a les caractéristiques d’un théâtre. D’ailleurs un personnage précise que « Racine aime les coups de théâtre ».
Le président Racine est un homme assez seul dans l’exercice de sa charge. Il est vrai qu’il a introduit de la distance – et pas seulement à cause de la grippe - dans ses rapports avec les assesseurs. Ces derniers, en son absence, ne se gênent pas pour colporter des rumeurs sur son compte, sans se préoccuper, bien qu’étant magistrats, de savoir si elles sont fondées ou non. Leur respect de la vérité ne dépasse pas le cadre de la salle d’audience.
Heureusement pour lui, Racine est un homme équilibré. Dès que sa journée est finie, il arrive à se couper mentalement de son travail de magistrat et à ne plus penser aux affaires qu’il traite. Du moment que la procédure est respectée, il ne veut pas s’encombrer le cerveau de détails qui ne le regardent pas.
Une contradiction, tout en étant déplorable,
ne remet pas forcément en cause le fondement d’un témoignage
Dans cette justice désacralisée et très humaine, la personnalité du président de cour pèse sur la manière de conduire les débats et sur la conclusion qui sera donnée au procès. Dans l’affaire d’infanticide présumé jugée ici, l’accusation repose notamment sur les témoignages. Or les témoins, habitants d’un quartier ouvrier, sont confus dans leurs dépositions. Ils ont du mal à formuler correctement leurs propos et manquent de précision dans le vocabulaire. A une question posée par le président, la réponse d’un témoin oscille entre « oui », « oui et non » et « je ne sais pas… je crois ». Les témoignages apparaissent ainsi bien fragiles. Même le travail de la police est aisément critiquable. Le jeune lieutenant ayant recueilli la déposition de l’accusé finit par reconnaître qu’il a reformulé ses réponses, quitte à les dénaturer. Le président Racine, tout en pointant les erreurs, essaie d’aller au-delà et ne veut pas perdre de vue l’essentiel. Une contradiction, tout en étant déplorable, ne remet pas forcément en cause le fondement d’un témoignage. Alors que les jurés, dans leurs délibérations, ont tendance à céder à leurs impressions d’audience et à leur ressenti, en gros à leurs émotions, un assesseur les invite à faire la part des choses. De son côté, le président Racine les a prévenus qu’il y aurait peut-être, à l’issue du procès, la frustration de ne pas savoir. « Nous sommes ici, leur a-t-il ajouté, pour réaffirmer les principes de la loi. »
L’Hermine est un film agréable à suivre. Une fois n’est pas coutume, Fabrice Luchini, dans le rôle de Racine, joue tout en retenue. Luchini dans L’Hermine, c’est la justice incarnée. Si les jurés peuvent être frustrés à l’issue du procès, le spectateur peut aussi légitimement l’être à l’issue du film. Il manque un zeste de suspense et l’on eût pu souhaiter un peu plus de tension dans l’intrigue de façon à la rendre plus haletante. Par exemple le réquisitoire de l’avocat général est quelque peu escamoté. Si Babett Knudsen, actrice danoise de la série Borgen, est pleine de charme dans son personnage de juré, on eût pu souhaiter davantage d’intensité dramatique dans sa relation avec Luchini.
Cependant, on ne s’ennuie pas à regarder ce film riche en enseignements. Il permet vraiment de mieux saisir le fonctionnement de la justice. On pourrait même souhaiter qu’il soit projeté aux élèves de l’Ecole nationale de la magistrature.
L’Hermine, de Christian Vincent, 2015, avec Fabrice Luchini et Babett Knudsen, actuellement en salles.
07:30 Publié dans Etude de moeurs, Film, Société | Tags : l'hermine, christian vincent, babett knudsen, luchini | Lien permanent | Commentaires (0)


