02/11/2020
Sur la scène internationale avec Hitler, de Paul-Otto Schmidt
Témoignage unique sur le IIIe Reich
Sur la scène internationale avec Hitler
Paul-Otto Schmidt fut l’interprète personnel de Hitler. Il fut le témoin d’entretiens que le dictateur allemand eut avec Mussolini, Chamberlain, Pétain… Il fait le portrait d’un Hitler moins sûr de lui qu’on ne pourrait le croire. Le dictateur veut avoir sa guerre, mais à condition qu’elle soit menée contre un ennemi facile à abattre.
Quand Hitler accéda à la chancellerie du Reich, Paul-Otto Schmidt était interprète au ministère des Affaires étrangères, communément appelé la Wilhemstrasse, du nom de la rue où étaient situés les bureaux dudit ministère. Dans le courant de l’année 1935, Hitler eut besoin d’un interprète pour une conversation prévue avec le ministre britannique des Affaires étrangères. L’un de ses collaborateurs lui cita alors le nom du Dr Schmidt, réputé pour maîtriser parfaitement l'anglais, ainsi que le français. Quand Hitler apprit que ce fonctionnaire avait travaillé à Genève auprès de la SDN (Société des nations), il fut d’abord réticent à faire appel à lui ; puis il accepta de le prendre à l’essai. Non seulement l’essai fut concluant, mais Hitler fut vivement impressionné par les capacités de Schmidt, si bien qu’il le félicita en ces termes : « Vous vous êtes remarquablement acquitté de votre tâche. Je ne soupçonnais pas qu’il pût exister un tel art de la traduction. Jusqu’ici, j’avais dû m’arrêter à chaque phrase pour qu’on pût traduire. » Hitler fut si satisfait de Schmidt qu’il décida d’en faire son interprète personnel ; c’est ainsi que celui-ci assista aux rencontres du chancelier allemand avec des personnalités telles que Mussolini, Franco, Llyod George, Chamberlain, Eden, le duc de Windsor, Daladier, Pétain, Laval, Darlan… Dans bien des cas, Schmidt fut seul témoin de ces entretiens au cours desquels il servait d’interprète aux deux parties. D’où une neutralité voulue de sa part, l’interprète n’ayant pas à prendre partie ou à montrer ses sentiments, mais se devant de traduire les propos tels qu’ils sont tenus.
 L’impartialité voulue à laquelle prétend Schmidt le conduit à porter un jugement nuancé sur les hommes et les événements. Au cours des années, il est parvenu à découvrir les différents visages du dictateur. Il y a d’abord le Hitler qui sait user de ses charmes pour dire à son interlocuteur ce qu’il a envie d’entendre. Le récit de sa conversation avec Llyod George (Premier ministre du Royaume-Uni en 1918) est hallucinant : Hitler lui serre la main en lui disant que pour les Allemands c’est lui, Llyod George, qui est le véritable vainqueur de la Grande Guerre ; et l’ancien Premier ministre britannique repart enthousiaste, en déclarant à Schmidt à propos de Hitler : « C’est vraiment un grand homme ! » Au cours de nombre d’entretiens diplomatiques, Hitler se montre un négociateur calme et courtois, qui s’exprime avec adresse et intelligence, loin du nazi farouche que dépeint la presse anglaise. Mais, à plusieurs reprises, en face de ses visiteurs, Schmidt le voit, sans transition, céder à des explosions de violence verbale. « On l’eût dit devenu un autre homme », note Schmidt. Puis sa colère, feinte ou simulée, retombait, et il redevenait aussi calme qu’il l’avait été avant l’incident.
L’impartialité voulue à laquelle prétend Schmidt le conduit à porter un jugement nuancé sur les hommes et les événements. Au cours des années, il est parvenu à découvrir les différents visages du dictateur. Il y a d’abord le Hitler qui sait user de ses charmes pour dire à son interlocuteur ce qu’il a envie d’entendre. Le récit de sa conversation avec Llyod George (Premier ministre du Royaume-Uni en 1918) est hallucinant : Hitler lui serre la main en lui disant que pour les Allemands c’est lui, Llyod George, qui est le véritable vainqueur de la Grande Guerre ; et l’ancien Premier ministre britannique repart enthousiaste, en déclarant à Schmidt à propos de Hitler : « C’est vraiment un grand homme ! » Au cours de nombre d’entretiens diplomatiques, Hitler se montre un négociateur calme et courtois, qui s’exprime avec adresse et intelligence, loin du nazi farouche que dépeint la presse anglaise. Mais, à plusieurs reprises, en face de ses visiteurs, Schmidt le voit, sans transition, céder à des explosions de violence verbale. « On l’eût dit devenu un autre homme », note Schmidt. Puis sa colère, feinte ou simulée, retombait, et il redevenait aussi calme qu’il l’avait été avant l’incident.
Hitler parlait 80 à 90 pour 100 du temps,
et c’était seulement tout à fait à la fin
que Mussolini pouvait prononcer quelques mots
Hitler se plaisait à rester dans les généralités et détestait que son interlocuteur le poussât à préciser sa pensée. « C’est un fait, écrit Schmidt, que j’ai pu constater bien des fois en travaillant pour lui. Il préférait les développements généraux, les grandes lignes, les perspectives historiques et les vastes considérations philosophiques. Il évitait le plus souvent les détails concrets, car, en les abordant, il eût pu être conduit à trahir trop nettement ses véritables intentions. »
Aux dires de Schmidt, Hitler avait la même attitude à l’égard de Mussolini. Il était avare de détails face à son allié et se gardait bien de lui dévoiler ses plans d’invasion, préférant le mettre devant le fait accompli. Bien que Mussolini comprenait l’allemand, Schmidt assistait à ses entretiens avec Hitler et traduisait en français les propos du chancelier. Schmidt souligne qu’au cours de ces rencontres Hitler monopolisait la parole : « Ces entretiens ne furent jamais des conversations au véritable sens du mot. Il vaudrait mieux les appeler des monologues de Hitler, pour bien préciser, car le dictateur allemand absorbait 80 à 90 pour 100 du temps, et c’était seulement tout à fait à la fin que Mussolini pouvait prononcer quelques mots. »
Lorsque, en 1936, il décida de remilitariser la Rhénanie,
Hitler eut très peur d’une réaction de la France,
mais elle ne vint pas
Il serait facile pour nous, près d’un siècle plus tard, de réécrire l’histoire à la lumière de ce qui est advenu ; néanmoins, à lire Schmidt, il était encore possible, en 1936, d’arrêter Hitler à moindre frais. A cette date, le dictateur décida de faire entrer les troupes allemandes en Rhénane, violant ainsi le traité de Locarno qui en faisait une zone démilitarisée. Il eut alors très peur d’une réaction de la France, mais elle ne vint pas, et il en fut extrêmement soulagé. Même pendant la guerre, Hitler revint, en présence de Schmidt, sur cet épisode et déclara à plusieurs reprises : « Si les Français avaient alors avancé, nous eussions dû nous retirer avec notre courte honte, car les forces militaires dont nous disposions étaient insuffisantes même pour tenter une résistance modeste. »
Devant ses interlocuteurs Hitler se faisait facilement menaçant, notamment face à Chamberlain venu le rencontrer à Berchtesgaden à l’été 1938, en pleine crise des Sudètes. Le dictateur lui déclara sans ambages : « Dans très peu de temps, j’aurai réglé cette question, de ma propre initiative, d’une manière ou d’une autre. ». Schmidt traduisit la dernière expression par « one way or another », Le Premier ministre britannique comprit aussitôt que Hitler n’excluait pas l’usage de la force et réagit vivement en disant que dans ces conditions sa présence était devenu inutile à Berchtesgaden et qu’il ne lui restait plus qu’à rentrer à Londres. Alors, à la grande stupéfaction de Schmidt, « l’inattendu se produisit, Hitler battit en retraite » A la veille de ce qui sera appelé les Accords de Munich, Hitler consentit, au dernier moment, à négocier ; ce revirement conduit Schmidt à avoir ce commentaire : « J’eus alors […] l’impression que Hitler s’effrayait devant les conséquences extrêmes. »
A l’annonce de la déclaration de guerre de l’Angleterre,
dont Schmidt lui fait part,
Hitler demeure pétrifié
De la lecture de ce livre il ressort que Hitler voulait avoir sa guerre, mais une guerre localisée, contre la Pologne, un ennemi facile à écraser. A l’été 1939, Ciano, ministre italien des Affaires étrangères, visita Hitler au Berghof et le mit en garde contre un risque de réaction des puissances occidentales en cas d’invasion de la Pologne. Dans son récit, Schmidt écrit qu’il entend encore la phrase que prononça Hitler à cette occasion : « Je suis persuadé, dur comme fer, que ni l’Angleterre, ni la France n’entreront dans un conflit général. »
Le 31 août, la Wehrmacht entre en Pologne. Le 2 septembre, l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Allemagne appelle la chancellerie et demande à être reçu, le lendemain à 9 heures, par Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, afin de lui faire part d’une communication en provenance de Londres. Ribbentrop comprend que la communication n’aura rien d’agréable et qu’il s’agit probablement d’un ultimatum. Malgré la gravité de la situation, il se défile et ordonne à Schmidt de recevoir à sa place l’ambassadeur. Le lendemain, un dimanche, à 9 heures précises, c’est donc Schmidt, interprète au ministère des Affaires étrangères, qui reçoit l’ambassadeur britannique, lequel lui remet un ultimatum qui équivaut à une déclaration de guerre de son pays. Aussitôt Schmidt se rend à la chancellerie où l’attend Hitler et lui traduit l’ultimatum remis par la Grande-Bretagne. Schmidt décrit la réaction du dictateur : « Hitler restait comme pétrifié, regardant droit devant lui. […] Il resta complètement silencieux et immobile à sa place. Au bout d’un moment, qui me parut une éternité, il se tourna vers Ribbentrop qui était resté comme figé, à la fenêtre. " Et maintenant ? " demanda Hitler à son ministre des Affaires étrangères, avec un éclair de fureur dans les yeux, comme s’il voulait exprimer que Ribbentrop l’avait faussement informé sur la réaction des Anglais. Ribbentrop répondit à voix basse : " Je présume qu’au cours des heures prochaines, les Français vont nous apporter un ultimatum équivalent. " » Sur ce point Ribbentrop eut raison, puisque, peu de temps après, la France remit à son tour un ultimatum aboutissant à un état de guerre.
Malgré le déclenchement des hostilités, Hitler eut encore besoin des services de Schmidt. Il assista notamment à la signature de l’Armistice avec la France, à Rethondes, en juin 1940, et servit d’interprète lors de l’entrevue avec Pétain, à Montoire, quelques mois plus tard.
Schmidt eut quelques ennuis à la fin de la guerre, car, lors de son arrestation, il était revêtu d’un uniforme SS : selon lui, Hitler, qui ne voulait plus le voir en civil, l’avait obligé à enfiler une telle tenue. Il est vrai que, comme l’écrit l’auteur, « dans le IIIe Reich, un uniforme n’était qu’un costume de figurant », tant les Allemands, sous le nazisme, était devenu un peuple en uniforme.
Schmidt, qui déclare ne pas avoir été nazi, tire une leçon de tous ces événements et se dit convaincu que la catastrophe qui se produisit fut rendue possible parce que l’Allemagne s’était éloignée des lois morales, essentiellement chrétienne. « J’ai constaté, au cours de ma carrière, écrit-il, que les hommes d’Etat et les peuples qui s’écartent de ces principes sont finalement conduits à la catastrophe, quelques trompeurs que puissent être des succès initiaux, remportés pendant une période plus ou moins longue. »
Le témoignage de Paul-Otto Schmidt constitue un document de première importance pour comprendre les coulisses du IIIe Reich. Il fait le portrait d’un Hitler moins sûr de lui qu’on ne pourrait le croire, prêt à reculer quand il est acculé. Hitler veut avoir sa guerre, mais à condition qu’elle soit menée contre un ennemi facile à abattre.
Dans l’édition française de ce livre publiée en 1950, Schmidt salue la mise en place du plan Schuman, créant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ; il écrit : « j’attends l’avenir avec confiance ».
Sur la scène internationale avec Hitler, de Paul-Otto Schmidt, 1950, éditions Perrin.
06/02/2020
Clarissa
Le monde vu à travers la vie d’une femme
Clarissa
Clarissa, fille d’un officier de l’armée austro-hongroise, prend conscience qu’elle vit dans un univers étriqué. Dès lors elle veut échapper à son milieu social pour vivre sa vie, quand, en 1914, éclate la guerre. Dans ce roman qui a la forme d’une chronique, Zweig montre sa capacité à mêler des destins individuels à la tragédie collective. Avec une économie de moyens, il atteint une grande profondeur psychologique dans les personnages.
Clarissa fait partie des œuvres que Stefan Zweig a laissé inachevées à sa mort. Mais inachevé ne veut pas dire inabouti. Cette histoire a un début et une fin, même s’il apparaît que Stefan Zweig avait l’intention de prolonger son roman de plusieurs chapitres supplémentaires. On retrouve tout au long du texte le style concis et précis de l’auteur, et l’on a peine à se dire qu’il aurait, selon son habitude, remanié encore et encore son texte pour en effacer toute lourdeur et toute surcharge.
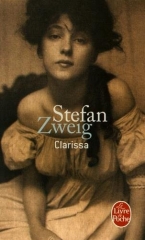 Présentée sous forme de chronique, Clarissa raconte, année après année, la vie d’une jeune femme née dans l’empire austro-hongrois. Le lecteur entre dans l’intimité de cette jeune femme qui se trouve confrontée à la tragédie collective de la guerre. Ce roman, c’est, a écrit Zweig, « le monde vu à travers la vie d’une femme ».
Présentée sous forme de chronique, Clarissa raconte, année après année, la vie d’une jeune femme née dans l’empire austro-hongrois. Le lecteur entre dans l’intimité de cette jeune femme qui se trouve confrontée à la tragédie collective de la guerre. Ce roman, c’est, a écrit Zweig, « le monde vu à travers la vie d’une femme ».
Clarissa Schulmeister est née en 1894. Sa mère est morte en la mettant au monde, et son père est militaire de carrière. Il est lieutenant-colonel affecté à l’état-major à Vienne, au moment où commence le récit. C’est un officier de bureau, sorte d’esprit étriqué, qui accumule des données chiffrées sur toutes les armées d’Europe, ce qui lui a valu le surnom de « maître statisticien ». Sa déformation professionnelle, due à l’abus de tableaux et de chiffres, est telle, qu’il exige de Clarissa qu’elle fasse un rapport quotidien de ses activités ; sur des feuilles préparées à cet usage elle devait noter ce qu’elle avait appris à chaque heure de cours, quels livres elle avait lus, quels morceaux de musique elle avait étudiés au piano... Cette besogne, qu’on appelle de nos jours le reporting, obligeait Clarissa à se noyer dans les détails et ne lui fut pas du tout bénéfique, selon Stefan Zweig : « En réalité, le caractère machinal de ces rapports et de ces annotations eut pour effet d’ôter à Clarissa toute vue d’ensemble sur ces années, car les impressions, au lieu de s’accumuler et de prendre du relief, tombaient en poussière et se désintégraient sous l’effet de ces rapports prématurés […] »
Le professeur Silberstein se dit sceptique
sur l’efficacité de la psychanalyse
Encouragée par son père à faire des études avant de se marier, Clarissa rencontre le professeur Silberstein, dont elle est l’étudiante puis l’assistante. Neurologue réputé et spécialiste des névroses, Silberstein est lui-même un névrosé. Semblable à de nombreux autres personnages créés par Zweig, il est facilement la proie d’idées fixes et ne le cache pas à Clarissa ; ainsi il lui déclare : « Quand quelque chose s’empare de moi, plus rien ne peut m’arrêter, je ne pense plus qu’à cela. » Il se dit sceptique sur l’efficacité de la psychanalyse : « Freud veut faire découvrir aux hommes la cause de leur déséquilibre psychique, et moi, je veux la leur faire oublier. Je crois qu’il vaut mieux leur en inculquer une autre qui soit inoffensive. Je ne crois pas que la vérité puisse les aider. […] Je ne crois pas à la guérison. » Pour échapper à ses névroses, il vit dans un tourbillon et multiplie les mondanités pour qu’on parle de lui et qu’on ne l’oublie pas.
Silberstein envie le calme et la sérénité de Clarissa. Mais, au lieu de la féliciter de l’équilibre de son caractère, il prend un air grave pour lui dire : « Vous avez vraiment une attitude passive. Vous n’exigez jamais rien. Il y a quelque chose qui fait de vous une personne merveilleuse. Je serais presque tenté de dire : " On sent à peine votre présence." » Et il lui annonce qu’elle sera un jour ou l’autre rattrapée par une illusion spécifique : « Vous n’y échapperez pas, vous n’échapperez pas à vous-même. »
Seuls les gens simples savent profiter des petits bonheurs de la vie
et sont vraiment heureux
Clarissa est chargée par le professeur Silberstein de le représenter à un congrès de pédagogie à Lucerne. Le congrès est organisé par des professeurs progressistes français regroupés au sein de L’Education nouvelle ; il est question de méthodes pédagogiques, de démarche scientifique, de Montessori, de Pestalozzi. Pour la première fois de sa vie, Clarissa côtoie des personnes d’un autre milieu social que le sien : les participants sont des instituteurs venus de toute l’Europe, ce sont des gens simples, des gens de condition modeste, qui n’avaient jamais voyagé avant de venir en Suisse. A l’occasion d’une croisière fluviale organisée en clôture du congrès, Clarissa les voit heureux d’être ensemble : ils s’enthousiasment devant des fleurs et mangent des tartines pour le déjeuner. « Je vis dans un univers étriqué. » se dit-elle en les voyant. Elle prend alors conscience que seuls ceux qui se contentent de peu, connaissent ces petits bonheurs. « Pour la première fois, écrit Zweig, elle s’ouvrait au monde. »
Sa rencontre avec Léonard est pour beaucoup à son ouverture au monde. Professeur au lycée de Dijon, il est l’organisateur du congrès ; ils sympathisent tous les deux et, à l’occasion de leurs conversations, il lui fait partager ses idées, qui sont assez largement le reflet de celles de Zweig. Son auteur préféré, c’est Montaigne, car, parmi tous les écrivains, déclare Léonard, « personne n’était plus humain, personne mieux que lui ne comprenait l’Homme, celui de tous les jours. » Il la met en garde contre le nationalisme : « C’est lui, le mal qui place une seule patrie au-dessus de toutes les autres. » Anticolonialiste, il lutte contre le chauvinisme et l’esprit de conquête et donne sa définition de la France : « Le sol, la terre, la langue, l’art, voilà ce qu’est la France et non le Cambodge, la Guyane et Madagascar. » Pour lui, ce sont les anonymes, tels les participants au congrès, qui comptent : « Ce ne sont pas les morts illustres qui font la valeur d’un pays. Ce sont les gens qui y vivent. »
En vacances, Clarissa et Léonard vivent hors du temps
et n’achètent pas de journaux,
car cela reviendrait à s’imposer une contrainte
En vacances dans les montagnes avec Léonard, elle connaît, le temps d’un été, des moments d’intense bonheur. Ils vivent libres, détachés de tout et hors du temps. Ils n’achètent pas les journaux, car, disent-ils, « cela reviendrait à nous imposer une contrainte. » Cette liberté qu’il souhaite vivre pleinement concerne en premier lieu le cerveau qui doit être détaché de toute entrave, ce qui conduit Léonard à dire : « Ne pas penser une heure durant ! Ce n’est pas une heure perdue. »
Clarissa sort métamorphosée de son expérience avec Léonard. Elle repense à son père qui, dévoré par le devoir, aura passé son existence à s’effacer pour servir ; maintenant elle entend rompre avec les principes que lui a inculqués son père : « A présent, vivre était son plus ardent désir. »
Mais la mobilisation générale, le départ de Léonard et la guerre vont bouleverser tous ses plans. Clarissa va alors connaître un autre événement qui va la transformer en tant que femme.
Heureusement pour le lecteur, Stefan Zweig a eu le temps de conduire Clarissa jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui donne au récit une fin, même provisoire. C’est l’occasion pour l’auteur d’exposer à nouveaux ses idées sur la nation et sur la guerre, cette fois par l’intermédiaire du professeur Silberstein. La fin de l’empire et de l’empereur ne signifie rien pour lui. « Nous vivons, c’est tout ce qui importe. », déclare-t-il.
Dans ce roman, Zweig montre sa capacité à mêler des destins individuels à la tragédie collective. Il propose une galerie de personnages aux caractères variés, et, avec une économie de moyens, il atteint une grande profondeur psychologique.
Clarissa, c’est l’histoire d’une jeune femme, qui, malgré son éducation et malgré la guerre, cherche à s’affranchir de son milieu social pour vivre en être libre.
Clarissa, de Stefan Zweig, 1942, collection Le Livre de poche.
09:04 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : clarissa, zweig | Lien permanent | Commentaires (0)
08/01/2018
Les Mains du miracle, de Kessel
L’histoire incroyable du masseur d’Himmler
Les Mains du miracle
Kessel raconte l’histoire de Félix Kersten, un médecin finlandais qui fut le masseur attitré de Himmler. Parce qu’il soulageait le chef des SS de ses maux d’estomac, il réussit à nouer des liens d’amitié avec lui et les mit à profit pour sauver des vies. Les Mains du miracle sont un récit captivant.
Dans le prologue de ce livre, Kessel parle d’une histoire « incroyable, insensée ». Lui-même demeura sceptique à l’écoute du récit que lui fit Félix Kersten, tant les faits énoncés ne pouvaient être vrais et paraissaient impossibles. Puis, à l’examen des documents que lui présenta son interlocuteur, Kessel finit par admettre l’authenticité des faits qui étaient soumis à son examen. C’est cette histoire, celle de Kersten et de Himmler, que Kessel raconte dans ce livre publié en 1959.
 Félix Kersten était un médecin finlandais d’origine allemande ; Kessel le décrit comme « un bon gros docteur, au bon visage, au bon sourire, aux bonnes mains. » Or ses mains étaient réputées faire des miracles depuis qu’un médecin chinois l’avait initié à la pratique du massage.
Félix Kersten était un médecin finlandais d’origine allemande ; Kessel le décrit comme « un bon gros docteur, au bon visage, au bon sourire, aux bonnes mains. » Or ses mains étaient réputées faire des miracles depuis qu’un médecin chinois l’avait initié à la pratique du massage.
Dans les années trente, Kersten est installé comme masseur à la fois à Berlin et à La Haye. Il s’est constitué une riche clientèle, composée notamment d’industriels et d’hommes d’affaires surmenés, qu’il arrive à soulager et à guérir. Un jour, l’un de ses patients allemands lui demande un grand service : il s’agit de prendre en consultation le Reichsführer Himmler, qui souffre de maux d’estomac que l’intéressé qualifie d’atroces.
Kersten va-t-il accepter d’examiner le chef des SS ? Un cas de conscience se pose à lui.
Attendu qu’un médecin ne choisit pas ses patients, mais qu’il doit soigner chacun sans distinction, Kersten en tire la conclusion qu’il ne peut se dérober. Une nouvelle fois, ses mains font des miracles : il parvient à soulager Himmler de ses douleurs et devient son masseur attitré.
Himmler n’est en rien le prototype de l’aryen blond et athlétique. Kersten le qualifie de « pédant chétif et malingre, étriqué au moral comme au physique ». Il distingue deux personnalités chez lui : d’un côté il y a le « bureaucrate fanatique et souverain du supplice et de l’extermination » ; et de l’autre il y a le Himmler réduit à une « pauvre pâte humaine, malléable à volonté, le drogué prêt à tout pour sa drogue », que représentent pour lui les massages pratiqués par Kersten.
Pour lui arracher des vies,
Kersten a recours à la vanité de Himmler
Dès que le mal devient trop violent, Himmler appelle son guérisseur à l’aide. Le bien-être que lui apportent les séances de massage le conduit à se laisser aller devant le docteur et à se livrer aux « confidences militaires et politiques, avec une indiscrétion difficile à croire ». L’intimité entre les deux hommes devient telle, que Himmler finit par faire de Kersten « son seul confident, son seul ami ». Il lui propose même de le faire inscrire dans la SS avec le grade de colonel ; Kersten use de toute la diplomatie possible pour décliner cette offre censée être un honneur.
Au cours d’une séance de massage, Himmler révèle à Kersten que Hitler lui a ordonné de « liquider » tous les juifs qui sont en leur pouvoir. Quand le médecin lui demande ce qu’il veut dire par là, Himmler lui déclare : « Je veux dire que cette race doit être exterminée entièrement, définitivement. » En entendant ce propos, Kersten tremble d’horreur et d’impuissance. Comprenant qu’il ne peut rien contre l’assassinat collectif, il se fait un devoir de sauver des individus, juifs ou non juifs, chaque fois qu’il en aura l’occasion. C’est ainsi qu’il sauve d’un camp de concentration dix Témoins de Jéhovah, qui viennent travailler dans son domaine agricole, hors de toute surveillance policière.
Pour sauver des vies, Kersten met à profit les moments d’apaisement que connaît Himmler à l’issue des séances de massage, en s’adressant à ses sentiments de gratitude et d’amitié. Quand cela s’avère insuffisant, il a recours à la vanité du chef SS : il lui présente la figure de l’empereur Henri l’Oiseleur comme un modèle de justice et de générosité dont il devrait s’inspirer, s’il veut entrer dans l’Histoire comme le « plus grand chef de la race allemande ». A force de donner régulièrement satisfaction à son masseur, Himmler finira par dire : « Le Dr Kersten m’arrache une vie à chacun de ses massages. »
Himmler, « maître des supplices »,
ne supportait pas la vue des souffrances,
ni la vue d’une goutte de sang
Au début de 1945, en lien avec les autorités suédoises, Kersten soumit à Himmler un document qui paraît invraisemblable, intitulé Contrat au nom de l’humanité. Il stipule que les camps de concentration ne seront pas dynamités à l’approche des armées alliées et qu’aucun prisonnier juif ne sera plus exécuté. Himmler consent à apposer sa signature. Il est vrai que celui-ci a pris conscience que la guerre est définitivement perdue. Kersten obtient aussi la libération de milliers de détenus juifs, qui sont envoyés en Suisse.
Les faits datant de 1945 et racontés dans ce livre sont aujourd’hui incontestés. Cependant des historiens ont exprimé des réserves sur certains points du témoignage de Kersten, notamment quand il prétend avoir sauvé le peuple néerlandais de la déportation. D’autres historiens n’ont pas ces préventions, tel le professeur François Kersaudy, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui a lu Les Mains du miracle dans sa jeunesse et en a fait l’un de ses livres de chevet.
On ne peut s’empêcher de rapprocher cet ouvrage de Hitler m’a dit, de Hermann Rauschning. Les deux livres se rejoignent dans leur description des mœurs des maîtres du Reich. Rauschning voyait dans le IIIe Reich un régime de gangsters pratiquant l’assassinat pour parvenir à leurs fins. On retrouve un tel esprit et de telles pratiques dans Les Mains du miracle. Ainsi, bien que médecin de Himmler, Kersten dit avoir échappé à une tentative d’assassinat préparée par le n°2 de la SS, Kaltenbrunner, qui avait prévu de le faire abattre au cours d’un banal contrôle routier ; mais un autre chef SS, le général Schellenberg, l’informa à temps du guet-apens qui était préparé contre lui.
Les Mains du miracle font aussi penser à La Mort est mon métier, de Robert Merle. Le Himmler de Kersten n’est pas un être sadique, mais un bureaucrate du crime qui fait preuve d’un « zèle meurtrier » dans le but de se montrer à la hauteur de la tâche que lui a confiée son Führer. Très différent d’un Gœring ou d’un Ribbentrop, Himmler, d’après Kersten, n’était habitué qu’à obéir et, à la différence des deux précités, ne songeait même pas à s’enrichir. Qui plus est, celui que Kessel appelle le « maître des supplices » ne supportait pas la vue des souffrances ni d’une goutte de sang. A la lecture de ce livre, comme à la celle de La Mort est mon métier, on a vraiment l’impression d‘être confronté à la banalité du mal théorisée par Hannah Arendt
Il n’y a pas besoin de s’intéresser particulièrement à la Seconde Guerre mondiale pour lire et aimer Les Mains du miracle ; car Kessel a privilégié la dimension humaine dans son récit. Ce livre est captivant, facile à lire, tout en étant profond. Il peut être recommandé à un adolescent.
Les Mains du miracle, de Joseph Kessel, 1959, collections L’Air du Temps (épuisé) et Folio.
10:21 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : les mains du miracle, kessel, kersten | Lien permanent | Commentaires (0)


