02/05/2016
M le Maudit, de Fritz Lang
Les assassins sont parmi nous
M le Maudit
M le Maudit est le premier film parlant tourné par Fritz Lang. C’est un chef-d’œuvre du suspense. Le cinéaste fait monter la tension en mettant en scène des meurtres de petites filles. Devant l’impuissance de la police, la pègre décide de traquer elle-même le coupable. Ce film, sorti en 1931, est indissociable de son contexte, la montée du nazisme en Allemagne.
A l’origine, le film devait s’appeler Les Assassins sont parmi nous. Fritz Lang avait prévu de tourner une séquence dans un hangar à Zeppelin, près de Berlin. Dans le courant de l’année 1931, il sollicita une autorisation de tournage auprès du directeur, un nazi convaincu. Celui-ci la lui refusa dans un premier temps. Mais une fois que Lang lui eut signifié que Les Assassins sont parmi nous racontaient l’histoire d’un tueur d’enfants, le nazi se ravisa et lui accorda son autorisation.
 Le cinéaste avait puisé son inspiration dans l’affaire du Vampire de Düsseldorf, un fait divers qui venait de faire la une de l’actualité, en Allemagne. L’année précédente, un homme avait été arrêté pour le meurtre de plusieurs personnes, dont une petite fille. Fritz Lang eût pu se contenter de mettre en scène l’enquête de la police et sa traque du meurtrier, ce qui eût suffi à rendre le film captivant ; mais il fit preuve d’une plus grande ambition en se concentrant sur le meurtrier, dont il fit le personnage principal de l’histoire.
Le cinéaste avait puisé son inspiration dans l’affaire du Vampire de Düsseldorf, un fait divers qui venait de faire la une de l’actualité, en Allemagne. L’année précédente, un homme avait été arrêté pour le meurtre de plusieurs personnes, dont une petite fille. Fritz Lang eût pu se contenter de mettre en scène l’enquête de la police et sa traque du meurtrier, ce qui eût suffi à rendre le film captivant ; mais il fit preuve d’une plus grande ambition en se concentrant sur le meurtrier, dont il fit le personnage principal de l’histoire.
M le Maudit est un chef-d’œuvre du suspense. Dès les premières minutes, Fritz Lang fait monter la tension. Par un habile montage, il met en scène en parallèle deux actions simultanées : une fillette sort de l’école ; le plan suivant montre une jeune femme dans sa cuisine, à la maison. Elle dresse le couvert en attendant sa fille. L’enfant marche dans la rue et croise des passants sur son chemin. La mère surveille la pendule et guette le moindre bruit en provenance de l’escalier. Mais sa fille tarde à rentrer à la maison, elle est sur le point de faire une mauvaise rencontre. A ce moment-là, le spectateur, impuissant, éprouve le besoin intérieur de dire à la mère : « Votre fille est dehors, dans la rue, à quelques pas d’ici, et elle court un grave danger! » Cette séquence, entièrement muette dans ce film parlant, est l’illustration même du suspense tel qu’il sera plus tard théorisé par Hitchcock.
Il apparaît vite à la police que le tueur de petites filles est un homme d’apparence ordinaire. Il aborde ses futures victimes en leur offrant un bonbon, puis un ballon. C’est un prédateur qui les attire dans un piège mortel. La psychose s’installe. Un simple papier de bonbon devient une pièce à conviction. La police est impuissante et son enquête piétine. Tout le monde soupçonne tout le monde. Le moindre geste prévenant à l’égard d’un enfant devient suspect. Comme le dit un responsable de la police, les assassins sont parmi nous.
Le coup de génie de Fritz Lang est d’avoir fait du meurtrier
un homme ordinaire que le spectateur finit par prendre en pitié
La police multiplie les rafles au sein de la pègre, mais sans résultat. Les truands sont agacés du fait que l’enquête se révèle infructueuse et continue de perturber leur trafic. Pour retrouver leur tranquillité, ils se décident à traquer eux-mêmes l’assassin pour le mettre hors d’état de nuire. Chez Fritz Lang, la pègre est un véritable syndicat du crime, avec ses adhérents qui portent un numéro d’identification. Dans une ville livrée au chaos, c’est le syndicat du crime qui représente la seule autorité capable de faire régner l’ordre. Ce monde de hors-la-loi prend l’apparence de la légalité en organisant sa propre justice. Une fois capturé, le meurtrier est traduit devant un tribunal clandestin. Son président est un homme inquiétant, vêtu d’un imperméable en cuir. En ouvrant l’audience, il déclare en parlant du meurtrier présumé : « Ce monstre ne mérite pas de vivre ! Il doit être supprimé ! éradiqué ! » Le syndicat du crime décrète ainsi qui a le droit de vivre et qui n’en a pas le droit. En voyant cette scène, il est difficile de s’empêcher de penser au parti nazi alors en pleine ascension sous la République de Weimar.
Le coup de génie de Fritz Lang est d’avoir fait du meurtrier, non un monstre froid, mais un homme comme un autre. Certes il tue, mais il n’y peut rien, tant il est prisonnier de ses pulsions. Le spectateur le voit plein de tendresse avec une fillette, alors qu’il lui offre un bonbon, puis un ballon. Fritz Lang réussit à instaurer de l’empathie entre le spectateur et le meurtrier. Quand M est, si l’on peut dire, « arrêté » par la pègre, ses yeux sont révulsés sous l’effet de la peur. Et quand il passe en jugement devant le tribunal clandestin, il n’est plus qu’un être effrayé qui a peur de mourir à son tour. Le spectateur oublie d’un coup ses crimes horribles et ses petites victimes innocentes, et finit par le prendre en pitié, voire par s’identifier à lui.
C’était le but recherché par Fritz Lang, qui déclara quelques années plus tard : « Alors que l’étau se resserre autour du meurtrier, nous ressentons à son égard un sentiment de pitié, voire de sympathie. […] Il existe en nous assez de sauvagerie pour nous identifier avec le hors-la-loi qui défie le monde et s’exalte dans la cruauté. » Fritz Lang, fait appel, non à la raison, mais à toutes les émotions enfouies au plus profond de chacun.
M le Maudit, de Fritz Lang, 1931, avec Peter Lorre, DVD Wild Side Video.
07:30 Publié dans Film, Histoire, Policier, thriller, suspense | Tags : m le maudit, fritz lang, peter lorre | Lien permanent | Commentaires (0)
11/04/2016
Fatherland, de Robert Harris
Thriller uchronique
Fatherland
Robert Harris imagine une intrigue policière ayant pour cadre le Berlin de 1964, capitale d’une Allemagne qui aurait gagné la guerre. Fatherland est ce qu’on pourrait appeler un thriller uchronique. A l’aide d’une solide documentation et tout en faisant preuve d’imagination, Robert Harris mêle habilement le vrai et le faux.
Par certains aspects, Fatherland a les caractéristiques d’un roman policier classique. Au départ, il s’agit d’une simple histoire de crime. Une nuit, à Berlin, l’inspecteur Xavier March, de la Kripo, la police criminelle, est appelé sur les bords de la Havel, pour constater le décès d’un individu retrouvé noyé. La victime est un ancien ministre, et sa mort n’est pas naturelle. L’inspecteur March enquête, il trouve des témoins, mais ils ont peur de parler. On cherche à l’envoyer sur de fausses pistes. Sa quête de la vérité gêne en haut lieu, lui-même reçoit des menaces…
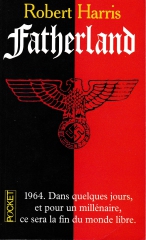 Beaucoup d’ingrédients servis dans Fatherland se retrouvent dans de nombreux autres thrillers : un assassinat, une enquête, des témoins qui se taisent définitivement, des fausses pistes, un secret d’Etat... Ce qui fait l’originalité de ce roman, c’est le contexte imaginé par l’auteur. Robert Harris a construit sa fiction sur la base d’une uchronie : il a placé son intrigue en avril 1964, dans un Berlin qui s’apprête à célébrer le soixante-quinzième anniversaire du Führer. Robert Harris imagine qu’Hitler a gagné la guerre et qu’il domine l’Europe. A condition d’accepter cette hypothèse de départ, les informations données par Robert Harris paraissent vraisemblables et font froid dans le dos. La nouvelle Europe est dominée par l’Allemagne qui a annexé ses proches voisins : « Le Luxembourg était devenu le Moselland, l’Alsace-Lorraine la Westmark ; l’Autriche, l’Ostmark. Même scénario pour la Tchécoslovaquie – le petit bâtard de Versailles n’était plus que le protectorat de Bohême et de Moravie. La Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie : gommées de la carte. […] A l’ouest, douze nations [dont la France et la Grande-Bretagne] avaient lié leur sort à celui de l’Allemagne, par le traité de Rome, et formaient l’espace économique européen. L’allemand était la deuxième langue officielle dans toutes les écoles. » Edouard VIII a été réinstallé sur le trône d’Angleterre et règne avec la reine Wallis à ses côtés. La Guerre froide oppose l’Allemagne aux Etats-Unis, mais la Détente semble se profiler, avec l’annonce du voyage qu’a prévu de faire à Berlin le président Kennedy. Il s’agit bien sûr de Joseph Kennedy, soixante-quinze ans, qui, quand il était ambassadeur en Allemagne avant-guerre, était réputé pour ses sympathies pro-nazies.
Beaucoup d’ingrédients servis dans Fatherland se retrouvent dans de nombreux autres thrillers : un assassinat, une enquête, des témoins qui se taisent définitivement, des fausses pistes, un secret d’Etat... Ce qui fait l’originalité de ce roman, c’est le contexte imaginé par l’auteur. Robert Harris a construit sa fiction sur la base d’une uchronie : il a placé son intrigue en avril 1964, dans un Berlin qui s’apprête à célébrer le soixante-quinzième anniversaire du Führer. Robert Harris imagine qu’Hitler a gagné la guerre et qu’il domine l’Europe. A condition d’accepter cette hypothèse de départ, les informations données par Robert Harris paraissent vraisemblables et font froid dans le dos. La nouvelle Europe est dominée par l’Allemagne qui a annexé ses proches voisins : « Le Luxembourg était devenu le Moselland, l’Alsace-Lorraine la Westmark ; l’Autriche, l’Ostmark. Même scénario pour la Tchécoslovaquie – le petit bâtard de Versailles n’était plus que le protectorat de Bohême et de Moravie. La Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie : gommées de la carte. […] A l’ouest, douze nations [dont la France et la Grande-Bretagne] avaient lié leur sort à celui de l’Allemagne, par le traité de Rome, et formaient l’espace économique européen. L’allemand était la deuxième langue officielle dans toutes les écoles. » Edouard VIII a été réinstallé sur le trône d’Angleterre et règne avec la reine Wallis à ses côtés. La Guerre froide oppose l’Allemagne aux Etats-Unis, mais la Détente semble se profiler, avec l’annonce du voyage qu’a prévu de faire à Berlin le président Kennedy. Il s’agit bien sûr de Joseph Kennedy, soixante-quinze ans, qui, quand il était ambassadeur en Allemagne avant-guerre, était réputé pour ses sympathies pro-nazies.
S’inspirant des projets d’Albert Speer qui était l’architecte d’Hitler, Robert Harris plante le décor et imagine à quoi ressemble la capitale du Reich hitlérien. Xavier March, en compagnie de son jeune fils, a pris place à bord d’un autobus touristique qui fait le tour de Berlin. Le guide leur présente les principaux monuments de la ville en commençant par le plus célèbre, le Grand Dôme. Il précise : « Le Grand Dôme du Reich est le plus grand édifice au monde. Il s’élève à plus d’un quart de kilomètre du sol et certains jours – remarquez aujourd’hui – le sommet est invisible. La coupole fait cent quarante mètres de diamètre ; elle peut contenir seize fois Saint-Pierre de Rome. » La visite se poursuit avec l’Arc de Triomphe ; le guide croit bon d’ajouter que « l’Arc de Triomphe de Paris y pénétrerait quarante-neuf fois. » Quand l’autobus s’engage dans l’imposante avenue de la Victoire, il est précisé qu’elle est « deux fois et demie plus longue que les Champs-Elysées à Paris. » Robert Harris, ou plutôt Xavier March, conclut : « Plus haut, plus long, plus grand, plus large, plus cher… Même dans la victoire, pensait March, l’Allemagne gardait un complexe d’infériorité. Rien n’avait de valeur en soi. Tout se comparait à ce qui existait ailleurs. »
Dans cette nouvelle Allemagne, reste un sujet tabou :
le sort des Juifs
La victoire de l’Allemagne apparaît d’ailleurs toute relative. Sur le papier, elle a gagné de vastes territoires à l’Est. La propagande promet aux volontaires de devenir colons sur des terres qui leur sont distribuées gracieusement. Pourtant ces vastes espaces ne sont pas sûrs. Robert Harris présente l’envers du décor : « La propagande montrait des colons heureux vivant dans l’opulence. Mais d’autres informations filtraient, sur la situation réelle : une existence conditionnée par un sol pauvre, un travail harassant, les mornes cités-dortoirs où les Allemands devaient se réfugier la nuit tombée, par crainte des attaques des partisans locaux. »
Dans cette nouvelle Allemagne, reste un sujet tabou : le sort des Juifs. Les personnages du roman s’abstiennent d’en parler, ou le font à mots couverts. L’un d’entre eux se borne à dire, quand il est question des Juifs au cours d’une conversation : « Comme chacun sait, ils sont à l’Est. » Et le personnage change aussitôt de sujet.
Ce qui rend percutant Fatherland, c’est le mélange habile entre le vrai et le faux. Robert Harris a su trouver le bon équilibre entre les deux. Par exemple, les citations d’Hitler qu’il met en exergue sont authentiques. Certes le Berlin colossal qu’il imagine n’a jamais vu le jour, mais il correspond, monument par monument, à celui qu’Hitler avait prévu de bâtir à partir des plans de Speer, si l’Allemagne avait gagné la guerre. A la lecture du livre, on perçoit que Robert Harris, tout en faisant preuve d’imagination, s’est solidement documenté sur le IIIème Reich.
Publié en 1992, Fatherland est le premier roman écrit par Robert Harris et contribua à sa renommée. Depuis, l’auteur s’est fait le spécialiste du thriller historique, visitant différentes époques, l’une après l’autre. Son dernier livre, D., publié en 2014, porte sur l’affaire Dreyfus. Robert Harris est aussi l’auteur de Ghostwriter, adapté au cinéma par Polanski.
Fatherland, de Robert Harris, 1992, collection Pocket.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Policier, thriller, XXe, XXIe siècles | Tags : fatherland, robert harris | Lien permanent | Commentaires (0)
22/02/2016
Il était un capitaine, de Bertrand Solet
L’affaire Dreyfus racontée aux jeunes
Il était un capitaine
Il était un capitaine fut publié au début des années soixante-dix, dans une collection pour la jeunesse. Aujourd’hui réédité, ce livre raconte, sous forme de fiction, les différents épisodes de l’affaire Dreyfus. La peinture de l’époque est particulièrement réussie. Le lecteur comprend mieux comment, de bonne foi, de nombreux contemporains crurent en la culpabilité du capitaine.
Dans Il était un capitaine, Bertrand Solet remonte aux sources de l’affaire Dreyfus ; il écrit : « Certains ont dit que tout avait commencé, en fait, le 23 septembre 1894, aux abords de la chapelle Sainte-Clotilde, à Paris. » Ce jour-là, la nommée Marie Bastian, femme de ménage à l’ambassade d’Allemagne, avait rendez-vous avec le commandant Henry, l’un des chefs du service « section des statistiques, rattachée au deuxième bureau » de l’Etat-major de l’armée. En clair, le commandant Henry était l’un des chefs du contre-espionnage. Marie Bastian lui remit un certain bordereau trouvé dans une corbeille à papier de l’ambassade. Henry fit ensuite son rapport à son supérieur hiérarchique, le colonel Sandherr, chef de la section des statistiques. Ledit bordereau était un document de la plus haute importance, il constituait la preuve qu’un officier de l’Etat-major livrait des secrets à l’Allemagne. Une enquête discrète fut confiée au commandant du Paty de Clam, qui, en étudiant les écritures, eut vite fait de démasquer le coupable : le capitaine Alfred Dreyfus, stagiaire à l’Etat-major. Dreyfus eut beau clamer son innocence, il fut confondu, arrêté et mis au secret. L’affaire, rondement menée, trouvait rapidement sa conclusion. En fait, elle ne faisait que commencer.
 Chapitre après chapitre, Bertrand Solet fait revivre les épisodes successifs de l’Affaire : la condamnation de Dreyfus par un conseil de guerre, sur la foi d’un dossier secret ; sa déportation à l’île du Diable ; la fabrication de fausses preuves contre lui ; la campagne de presse en sa faveur ; la cassation et l’annulation du procès ; la tenue d’un second conseil de guerre, qui, lui aussi, prononce sa condamnation ; et puis, sa réhabilitation. Les personnages de l’Affaire sont nombreux, ce qui demande au jeune lecteur un effort d’attention. Pour rendre le récit plus fluide, Bertrand Solet a inventé le personnage de Maxime Dumas, un jeune journaliste chargé de couvrir l’affaire Dreyfus.
Chapitre après chapitre, Bertrand Solet fait revivre les épisodes successifs de l’Affaire : la condamnation de Dreyfus par un conseil de guerre, sur la foi d’un dossier secret ; sa déportation à l’île du Diable ; la fabrication de fausses preuves contre lui ; la campagne de presse en sa faveur ; la cassation et l’annulation du procès ; la tenue d’un second conseil de guerre, qui, lui aussi, prononce sa condamnation ; et puis, sa réhabilitation. Les personnages de l’Affaire sont nombreux, ce qui demande au jeune lecteur un effort d’attention. Pour rendre le récit plus fluide, Bertrand Solet a inventé le personnage de Maxime Dumas, un jeune journaliste chargé de couvrir l’affaire Dreyfus.
La peinture de l’époque est particulièrement réussie. Dans les années 1890, la IIIe République est bien jeune et mal assurée. Une restauration monarchique n’est pas à exclure. L’armée est toute puissante et occupe la première place dans le cœur de la nation, car c’est elle qui a la responsabilité de préparer la revanche contre l’Allemagne. Dans ces circonstances, le ministre de la Guerre est quasi-systématiquement un militaire. En 1894, il s’agissait du général Mercier, un républicain, qui ne tarda pas à être convaincu de la culpabilité de Dreyfus et qui devint son principal accusateur. Dans ses dires, il fut appuyé par le général de Boisdeffre, chef d’Etat-major général de l’armée, qui ferma les yeux sur les agissements du commandant Henry, alors que ce dernier était un faussaire, grand spécialiste de la fabrication de faux documents. A partir de deux brouillons de vraies lettres et en y insérant quelques mots supplémentaires bien choisis, il se révéla capable de fabriquer une lettre, fausse celle-là, établissant la culpabilité de Dreyfus ; cette lettre fut appelée le faux Alexandrine. Henry n’était certes pas un homme recommandable, mais comme l’écrit Solet, « un service de renseignement n’est jamais un endroit très propre ».
Dans ces conditions, on comprend mieux comment, de bonne foi, de nombreuses personnes furent convaincues de la culpabilité de Dreyfus. Tous les éléments portés à la connaissance du public allaient dans le sens de sa culpabilité. Le général Mercier martelait : « Il existe des charges accablantes contre le capitaine. La culpabilité est certaine. » Jean Jaurès lui-même trouva trop clément le jugement du premier conseil de guerre, condamnant Dreyfus à la déportation. Par la suite, il se ravisa et devint un Dreyfusard de premier plan. Par ailleurs, l’antisémitisme était tellement répandu et diffus à travers la nation que Dreyfus faisait un coupable idéal.
A la manière de Balzac, Solet entend dissiper
les ténèbres de l’Affaire
Un homme fit beaucoup pour établir l’innocence de Dreyfus ; cet homme est au centre du récit, c’est le lieutenant-colonel Picquard. Picquard succéda au colonel Sandherr à la tête du service des statistiques. Convaincu lui aussi de la culpabilité du capitaine, il fut chargé par ses supérieurs de rassembler de nouvelles preuves. Il se plongea dans le dossier, examina les pièces et se rendit compte que certaines d’entre elles étaient fausses. Il confondit le faussaire, son subordonné Henry, et démasqua le véritable traitre à la patrie, le commandant Esterhazy. Picquard présenta les résultats de son enquête au général de Boisdeffre. Mais au lieu de lui donner raison, Boisdeffre lui ordonna de garder le silence. Picquard, étant honnête avant tout, refusa de se taire. Avant qu’un scandale n’éclate, il fut muté en Afrique du Nord, dans une contrée dangereuse, ses supérieurs caressant l’espoir qu’une balle perdue le ferait taire définitivement.
Par ailleurs, Solet montre bien comment le commandant Esterhazy, un être impudent sans foi ni loi, fut soutenu par l’Etat-major, qui l’aida secrètement dans sa défense et dans sa fuite. Il faut dire qu’Esterhazy pensait tenir l’Etat-major à sa merci, il le menaçait régulièrement de révélations qui pourraient être embarrassantes pour les chefs.
Lorsque l’Affaire éclata, il y eut, semble-t-il, un homme qui, d’emblée, ne crut pas en la culpabilité de Dreyfus. Cet homme, écrit Solet, c’est le généralissime Saussier, gouverneur militaire de Paris, le plus haut chef de l’armée. Devant le président de la République, il eut alors cette phrase sibylline : « Cet imbécile de Mercier s’est encore mis le doigt dans l’œil. » Pourtant le général Saussier ne fit aucune démarche en faveur de Dreyfus.
Dans cette affaire, il reste bien des zones d’ombre. A la fin du livre, tel Balzac dans Une ténébreuse affaire, Bertrand Solet entend faire la lumière sur l’Affaire Dreyfus en dissipant les ténèbres qui la couvrent. Il éclaire les zones d’ombre en faisant sienne la thèse jadis défendue par l’historien Henri Guillemin. Cette thèse, dans le style « complotiste », est contestée par nombre de spécialistes, mais elle est passionnante à connaître.
Il était un capitaine, de Bertrand Solet, 1971, collections Plein Vent (épuisé) et Le Livre de Poche.
07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : il était un capitaine, bertrand solet, dreyfus, affaire dreyfus | Lien permanent | Commentaires (0)


