05/05/2014
Madame Malraux, d'Aude Terray
Les statues qu’on abat
Madame Malraux
Madame Malraux fut d’abord l’épouse de Malraux. Devenue veuve après la guerre, elle se remaria avec et André Malraux, frère aîné de son défunt mari. Le livre d’Aude Terray nous fait vivre dans l’intimité du grand homme, il nous raconte les drames qui ont marqué la famille, et ne nous cache pas qu’André fut quelques fois bien décevant.
Madame Malraux, née Madeleine Lioux, est décédée en janvier 2014. Deux ans avant sa mort, elle a raconté sa vie à l’historienne Aude Terray, déjà auteur d’une très intéressante biographie de Claude Pompidou. Madeleine Lioux est née en 1914 dans une famille de la bourgeoisie toulousaine. Son père est un riche industriel passionné de musique. La petite Madeleine est une pianiste prodige. En 1928, elle monte à Paris et entre au conservatoire. En 1942, elle tombe amoureuse d’un jeune homme de trente ans, Roland Malraux. Roland a été le secrétaire de Gide, pour qui il faisait des traductions d’articles de journaux allemands et anglais. Il est le demi-frère d’André Malraux. Ils ont le même père, mais Roland est un fils adultérin.
 Peu à peu, Madeleine s’aperçoit que rien n’est simple chez les Malraux. André, le grand homme, se montre même bien décevant. Il est marié à Clara, mais il a une maîtresse, Josette Clotis, qui le pousse à divorcer. Le divorce ne vient pas. Josette Clotis s’impatiente. Elle attend un enfant, qu’elle choisit de mettre au monde afin de mettre André face à ses responsabilités. Gauthier naît en 1940. André ne le reconnaît pas. Pour que l’enfant ait un père, Roland fait une fausse déclaration à l’état-civil ; Gauthier devient officiellement son fils. En 1943, Josette Clotis est à nouveau enceinte. Roland précipite son mariage avec Madeleine pour reconnaître l’enfant à venir. Vincent naît en 1943. Mais cette fois la mère refuse de renouveler le stratagème, afin qu’André comprenne la situation une fois pour toute. André ne veut rien entendre. Vincent sera ce qu’on appelait alors un bâtard, et portera le nom de Clotis. Quant à Madeleine, devenue madame Roland Malraux, elle aura de son mari un fils prénommé Alain.
Peu à peu, Madeleine s’aperçoit que rien n’est simple chez les Malraux. André, le grand homme, se montre même bien décevant. Il est marié à Clara, mais il a une maîtresse, Josette Clotis, qui le pousse à divorcer. Le divorce ne vient pas. Josette Clotis s’impatiente. Elle attend un enfant, qu’elle choisit de mettre au monde afin de mettre André face à ses responsabilités. Gauthier naît en 1940. André ne le reconnaît pas. Pour que l’enfant ait un père, Roland fait une fausse déclaration à l’état-civil ; Gauthier devient officiellement son fils. En 1943, Josette Clotis est à nouveau enceinte. Roland précipite son mariage avec Madeleine pour reconnaître l’enfant à venir. Vincent naît en 1943. Mais cette fois la mère refuse de renouveler le stratagème, afin qu’André comprenne la situation une fois pour toute. André ne veut rien entendre. Vincent sera ce qu’on appelait alors un bâtard, et portera le nom de Clotis. Quant à Madeleine, devenue madame Roland Malraux, elle aura de son mari un fils prénommé Alain.
Roland Malraux s’engage dans la Résistance. Claude, le troisième frère Malraux, fait de même, tandis qu’André, lui, ne bouge pas. Le héros de la guerre d’Espagne se réfugie dans un attentisme prudent. En mars 1944, Roland et Claude Malraux sont arrêtés par les Allemands. Suite à ce double coup dur, André entre en résistance. Bien que son engagement soit tardif, il s’impose rapidement comme un chef. Il y va au culot et joue de son prestige. Pour asseoir sa légitimité, il évoque des actes héroïques qu’il a commis dès 1940. Les faits décrits sont authentiques, à la réserve près qu’André s’attribue la paternité d’opérations dont ses deux frères cadets sont les véritables auteurs. Néanmoins, sous le nom de colonel Berger, André Malraux devient le chef incontesté de la brigade Alsace-Lorraine et combat courageusement jusqu’à la victoire de 1945.
Après la guerre, quand il devient évident que Roland Malraux ne reviendra plus, André propose à Madeleine de vivre sous son toit. André, même s’il reste officiellement marié à Clara, est esseulé depuis la mort accidentelle de Josette Clotis. Madeleine vient vivre à Boulogne dans l’hôtel particulier du grand homme. André mène maintenant la vie d’un riche rentier. Il a des domestiques, un chauffeur et une limousine. D’où lui vient sa soudaine fortune ? Nul ne le sait. Aude Terray propose une piste pour expliquer l’origine de cet argent.
Malraux est difficile à vivre
Au bout de quelques temps, Madeleine, veuve de Roland Malraux, épouse l’écrivain et devient madame André Malraux. Son nouveau mari se montre très exigeant. Il veut que son épouse soit digne de lui. Elle doit mettre en valeur son génie, elle doit briller mais sans lui faire de l’ombre. Madeleine accepte bien des sacrifices et doit s’effacer devant lui. Le lecteur comprend qu’elle a réussi à tenir parce qu’elle avait conscience de vivre à côté d’un génie.
Dans la vie quotidienne, Malraux est difficile à vivre. Il abuse du whisky, des somnifères et des amphétamines. Sa silhouette épaissit. Ses relations sont difficiles avec ses fils. Un jour de 1956, il convoque Gauthier, Vincent et Alain dans son bureau, et, selon Madeleine, leur déclare froidement : « Vous avez un âge où il ne faudra plus nous embrasser. Vous pouvez disposer. »
Madeleine partage le combat de son mari pour de Gaulle. Malraux a rencontré le général en 1945 et a été subjugué. En 1958, il rêve d’un grand ministère et doit se contenter des Affaires culturelles. C’est lui qui est à l’origine du transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin. Il y prononce son plus grand discours, resté dans la mémoire nationale : « Entre ici, Jean Moulin !... ». Mais Madeleine, qui vit dans le souvenir de Roland et de Claude, est très mal à l’aise ce jour-là. Elle trouve tout cela bien grandiloquent et hors-de-propos.
Trois auparavant est survenu un drame. En 1961, Vincent, âgé de dix-huit ans, est au volant de sa voiture de sport, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, il a pour passager son frère Gauthier, âgé de vingt ans. La voiture sort de la route et percute un arbre. Les deux garçons sont tués. Apprenant la nouvelle, Malraux ne manifeste aucune émotion. Il réagit en soldat, habitué à voir ses camarades tomber au combat. En réalité, il tait sa douleur qu’il ne sait exprimer. Peu à peu, il va devenir une épave.
Le livre d’Aude Terray nous raconte une histoire tragique et pathétique. Même s’il s’agit de la version des faits vus par Madeleine Malraux, l’ensemble paraît sincère. Il ne s’agit pas d’une hagiographie, comme ne l’était pas non plus la biographie de Claude Pompidou. Aude Terray a su garder une distance critique avec son sujet. Il est dommage que le livre n’ait pas été davantage relu, certaines phrases étant peu claires. Cependant le livre est fascinant. Le lecteur est emporté dans un tourbillon, il est mêlé à la grande histoire tout en partageant le quotidien de la famille Malraux.
Madame Malraux, d’Aude Terray (2013), éditions Perrin.
08:05 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : madame malraux, aude terray, madeleine malraux, malraux | Lien permanent | Commentaires (0)
31/03/2014
La Grande Illusion, de Jean Renoir
Von Stroheim superstar
La Grande Illusion
Jean Gabin est l’acteur principal du film de Jean Renoir. Mais Erich von Stroheim lui vole la vedette. Il est inoubliable dans le rôle du commandant von Rauffenstein, un officier de la vieille aristocratie prussienne. Son personnage tend à phagocyter un film qui fit impression sur les spectateurs à sa sortie en 1937, alors que l’Europe était à nouveau menacée par la guerre.
Quand, en 1937, Jean Renoir entreprend le tournage de La Grande Illusion, il offre tout naturellement le premier rôle à Jean Gabin. Quelques mois plus tôt, l’acteur est devenu la vedette numéro un du cinéma français, suite à la sortie sur les écrans de Pépé le Moko. La Grande Illusion rassemble des souvenirs de Renoir liés à la première guerre mondiale. Le lieutenant Maréchal, joué par Jean Gabin, est un officier mécanicien sorti du rang. Il vole en compagnie du capitaine de Boeldieu quand leur avion est descendu par les Allemands. Boeldieu est indemne, mais Maréchal est blessé au bras. C’est le commandant von Raffaunstein qui les abattus. Rauffenstein un véritable chevalier du ciel qui combat ses adversaire à la loyale. Il présente au lieutenant Maréchal ses excuses pour la blessure, et prie ses deux prisonniers à déjeuner. Puis, Boeldieu et Maréchal sont emmenés en captivité. Quelques mois plus tard, ils sont transférés dans une forteresse dont le commandant n’est autre que Rauffenstein. Il invite Boeldieu à dîner et, entre aristocrates, noue une relation privilégiée avec lui.
 Ce film montre que la guerre favorise le brassage des classes sociales et, en même temps, il joue sur les oppositions entre les différents milieux. Le lieutenant Maréchal, donc Jean Gabin, est un peu rustre, il n’est pas très cultivé et son vocabulaire est limité. A l’opposé, le capitaine de Boeldieu a un langage recherché, il parle couramment l’anglais et a des gestes posés. L’aristocrate français est interprété par Pierre Fresnay, qui n’a pas besoin de beaucoup se forcer pour être suffisant.
Ce film montre que la guerre favorise le brassage des classes sociales et, en même temps, il joue sur les oppositions entre les différents milieux. Le lieutenant Maréchal, donc Jean Gabin, est un peu rustre, il n’est pas très cultivé et son vocabulaire est limité. A l’opposé, le capitaine de Boeldieu a un langage recherché, il parle couramment l’anglais et a des gestes posés. L’aristocrate français est interprété par Pierre Fresnay, qui n’a pas besoin de beaucoup se forcer pour être suffisant.
Mais, dans le film, Gabin et Fresnay se font voler la vedette par l’acteur qui interprète Rauffenstein : Erich von Stroheim. En pleine préparation du tournage, Renoir était en quête d’un acteur pour le personnage quand il apprit que von Stroheim, alors en France, serait intéressé par le rôle. Renoir vénérait von Stroheim qui avait été un grand réalisateur du cinéma muet. Mais, rejeté par Hollywood, il s’était résolu à quitter l’Amérique. Renoir lui confie le rôle, bien que le personnage occupe une place a priori réduite dans le scénario. Or, si von Stroheim est un grand metteur en scène, c’est d’abord un grand metteur en scène de lui-même. Il prend son rôle d’officier prussien très au sérieux et lui donne toute son ampleur. C’est lui qui a l’idée de porter une minerve qui confère la raideur qui sied au personnage. C’est encore lui qui a l’idée de rejeter son buste vers l’arrière dès qu’il boit un verre. La personnalité de Rauffenstein est tellement forte, ses gestes sont si bien étudiés, que von Stroheim finit par phagocyter le film. Voler la vedette à Gabin, il fallait le faire !
Roosevelt recommanda le film
Pendant des décennies, la version qui fut diffusée était une version ramenée à une heure et demie, qui resserrait le film sur la relation Boeldieu-Rauffenstein. Rauffenstein donnait ainsi l’impression d’être le personnage central du film. Depuis quelques dizaines d’années, le film est présenté dans une version plus longue, de plus d’une heure quarante-cinq. Jean Gabin y prend plus de place. La séquence au cours de laquelle il trouve refuge dans une ferme est davantage développée. En compagnie de Dalio, dans le rôle d’un autre officier français, il est abrité par une jeune Allemande veuve de guerre, jouée par Dita Parlo. Dans son montage actuel, La Grande Illusion est plus conforme au projet que Renoir avait en tête. Mais, en contrepartie, le film souffre d’une baisse de rythme à partir du moment où Boeldieu et Rauffenstein disparaissent de l’histoire. Sans devenir inintéressant, le film perd de sa force et devient alors plus quelconque.
Longtemps les critiques se sont demandé ce qu’il fallait entendre par la grande illusion. La version diffusée de nos jours permet de répondre à cette interrogation. A la fin du film, Gabin dit : « J’espère que c’est la dernière guerre » et Dalio lui répond : « Tu te fais vraiment des illusions ! »
Il serait vain de multiplier les exégèses de ce film et d’y lire des messages que peut-être il ne contient pas. A sa sortie, en 1937, La Grand Illusion rencontra un succès mondial, alors que la menace de guerre ne cessait de monter. Le président Roosevelt déclara : « Toute personne qui croit en la démocratie devrait voir ce film ». Ce film aurait-il eu un si grand destin s’il n’avait bénéficié de la prestation de von Stroheim et s’il était sorti dans un autre contexte ? Poser la question, c’est déjà y répondre.
La Grande Illusion, de Jean Renoir (1937), avec Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Carette et Dalio, DVD StudioCanal.
09:05 Publié dans Film, Film de guerre, Histoire | Tags : la grande illusion, renoir, gabin, dita parlo, fresnay, stroheim, carette, dalio | Lien permanent | Commentaires (0)
24/03/2014
Les Justes, d'Albert Camus
La justice au-dessus de tout ?
Les Justes
La pièce fut créée sur scène en 1949, avec Serge Reggiani, Maria Casarès et Michel Bouquet dans les rôles principaux. Camus s’est inspiré d’un fait réel : l’assassinat, en 1905, du grand-duc Serge. La pièce est vivante, les dialogues sont concis et les réflexions philosophiques ne sont pas pesantes du tout.
Le grand-duc Serge doit mourir. Ainsi en a décidé le groupe de combat du parti socialiste révolutionnaire. Son exécution est destinée à hâter la libération du peuple russe. Ses déplacements sont maintenant connus. Les terroristes se réunissent pour établir un plan d’action. Le poète Kaliayev se porte volontaire pour lancer la bombe sur sa voiture du grand-duc. Kaliayev est épris de justice ; c’est un militant résolu de la cause, mais c’est aussi un humaniste. Or, le jour dit, il s’apprête à lancer son engin quand il s’aperçoit que le grand-duc est accompagné de ses deux jeunes neveux, qui ont pris place à ses côtés. Kaliayev hésite. Une cause aussi juste que celle de la révolution autorise-t-elle à tuer des enfants innocents ?
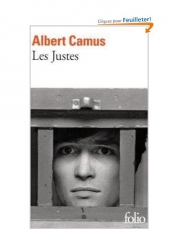 Dans son introduction aux Justes, Albert Camus explique qu’il s’est inspiré d’un fait réel : l’assassinat, en 1905, du grand-duc Serge, oncle du tsar Nicolas II. Les situations sont historiques. Camus a même conservé au héros son véritable nom, Kaliayev. Si, bien sûr, il est préférable de voir les pièces de théâtre sur scène avec des acteurs en chair et en os, les pièces étant faites pour être jouées, il faut cependant reconnaître que Les Justes se lit très facilement. La pièce est vivante, les dialogues sont concis, les réflexions philosophiques ne sont pas pesantes et, comme dans un film d’action, nous vivons l’attentat « en direct ».
Dans son introduction aux Justes, Albert Camus explique qu’il s’est inspiré d’un fait réel : l’assassinat, en 1905, du grand-duc Serge, oncle du tsar Nicolas II. Les situations sont historiques. Camus a même conservé au héros son véritable nom, Kaliayev. Si, bien sûr, il est préférable de voir les pièces de théâtre sur scène avec des acteurs en chair et en os, les pièces étant faites pour être jouées, il faut cependant reconnaître que Les Justes se lit très facilement. La pièce est vivante, les dialogues sont concis, les réflexions philosophiques ne sont pas pesantes et, comme dans un film d’action, nous vivons l’attentat « en direct ».
Camus glisse dans la bouche des personnages des réflexions récurrentes dans son œuvre. La justice est-elle au dessus-de tout ? Ou encore, y a-t-il quelque chose qui puisse justifier la mort d’un enfant innocent ? Si Kalayev hésite, en revanche son camarade Stepan, lui, a la réponse : oui, les deux neveux du grand-duc doivent mourir. Peut-être sont-ils innocents. Mais renoncer, du fait d’une sensiblerie hors de propos, retardera la libération du peuple russe. Et, pendant tout ce temps perdu, des milliers d’enfants mourront de faim. Or, selon Stepan, « la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là ». Qu’importe que les justiciers soient des assassins, seul le résultat compte ; la mort du grand-duc est un acte de justice.
Les Justes fut créée en 1949, avec le jeune Serge Reggiani dans le rôle d’un Kalliayev tourmenté. La fragile Maria Casarès jouait Dora, terroriste plus âgée que ses camarades, riche de son expérience. Sa réflexion lui fait dire : si la révolution tolère que des enfants soient broyés par des bombes, alors l’humanité entière haïra la révolution.
Quant à Michel Bouquet, alors âgé de vingt-quatre ans, on l’imagine aisément dans le rôle de Stepan, terroriste froid et déterminé, qui ne va pas se laisser attendrir par la mort de deux enfants, fussent-ils innocents. Le même Michel Bouquet jouera un rôle analogue dans Katia,de Robert Siodmak (film à la mauvaise réputation injustifiée). Là encore, il interprètera un terroriste implacable appartenant à une organisation qui prononce la condamnation à mort du tsar Alexandre II.
Les Justes, d’Albert Camus (1949), pièce créée, sur une mise en scène de Jacques Hébertot, par Maria Casarès, Serge Reggiani et Michel Bouquet, collection Folio.
09:05 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Théâtre | Tags : les justes, camus, jacques hébertot, maria casarès, reggiani, michel bouquet | Lien permanent | Commentaires (0)


